Ce sujet a été résolu
Surtout que Molière était encore meilleur dramaturge que comédien.
AMPHITRYON.
En 1667, Molière écrit seulement Pastorale comique et le Sicilien. Il y a eu une rueur comme quoi il était mort, durant une période où il était malade. Le 5 août il fait jouer l'Imposteur version adoucie de Tartuffe qui fut interdit comme la pièce originale. Condamné au régime lacté, retiré dans sa maison de campagne d'Auteuil, il se met à relire Plaute qui lui fournit 2 comédies, Amphitryon et l'Avare. La première est jouée le 13 janvier 1668 et marque le retour de Molière dans un genre nouveau. Il délaisse comédie de moeurs et de caractères pour faire un sujet mythologique. La comédie de Plaute avait connu une première adaptation due à Rotrou sous le titre de Les Sosies qui fut créé au théâtre des Marais en 1636. Elle est transformée sous le titre de la Naissance d'Hercule en 1850. En 1653 au cours du Grand Ballet royal de la Nuit, avait été représentée une pantomime intitulée la Comédie muette d'Amphitryon. Le vieux mythe légendaire que Giraudoux reprit de nos jours n'avait cessé d'être en faveur auprès du public. Molière suit de près ces 2 modèles, Plaute et Rotrou. Durant ses pérégrinations en province peut être a-t-il joué cette comédie de Rotrou et qu'il la connaissait déjà. Pas étonnant qu'il les ait transposés dans ce cas. Il a sut quand même faire une oeuvre originale. Il ramène sur le plan de la comédie galante le vieux mythe de la comédie latine en supprimant la naissance et les exploits d'Hercule, qui entraînait un ton plus grave hors scènes de comédie chez Plaute. Du coup l'action était resserrée dans les limites d'une aventure comique et scabreuse ayant un dénouement tout terrestre, où la majesté des Dieux de l'Olympe s'estompait pour laisser place à un ton humain. Jupiter humanisé, amoureux passionné et tendre, coloré de préciosité, ressemblait à un courtisan de Versailles.
Molière innove en créant le personnage de Cléanthis, inconnu de ses devanciers. En donnant une épouse à Sosie, il rétablit le parallélisme traditionnel du couple de valets et du couple de maîtres. En plus il apportait une autre innovation, faisant du premier couple un double exact du deuxième. La façon cavalière dont Mercure sous les traits empruntés de Sosie, traite la prude Cléanthis s'oppose savoureusement à l'amour galant de Jupiter pour Alcmène. Cette dernière est un des plus délicates créations féminines de Molière. Elle est dans la ligne d'Elmire et d'Agnès car tendre, indulgente et pudique. Mme Madeleine Renaud a traduit avec charme les sentiments de la femme d'Amphitryon devenue sans le savoir, la maîtresse de Jupiter, et tout étonnée de se trouver entraînée dans une aventure mythologique qui la dépasse. Enfin, Molière a innové en écrivant sa nouvelle comédie en vers livres, aux rythmes irréguliers, dont il tiré les meilleurs effets comiques et poétiques. Il est au XVIIème siècle le seul maître du vers libre qu'on puisse opposer ou comparer à La Fontaine. Il a mis autant de grâce et de charme dans les vers irréguliers d'Amphitryon que de force dans les alexandrins de ses autres comédies. Son adresse à manier des rythmes divers donne à cette pièce, non exempte de marivaudage, une place tout à fait à part dans le théâtre. Elle n'a pas cessé d'être jouée depuis. Mais la comédie pose un problème historique car l'aventure de Jupiter et d'Alcmène est-elle une allusion à la liaison de Louis XIV et de Mme de Montespan. " Un partage avec Jupiter / N'a rien du tout qui déshonore
Une ironique consolation pour le marquis de Montespan. Mais des historiens repoussent l'hypothèse sous prétexte que quand Molière écrit sa comédie en 1667, la liaison est secrète officiellement car Mlle de La Vallière est toujours seule maîtresse déclarée à la cour. Mais les rumeurs peuvent courir vite avec les courtisans. Et c'était un secret de Polichinelle. Le duc d'Enghien fait allusion à cette liaison dès novembre 1666, un peu plus tard dans les correspondances diplomatiques des ambassadeurs de Savoie et d'Angleterre. Molière fréquentait la cour et pouvait être renseigné aussi bien que les ambassadeurs sur cette aventure, quoique inconnue au grand public. Sans qu'une preuve formelle puisse être fournie Molière a pu y penser au moment de l'écriture de son oeuvre.
LE SICILIEN ou l'AMOUR PEINTRE.
Molière écrit Mélicerte et Pastorale comique durant les mêmes fêtes du Ballet des Muses. En février 1667 il fait représentée une comédie en 1 acte avec des couplets chantés et des danses dont Lulli composa la musique. Il s'agissait pour les Muses héroines de ces fêtes de présenter à la cour réunie à Saint Germain des Turcs et des Maures et de fournir de pittoresques costumes exotiques à Louis XIV et à Mlle de La Villière qui parurent dans ce divertissement. Il obtient un succès vif de curiosité, mais transporté au Palais-Royal le 10 juin suivant, il trouve un public plus réservé. Ces pièces de circonstance perdent souvent leur saveur hors du cadre où elles ont été écrites et de l'occasion les ayant fait naître. C'est une oeuvre brève, légère, qu'il place dans une Sicile lointaine. Molière se souvenait de son Etourdi et des amants déguisés en peintre que Du Ryer avait mis en scène dans Argenis et Rotrou dans la Pèlerine amoureuse. Un événement banal comme dans l'Amour médecin et le Médecin malgré lui, qui lui fournit un dénouement sans imprévu et commode. L'intérêt du Sicilien est dans son style d'un caractère nouveau. Après le vers soutenu de la grande comédie, après la langue populaire et parfois crue des farces, Molière tente la manière poétique. Le Sicilien, écrit en prose et faute de temps, contenait des blancs à l'époque. ON trouve dans cette prose au rythme poétique une abondance d'images souvent heureuses : " Le Ciel s'est habillé ce soir en Scaramouche. " Ce parfum de poésie répandu dans cette petite comédie sans prétention conserve encore son charme aujourd'hui et nous révèle un Molière encore inconnu qui va affirmer prochainement ses dons poétiques dans Amphitryon.
L'AVARE.
En attendant la résurrection du Tartuffe toujours interdit à ce moment là, Molière donne au public du Palais-Royal, l'Avare, une comédie nouvelle. Elle est représentée pour la première fois le 9 septembre 1668. Une grande comédie de caractères et de moeurs dont il espérait une revanche du semi succès seulement du Misanthrope il y a 2 ans. Mais cette comédie était encore en prose, faute de temps peut être encore. C'était nouveau pour une pièce en 5 actes. Certains voyaient cela comme une inconvenance car ces grandes pièces exigent comme la tragédie de l'usage de l'alexandrin. Plus nettement que le Misanthrope, l'Avare échoue en ne tenant qu'un mois avant d'être soutenue par George Dandin. Seulement 47 représentations à Paris jusqu'à la mort de Molière. Mais la postérité remet cette oeuvre parmi les grands classiques. Elle a toujours été jouée à la Comédie-Française et ailleurs aussi. Bon nombre de comédiens voulaient essayer le rôle d'Harpagon comme dans celui d'Alceste. Enormément de sources livresques pour la pièce. Il a emprunté aux lazzi traditionnels de la comédie italienne sans pouvoir préciser les cavenas dont il a pu s'inspirer car pour la plupart de ceux conservés, impossible de dire s'ils sont parus avant ou après Molière. A coup sûr il s'est inspiré de l'Aulularia de Plaute qui lui fournit le thème de la cassette volée par La Flèche et le fameux sans dot. Il y a des réminiscences des Suppositi de l'Aristote, du Docteur Amoureux de Le Vert où se trouve le thème de l'amoureux travesti en intendant et le nom du personnage d'Elise. "La Mere coquette" de Donneau de Visé offrait l'exemple d'une rivalité amoureuse entre le père et le fils. La Dame d'intrigue de Chappuzeau inspirée elle aussi de l'Aulularia, lui donne sous le nom de Ruffine, l'originale de l'entremetteuse Frosine. Il emprunte à "La Belle Plaideuse" de Boisrobert la scène où le père et le fils se retrouvent face à face emprunteur et usurier et peut être le dessin général de la famille d'Harpagon.
Tous ces emprunts sont fondus dans une pièce de Molière et qui porte sa marque. L'Avare nous offre une peinture de moeurs donnant toute sa réalité au personnage central. Comme dans Tartuffe comme plus tard, dans les Femmes savantes, nous sommes au sein d'une famille bourgeoise de Paris au XVIIème siècle, famille riche et paisible, qui n'aurait pas d'histoire si elle n'était troublée par l'égoisme et par l'avarice sordide d'Harpagon, qui y sème la haine et conséquemment l'intrigue, le vol, la jalousie. Molière prend la défense des 2 couples d'amoureux comme toujours, dont les projets sont menacés par le vice d'Harpagon. Ce dernier n'est donc pas une abstraction. C'est un personnage très vivant placé dans un milieu social bien déterminé dont le caractère est peint à petites touches, dans des situations successives dont il est seul responsable. On arrive à une famille entièrement dressée, servantes et valets compris, contre le maître de maison, par des moyens appropriés mais souvent d'une moralité douteuse. Le spectateur ressent une gêne, un malaise à passer 2 heures au milieu de ce foyer dont l'atmosphère est empoisonné. La malédiction qu'Harpagon lance contre son fils, qui la reçoit avec une insolente désinvolture, explique peut être le jugement de Goethe, à qui l'Avare apparaît tragique. Vus sous cet angle, on n'est effectivement pas loin du drame. Mais Molière grâce à son génie comique a évité cet écueil. A la scène le personnage d'Harpagon reste plus bouffon qu'odieux par ses extravagances. La preuve en est les rires que la pièce a soulevé devant un public de jeunes. L'invention comique l'emporte. Même le monologue d'Harpagon où l'avare apparaît comme sa propre victime et pourrait devenir pitoyable.
AMPHITRYON.
En 1667, Molière écrit seulement Pastorale comique et le Sicilien. Il y a eu une rueur comme quoi il était mort, durant une période où il était malade. Le 5 août il fait jouer l'Imposteur version adoucie de Tartuffe qui fut interdit comme la pièce originale. Condamné au régime lacté, retiré dans sa maison de campagne d'Auteuil, il se met à relire Plaute qui lui fournit 2 comédies, Amphitryon et l'Avare. La première est jouée le 13 janvier 1668 et marque le retour de Molière dans un genre nouveau. Il délaisse comédie de moeurs et de caractères pour faire un sujet mythologique. La comédie de Plaute avait connu une première adaptation due à Rotrou sous le titre de Les Sosies qui fut créé au théâtre des Marais en 1636. Elle est transformée sous le titre de la Naissance d'Hercule en 1850. En 1653 au cours du Grand Ballet royal de la Nuit, avait été représentée une pantomime intitulée la Comédie muette d'Amphitryon. Le vieux mythe légendaire que Giraudoux reprit de nos jours n'avait cessé d'être en faveur auprès du public. Molière suit de près ces 2 modèles, Plaute et Rotrou. Durant ses pérégrinations en province peut être a-t-il joué cette comédie de Rotrou et qu'il la connaissait déjà. Pas étonnant qu'il les ait transposés dans ce cas. Il a sut quand même faire une oeuvre originale. Il ramène sur le plan de la comédie galante le vieux mythe de la comédie latine en supprimant la naissance et les exploits d'Hercule, qui entraînait un ton plus grave hors scènes de comédie chez Plaute. Du coup l'action était resserrée dans les limites d'une aventure comique et scabreuse ayant un dénouement tout terrestre, où la majesté des Dieux de l'Olympe s'estompait pour laisser place à un ton humain. Jupiter humanisé, amoureux passionné et tendre, coloré de préciosité, ressemblait à un courtisan de Versailles.
Molière innove en créant le personnage de Cléanthis, inconnu de ses devanciers. En donnant une épouse à Sosie, il rétablit le parallélisme traditionnel du couple de valets et du couple de maîtres. En plus il apportait une autre innovation, faisant du premier couple un double exact du deuxième. La façon cavalière dont Mercure sous les traits empruntés de Sosie, traite la prude Cléanthis s'oppose savoureusement à l'amour galant de Jupiter pour Alcmène. Cette dernière est un des plus délicates créations féminines de Molière. Elle est dans la ligne d'Elmire et d'Agnès car tendre, indulgente et pudique. Mme Madeleine Renaud a traduit avec charme les sentiments de la femme d'Amphitryon devenue sans le savoir, la maîtresse de Jupiter, et tout étonnée de se trouver entraînée dans une aventure mythologique qui la dépasse. Enfin, Molière a innové en écrivant sa nouvelle comédie en vers livres, aux rythmes irréguliers, dont il tiré les meilleurs effets comiques et poétiques. Il est au XVIIème siècle le seul maître du vers libre qu'on puisse opposer ou comparer à La Fontaine. Il a mis autant de grâce et de charme dans les vers irréguliers d'Amphitryon que de force dans les alexandrins de ses autres comédies. Son adresse à manier des rythmes divers donne à cette pièce, non exempte de marivaudage, une place tout à fait à part dans le théâtre. Elle n'a pas cessé d'être jouée depuis. Mais la comédie pose un problème historique car l'aventure de Jupiter et d'Alcmène est-elle une allusion à la liaison de Louis XIV et de Mme de Montespan. " Un partage avec Jupiter / N'a rien du tout qui déshonore
Une ironique consolation pour le marquis de Montespan. Mais des historiens repoussent l'hypothèse sous prétexte que quand Molière écrit sa comédie en 1667, la liaison est secrète officiellement car Mlle de La Vallière est toujours seule maîtresse déclarée à la cour. Mais les rumeurs peuvent courir vite avec les courtisans. Et c'était un secret de Polichinelle. Le duc d'Enghien fait allusion à cette liaison dès novembre 1666, un peu plus tard dans les correspondances diplomatiques des ambassadeurs de Savoie et d'Angleterre. Molière fréquentait la cour et pouvait être renseigné aussi bien que les ambassadeurs sur cette aventure, quoique inconnue au grand public. Sans qu'une preuve formelle puisse être fournie Molière a pu y penser au moment de l'écriture de son oeuvre.
LE SICILIEN ou l'AMOUR PEINTRE.
Molière écrit Mélicerte et Pastorale comique durant les mêmes fêtes du Ballet des Muses. En février 1667 il fait représentée une comédie en 1 acte avec des couplets chantés et des danses dont Lulli composa la musique. Il s'agissait pour les Muses héroines de ces fêtes de présenter à la cour réunie à Saint Germain des Turcs et des Maures et de fournir de pittoresques costumes exotiques à Louis XIV et à Mlle de La Villière qui parurent dans ce divertissement. Il obtient un succès vif de curiosité, mais transporté au Palais-Royal le 10 juin suivant, il trouve un public plus réservé. Ces pièces de circonstance perdent souvent leur saveur hors du cadre où elles ont été écrites et de l'occasion les ayant fait naître. C'est une oeuvre brève, légère, qu'il place dans une Sicile lointaine. Molière se souvenait de son Etourdi et des amants déguisés en peintre que Du Ryer avait mis en scène dans Argenis et Rotrou dans la Pèlerine amoureuse. Un événement banal comme dans l'Amour médecin et le Médecin malgré lui, qui lui fournit un dénouement sans imprévu et commode. L'intérêt du Sicilien est dans son style d'un caractère nouveau. Après le vers soutenu de la grande comédie, après la langue populaire et parfois crue des farces, Molière tente la manière poétique. Le Sicilien, écrit en prose et faute de temps, contenait des blancs à l'époque. ON trouve dans cette prose au rythme poétique une abondance d'images souvent heureuses : " Le Ciel s'est habillé ce soir en Scaramouche. " Ce parfum de poésie répandu dans cette petite comédie sans prétention conserve encore son charme aujourd'hui et nous révèle un Molière encore inconnu qui va affirmer prochainement ses dons poétiques dans Amphitryon.
L'AVARE.
En attendant la résurrection du Tartuffe toujours interdit à ce moment là, Molière donne au public du Palais-Royal, l'Avare, une comédie nouvelle. Elle est représentée pour la première fois le 9 septembre 1668. Une grande comédie de caractères et de moeurs dont il espérait une revanche du semi succès seulement du Misanthrope il y a 2 ans. Mais cette comédie était encore en prose, faute de temps peut être encore. C'était nouveau pour une pièce en 5 actes. Certains voyaient cela comme une inconvenance car ces grandes pièces exigent comme la tragédie de l'usage de l'alexandrin. Plus nettement que le Misanthrope, l'Avare échoue en ne tenant qu'un mois avant d'être soutenue par George Dandin. Seulement 47 représentations à Paris jusqu'à la mort de Molière. Mais la postérité remet cette oeuvre parmi les grands classiques. Elle a toujours été jouée à la Comédie-Française et ailleurs aussi. Bon nombre de comédiens voulaient essayer le rôle d'Harpagon comme dans celui d'Alceste. Enormément de sources livresques pour la pièce. Il a emprunté aux lazzi traditionnels de la comédie italienne sans pouvoir préciser les cavenas dont il a pu s'inspirer car pour la plupart de ceux conservés, impossible de dire s'ils sont parus avant ou après Molière. A coup sûr il s'est inspiré de l'Aulularia de Plaute qui lui fournit le thème de la cassette volée par La Flèche et le fameux sans dot. Il y a des réminiscences des Suppositi de l'Aristote, du Docteur Amoureux de Le Vert où se trouve le thème de l'amoureux travesti en intendant et le nom du personnage d'Elise. "La Mere coquette" de Donneau de Visé offrait l'exemple d'une rivalité amoureuse entre le père et le fils. La Dame d'intrigue de Chappuzeau inspirée elle aussi de l'Aulularia, lui donne sous le nom de Ruffine, l'originale de l'entremetteuse Frosine. Il emprunte à "La Belle Plaideuse" de Boisrobert la scène où le père et le fils se retrouvent face à face emprunteur et usurier et peut être le dessin général de la famille d'Harpagon.
Tous ces emprunts sont fondus dans une pièce de Molière et qui porte sa marque. L'Avare nous offre une peinture de moeurs donnant toute sa réalité au personnage central. Comme dans Tartuffe comme plus tard, dans les Femmes savantes, nous sommes au sein d'une famille bourgeoise de Paris au XVIIème siècle, famille riche et paisible, qui n'aurait pas d'histoire si elle n'était troublée par l'égoisme et par l'avarice sordide d'Harpagon, qui y sème la haine et conséquemment l'intrigue, le vol, la jalousie. Molière prend la défense des 2 couples d'amoureux comme toujours, dont les projets sont menacés par le vice d'Harpagon. Ce dernier n'est donc pas une abstraction. C'est un personnage très vivant placé dans un milieu social bien déterminé dont le caractère est peint à petites touches, dans des situations successives dont il est seul responsable. On arrive à une famille entièrement dressée, servantes et valets compris, contre le maître de maison, par des moyens appropriés mais souvent d'une moralité douteuse. Le spectateur ressent une gêne, un malaise à passer 2 heures au milieu de ce foyer dont l'atmosphère est empoisonné. La malédiction qu'Harpagon lance contre son fils, qui la reçoit avec une insolente désinvolture, explique peut être le jugement de Goethe, à qui l'Avare apparaît tragique. Vus sous cet angle, on n'est effectivement pas loin du drame. Mais Molière grâce à son génie comique a évité cet écueil. A la scène le personnage d'Harpagon reste plus bouffon qu'odieux par ses extravagances. La preuve en est les rires que la pièce a soulevé devant un public de jeunes. L'invention comique l'emporte. Même le monologue d'Harpagon où l'avare apparaît comme sa propre victime et pourrait devenir pitoyable.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
Malgré cela les procédés de bouffonerie l'emporte car on rigole de ses folies et on oublie de se plaindre. Ce serait une erreur donc que de tirer le rôle d'Harpagon vers le drame car Molière le jouait avec toutes les ressources de son art d'acteur comique. Il n'en reste pas moins vrai que comme Alceste qui doit faire rire aussi, Harpagon suscite des réflexions sérieuses voire amères sur la nature humaine.
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC.
En septembre 1669, Louis XIV offre les plaisirs de la chasse à sa cour à Chambord. A cela il voulait ajouter le divertissement de la comédie de Molière qui dut encore une fois faire assez vite. Monsieur de Pourceaugnac est une comédie-ballet dont les danses furent réglées par Beauchamp et la musique de Lulli. Le Florentin fit mieux car il joue un rôle dans la pièce muni d'une seringue monumentale et se livra à des extravagances comiques qui divertirent le roi. Le gazetier Robinet nous dit que Molière, cherchant un grotesque à berner, tomba sur un Limousin qui avait eu au théâtre des démêlés avec les comédiens. Le malheureux se reconnut et, furieux, essaya de faire interdire la pièce. Le personnage central trouvé, il fallait une situation comique et une intrigue sommaire pour bâtir une farce. Elle fut fournie à Molière par 2 scénarios italiens. A Policinella pazzo per foraz, il emprunta le thème du prinvincial, moqué par les enfants du pays, trompé par un aigrefin, soigné de force par 2 médecins et 1 apothicaire. A Policinella burlato il prit son dénouement. Avec ces éléments, la farce était quasi faite et il ne restait plus qu'à l'écrire. La pièce est représentée pour la première fois à Chambord le 6 octobre où elle eut du succès. Ensuite à partir du 15 novembre au Palais-Royal devant le public parisien. Le thème du nobliau provincial ridicule déjà esquissé avec la peinture du couple Sotenville dans George Dandin, était à la mode et Molière y reviendra par la suite avec la Comtesse d'Escarbagnas. On peut penser que Monsieur de Pourceaugnac préfigure Monsieur Jourdain car il est lui aussi un parvenu. Il appartient à la noblesse de robe, quoi qu'il en dise, et dans sa sottise suffisante, il laisse échapper des mots qui prouvent qu'il a la pratique de la procédure. A ce titre il est doublement ridicule aux yeux de la noblesse de cour.
Le succès remporté par cette comédie-ballet qui en fait n'est qu'une farce, succès qu'elle connait encore aujourd'hui, s'explique par tous les jeux de scène traditionnels et par le rythme que sait lui imprimer une bonne troupe comique. Danseurs et chanteurs accusent ce mouvement endiablé. Nous sommes tout près de la parade tabarinique et c'est la mascarade des porteurs de seringues à travers la salle qui déchaîne le rire. A la lecture, la farce n'a pas une grande vis comica certes. L'intrigue est mince : un prétendant ridicule berné et évincé par les ruses d'un valet au bénéfice des 2 jeunes amants complices. Sur ce canevas rudimentaire, Molière brode une série de sketches dans la plus pure tradition de la farce : consultation solennelle et creuse des 2 médecins ( ne pas oublier que Molière est toujours malade à cette époque ), quiproquos, baragouins en patois flamand, languedocien et picard, dialogues destinés à permettre à Monsieur de Pourceaugnac d'étaler sa maladresse, sa sottise et sa vanité, apothicaire bredouillant, tout cela a besoin de comédiens rompus au jeu rapide et bondissant de la commedia dell'arte pour déchaîner le rire. Quant à chercher dans cette bouffonnerie je ne sais quel arrière-plan amer ou sinistre qui lui donnerait, aux yeux de Michelet, un caractère " horrible ", cela relève d'une incompréhension du texte.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
copié collé  https://onche.org/topic/7[...]amais-existe-ayaaaaaaaaaa
https://onche.org/topic/7[...]amais-existe-ayaaaaaaaaaa

Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
Tu dis de la merde, y a justement rien sur Molière

0 papier administratif, 0 acte de naissance, 0 représentation, 0 écrit personnel de lui, 0 lettre, 0 correspondance, personne l'a jamais vu

Louis XIV a jamais vu Molière l'abruti

Céline, on a ses interviews, ses photos et ses lettres le low IQ


0 papier administratif, 0 acte de naissance, 0 représentation, 0 écrit personnel de lui, 0 lettre, 0 correspondance, personne l'a jamais vu

Louis XIV a jamais vu Molière l'abruti

Céline, on a ses interviews, ses photos et ses lettres le low IQ

T as juste Louis 14 qui a aménagé un théâtre privé pour le voir sur scène toutes les semaines
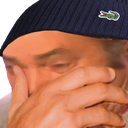
il y a un an





