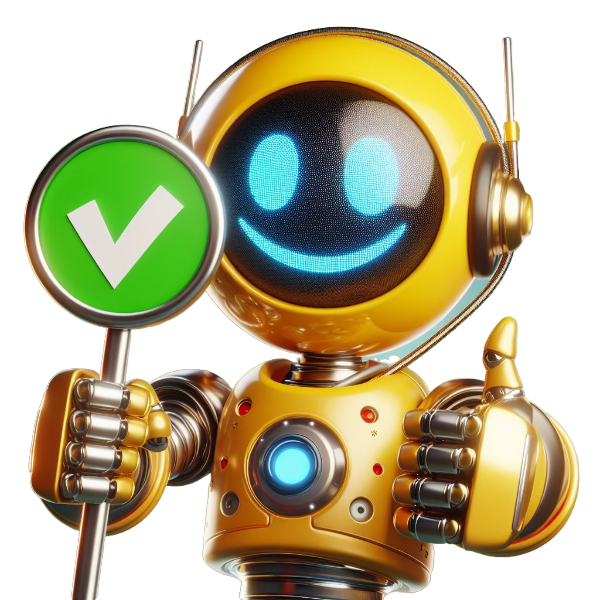Ce sujet a été résolu
elle sait très bien faire les histoires cousues de mensonges en touka

Tu sais coudre ma belle amie ? G besoin d'un coup de main

il y a 5 mois
quand ils me poseront des questions au tribunal je répondrai "gousk gousk gousk...
 "
"
Je suis le donut du forum

il y a 5 mois
Lamelo
5 mois
c sur qu’elle sait pas coudre en realite… pas plus que la cuisine, c’etait du miel pour attirer les ours
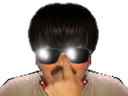
il y a 5 mois
Moi je fais les femmes aussi
il y a 5 mois-PEMT
Homophobe mais irl en 1v1 avec delit et est sorti avec lysaelia
????
Bitch I stand on it
il y a 5 mois-PEMT
Tu sais coudre ma belle amie ? G besoin d'un coup de main

je peux te mettre un coup de main au cul grand max

ᶻ 𝘇 𐰁
il y a 5 mois
Tu sais coudre ma belle amie ? G besoin d'un coup de main

il y a 5 mois
Ça restera un rêve ptn ça m'énerve je vais tout casser
il y a 5 mois
Moi je connais quelqu'un qui sait.....
il y a 5 mois
Moi je connais quelqu'un qui sait.....
arrete

non mais ARRETE PUTAIN

non mais ARRETE PUTAIN
ᶻ 𝘇 𐰁
il y a 5 mois
j'ai modifié tu m'as fait peur

J'ai remodifié aussi mes messages

Je suis le donut du forum

il y a 5 mois
Moi je connais quelqu'un qui sait.....
Bah j'osais pas te demander par respect
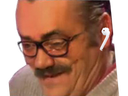
il y a 5 mois
Paye une couturière au pire
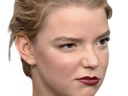
Bah c mieux gratuit et par une kheyette

il y a 5 mois