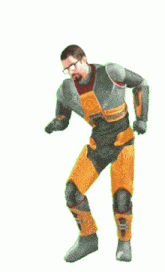Ce sujet a été résolu
Les modes.
Le Moyen Age musical se caractérisait souvent par ses degrés de récitation, ses règles d'enchaînements, ses formules d'intonation et ses finales. Les modes modernes ont fait des expérimentations de combinaisons de tons et demi tons pour susciter des couleurs alternatives aux sempiternels modes majeur et mineur.
Il y a les modes naturels qui sont la reprise des modes du Moyen Age et de la Renaissance pour leur charme médiéval, ancien mais avec des nouveautés découlant de l'esprit d'harmonique de l'époque moderne. Le jazz en fait aussi usage. Parmi les synonymes des modes naturels on a les modes ecclésiastiques, d'Eglise et les modes diatoniques, voire, les modes grecs même s'ils sont à proscrire car erroné. Ensuite il y a les modes artificiels qui sont de nouvelles échelles créées par un désir de sonorités et de nouvelle rhétoriques : la gramme par tons, le mode ton/demi ton, le mode de Bartok. Enfin il y a les modes ethniques qui sont les adoptions de nombreuses échelles caractéristiques, suscitée par l'éveil des écoles nationales et par un goût pour l'exotisme : gamme chinoise, mode andalou, mode de Java, modes d'Europe centrale, échelles karnatiques d'Inde. Ils sont innombrables dont il s'agira seulement de parler des plus fréquentes et celles qui furent utilisées plus récemment.
Pour ce qui est des modes naturels, le Moyen Age avait mis au point un système de 8 modes ( l'octoéchos ). 4 nouvelles échelles les complétèrent à la Renaissance. Construites à partir du la et du do, elles préfiguraient les modes mineures et majeures. Ce système modal fut abandonné à l'époque baroque. Quand les compositeurs, pour renouveler le langage, les compositeurs de la fin du XIXème siècle reprirent ces échelles anciennes, les 12 modse furent réduits à 6 car il n'a plus été tenu compte des différences d'ambitus ( formes authentes et plagales ). De plus un septième mode construit à partir du si fut ajouté. Chaque note naturelle peut être le départ d'un mode. On dit alors selon la note de départ, mode de do, mode de ré,, etc.... Une deuxième terminologie d'origine grecque s'est généralisée depuis le IXème siècle. Bien que provenant d'une lecture erronée de la théorie grecque, elle propose une alternative courante de dénomination. Dans la pratique, chacun des 7 modes peut être transposé sur les 12 degrés chromatiques. On peut avoir un mode de ré transposé sur mi, un mode de fa transposé sur ré bémol, etc.... On peut jouer ces modes, explorer leurs harmonies et noter les cadences particulières qu'ils permettent. Des compositeurs ont mis en valeur ces enchaînements harmoniques caractéristiques. Notamment en mode ré, le rapport plagal ( IV -I ) est souvent privilégié avec son enchaînement entre un quatrième degré majeur et un premier degré mineur.
Une méthode pour construire les modes naturels.
Les différents modes se comprennent et se perçoivent par eux même. Mais pour leur apprentissage, il y a une autre méthode de construction par comparaison avec le majeur et le mineur mélodique descendant. Elle permet de parvenir à une très grande vivacité. Il suffit d'apprendre les notes caractéristiques de grande échelle. A part le mode de si, comportant 2 notes caractéristiques, aucun mode n'a plus d'une note caractéristique à mémoriser. Exemple d'application : imaginons qu'on souhaite construire un mode de mi, transposé sur fa. Il suffit d'imaginer un mode de fa mineur mélodique descendant et d'ajouter la note caractéristique, le second degré abaissé.
Une classification des modes naturels.
Pour reconnaître à l'oreille 7 modes diatoniques, on les classe en regardant si leurs deuxième, troisième, 6ème et 7ème sont majeures ou mineures et si leurs quartes et quintes sont justes. En suivant le cycle des quintes, on ne modifie à chaque fois qu'un intervalle et on passe du plus sombre, le mode de si, au plus lumineux, le mode de fa.
Le mode pentatonique ( ou pentaphonique ).
Contrairement aux gammes diatoniques, les modes ne sont pas toujours faites de 7 notes. Il peuvent n'en avoir que 4 ( modes tétraphoniques ). Ou alors 5. Voire parfois plus, à savoir 8, 9, voire 11 ou 12.Le mode de 5 sons dit mode pentatonique ou pentaphonique est presque un mode universel tant le nombre de cultures l'ayant utilisé est varié. Mais ses 2 zones géographiques principales se trouvent en Afrique et en Asie. Il faut noter qu'il y est aussi en Occident et qu'il est parfois à l'origine de la formation des modes grégoriens. Mais il est parfois utilisé sans connotation historique ou ethnique particulière. Une de ses particularités est de n'avoir aucun demi ton. Aussi il est qualifié de mode anhémitonique. Pour visualiser instantanément ce mode il suffit de remarquer qu'il correspond aux touches noires du piano.
.
Le mode blues.
Le mode blues est de base un mode pentatonique.
Mais il peut être utilisé avec quelques notes de passage, dont une chromatique. Il donne le sentiment de partir du second degré du mode pentatonique et d'être de type mineur. C'est la tierce qui donne son caractère principal au mode blues. A savoir mineure dans les mélodies mais majeures dans les harmonies. C'est une tierce majeure ou mineure. La tierce du blues, quand elles est chantée, est souvent intermédiaire entre le majeur et le mineur : c'est l'une des 3 blues notes, les 2 autres étant la quinte diminuée et la septième mineure.
Le mode andalou.
La culture ibérique a connu un grand essor à la fin du XIXème siècle que ce soit via le rayonnement de grands compositeurs espagnols comme Albeniz, de Falla ou Granados ou par l'influence qu'elle a exercé sur ls musiciens français comme Ravel, Bizet ou encore Debussy. La richesse des rythmes et le charme des tournures musicales harmoniques et mélodiques des musiques espagnoles sont les raisons pour lesquelles ces musiques espagnoles ont eu autant de succès. On peut notamment citer le mode andalou qui fut utilisé par bien des compositeurs au début du XXème siècle. Il se caractérise par un tierce mobile pouvant être alternativement voire simultanément majeure et mineure. L'intervalle de seconde augmentée optionnelle entre le deuxième et le troisième degré ainsi que le demi ton au dessus de la tonique sont aussi typiques et originales. A noter qu'il peut être penser comme un mode mineur mélodique descendant dont la dominante serait prise comme tonique.
On peut prendre les exemples du " Le mode andalou " de Raval, Rhapsodie espagnole où le mode andalou transposé sur fa a nettement une fière allure espagnole alors que celui ci, transposé sur sol de l'exemple " Le mode andalou ", Debussy, Quatuor, est plus abstrait, comme une libre improvisation sur un tapis d'ostinatos.
La classification de messiaen.
A noter que Olivier Messiaen a classifié 7 notes, allant de 6 à 10 sons. Fasciné par les impossibilités comme les rythmes non rétrogradables, c'est à dire des rythmes identiques qu'ils soient lus de gauche à droite ou droite à gauche, Messiaen s'est intéressé aux modes de transpositions limitées. Il s'agit des modes ne pouvant pas être transposés 11 fois comme les modes mineurs et majeurs car ils redonnent la forme initiale en moins d'étapes. Dans la liste de 7 modes, on a déjà parlé du mode 1, la gamme par tons, et le mode 2, le mode ton/demi ton. Les modes à transpositions limitées de Messiaen montre les 7 modes de Messiaen et indique le nombre de sons de chacun, plus son nombre de formes distinctes.
La gamme par tons.
On a une gamme par tons instantanément en faisant des notes de passage régulière sur un accord de quinte augmentée car la gamme de tons est formée de 2 accords de quinte augmentée imbriquées. C'est une échelle de 6 sons constituée exclusivement de secondes majeures. L'exception réside dans la tierce diminuée ( enharmonie de seconde majeure ) nécessaire pour retourner à l'octave. La préférence pour les accidents notés, dièses ou bémols, peut souvent varier au fur et à mesure des mouvements mélodiques. C'est une échelle symétrique. Il n'y en a que 2 distinctes car quand on transpose 2 fois de suite l'échelle d'un demi ton, on retombe sur la première. A noter aussi que les 6 sons de l'échelle, plus les 6 sons de l'échelle transposée, totalisent les 12 sons possibles. Pour ces 2 raisons, ce mode est répertorié dans la classification des modes à transpositions limitées de Messiaen : c'est le mode 1. Ce mode peut, comme dans l'exemple " Voiles " de Debussy, créer une atmosphère diaphane, irréelle. Il se suffit dans ce cas à lui même. Une de ses autre Une de ses autres utilisations fréquentes consiste à " noyer le ton ". Le mode a pour utilité de créer dans ce cas une zone floue entre 2 modes ou 2 tonalités. Puis il existe une utilisation inattendue, à savoir quand on altère la quinte d'un accord de septième de dominante, on a un fragment de gamme par tons. Les musiciens de jazz, notamment le pianiste Thelonious Monk, se servent parfois de cette propriété pour jouer une gamme de tons lors des cadences.
Les modes du mineur mélodique ascendant.
De même que les modes peuvent être construits sur les différents degrés de la gamme majeure, ls musiciens de jazz aiment jouer sur les modes utilisant les degrés de la gamme mineure mélodique ascendante. Parmi les 7 échelles possibles à partir du mineur mélodique ascendant, celle partant du septième degré est particulièrement intéressante et se nomme mode altéré. On peut la concevoir comme l'enchaînement d'un fragment de mode demi-ton/ton avec un fragment de gamme par ton. Cette échelle est surtout utilisée pour improviser sur un accord de dominante altéré, d'où son nom. A noter que le mode acoustique étudié avant cela, et pensé comme une échelle évoquant les harmoniques naturels, se construit également en partant du mineur mélodique ascendant. C'est le mode 4.
Le mode ton/demi-ton.
.
.
il y a 8 mois
Un visage sincère et plein d'empathie est le vrai visage de la " force"
il y a 8 mois
Pôtite chanson qu'on écoutait avec ma mère dans la voiture quand j'étais enfant
On en fait des belles trouvailles sur ytb à 4h du mat'
Et c'est signé "Z" comme "Harry se lève" !
il y a 8 mois
Bien pour frimer devant le miroir
Et c'est signé "Z" comme "Harry se lève" !
il y a 8 mois