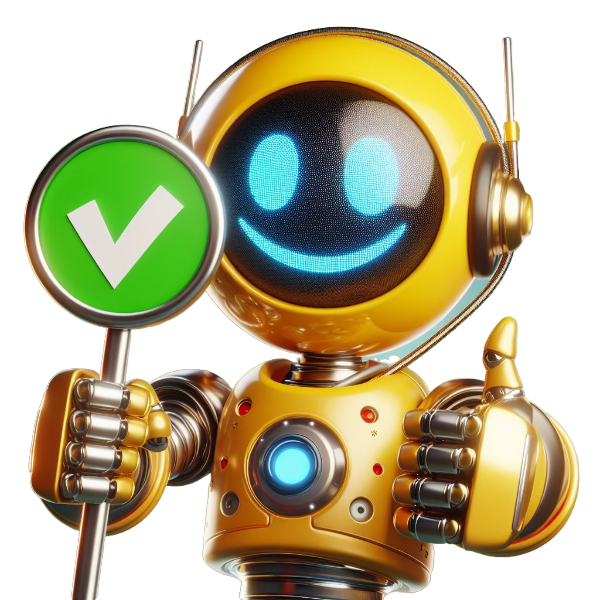Ce sujet a été résolu
Pitié quoi j'en ai marre. J'ai été toujours gentille avec tlm ici, c'est sûrement pour ça que jmen prends plein la gueule

ᶻ 𝘇 𐰁
il y a 10 mois
Allez ça recommence

Je venais passer un bon moment avec mes cyber potes mais je me fais cyber harceler par des arabes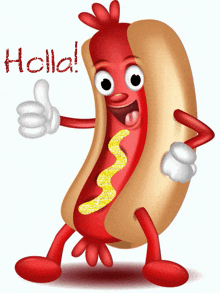
Je venais passer un bon moment avec mes cyber potes mais je me fais cyber harceler par des arabes
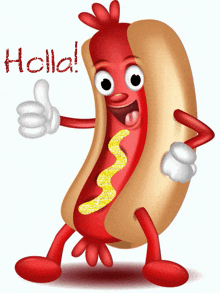
ça va j'ai le droit je le fais avec parcimonie

Je préfère être un rat des champs
il y a 10 mois
x0x0
10 mois
Chak je comprend c'est un enculé mais les réac rire vous êtes des fdp

T'ose dire ça gros pd ?
ᶻ 𝘇 𐰁
il y a 10 mois
Pas compris pourquoi ce topic à été up peut être que c'est un message codé pour dire qu'IL veut des privautés de ma part

Je suis le donut du forum

il y a 10 mois
J'avoue
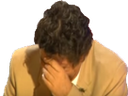
J'allais écrire csc mais c'est le stade au dessus là ça mérite un recadrage

Je préfère être un rat des champs
il y a 10 mois
Ça va faire baisser ma cote
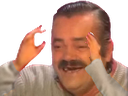
Elle remontera demain tkt
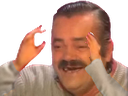
Je suis le vrais héros de tous les temps https://pastebin.com/RiUTcpxB

il y a 10 mois
AYAAAA ORSIK
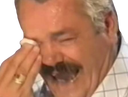
Je suis le vrais héros de tous les temps https://pastebin.com/RiUTcpxB

il y a 10 mois
CEST QUOI LA DIFFÉRENCE ENTRE UN NOIR ET UN PNEU ????

LE PNEU IL PUE SEULEMENT QUAND TU LE BRULES

PUTAIN VOUS ME METTEZ HORS DE MOI



LE PNEU IL PUE SEULEMENT QUAND TU LE BRULES
PUTAIN VOUS ME METTEZ HORS DE MOI
ᶻ 𝘇 𐰁
il y a 10 mois
Elle remontera demain tkt
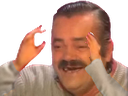
Je te roule dessus l'op !!
il y a 10 mois
Je te roule dessus l'op !!
Mais enfin ça va pas !
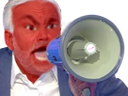
Je suis le vrais héros de tous les temps https://pastebin.com/RiUTcpxB

il y a 10 mois
Tiens vous saviez que la première dame de Guinée était une gendarme française complètement random ?

En terme d'ascenseur social on peut pas faire plus inattendu je pense


En terme d'ascenseur social on peut pas faire plus inattendu je pense

il y a 10 mois
Très haut bien sûr

@Pogo fais gaffe la dernière fois qu'elle m'a dis ça elle m'a mis tout en bas avec oib et les autres fou du bus

Je préfère être un rat des champs
il y a 10 mois
uwu

il y a 10 mois