Ce sujet a été résolu
Par contre pour les ouvriers en général c'était pas top.
Naissance des mondes ouvriers.
Les hommes sont plus lents que les techniques et les capitaux. Ils mettent donc plus de temps à prendre conscience de leur condition nouvelle et inégalement. Par le contact quotidien et par la lutte. Avant cette identification du travailleur de la révolution industrielle avec lui même ou avec les autres, bien souvent une ou deux générations auront vécu une longue et difficile transition. Pour amorcer la croissance, tous les facteurs de production étant employés à pleine capacité, l'investissement nécessaire ne peut se faire le plus souvent qu'au détriment de la consommation. Pour assurer l'avenir de l'industrialisation, le capitalisme ne peut pas jouer sur les deux termes et en conséquence, choisit délibérément de privilégier l'investissement. Seule une longue journée de travail et des bas salaires jetés à une main d'oeuvre abondante et inorganisée, avec un marché du travail solidement tenu de manière à n'offrir l'emploi qu'à ceux qui acceptent les nouvelles règles de la production, peuvent favoriser l'investissement. La misère ouvrière n'est donc pas, comme bien des contemporains l'ont cru en toute bonne foi, le fruit d'un coupable relâchement moral des employeurs, un mépris de la condition humaine et de la justice. Elle est une sorte de loi naturelle du capitalisme en expansion. Les économistes anglais du XIXème siècle eux, ne s'y sont pas trompés, qui ont établit vite le lien entre la production, le profit et le salaire limité au niveau minimal de subsistance nécessaire au renouvellement de la forte de travail du salarié. Au terme de l'adaptation, le travailleur qui vend sa force de travail, ne fit qu'à condition de trouver un emploi, et ne l'obtient que si son travail entre dans le nouveau système, encaissera du mieux être à son tour. C'est en vertu de ses lois économiques et sans compassion moraliste déplacée qu'il faut donc décrire le monde ouvrier nouveau. Division du travail, productivité et accroissement du capital sont organiquement liés.
Certes, tout un monde du travail, divers, puissant, vit en marge de l'usine. Artisans du bâtiment, mobiles organisés, souvent mieux payés, vindicatifs. Ouvriers du livre, plus instruits, qui donneront, avec les ouvriers plus indépendants des métiers d'art, ferronniers, bronziers, les premiers militants du mouvement ouvrier. " Canuts " lyonnais, fiers d'une indépendance familiale en voie de disparition. Monde des " compagnons " des métiers, instruit par de puissantes associations de soutien, aristocratie ouvrière et artisanale issue de l'âge pré industriel. Cette élite ouvrière, consciente et organisée, joue longtemps un rôle d'éducation et d'encadrement des autres travailleurs. Mais, passé 1840, elle est mal adaptée à la concurrence de l'usine, ne se perpétue longtemps que dans les pays plus lents à épanouir une industrie moderne, comme la France : les nouveaux venus dans ces professions doivent se plier à la règle de l'exploitation rationnelle. Pour eux, comme pour les entrepreneurs, l'usine l'emporte à la longue.
L'exploité modèle est donc dès l'origine, le travailleur de grande entreprise. Il vient dans une forte proportion des campagnes voisines et la législation intervient pour faciliter la mobilité de la main d'oeuvre. En Grande Bretagne, depuis le XVIIème siècle, la loi faisait obligation aux paroisses de parquer dans des workhouses pénitentiaires et moralisantes les pauvres sans travail rejetés du monde rural. La loi de 1795, qui établir la liberté de déplacement pour ces indigents, en retirant à leurs paroisses d'origine, le plus souvent rurales l'obligation de les récupérer et de les héberger, les livre au liber jeu du marché et les précipitera vers les centres manufacturiers qui cherchent une main d'oeuvre. Même évolution en Allemagne, en Europe centrale, où les codes d'assistance sont eux aussi assouplis au début du XIXème siècle. Seule la France ralentira le processus, avec la création d'une classe de paysans moyens nombreux issus du partage, inégal mais réel, de la terre des privilégiés sous la Révolution. Dans le même esprit, les contrats de travail, qui pouvaient lier à vie les serfs ou les valeurs à leur employeur, non seulement dans l'agriculture mais dans les mines à réglementation médiévale, sont abrogés partout en Europe. Désormais, le libre mouvement de la main d'oeuvre prend une amplitude sans cesse accrue : glissement de l'Angleterre" verte " du Sud vers l'Angleterre " noire " du Centre et de l'Ouest, concentrations allemandes vers la Ruhr, belges vers le Borinage, françaises vers le Nord, l'Est et Paris, sardes, et " braccianti " du Sud italien vers gênes, Turin et Milan. Bien vite aussi, des mouvements peuvent prendre l'allure d'émigrations massives, comme celle des Irlandais dès le derniers tiers du XVIIIème siècle, peuplant les foyers industriels d'Angleterre, d'Ecosse et du pays de Galles, manoeuvres à tout faire, agités, parqués, avec, par villages entiers, des nouveaux venus à chaque famine ou à chaque crise.
Ainsi, régulièrement renouvelée, cette main d'oeuvre et réutilisée dans les usines. L'ouvrier est attaché à sa machine, chargé de l'alimenter, la surveiller, la nettoyer, en vue de fabriquer un des éléments du produits fini. L'apprentissage est rapide : aucune technique ancestrale à transmettre, aucun souci d'achever l'objet avec patience et habileté. L'ouvrier est interchangeable, sur une machine interchangeable. Des opérations très simples pour la plupart, effectuées à un rythme contrôlé, mais qui ne demandent pas, en dehors de la répétition du geste, une forte physique considérable, surtout dans l'industrie textile. Le réglage des machines est fait par quelques spécialistes qui, très lentement, constitueront une élite de professionnels dominant les maneuvres à la fin du XIXème siècle. Souvent, l'ouvrier sur machine peut, d'un jour à l'autre, devenir manutentionnaire, magasinier, emballeur, essayer, finisseur : les spécialisations sont introduites tardivement. Une atmosphère de désordre, sans comparaison avec l'usine taylorisée du XXème siècle, un bruit permanent et varié, l'atelier parfois glacial l'hiver et torride l'été, l'huile des machines maculant les vêtements, peu d'aération, très rarement un vestiaire, une cantine et des " commodités ", la cadence, une surveillance militaire des contremaîtres rendent le travail pénible et dégradant.
A chaque instant, l'accident est possible, au milieu des volants, des roues et des courroies de transmission. Aucune protection, si bien que les enquêtes parlementaires anglaises de 1833 révèlent ces foules d'estropiés, le plus souvent ayant perdu un bras, renvoyé, sans assurance d'aucune sorte, et errant dans le comté de Berdy. A Manchester, note Engels, on a l'impression de vivre " au milieu d'une armée qui revient de campagne ". Dans les mines, les descentes par échelles ou par chaînes au fond du puits, avant que les compagnies ne consentent à tolérer l'usage des bennes à charbon par leurs mineurs, les éboulements dans des galeries mal étayées, l'inondation, le grisou mal détecté, l'incendie, multiplient les risques pour les haveurs. La mécanisation intervient lentement on l'a vu, car les prix de vente restent stables : les employeurs préfèrent accélérer la rotation des équipes, payer " à la berline " remplie, imposer des cadences plus fortes.
Pourtant, la journée de travail est étirée aux limites de la résistance physique des ouvriers. " Limitée " au XVIIIème siècle par la durée du jour, elle s'allonge jusqu'en 1850, avec l'éclairage au gaz qui permet de faire tourner certaines fabriques nuits et jour. Quelques patrons libéraux, comme Arkwright, qui désirent assurer la rentabilité du travail en évitant d'épuiser les ouvriers, limitent la journée à 12 heures. En moyenne, jusqu'en 1860 environ, elle oscille pourtant, dans toutes les branches de l'activité industrielle, de 12 à 15 heures. Ce n'est pas une nouveauté, comparé au vieux domestic system : jusqu'à la fin du second Empire, un canut lyonnais doit rester 16 heures par jour devant son métier pour survivre. Mais en usine, la nouveauté vient de la régularité : pauses et horaires des repas rognés par le patron, vigilance des gardiens, trucage variés sur les sonneries des cloches et des horloges au début du siècle, paiement à la pièce usinée substituée au tarif horaire. Travail continu, sans congés ni jours fériés, où le repos dominical n'est même pas toujours respecté, où l'absentéisme est une soupape de sûreté. De la Pennsylvanie à L'Oural, de la Clyde à Pô, même souffrance jusqu'en 1850. Et souvent en pure perte, car la fatigue accumulée, la maladie, la médiocre nourriture font, dans ces conditions terribles, baisser le rendement par ouvrier. Pour augmenter la production, il faut allonger encore le travail et employer de nouveaux travailleurs.
.
Naissance des mondes ouvriers.
Les hommes sont plus lents que les techniques et les capitaux. Ils mettent donc plus de temps à prendre conscience de leur condition nouvelle et inégalement. Par le contact quotidien et par la lutte. Avant cette identification du travailleur de la révolution industrielle avec lui même ou avec les autres, bien souvent une ou deux générations auront vécu une longue et difficile transition. Pour amorcer la croissance, tous les facteurs de production étant employés à pleine capacité, l'investissement nécessaire ne peut se faire le plus souvent qu'au détriment de la consommation. Pour assurer l'avenir de l'industrialisation, le capitalisme ne peut pas jouer sur les deux termes et en conséquence, choisit délibérément de privilégier l'investissement. Seule une longue journée de travail et des bas salaires jetés à une main d'oeuvre abondante et inorganisée, avec un marché du travail solidement tenu de manière à n'offrir l'emploi qu'à ceux qui acceptent les nouvelles règles de la production, peuvent favoriser l'investissement. La misère ouvrière n'est donc pas, comme bien des contemporains l'ont cru en toute bonne foi, le fruit d'un coupable relâchement moral des employeurs, un mépris de la condition humaine et de la justice. Elle est une sorte de loi naturelle du capitalisme en expansion. Les économistes anglais du XIXème siècle eux, ne s'y sont pas trompés, qui ont établit vite le lien entre la production, le profit et le salaire limité au niveau minimal de subsistance nécessaire au renouvellement de la forte de travail du salarié. Au terme de l'adaptation, le travailleur qui vend sa force de travail, ne fit qu'à condition de trouver un emploi, et ne l'obtient que si son travail entre dans le nouveau système, encaissera du mieux être à son tour. C'est en vertu de ses lois économiques et sans compassion moraliste déplacée qu'il faut donc décrire le monde ouvrier nouveau. Division du travail, productivité et accroissement du capital sont organiquement liés.
Certes, tout un monde du travail, divers, puissant, vit en marge de l'usine. Artisans du bâtiment, mobiles organisés, souvent mieux payés, vindicatifs. Ouvriers du livre, plus instruits, qui donneront, avec les ouvriers plus indépendants des métiers d'art, ferronniers, bronziers, les premiers militants du mouvement ouvrier. " Canuts " lyonnais, fiers d'une indépendance familiale en voie de disparition. Monde des " compagnons " des métiers, instruit par de puissantes associations de soutien, aristocratie ouvrière et artisanale issue de l'âge pré industriel. Cette élite ouvrière, consciente et organisée, joue longtemps un rôle d'éducation et d'encadrement des autres travailleurs. Mais, passé 1840, elle est mal adaptée à la concurrence de l'usine, ne se perpétue longtemps que dans les pays plus lents à épanouir une industrie moderne, comme la France : les nouveaux venus dans ces professions doivent se plier à la règle de l'exploitation rationnelle. Pour eux, comme pour les entrepreneurs, l'usine l'emporte à la longue.
L'exploité modèle est donc dès l'origine, le travailleur de grande entreprise. Il vient dans une forte proportion des campagnes voisines et la législation intervient pour faciliter la mobilité de la main d'oeuvre. En Grande Bretagne, depuis le XVIIème siècle, la loi faisait obligation aux paroisses de parquer dans des workhouses pénitentiaires et moralisantes les pauvres sans travail rejetés du monde rural. La loi de 1795, qui établir la liberté de déplacement pour ces indigents, en retirant à leurs paroisses d'origine, le plus souvent rurales l'obligation de les récupérer et de les héberger, les livre au liber jeu du marché et les précipitera vers les centres manufacturiers qui cherchent une main d'oeuvre. Même évolution en Allemagne, en Europe centrale, où les codes d'assistance sont eux aussi assouplis au début du XIXème siècle. Seule la France ralentira le processus, avec la création d'une classe de paysans moyens nombreux issus du partage, inégal mais réel, de la terre des privilégiés sous la Révolution. Dans le même esprit, les contrats de travail, qui pouvaient lier à vie les serfs ou les valeurs à leur employeur, non seulement dans l'agriculture mais dans les mines à réglementation médiévale, sont abrogés partout en Europe. Désormais, le libre mouvement de la main d'oeuvre prend une amplitude sans cesse accrue : glissement de l'Angleterre" verte " du Sud vers l'Angleterre " noire " du Centre et de l'Ouest, concentrations allemandes vers la Ruhr, belges vers le Borinage, françaises vers le Nord, l'Est et Paris, sardes, et " braccianti " du Sud italien vers gênes, Turin et Milan. Bien vite aussi, des mouvements peuvent prendre l'allure d'émigrations massives, comme celle des Irlandais dès le derniers tiers du XVIIIème siècle, peuplant les foyers industriels d'Angleterre, d'Ecosse et du pays de Galles, manoeuvres à tout faire, agités, parqués, avec, par villages entiers, des nouveaux venus à chaque famine ou à chaque crise.
Ainsi, régulièrement renouvelée, cette main d'oeuvre et réutilisée dans les usines. L'ouvrier est attaché à sa machine, chargé de l'alimenter, la surveiller, la nettoyer, en vue de fabriquer un des éléments du produits fini. L'apprentissage est rapide : aucune technique ancestrale à transmettre, aucun souci d'achever l'objet avec patience et habileté. L'ouvrier est interchangeable, sur une machine interchangeable. Des opérations très simples pour la plupart, effectuées à un rythme contrôlé, mais qui ne demandent pas, en dehors de la répétition du geste, une forte physique considérable, surtout dans l'industrie textile. Le réglage des machines est fait par quelques spécialistes qui, très lentement, constitueront une élite de professionnels dominant les maneuvres à la fin du XIXème siècle. Souvent, l'ouvrier sur machine peut, d'un jour à l'autre, devenir manutentionnaire, magasinier, emballeur, essayer, finisseur : les spécialisations sont introduites tardivement. Une atmosphère de désordre, sans comparaison avec l'usine taylorisée du XXème siècle, un bruit permanent et varié, l'atelier parfois glacial l'hiver et torride l'été, l'huile des machines maculant les vêtements, peu d'aération, très rarement un vestiaire, une cantine et des " commodités ", la cadence, une surveillance militaire des contremaîtres rendent le travail pénible et dégradant.
A chaque instant, l'accident est possible, au milieu des volants, des roues et des courroies de transmission. Aucune protection, si bien que les enquêtes parlementaires anglaises de 1833 révèlent ces foules d'estropiés, le plus souvent ayant perdu un bras, renvoyé, sans assurance d'aucune sorte, et errant dans le comté de Berdy. A Manchester, note Engels, on a l'impression de vivre " au milieu d'une armée qui revient de campagne ". Dans les mines, les descentes par échelles ou par chaînes au fond du puits, avant que les compagnies ne consentent à tolérer l'usage des bennes à charbon par leurs mineurs, les éboulements dans des galeries mal étayées, l'inondation, le grisou mal détecté, l'incendie, multiplient les risques pour les haveurs. La mécanisation intervient lentement on l'a vu, car les prix de vente restent stables : les employeurs préfèrent accélérer la rotation des équipes, payer " à la berline " remplie, imposer des cadences plus fortes.
Pourtant, la journée de travail est étirée aux limites de la résistance physique des ouvriers. " Limitée " au XVIIIème siècle par la durée du jour, elle s'allonge jusqu'en 1850, avec l'éclairage au gaz qui permet de faire tourner certaines fabriques nuits et jour. Quelques patrons libéraux, comme Arkwright, qui désirent assurer la rentabilité du travail en évitant d'épuiser les ouvriers, limitent la journée à 12 heures. En moyenne, jusqu'en 1860 environ, elle oscille pourtant, dans toutes les branches de l'activité industrielle, de 12 à 15 heures. Ce n'est pas une nouveauté, comparé au vieux domestic system : jusqu'à la fin du second Empire, un canut lyonnais doit rester 16 heures par jour devant son métier pour survivre. Mais en usine, la nouveauté vient de la régularité : pauses et horaires des repas rognés par le patron, vigilance des gardiens, trucage variés sur les sonneries des cloches et des horloges au début du siècle, paiement à la pièce usinée substituée au tarif horaire. Travail continu, sans congés ni jours fériés, où le repos dominical n'est même pas toujours respecté, où l'absentéisme est une soupape de sûreté. De la Pennsylvanie à L'Oural, de la Clyde à Pô, même souffrance jusqu'en 1850. Et souvent en pure perte, car la fatigue accumulée, la maladie, la médiocre nourriture font, dans ces conditions terribles, baisser le rendement par ouvrier. Pour augmenter la production, il faut allonger encore le travail et employer de nouveaux travailleurs.
.
il y a un an
Sans oublier le travail des enfants dans certains cas. Le IIIème République avait vraiment abusé là dessus ( en dépit de quelques lois sociales par ci par là.
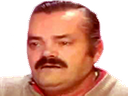
Les crises.
Ainsi décrit, le monde économique né de la révolution industrielle paraît décidément bien assuré sans sa puissance. Et les européens ne s'y sont pas trompés, qui virent là le sceau d'un progrès de l'humanité dont l'application leur avait échu justement. C'est pourquoi ceux auxquels l'entreprise profitaient furent très peu sensibles aux accidents et aux crises que la nouvelle économie engendra très tôt. Le XIXème siècle est fondamentalement optimiste, bercé dans l'euphorie saint simonienne et scientiste. Les contemporains constatent les crises, leur périodicité, leurs méfaits sociaux, mais n'en donnent que des explications monétaires, les relient dans le meilleur des cas à un excès d'investissement; Jamais, malgré les liens unissant les économistes libéraux à quelques rares hommes d'affaires, les théories des crises ne sont connues et discutée, jamais surtout on ne les relie à des dérèglements de la production et du profit. Source : Pour la France, cf B. Gille. Seuls des économistes obstinés et quelques esprits chagrins hantés par la misère ouvrière les scrutent avec insistance, assurés d'y trouver les mécanismes secrets de l'économie nouvelle. En entant de nous replacer dans l'optique des contemporains, il faut suivre les crises les plus aiguies. D'abord la crise de l'Ancien Régime, caractérisée par une sous production agricole, gagnant ensuite le commerce et l'industrie, telle que par exemple la France la connu à la veille de la Révolution de 1789 avec ses disettes, ses accaparements, ses chômages, ses convois de grain pillés, n'apparaît plus avec netteté au XIXème siècle. A économie nouvelle, crises nouvelles.
Ensuite, en 1816 apparaît une crise de type nouveau que Ricardo, qui en fut témoin, nomma crise de reconversion. En guerre depuis 1793 avec la France, la Grande Bretagne avait gonflé ses dépenses publiques et militaires, émis beaucoup de monnaie, favorisé son agriculture dont les prix des denrées s'étaient élevés. Avec Waterloo, une fièvre spéculative se déclare. Les industriels anglais pensent pouvoir inonder en produits textiles et mécaniques une Europe qui leur avait été largement fermée par le Blocus continental. Mais l'Europe, appauvrie, mieux dominée par les produits français et belges, n'absorbe pas la quantité de produits espérée. D'où engorgement de stocks. La reprise du commerce international permet l'entrée de produits alimentaires importés : les prix agricoles anglais s'effondrent. L'affolement, l'inflation, la spéculation créent une crise monétaire, avec de nombreuses faillites de banques. Tous les secteurs de l'économie sont désormais atteints, alors qu'une mauvaise révolte en 1817 aggrave la misère et l'agitation sociale. Les Etats Unis, surpris par le retour du commerce anglais vers le continent européen, voient leurs exportations diminuer. La France connait une grave crise agricole qu'elle ne peut pas compenser par des ventes industrielles face à une concurrence anglais acharnée. Blocage de tous les secteurs, extension mondiale amorcée : cette crise est moderne dans une large mesure. Puis, la stagnation industrielle et commerciale permet d'éponger les surplus et l'économie redémarre vers 1818, sans grands soubresauts, au point que Ricardo conclut qu'une crise de surproduction prolongée était impossible, que l'équilibre se rétablirait toujours naturellement.
Nouvelle crise en 1825, boursière celle là, née à Londres à la suite de spéculations hasardeuses des banques en Amérique latine. La hausse des taux d'escompte stoppe le crédit et l'investissement, entraînant en 1826 une grave récession du textile et du commerce anglais. Touchés dans leurs exportations de coton, les Etats Unis subissent le contrecoup. Sismondi et Jean Baptiste Say y virent la première crise monétaire et industrielle véritable. Puis, entre 1836 et 1839, une crise financière, frappant la Grande Bretagne et les Etats Unis, après des spéculations hasardeuses au Portugal et en Espagne se traduit par une hausse du coton. Entre 1846 et 1851, survient une des plus profondes dépressions du siècle,, modèle de crise mixte. Elle est agricole et d'ancien type dans ses origines, avec la maladie de la pomme de terre en Irlande, les mauvaises récoltes de coton aux Etats Unis, les hausses des prix des céréales après le gel des emblavures en Europe dans le dur hiver 1846 - 1847. Elle se complique d'une crise financière, lorsque les compagnies ferroviaires hâtivement constituées depuis quelques années demandèrent à leurs actionnaires, dont elles ont déjà tari les disponibilités, des versements complémentaires pour achever les constructions. Le crédit extérieur manque, car il est mobilisé pour les indispensables importations de blé, russe surtout. Les compagnies sautent. Puis la crise devient industrielle : la consommation s'arrête car l'alimentation avec les prix agricoles en hausse, absorbe toutes les ressources des particuliers. Dans ses cheminements, cette crise caractérise bien un monde où la révolution industrielle n'a pas encore triomphé, où les vieux problèmes ruraux restent déterminants. Mais son ampleur sans précédent explique en grande partie les révolutions de 1848 en Europe.
Puis, tout évolue. En 1857, première crise de surproduction agricole : le blé américain ne s'exporte plus à cause des belles récoltes européennes et la reprise des fournitures russes après la guerre de Crimée. Pour acheter leurs produits manufacturés à l'Europe, les banques américaines empruntent massivement à Londres. La spéculation aidant, une crise du crédit s'enclenche. En 1866, au contraire, l'arrêt des fournitures de coton par les Etats Unis, qui sortent des 5 années de guerre de Sécession, oblige les industries européennes à s'approvisionner au prix fort, hâtivement, en Inde et en Egypte, ce qui déclenche une crise financière très vive. Etats Unis, Grande Bretagne, Allemagne, France, toutes les grands puissances sont, pour la première fois, touchées en même temps : la diffusion internationale des capitaux, l'extension des aires d'approvisionnement dilatent la crise à l'ensemble du monde industrialisé. Enfin, en 1873, éclate la crise qui, pour E. Labrousse, est le signe de l'ère industrielle contemporaine enfin adulte. Née dans les pays les plus fraîchement industrialisés, Etats Unis et Allemagne, elle s'étend brutalement à l'ensemble du monde capitaliste. Elle est clairement liée à une surproduction généralisée des industries textiles et sidérurgiques. Ses aspects financiers soulignent le rôle prépondérant du marché international, puisque la banqueroute espagnole, la suspension du paiement des dettes turques, les difficultés d'Amérique latine et de Russie paralysent brutalement le jeu normal des investissements mondiaux des pays dominants. Enfin, la chute brutale et corollaire des prix, des salaires et des profits témoigne de la maturité du système qui les relie.
On peut terminer avec une description chronologique autre. Car elle marque une coupure dans le siècle. Cette surproduction des produits de l'industrie, cette soumission du monde au jeu des capitaux des premières puissances industrielles marquent, à l'échelle internationale au moins, la limite chronologique de notre étude. La révolution industrielle a triomphé. Centrée sur la Grande Bretagne, les Etats Unis, la France et l'Allemagne, elle leur permet de dominer le monde. Le grand problème de l'avenir n'est plus produire mais vendre et se partager les marchés : l'âge libéral cède sa place. Désormais, après 1873, aucune révolution industrielle nationale ne se fera sans que les 4 grandes puissances n'interviennent, favorablement ou non, peu important, dans son démarrage et sa croissance. Les processus d'industrialisation naturels ne jouent plus aussi librement qu'avant, car les économies dominantes veillent. Les déséquilibres économiques du XXème siècle naissent sur ce sommet de 1873. Mais les réflexions économiques permettent de confirmer cette explication. Au XIXème siècle, l'alternance régulière des crises conduit à élaborer assez facilement les premières théories des cycles. Dans ses " Crises commerciales et leur retour périodique en France, en Angleterre, et aux Etats Unis ", parues en 1862, Clément Juglar définit le cycle majeur de l'histoire économique de son siècle, à périodicité de 6 à 11 ans, avec ses phases régulières d'essor, de crise, de dépression et de reprise, que tous les travaux contemporains retrouvent immanquablement. Sauf pour les Etats Unis, où le cycle de Kitchin, sur 3 ou 4 ans, est plus fréquent. Les grandes explications des crises dont données, même si les industriels, les banquiers et les hommes d'Etat du temps ne savent pas comprendre qu'on peut prévoir et peut être maîtriser les catastrophes :
Les crises.
Ainsi décrit, le monde économique né de la révolution industrielle paraît décidément bien assuré sans sa puissance. Et les européens ne s'y sont pas trompés, qui virent là le sceau d'un progrès de l'humanité dont l'application leur avait échu justement. C'est pourquoi ceux auxquels l'entreprise profitaient furent très peu sensibles aux accidents et aux crises que la nouvelle économie engendra très tôt. Le XIXème siècle est fondamentalement optimiste, bercé dans l'euphorie saint simonienne et scientiste. Les contemporains constatent les crises, leur périodicité, leurs méfaits sociaux, mais n'en donnent que des explications monétaires, les relient dans le meilleur des cas à un excès d'investissement; Jamais, malgré les liens unissant les économistes libéraux à quelques rares hommes d'affaires, les théories des crises ne sont connues et discutée, jamais surtout on ne les relie à des dérèglements de la production et du profit. Source : Pour la France, cf B. Gille. Seuls des économistes obstinés et quelques esprits chagrins hantés par la misère ouvrière les scrutent avec insistance, assurés d'y trouver les mécanismes secrets de l'économie nouvelle. En entant de nous replacer dans l'optique des contemporains, il faut suivre les crises les plus aiguies. D'abord la crise de l'Ancien Régime, caractérisée par une sous production agricole, gagnant ensuite le commerce et l'industrie, telle que par exemple la France la connu à la veille de la Révolution de 1789 avec ses disettes, ses accaparements, ses chômages, ses convois de grain pillés, n'apparaît plus avec netteté au XIXème siècle. A économie nouvelle, crises nouvelles.
Ensuite, en 1816 apparaît une crise de type nouveau que Ricardo, qui en fut témoin, nomma crise de reconversion. En guerre depuis 1793 avec la France, la Grande Bretagne avait gonflé ses dépenses publiques et militaires, émis beaucoup de monnaie, favorisé son agriculture dont les prix des denrées s'étaient élevés. Avec Waterloo, une fièvre spéculative se déclare. Les industriels anglais pensent pouvoir inonder en produits textiles et mécaniques une Europe qui leur avait été largement fermée par le Blocus continental. Mais l'Europe, appauvrie, mieux dominée par les produits français et belges, n'absorbe pas la quantité de produits espérée. D'où engorgement de stocks. La reprise du commerce international permet l'entrée de produits alimentaires importés : les prix agricoles anglais s'effondrent. L'affolement, l'inflation, la spéculation créent une crise monétaire, avec de nombreuses faillites de banques. Tous les secteurs de l'économie sont désormais atteints, alors qu'une mauvaise révolte en 1817 aggrave la misère et l'agitation sociale. Les Etats Unis, surpris par le retour du commerce anglais vers le continent européen, voient leurs exportations diminuer. La France connait une grave crise agricole qu'elle ne peut pas compenser par des ventes industrielles face à une concurrence anglais acharnée. Blocage de tous les secteurs, extension mondiale amorcée : cette crise est moderne dans une large mesure. Puis, la stagnation industrielle et commerciale permet d'éponger les surplus et l'économie redémarre vers 1818, sans grands soubresauts, au point que Ricardo conclut qu'une crise de surproduction prolongée était impossible, que l'équilibre se rétablirait toujours naturellement.
Nouvelle crise en 1825, boursière celle là, née à Londres à la suite de spéculations hasardeuses des banques en Amérique latine. La hausse des taux d'escompte stoppe le crédit et l'investissement, entraînant en 1826 une grave récession du textile et du commerce anglais. Touchés dans leurs exportations de coton, les Etats Unis subissent le contrecoup. Sismondi et Jean Baptiste Say y virent la première crise monétaire et industrielle véritable. Puis, entre 1836 et 1839, une crise financière, frappant la Grande Bretagne et les Etats Unis, après des spéculations hasardeuses au Portugal et en Espagne se traduit par une hausse du coton. Entre 1846 et 1851, survient une des plus profondes dépressions du siècle,, modèle de crise mixte. Elle est agricole et d'ancien type dans ses origines, avec la maladie de la pomme de terre en Irlande, les mauvaises récoltes de coton aux Etats Unis, les hausses des prix des céréales après le gel des emblavures en Europe dans le dur hiver 1846 - 1847. Elle se complique d'une crise financière, lorsque les compagnies ferroviaires hâtivement constituées depuis quelques années demandèrent à leurs actionnaires, dont elles ont déjà tari les disponibilités, des versements complémentaires pour achever les constructions. Le crédit extérieur manque, car il est mobilisé pour les indispensables importations de blé, russe surtout. Les compagnies sautent. Puis la crise devient industrielle : la consommation s'arrête car l'alimentation avec les prix agricoles en hausse, absorbe toutes les ressources des particuliers. Dans ses cheminements, cette crise caractérise bien un monde où la révolution industrielle n'a pas encore triomphé, où les vieux problèmes ruraux restent déterminants. Mais son ampleur sans précédent explique en grande partie les révolutions de 1848 en Europe.
Puis, tout évolue. En 1857, première crise de surproduction agricole : le blé américain ne s'exporte plus à cause des belles récoltes européennes et la reprise des fournitures russes après la guerre de Crimée. Pour acheter leurs produits manufacturés à l'Europe, les banques américaines empruntent massivement à Londres. La spéculation aidant, une crise du crédit s'enclenche. En 1866, au contraire, l'arrêt des fournitures de coton par les Etats Unis, qui sortent des 5 années de guerre de Sécession, oblige les industries européennes à s'approvisionner au prix fort, hâtivement, en Inde et en Egypte, ce qui déclenche une crise financière très vive. Etats Unis, Grande Bretagne, Allemagne, France, toutes les grands puissances sont, pour la première fois, touchées en même temps : la diffusion internationale des capitaux, l'extension des aires d'approvisionnement dilatent la crise à l'ensemble du monde industrialisé. Enfin, en 1873, éclate la crise qui, pour E. Labrousse, est le signe de l'ère industrielle contemporaine enfin adulte. Née dans les pays les plus fraîchement industrialisés, Etats Unis et Allemagne, elle s'étend brutalement à l'ensemble du monde capitaliste. Elle est clairement liée à une surproduction généralisée des industries textiles et sidérurgiques. Ses aspects financiers soulignent le rôle prépondérant du marché international, puisque la banqueroute espagnole, la suspension du paiement des dettes turques, les difficultés d'Amérique latine et de Russie paralysent brutalement le jeu normal des investissements mondiaux des pays dominants. Enfin, la chute brutale et corollaire des prix, des salaires et des profits témoigne de la maturité du système qui les relie.
On peut terminer avec une description chronologique autre. Car elle marque une coupure dans le siècle. Cette surproduction des produits de l'industrie, cette soumission du monde au jeu des capitaux des premières puissances industrielles marquent, à l'échelle internationale au moins, la limite chronologique de notre étude. La révolution industrielle a triomphé. Centrée sur la Grande Bretagne, les Etats Unis, la France et l'Allemagne, elle leur permet de dominer le monde. Le grand problème de l'avenir n'est plus produire mais vendre et se partager les marchés : l'âge libéral cède sa place. Désormais, après 1873, aucune révolution industrielle nationale ne se fera sans que les 4 grandes puissances n'interviennent, favorablement ou non, peu important, dans son démarrage et sa croissance. Les processus d'industrialisation naturels ne jouent plus aussi librement qu'avant, car les économies dominantes veillent. Les déséquilibres économiques du XXème siècle naissent sur ce sommet de 1873. Mais les réflexions économiques permettent de confirmer cette explication. Au XIXème siècle, l'alternance régulière des crises conduit à élaborer assez facilement les premières théories des cycles. Dans ses " Crises commerciales et leur retour périodique en France, en Angleterre, et aux Etats Unis ", parues en 1862, Clément Juglar définit le cycle majeur de l'histoire économique de son siècle, à périodicité de 6 à 11 ans, avec ses phases régulières d'essor, de crise, de dépression et de reprise, que tous les travaux contemporains retrouvent immanquablement. Sauf pour les Etats Unis, où le cycle de Kitchin, sur 3 ou 4 ans, est plus fréquent. Les grandes explications des crises dont données, même si les industriels, les banquiers et les hommes d'Etat du temps ne savent pas comprendre qu'on peut prévoir et peut être maîtriser les catastrophes :
il y a un an
D'ailleurs je conseillerais ce livre intéressant sur la révolution industrielle : 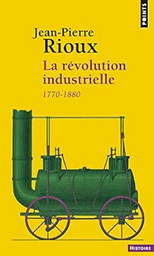
crise de surcapitalisation, lorsque le loyer de l'argent devient trop cher pour les entreprises mal outillées qui n'ont pas su assimiler les nouveautés technologiques. Crise de surproduction de Sismondi, liées à des erreurs de prévision des chefs d'entreprise, qui préjugent des capacités de consommation d'un pays en refusant de débloquer les salaires pour maintenir leurs marges bénéficiaires. Crise conjuguée de sous consommation et de surproduction, décrite par Marx aux livres I et III du Capital, reflet des contradictions d'un système condamné à la croissance pour éviter la baisse tendancielle des taux de profit et tout en pratiquant la loi d'airan des salaires qui préserver la plus value. Les économistes du XXème siècle peuvent affiner l'analyser, scruter les disparités des cycles et des secteurs de production, dégager des processus cumulatifs élargissent la moindre crise : l'essentiel a été dit dès le XIXème siècle. Par l'intrusion d'une économie de type nouveau qui rassemble en quelques mains les moyens de production tout en accentuant, par la division du travail et la concentr
La révolution industrielle.
Villes, usines, ouvriers.
Naissance des mondes ouvriers.
De l'atelier à l'usine, du travailleur au prolétaire, le cheminement est il le même? Les hommes étant plus lents que le capitaux et les techniques, ils mettent du temps pour prendre compte de leur nouvelle condition. Une ou deux générations pour faire la transition. Tous les facteurs de production sont employés à pleine capacité pour amorcer la croissance. L'investissement nécessaire ne peut se faire le plus souvent qu'au détriment de la consommation. Pour assurer l'avenir de l'industrialisation, le capitalisme ne peut pas jouer sur les 2 termes et donc il privilégie l'investissement. Seuls une longue journée de travail et de bas salaires jetés à une main d'oeuvre abondante et inorganisée avec un marché du travail solidement tenu de manière à n'offrir l'emploi qu'à ceux qui acceptent les nouvelles règles de la production, peuvent favoriser l'investissement. La misère ouvrière n 'est doc pas le fruit d'un relâchement coupable des employeurs ou du mépris de la condition humaine. C'est une forme de loi naturelle du capitalisme en expansion. Des économistes anglais du XIXème siècle ont établi le lien en la production, le profit et le salaire limité au niveau minimal de subsistance nécessaire. Au terme de l'adaptation, le travailleur vendant sa force de travail ne vit qu'à condition de trouver un emploi et ne l'obtient que si son travail entre dans le nouveau système, encaissera du mieux être à son tour. C'est en vertu de ces lois économiques qu'il faut décrire ce monde ouvrier. Division du travail, productivité et accroissement du capital sont organiquement liés.
Artisans du bâtiment, mobiles, organisés, souvent mieux payés, vindicatifs, ouvriers du livre, plus instruits, qui donneront avec les ouvriers plus indépendants des métiers d'art, ferronniers, bronziers, les premiers militants du mouvement ouvrier, canuts lyonnais, fiers d'une indépendance familiale en voie de disparition, monde des compagnons des métiers, instruit par de puissantes associations de soutien aristocratie ouvrière et artisanale issue de l'âge pré industriel. Cette élite ouvrière organisée joue longtemps un rôle d'éducation et d'encadrement des autres travailleurs. Passé 1840, elle est mal adaptée à la concurrence de l'usine, ne se perpétue longtemps que dans les pays plus lents à s'épanouir une industrie moderne.Il vient en de fortes proportions des campagnes voisines. En Grande Bretagne depuis le XVIIème siècle la loi faisait obligation aux paroisse de parquer dans les workhouses pénitentiaires et moralisantes les pauvres sans travail rejetés du monde rural. La loi de 1795 qui établit la liberté de déplacement pour ces indigents, en retirant à leurs paroisses d'origine, le plus souvent rurales, l'obligation de les récupérer et de les héberger, les livre au libre jeu du marché et les précipitera vers les centres manufacturiers qui cherchent une main d'oeuvre. Même évolution en Allemagne, en Europe centrale où les codes d'assistance sont assouplis au début du XIXème siècle. La France ralentit le processus avec la création d'une classe de paysans moyens nombreux issus du partage inégal de la terre des privilégiés sous la Révolution.
L'ouvrier est interchangeable, sur une machine interchangeable, des opérations simples à apprendre pour la plupart. Pas de techniques ancestrales. le tout fait à un rythme contrôle mais ne demandant pas en dehors de la répétition du geste, une force physique considérable. Surtout dans l'industrie textile. Le réglage des machines est juste fait par quelques spécialistes qui dominent les maneuvre à la fin du XIXème siècle. L'ouvrier sur machine peut souvent d'un jour à l'autre devenir manutentionnaire, magasinier, emballeur, essayer, finisseur. Les spécialisations sont introduites tardivement; Une atmosphère de désordre, un atelier très chaud en été mais glacial en hiver, l'huile des machines maculant les vêtements, peu d'aération, rarement un vestiaire, une cantine et des commodités, la cadence, la surveillance des contremaîtres rendant le travail plus pénible. L'accident est toujours possible au milieu des volants, roues et courroies de transmission. Les enquêtes parlementaires anglaises de 1822 révèlent ces foules d'estropiés, le plus souvent ayant perdu un bras, renvoyés sans assurance d'aucune sorte, et errant dans le comte de Derby. A Manchester, note Engels, on a l'impression de vivre " au milieu d'une armée qui revient de campagne ". Dans les mines, les descentes par échelles ou par chaînes au fond du puits, avant que les compagnies ne consentent à tolérer l'usage des bennes à charbon par leurs mineurs, les éboulements dans des galeries mal étayées, l'inondation, le grisou mal détecté, l'incendie, multiplient les risques pour les haveurs. La mécanisation intervient lentement car les prix de vente restent stables : les employeurs préfèrent accélérer la rotation des équipes, payer " à la berline " remplie, imposer des cadences plus fortes.
.
La journée de travail est étirée. Elle s'allonge jusqu'en 185à avec l'éclairage du gaz permettant de faire tourner certaines fabriques nuit et jour. En moyenne jusqu'en 1860 environ elle oscille dans toutes les branches de l'activité industrielle, de 12 à 15 heures. Comparé au vieux domestic system ce n'est pas une nouveauté : jusqu'à la fin du second Empire, un canut lyonnais doit rester 16 heures par jour devant son métier pour survivre. La régularité est cependant la nouveauté majeure de l'usine, entre la vigilance des gardiens, les pauses, les horaires de repas rognés, les trucages sur les sonneries des cloches et horloges au début du XIXème siècle, paiement à la pièce usinée substituée au tarif horaire, le travail continue, sans congés ou jours fériés, où le repos dominical n'est même pas toujours respecté, où l'absentéisme est une soupape de sûreté. La fatigue, la nourriture médiocre, la maladie, font baisser le rendement par ouvrier. Pour augmenter la production, il faut allonger encore le travail et employer de nouveaux travailleurs. Aux premiers temps de la révolution industrielle, alors que certains hommes se détournent de ce travail humiliant, la solution trouvée a été l'utilisation de femmes et d'enfants. Il s'agissait de briser par la concurrence les résistances éventuelles des travailleurs hommes et abaisser les salaires, de livrer des familles entières au travail industriel et ainsi accélérer la rupture avec le monde et les activités rurales. Enfin, utiliser la machine à pleine rendement en appropriant une immense source de travail neuve. Les femmes font un travail d'homme dans le tissage, la filature, les verreries, les ateliers mécaniques et les mines. Les enfants sont souvent employés dans des travaux où leurs souplesses et leurs plus petites tailles sont un avantage, dans les maines ou encore, rattacher les fils brisés derrière les métiers, nettoyer les parties peu accessibles des machines.
crise de surcapitalisation, lorsque le loyer de l'argent devient trop cher pour les entreprises mal outillées qui n'ont pas su assimiler les nouveautés technologiques. Crise de surproduction de Sismondi, liées à des erreurs de prévision des chefs d'entreprise, qui préjugent des capacités de consommation d'un pays en refusant de débloquer les salaires pour maintenir leurs marges bénéficiaires. Crise conjuguée de sous consommation et de surproduction, décrite par Marx aux livres I et III du Capital, reflet des contradictions d'un système condamné à la croissance pour éviter la baisse tendancielle des taux de profit et tout en pratiquant la loi d'airan des salaires qui préserver la plus value. Les économistes du XXème siècle peuvent affiner l'analyser, scruter les disparités des cycles et des secteurs de production, dégager des processus cumulatifs élargissent la moindre crise : l'essentiel a été dit dès le XIXème siècle. Par l'intrusion d'une économie de type nouveau qui rassemble en quelques mains les moyens de production tout en accentuant, par la division du travail et la concentr
La révolution industrielle.
Villes, usines, ouvriers.
Naissance des mondes ouvriers.
De l'atelier à l'usine, du travailleur au prolétaire, le cheminement est il le même? Les hommes étant plus lents que le capitaux et les techniques, ils mettent du temps pour prendre compte de leur nouvelle condition. Une ou deux générations pour faire la transition. Tous les facteurs de production sont employés à pleine capacité pour amorcer la croissance. L'investissement nécessaire ne peut se faire le plus souvent qu'au détriment de la consommation. Pour assurer l'avenir de l'industrialisation, le capitalisme ne peut pas jouer sur les 2 termes et donc il privilégie l'investissement. Seuls une longue journée de travail et de bas salaires jetés à une main d'oeuvre abondante et inorganisée avec un marché du travail solidement tenu de manière à n'offrir l'emploi qu'à ceux qui acceptent les nouvelles règles de la production, peuvent favoriser l'investissement. La misère ouvrière n 'est doc pas le fruit d'un relâchement coupable des employeurs ou du mépris de la condition humaine. C'est une forme de loi naturelle du capitalisme en expansion. Des économistes anglais du XIXème siècle ont établi le lien en la production, le profit et le salaire limité au niveau minimal de subsistance nécessaire. Au terme de l'adaptation, le travailleur vendant sa force de travail ne vit qu'à condition de trouver un emploi et ne l'obtient que si son travail entre dans le nouveau système, encaissera du mieux être à son tour. C'est en vertu de ces lois économiques qu'il faut décrire ce monde ouvrier. Division du travail, productivité et accroissement du capital sont organiquement liés.
Artisans du bâtiment, mobiles, organisés, souvent mieux payés, vindicatifs, ouvriers du livre, plus instruits, qui donneront avec les ouvriers plus indépendants des métiers d'art, ferronniers, bronziers, les premiers militants du mouvement ouvrier, canuts lyonnais, fiers d'une indépendance familiale en voie de disparition, monde des compagnons des métiers, instruit par de puissantes associations de soutien aristocratie ouvrière et artisanale issue de l'âge pré industriel. Cette élite ouvrière organisée joue longtemps un rôle d'éducation et d'encadrement des autres travailleurs. Passé 1840, elle est mal adaptée à la concurrence de l'usine, ne se perpétue longtemps que dans les pays plus lents à s'épanouir une industrie moderne.Il vient en de fortes proportions des campagnes voisines. En Grande Bretagne depuis le XVIIème siècle la loi faisait obligation aux paroisse de parquer dans les workhouses pénitentiaires et moralisantes les pauvres sans travail rejetés du monde rural. La loi de 1795 qui établit la liberté de déplacement pour ces indigents, en retirant à leurs paroisses d'origine, le plus souvent rurales, l'obligation de les récupérer et de les héberger, les livre au libre jeu du marché et les précipitera vers les centres manufacturiers qui cherchent une main d'oeuvre. Même évolution en Allemagne, en Europe centrale où les codes d'assistance sont assouplis au début du XIXème siècle. La France ralentit le processus avec la création d'une classe de paysans moyens nombreux issus du partage inégal de la terre des privilégiés sous la Révolution.
L'ouvrier est interchangeable, sur une machine interchangeable, des opérations simples à apprendre pour la plupart. Pas de techniques ancestrales. le tout fait à un rythme contrôle mais ne demandant pas en dehors de la répétition du geste, une force physique considérable. Surtout dans l'industrie textile. Le réglage des machines est juste fait par quelques spécialistes qui dominent les maneuvre à la fin du XIXème siècle. L'ouvrier sur machine peut souvent d'un jour à l'autre devenir manutentionnaire, magasinier, emballeur, essayer, finisseur. Les spécialisations sont introduites tardivement; Une atmosphère de désordre, un atelier très chaud en été mais glacial en hiver, l'huile des machines maculant les vêtements, peu d'aération, rarement un vestiaire, une cantine et des commodités, la cadence, la surveillance des contremaîtres rendant le travail plus pénible. L'accident est toujours possible au milieu des volants, roues et courroies de transmission. Les enquêtes parlementaires anglaises de 1822 révèlent ces foules d'estropiés, le plus souvent ayant perdu un bras, renvoyés sans assurance d'aucune sorte, et errant dans le comte de Derby. A Manchester, note Engels, on a l'impression de vivre " au milieu d'une armée qui revient de campagne ". Dans les mines, les descentes par échelles ou par chaînes au fond du puits, avant que les compagnies ne consentent à tolérer l'usage des bennes à charbon par leurs mineurs, les éboulements dans des galeries mal étayées, l'inondation, le grisou mal détecté, l'incendie, multiplient les risques pour les haveurs. La mécanisation intervient lentement car les prix de vente restent stables : les employeurs préfèrent accélérer la rotation des équipes, payer " à la berline " remplie, imposer des cadences plus fortes.
.
La journée de travail est étirée. Elle s'allonge jusqu'en 185à avec l'éclairage du gaz permettant de faire tourner certaines fabriques nuit et jour. En moyenne jusqu'en 1860 environ elle oscille dans toutes les branches de l'activité industrielle, de 12 à 15 heures. Comparé au vieux domestic system ce n'est pas une nouveauté : jusqu'à la fin du second Empire, un canut lyonnais doit rester 16 heures par jour devant son métier pour survivre. La régularité est cependant la nouveauté majeure de l'usine, entre la vigilance des gardiens, les pauses, les horaires de repas rognés, les trucages sur les sonneries des cloches et horloges au début du XIXème siècle, paiement à la pièce usinée substituée au tarif horaire, le travail continue, sans congés ou jours fériés, où le repos dominical n'est même pas toujours respecté, où l'absentéisme est une soupape de sûreté. La fatigue, la nourriture médiocre, la maladie, font baisser le rendement par ouvrier. Pour augmenter la production, il faut allonger encore le travail et employer de nouveaux travailleurs. Aux premiers temps de la révolution industrielle, alors que certains hommes se détournent de ce travail humiliant, la solution trouvée a été l'utilisation de femmes et d'enfants. Il s'agissait de briser par la concurrence les résistances éventuelles des travailleurs hommes et abaisser les salaires, de livrer des familles entières au travail industriel et ainsi accélérer la rupture avec le monde et les activités rurales. Enfin, utiliser la machine à pleine rendement en appropriant une immense source de travail neuve. Les femmes font un travail d'homme dans le tissage, la filature, les verreries, les ateliers mécaniques et les mines. Les enfants sont souvent employés dans des travaux où leurs souplesses et leurs plus petites tailles sont un avantage, dans les maines ou encore, rattacher les fils brisés derrière les métiers, nettoyer les parties peu accessibles des machines.
il y a un an

