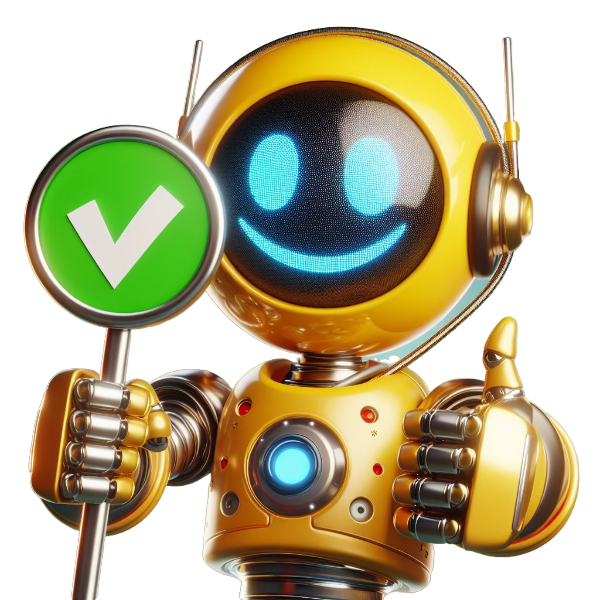Ce sujet a été résolu
Ils avaient pas le choix oui, c'était ça ou mourir

Ne te fais pas plus bête que tu ne l’es khey. La révolution industrielle c’est pas exemple la production véhicule en série
Une fois que le paysan a compris l’intérêt qu’il tire d’un tracteur, évidement qu’il va adhérer

Une fois que le paysan a compris l’intérêt qu’il tire d’un tracteur, évidement qu’il va adhérer
il y a un an
il y a le bon et le mauvais capitalisme

Tout à fait !
Et quand je parle de bien faire les choses il est question de se servir du capitalisme/industrie pour anéantir complètement les, les et les au XIXème siècle et première moitié du XXème quand on pouvait encore le faire
Et quand je parle de bien faire les choses il est question de se servir du capitalisme/industrie pour anéantir complètement les, les et les au XIXème siècle et première moitié du XXème quand on pouvait encore le faire
Europe. Jeunesse. Révolution. Europa. Ghjuventù. Rivuluzione. 🇫🇷 🇺🇦
il y a un an
Pour moi c'était bien, ça a amené des récoltes en nourriture bien plus massives à ce qu'on avait avant
Le problème c'était les conditions de vie terribles des mineurs de fond et les autres métiers de prolos, mais grand respect pour eux ils ont façonné notre futur
 plus personne ne meurt de faim aujourd'hui (dans notre pays)
plus personne ne meurt de faim aujourd'hui (dans notre pays)
Le problème c'était les conditions de vie terribles des mineurs de fond et les autres métiers de prolos, mais grand respect pour eux ils ont façonné notre futur
il y a un an
des énormes menteurs ceux qui mettent "non", vous survivez pas un mois au moyen âge bande de tocards
il y a un an
Quand on aura des robots qui bossent à notre place et qu'on ait plus que du temps libre pour exprimer notre créativité ou pour rien branler, là je pourrais dire que oui
Sinon bof bof
Ça a quand-même permis d'accélérer les découvertes technologiques
Sinon bof bof
Ça a quand-même permis d'accélérer les découvertes technologiques
il y a un an
t'es un gauchiste tu t'en veux de ton héritage de bourgeois alors qu'on s'en fout

il y a un an
Oui, le seul inconvénient de cette révolution est l'enrichissement des grandes familles de banquier type Rothschild

il y a un an
Dodge
1 an
Oui, le seul inconvénient de cette révolution est l'enrichissement des grandes familles de banquier type Rothschild

Ah bah on peut pas tout avoir dans ce monde

il y a un an
ça te pose tellement de questions ce statut que t'en fais des topics, j'ai jamais fait de topic l'élite des prolo

Je dis ça en toute amitié je t'aime bien le S
Je dis ça en toute amitié je t'aime bien le S
il y a un an
DarylDixon
1 an
Oui et non
 C'est nuancé
C'est nuancé

Oui quand même, au début c’était le top, à l’époque ça laissait un peu de répit au travailleur.
En plein camp d’entraînement à Chiang Maï

il y a un an
il y a un an
Le gap technologique est incroyable, mais du point de vue humain quand à sa qualité de vie c’est pas folichon

il y a un an
CHAPITRE : VILLES, USINES, OUVRIERS
Bien sûr, pour qu'il y ait croissances et profits il faut une reconstruction de la société dans son ensemble avec des bouleversements sociaux. D'abord on sait qu'il y a eu un essor urbain. Les agglomérations de plus de 5 000 habitants rassemblaient vers 1800 7% environ de la population mondiale. En 1850 c'était 13% et en 1900, 25%. Encore faut il cerner l'ampleur géographique de la vague. En effet, en Asie et Afrique, à l'exception du Japon et quelques ports lancés dans le commerce internationale, les autres ne sont pas concernés. En revanche, en Amérique et dans les pays neufs de l'hémisphère austral, on observe une poussée brutale de l'urbanisation dans toutes les zones reliées au capitalisme. En fait, c'est en Europe occidentale que la poussée fut la plus constante et qu'elle eut l'influence la plus impérative sur l'ensemble de la société par lente imprégnation de l'économie et des habitants. C'est que la croissance urbaine est liée désormais bien plus souvent à l'industrialisation. La mobilité de la main d'oeuvre est une nécessité pour l'industrie nouvelle qui divise le travail et passe du domestic system à l'agglomération de la manufacture et de l'usine, tout en disposant sur un espace restreint des sources de matières premières et de main d'oeuvres pour abaisser les coûts. Dans des zones, comme les pays Baltes ou la Russie, où les paysans libérés su servage restent cependant fixés sur les domaines, l'industrialisation et l'urbanisation piétinent. En revanche, dès qu'une nouveauté technique est introduite dans une ville anglaise par la révolution industrielle, la ville gonfle : Leeds au début du XVIIIème siècle, vieux centre lainier, était plus importante que Manchester. En 1775, elle n'a que 17 000 habitants alors que Manchester en compte 20 000 et progresse très vite car elle s'est spécialisée dans la filature mécanique du coton.
En France, jusqu'en 1840 environ, la croissance urbaine, Paris excepté, ne dépasse guère celle des campagnes, précisément parce que la révolution industrielle y revêt une forme originale, appuyée sur la main d'oeuvre rurale, où la production de certains produits textiles est privilégiée par rapport à la métallurgie et aux productions mécanisées. Face à elle, le Royaume Uni et l'Allemagne ont une urbanisation plus brutale. Mais si l'on pousse l'analyse, on s'aperçoit aussi que l'industrialisation favorise plus volontiers les grandes villes. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants en Europe, qui rassemblaient moins de 2% de la population, en comptent 15% en 1910. Et parmi elles, les très grandes grossissent encore plus vite. Siècle des villes, siècle des capitales surtout. Dans l'urbanisation comme ailleurs, la loi brutale du plus fort s'impose. La population de Londres double en 30 ans, presque un français sur 10. Le gain, au cours du XIXème siècle, est de 300% pour Saint Petersbourg, 490% pour Vienne. Berlin, avec 872% bat tous les records : elle a ravi aux centres régionaux le premier rang pour la banque, le textile et la sidérurgie, l'enseignement. Nourri les grandes dynasties bourgeoises de la chimie, de l'électricité, de l'acier, les Simens et les Borsig. C'est que cette concentration du pouvoir et de la production est dans la logique du système industriel. Seule la grande ville est vraiment un carrefour moderne, c'est ferroviaire ou maritime : elle contrôle parti ou totalité d'un réseau, est ainsi placée à une position stratégique pour la conquête du marché des petites agglomérations et des campagnes. Les gros utilisateurs s'agglutinent désormais dans ces centres moteurs où les compagnies ferroviaires et les armateurs consentent à leurs produits des tarifs préférentiels.
Ainsi, le long de la ligne du PLM, la population des villes desservies par le chemin de fer double en 50 ans à partir du Second Empire. Dans les pays neufs comme les Etats Unis, la voie ferrée fait surgir des villes, tout comme en Russie. Tous les ports qui ont su à temps se reconvertir au trafit à la vapeur progressent au point de départ comme au point d'arrivée du trafic et Hong Kong, Singapour, Chang Hai, Buenos Aires répliquent à Londres, Rotterdam, Marseille ou New York. La liaison croissante de la technologie et de la recherche favorise en outre les villes universitaires hardies, et l'ampleur des moyens matériels nécessaires après 1860 pour la faire progresser sélectionne les plus puissantes. La grande ville enfin est la seule où les banquiers de type ancien ont pu s'adapter aux nécessités nouvelles du crédit et de l'investissement car ils disposaient de réserves suffisantes et de nombreux déposants. Or ils accordent leurs prêts de préférence aux industriels qu'ils contrôlent facilement. Par les capitaux, se tisse un réseau d'influence urbain qui stimule l'industrialisation générale de la ville et de sa région dominée. En France, l'exemple lyonnais est particulièrement frappant. J. Bouvier et A. Labasse : " Les capitaux et la Région ". A. Colin, 1955. L'industrie réveille et multiplie toutes les fonctions de services, publics ou privés qu'exerçait traditionnellement la ville. La concentration amorce un afflux de ruraux attirés par les salaires industriels et qui gagnent directement la grande agglomération, sans transiter, comme aujourd'hui, par les villes locales de relais. Ce gonflement de population ouvrière, par un effet multiplicateur, assure la croissance d'une population tertiaire de commerçants d'employés.
A l'origine de cette coalescence d'usines et d'ateliers, la grande ville s'impose donc tout au long du siècle de plus en plus comme le centre de distribution des biens, services et capitaux, vers la région qu'elle contrôle et où elle a bâtie une solide hiérarchie des villes petites et moyennes. Toutes les nouveautés affirmées par l'irruption de l'industrie profitent à la grande ville. Dans ces conditions, al vieille structure urbaine traditionnelle ne répond plus aux nécessités de l'économie et de sa gestion. la ville " de province " avec ses foires, ses fonctions religieuses, administratives ou militaires, son réseau d'influence sur les campagnes patiemment tissé par ses artisans négociants et notaires, parfois ses ateliers et ses petits métiers, doit se soumettre ou dépérir inexorablement. L'ensemble français est bien clair sur ce point. La ville paisible et équilibrée, celle des romans de Balzac, se maintient, avec ses richesses bien digérées jusque vers 1850, active, avec une vie de société originale. Dans les activités économiques comme dans le façonnement de la vie quotidienne et de son cadre, ni Paris ni les grandes métropoles ne font la loi. Tout change dans la seconde moitié du siècle. Ainsi, la concurrence de Roubaix est fatale aux centres lainiers du languedoc : Lodève, Bédarieux meurent lentement. Toutes les villes du Bassin parisien amorcent un déclin soutenu, broyées par la puissance de la capitale : Châlons sur Marne, Beauvais, Orléans et même les villes de Beauce et du Gâtinais, jadis tournées vers la Loire, sont pour longtemps dans l'orbite de Paris, qui distribue ses capitaux et ses produits et ramasse sa main d'oeuvre. L'irruption du chemin de fer, avec un réseau en étoile destiné à tout concentrer sur Paris, accélère le processus. Malheure à celle qui, comme Tours, refuse la voie ferrée : son déclin est plus brutal. Les autres s'épuisent.
Avec des natalités en baisse comme Clermont Ferrand, Rennes, Angers, mal reliées à Paris, sous industrialisées, stagnent. Il faut attendre la fin du siècle avec la création d'un réseau ferré secondaire décidé par la IIIème République, pour que s'éveillent bien des centres locaux. Quelques vieux réseaux urbains, comme celui du Bas Languedoc, au temps de la reconstruction du vignoble, avec leurs solides assises, profitent d'une crise pour se raffermir, en acceptant de servir de relais aux capitaux de Paris et des grandes régions industrielles. C'est ce que démontre R. Dugrand dans " Villes et Campagnes du Bas Languedoc ". Capitaliste par ses fonctions, la grande l'est également dans son paysage et sa vie. " Pieuvre ardente " pour le poète Verhaeren, elle est en mouvement. Sa population croît brutalement, par l'industrialisation, par l'appel de services, par la simple détresse des campagnes qui déversent les " provinciaux ", par l'arrivée enfin d'immigrants dans les pays neufs. Les accroissements naturels, qui peuvent être sensibles dans les quartiers pauvres à forte natalité, ne jouent qu'un rôle secondaire dans la croissance de la population, au moins jusqu'en 1860. A la fin du siècle, l'enracinement des habitants aidant, on assiste à une lente victoire des natalités urbaines sur celles des campagnes, avec d'importantes variations régionales et nationales. Grossie par ses nouveaux habitants, la ville s'étale : Londres, sans ceinture de fortifications, s'élance librement et se dilue en banlieues à ségrégation sociale marquée : tout l'est, ouvrier, tout l'ouest, aristocratique, bourgeois, résidentiel et aéré. Les remparts sont franchis : à Vienne, qui en 1857 y installe le Ring, à Anvers, à Cologne, à Bâle, à Milan. Les quartiers de la gare, presque toujours excentrées à l'origine, sont, avec les grands axes routiers, des pôles de développement où triomphe la médiocre esthétique des hôtels des voyageurs et des gargotes.
il y a un an
Au niveau des progrès techniques oui.
Sautant les faubourgs historiques serrés autour des vieilles portes, le jeunes banlieues partent à l'assaut des campagnes maraîchères, créant dans le désordre une vie et un paysage urbains totalement neufs. Parfois, dans des zones industrielles privilégiées, les banlieues de villes voisines se rejoignent, créant ces " conurbations " de la Ruhr, des Midlands, du nord de la France. Dans le même temps, les centres, dont la croissance démographique se ralentit, deviennent les zones privilégiées de la gestion, sur le modèle de la City londienienne, mais entassent leurs habitants dans des immeubles " de rapport " élevés, tandis que de grands travaux publics essaient d'y rendre la circulation plus aisée.
Pas d'esthétique, ou plutôt une longue et bien laide hésitation entre le style renaissance ou gothique pour les bâtiments publics, dont la Vienne de François Joseph donne l'exemple, et le style contourné des immeubles bourgeois. parfois symboles des temps nouveaux, la verre et l'acier sont mis à contribution, pour édifier des églises, des halls, des palais d'expositions, dont le Crystal Palaca de Londres est l'ancêtre. La vie urbaine pose très vite d'énormes problèmes. Une longue voie à entretenir ( Londres à 8 500 km de rues vers 1860 ), à éclairer au gaz, puis à l'électricité, des égoûts à creuser, des ordures à évacuer, un approvisionnement délicat à organiser en eau, en aliments, en énergie, en matières premières industrielles : le canal, l'usine à gaz, le hangar s'intègrent mal au paysage. L'étude reste à faire des origines, alors, de ce qu'on nomme aujourd'hui " nuisances ", " pollution ", et " environnement ". A. Corbin. Dans la cohue des fiacres, les omnibus à chevaux et les nouveaux tramways accroissent l'encombrement, dont Londres une fois encore, donne l'exemple, au point qu'on songera très tôt à y créer un chemin de fer souterrain. Mais cet urbanisme hésitant de la grandeur et de l'utilité disparaît dès qu'on aborde les quartiers populaires et les banlieues, avec leurs impasses, leurs chemins boueux, leurs rares becs de gaz, leurs entassements humains qui donnent une toile de fond peu flatteuse à la vie ouvrière. C'est que la grande ville, malgré sa modernité, reste le reflet de la société industrielle qui l'a créée. Les grands travaux du centre ont souvent chassé les habitants vers les périphériques avec un tri soigneux entre riches et pauvres, avec une curieuse ségrégation géographique qui donne l'ouest aux premiers et laisse les autres se concentrer à l'est. Dès 1830 à Manchester, les bourgeois délaissent leurs usines et les cottages de leurs ouvriers pour s'isoler dans des banlieues plus verdoyantes.
Vieux quartiers surchargés ou zones nouvelles, construites à la hâte à grand renfort de plâtre et de torchis, rassemblent les travailleurs, face à une ville dorée, en pierre de taille et belle avenues des nantis. " Slums " londoniens, " Petite Irlande " de Manchester, " courées " de Roubaix, faubourgs inquiétants de Dusselfordt, ces villes dans la ville ne communiquent plus avec les " beaux quartiers ". Les antagonismes et les cloisonnements sociaux de la nouvelle société s'inscrivent définitivement dans l'espace urbain. Il faut aussi parler de Paris qui a fasciné le monde et dans laquelle toutes les nouveaux décrites jusqu'ici peuvent être entrevues. Sa croissance épouse le rythme de l'industrialisation. La vieille capitale de l'administration et de l'atelier, forte de 500 000 habitants vers 1800, grossit régulièrement jusqu'au milieu du siècle dans son cadre traditionnel surchargé : 714 000 en 1817, 868 000 en 1836, 1 million en 1846. Avec le second Empire et l'essor capitaliste, elle double en population et en superficie : 1 800 000 en 1872 pour la seule ville, 2 millions en 1879. Puis avec un accroissement naturel faible, une immigration mieux disciplinée, elle passe plus lentement à 2 500 000 en 1896 seulement, reflétant l'essoufflement industriel de la phase de dépression et la stagnation démographique du pays tout entier. Mais, avec des pulsions rythmées, elle a en un siècle absorbé à elle seule la quasi totalité de l'accroissement démographique français. Son rôle économique est complexe. Face aux grandes concentrations du Nord ou de l'Est, elle garde une physionomie industrielle longtemps traditionnelle. Certes, dès 1866, 2 parisiens actifs sur 3 sont salariés, 1 sur 2 vit du travail industriel. Mais les grosses entreprises restent peu nombreuses : pour environ 100 000 patrons en 1860, 7 500 seulement occupent plus de 10 ouvriers. C'est dire que le monde des métiers traditionnels, de l'artisanat, du travail à façon domine largement.
Et il faut attendre la fin du siècle pour que les grosses entreprises rassemblent plus d'un ouvrier sur trois. Mais les facteurs de domination sont déjà en place : liaisons routières, ferroviaires, fluviales avec les centres industriels actifs. Rôle bancaire décisif, rôle commercial accru avec la naissance sous le second Empire du grand magasin qui sait rapidement, pour la " Samaritaine " par exemple, étendre son influence en province, vendue par correspondance et contrôler des réseaux de distribution. Concentration presque totale de la recherche scientifique et de la formation des cadres de l'industrie et du commerce. Rôle politique, centre de diffusion de l'information moderne. Paris rassemble les énergies françaises, avant de les digérer à son profit. L'horizon du " désert français " se dessine sous la IIIème République, tandis que des régions passent sous le contrôle étroit des intérêts parisiens. J F. Gravier, " Paris et le Désert français ". Enfin, la ségrégation sociale s'accentue avec la croissance et le remodelage de la ville sous le Second Empire. Aux banlieues d'agrément de l'ouest, de Neuilly à Chatou, avec leurs hôtels et leurs villes pour l'été, s'opposent le flot des banlieues ouvrières du nord et du sud, avec leurs ateliers et leurs grosses usines mécaniques, les constructions hâtives qui englobent les vieilles cités, Clichy, Saint Denis, Aubervilliers, Montrouge, Boulogne, et bien d'autres.
De 1861 à 1881, Ivry passe de 7000 à 18 000 habitants, dont les 3 quarts ont moins de 40 ans, entassés dans les baraquements ou les immeubles du centre. L. Chevalier, " La formation de la population parisienne au XIXème siècle ". La ville de Paris s'agrandit en 1860 aux dimensions actuelle de ses 20 arrondissements, annexant les communes qui s'étendaient entre les " barrières " et les fortification élevées sous la monarchie de juillet. Sous l'impulsion du préfet Haussmann, entouré d'une nuée de spéculateurs et d’entrepreneurs, le vieux centre est rapidement transformé. Les buts de l'opération sont multiples : résorber le chômage des ouvriers du bâtiment, assainir Paris, faciliter la circulation et rendre impossibles les émeutes par des artères larges et rectilignes, en faire la Rome de l'âge industriel. 100 kilomètres de voies modernes sont tracées, 25 000 maisons détruites dans le centre, 70 000 bâties, un ensemble de bâtiments utilitaires ( les Halles, les gares ) ou prestigieux ( églises, Opéra ) édifiées avec une réussite parfois douteuse. La vie quotidienne est améliorée, avec l'eau, la lumière au gaz, l'égoût, les espaces verts, y compris, quoiqu'en aient dit les détracteurs du préfet, dans les quartiers populaires et même quelques banlieues. Ces bouleversements, bénéfiques, aèrent la cité, mais révèlent les nouveaux rapports sociaux de la société industrielle. Le centre, soigneusement quadrillé, évacue ses artisans, la foule des petits métiers, laissant la place aux fonctionnaires et aux commerçants, aux rentiers et aux bourgeois.
Les travailleurs sont rejetés sur les périphéries, car le vieux Paris central, avec les spéculations sur les terrains, les hausses sensibles des loyers, les démolitions, n'est plus dans leurs moyens. Des hauteurs de Montmartre et de Bellevile aux arrondissements nouveaux du sud, une ceinture ouvrière enserre la ville, interrompue seulement à l'ouest des Ternes à Auteuil. Un contemporain est frappé par " cette ville du luxe , entourée par la ville de la misère ", avec ses immeubles aux logements exigus, ses cités étroites, ses ateliers et ses usines jetés pêle mêle, ses estaminets, " ce sont toutes les déductions aux prises avec toutes les convoitises ". Le Paris des Champs Elysées, du faubourg Saint Germain, des Expositions universelles, à la gloire du machinisme, du bois de Boulogne où l'équitation délasse, scrute parfois avec quelque angoisse Belleville et Vaugirard. Et la Commune de 1971 sera, pour une large part, avec sa prise de l'Hôtel de Ville et des vieux quartiers des barricades par ses insurgés, " la reconquête de la Ville par la Ville ". Source : J. Rougerie, " Paris libre 1871 ", Le Seuil, 1971, Page 19. Bouleversée, grossie, hiérarchisée, la grande ville nait, directement ou indirectement, de la révolution industrielle et en maîtrise les développements futurs. Elle devient le centre attractif où la civilisation nouvelle s'élabore, face à la province routinière et rurale. Avec ses élégances, et ses tentations, ses distractions multiples et ses prestiges artistiques et intellectuels, ses fièvres et ses triomphes, elle est dans sa sphère une " ville lumière ". Mais après avoir transformé et souvent rejeté ceux qui ont permis par leur travail son épanouissement.
Sautant les faubourgs historiques serrés autour des vieilles portes, le jeunes banlieues partent à l'assaut des campagnes maraîchères, créant dans le désordre une vie et un paysage urbains totalement neufs. Parfois, dans des zones industrielles privilégiées, les banlieues de villes voisines se rejoignent, créant ces " conurbations " de la Ruhr, des Midlands, du nord de la France. Dans le même temps, les centres, dont la croissance démographique se ralentit, deviennent les zones privilégiées de la gestion, sur le modèle de la City londienienne, mais entassent leurs habitants dans des immeubles " de rapport " élevés, tandis que de grands travaux publics essaient d'y rendre la circulation plus aisée.
Pas d'esthétique, ou plutôt une longue et bien laide hésitation entre le style renaissance ou gothique pour les bâtiments publics, dont la Vienne de François Joseph donne l'exemple, et le style contourné des immeubles bourgeois. parfois symboles des temps nouveaux, la verre et l'acier sont mis à contribution, pour édifier des églises, des halls, des palais d'expositions, dont le Crystal Palaca de Londres est l'ancêtre. La vie urbaine pose très vite d'énormes problèmes. Une longue voie à entretenir ( Londres à 8 500 km de rues vers 1860 ), à éclairer au gaz, puis à l'électricité, des égoûts à creuser, des ordures à évacuer, un approvisionnement délicat à organiser en eau, en aliments, en énergie, en matières premières industrielles : le canal, l'usine à gaz, le hangar s'intègrent mal au paysage. L'étude reste à faire des origines, alors, de ce qu'on nomme aujourd'hui " nuisances ", " pollution ", et " environnement ". A. Corbin. Dans la cohue des fiacres, les omnibus à chevaux et les nouveaux tramways accroissent l'encombrement, dont Londres une fois encore, donne l'exemple, au point qu'on songera très tôt à y créer un chemin de fer souterrain. Mais cet urbanisme hésitant de la grandeur et de l'utilité disparaît dès qu'on aborde les quartiers populaires et les banlieues, avec leurs impasses, leurs chemins boueux, leurs rares becs de gaz, leurs entassements humains qui donnent une toile de fond peu flatteuse à la vie ouvrière. C'est que la grande ville, malgré sa modernité, reste le reflet de la société industrielle qui l'a créée. Les grands travaux du centre ont souvent chassé les habitants vers les périphériques avec un tri soigneux entre riches et pauvres, avec une curieuse ségrégation géographique qui donne l'ouest aux premiers et laisse les autres se concentrer à l'est. Dès 1830 à Manchester, les bourgeois délaissent leurs usines et les cottages de leurs ouvriers pour s'isoler dans des banlieues plus verdoyantes.
Vieux quartiers surchargés ou zones nouvelles, construites à la hâte à grand renfort de plâtre et de torchis, rassemblent les travailleurs, face à une ville dorée, en pierre de taille et belle avenues des nantis. " Slums " londoniens, " Petite Irlande " de Manchester, " courées " de Roubaix, faubourgs inquiétants de Dusselfordt, ces villes dans la ville ne communiquent plus avec les " beaux quartiers ". Les antagonismes et les cloisonnements sociaux de la nouvelle société s'inscrivent définitivement dans l'espace urbain. Il faut aussi parler de Paris qui a fasciné le monde et dans laquelle toutes les nouveaux décrites jusqu'ici peuvent être entrevues. Sa croissance épouse le rythme de l'industrialisation. La vieille capitale de l'administration et de l'atelier, forte de 500 000 habitants vers 1800, grossit régulièrement jusqu'au milieu du siècle dans son cadre traditionnel surchargé : 714 000 en 1817, 868 000 en 1836, 1 million en 1846. Avec le second Empire et l'essor capitaliste, elle double en population et en superficie : 1 800 000 en 1872 pour la seule ville, 2 millions en 1879. Puis avec un accroissement naturel faible, une immigration mieux disciplinée, elle passe plus lentement à 2 500 000 en 1896 seulement, reflétant l'essoufflement industriel de la phase de dépression et la stagnation démographique du pays tout entier. Mais, avec des pulsions rythmées, elle a en un siècle absorbé à elle seule la quasi totalité de l'accroissement démographique français. Son rôle économique est complexe. Face aux grandes concentrations du Nord ou de l'Est, elle garde une physionomie industrielle longtemps traditionnelle. Certes, dès 1866, 2 parisiens actifs sur 3 sont salariés, 1 sur 2 vit du travail industriel. Mais les grosses entreprises restent peu nombreuses : pour environ 100 000 patrons en 1860, 7 500 seulement occupent plus de 10 ouvriers. C'est dire que le monde des métiers traditionnels, de l'artisanat, du travail à façon domine largement.
Et il faut attendre la fin du siècle pour que les grosses entreprises rassemblent plus d'un ouvrier sur trois. Mais les facteurs de domination sont déjà en place : liaisons routières, ferroviaires, fluviales avec les centres industriels actifs. Rôle bancaire décisif, rôle commercial accru avec la naissance sous le second Empire du grand magasin qui sait rapidement, pour la " Samaritaine " par exemple, étendre son influence en province, vendue par correspondance et contrôler des réseaux de distribution. Concentration presque totale de la recherche scientifique et de la formation des cadres de l'industrie et du commerce. Rôle politique, centre de diffusion de l'information moderne. Paris rassemble les énergies françaises, avant de les digérer à son profit. L'horizon du " désert français " se dessine sous la IIIème République, tandis que des régions passent sous le contrôle étroit des intérêts parisiens. J F. Gravier, " Paris et le Désert français ". Enfin, la ségrégation sociale s'accentue avec la croissance et le remodelage de la ville sous le Second Empire. Aux banlieues d'agrément de l'ouest, de Neuilly à Chatou, avec leurs hôtels et leurs villes pour l'été, s'opposent le flot des banlieues ouvrières du nord et du sud, avec leurs ateliers et leurs grosses usines mécaniques, les constructions hâtives qui englobent les vieilles cités, Clichy, Saint Denis, Aubervilliers, Montrouge, Boulogne, et bien d'autres.
De 1861 à 1881, Ivry passe de 7000 à 18 000 habitants, dont les 3 quarts ont moins de 40 ans, entassés dans les baraquements ou les immeubles du centre. L. Chevalier, " La formation de la population parisienne au XIXème siècle ". La ville de Paris s'agrandit en 1860 aux dimensions actuelle de ses 20 arrondissements, annexant les communes qui s'étendaient entre les " barrières " et les fortification élevées sous la monarchie de juillet. Sous l'impulsion du préfet Haussmann, entouré d'une nuée de spéculateurs et d’entrepreneurs, le vieux centre est rapidement transformé. Les buts de l'opération sont multiples : résorber le chômage des ouvriers du bâtiment, assainir Paris, faciliter la circulation et rendre impossibles les émeutes par des artères larges et rectilignes, en faire la Rome de l'âge industriel. 100 kilomètres de voies modernes sont tracées, 25 000 maisons détruites dans le centre, 70 000 bâties, un ensemble de bâtiments utilitaires ( les Halles, les gares ) ou prestigieux ( églises, Opéra ) édifiées avec une réussite parfois douteuse. La vie quotidienne est améliorée, avec l'eau, la lumière au gaz, l'égoût, les espaces verts, y compris, quoiqu'en aient dit les détracteurs du préfet, dans les quartiers populaires et même quelques banlieues. Ces bouleversements, bénéfiques, aèrent la cité, mais révèlent les nouveaux rapports sociaux de la société industrielle. Le centre, soigneusement quadrillé, évacue ses artisans, la foule des petits métiers, laissant la place aux fonctionnaires et aux commerçants, aux rentiers et aux bourgeois.
Les travailleurs sont rejetés sur les périphéries, car le vieux Paris central, avec les spéculations sur les terrains, les hausses sensibles des loyers, les démolitions, n'est plus dans leurs moyens. Des hauteurs de Montmartre et de Bellevile aux arrondissements nouveaux du sud, une ceinture ouvrière enserre la ville, interrompue seulement à l'ouest des Ternes à Auteuil. Un contemporain est frappé par " cette ville du luxe , entourée par la ville de la misère ", avec ses immeubles aux logements exigus, ses cités étroites, ses ateliers et ses usines jetés pêle mêle, ses estaminets, " ce sont toutes les déductions aux prises avec toutes les convoitises ". Le Paris des Champs Elysées, du faubourg Saint Germain, des Expositions universelles, à la gloire du machinisme, du bois de Boulogne où l'équitation délasse, scrute parfois avec quelque angoisse Belleville et Vaugirard. Et la Commune de 1971 sera, pour une large part, avec sa prise de l'Hôtel de Ville et des vieux quartiers des barricades par ses insurgés, " la reconquête de la Ville par la Ville ". Source : J. Rougerie, " Paris libre 1871 ", Le Seuil, 1971, Page 19. Bouleversée, grossie, hiérarchisée, la grande ville nait, directement ou indirectement, de la révolution industrielle et en maîtrise les développements futurs. Elle devient le centre attractif où la civilisation nouvelle s'élabore, face à la province routinière et rurale. Avec ses élégances, et ses tentations, ses distractions multiples et ses prestiges artistiques et intellectuels, ses fièvres et ses triomphes, elle est dans sa sphère une " ville lumière ". Mais après avoir transformé et souvent rejeté ceux qui ont permis par leur travail son épanouissement.
il y a un an