Ce sujet a été résolu
Le fait d'être "soumis" au langage a comme conséquence pour le sujet de ne pas avoir à sa disposition - contrairement à l'animal - un comportement prédéterminé.
La perte qu'implique la "prise" dans le langage engendre une incertitude irréductible pour le sujet quant à son désir.
Il est condamné à le chercher sans plus jamais pouvoir le trouver absolument.
Lacan a qualifié de division du sujet cet effet du langage, divisant le sujet entre ce qu'il dit et le fait dire, entre énoncé et énonciation.
La division du sujet (ou "division subjective") chez Lacan
Lacan part de l'idée que le sujet n’est pas un être unifié et transparent à lui-même, mais fondamentalement divisé. Cette division vient de son entrée dans le langage, qui structure toute son expérience du monde.
C’est le fait que le sujet ne coïncide jamais complètement avec lui-même. Il est séparé :
- entre ce qu’il est dans l’inconscient (désirs, pulsions, rêves, fantasmes)
- et ce qu’il est dans le langage (ce qu’il peut dire de lui-même, ce qu’il montre socialement)
Il est aussi divisé entre :
- ce qu’il désire
- et ce qu’il doit dire pour être reconnu par les autres.
Lacan dit : « Le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. »
Cela veut dire que le sujet n'apparaît que dans le langage, jamais comme une unité stable, mais comme un manque, une trace, un effet du langage lui-même.
La forclusion est un mécanisme psychotique : un signifiant fondamental n’entre jamais dans le Symbolique. Il est exclu du langage, du discours de l’Autre.
Cela produit des "trous" dans le symbolique, qui peuvent revenir dans le réel sous forme d’hallucinations ou de délires.
Le langage chez Lacan
Lacan s’appuie sur la linguistique de Saussure et sur la philosophie de Freud pour dire que le langage n’est pas un simple outil de communication. Il structure l’inconscient et fabrique le sujet.
Le langage précède le sujet
L’enfant entre dans le langage avant même de se connaître lui-même. Il apprend à parler avec les mots des autres, il est "parlé" avant de parler.
Ce que nous appelons "je", notre "moi", n’est pas à l’origine de nos paroles : il en est le produit.
Donc, pour Lacan, « l’inconscient est structuré comme un langage ».
Le signifiant et le signifié
Lacan reprend la distinction de Ferdinand de Saussure, mais il la transforme profondément.
Chez Saussure :
Signifiant : la forme sonore ou écrite du mot (ex. : "chien")
Signifié : le concept auquel on pense quand on entend ce mot (ex. : un animal à quatre pattes)
Saussure disait que le lien entre les deux est arbitraire, et que l’un va toujours avec l’autre.
Chez Lacan :
Le signifiant prend le premier rôle. Il domine le signifié.
Le sujet est pris dans la chaîne des signifiants : les mots s’enchaînent, se renvoient les uns aux autres, sans jamais atteindre un sens stable ou final.
Le signifié est instable, il glisse sous l’effet des signifiants.
C’est ce que Lacan appelle le "glissement du signifié sous le signifiant".
Par exemple : si je dis "chien", l’image mentale dépend de mon histoire, de ma langue, de mon imaginaire. Le mot peut évoquer autre chose selon le contexte : fidélité, peur, enfance, etc. Le signifié n’est pas fixe, il est en mouvement, chargé de désir et d’inconscient.
il y a 8 mois
Le stade du miroir, c’est le moment où l’enfant, entre 6 et 18 mois, se reconnaît dans un miroir pour la première fois. Il perçoit une image totale et cohérente de lui-même, alors que son vécu corporel est encore morcelé.
Cela crée une méconnaissance structurante :
L’enfant croit se trouver dans cette image extérieure, alors qu’elle est autre, miroirique, aliénante.
Il y a une capture narcissique, une identification à une image de soi qui n’est pas soi.
Narcisse, dans ce sens, devient l’archétype de cette aliénation spéculaire :
Il prend son reflet pour lui-même et meurt de ne jamais pouvoir fusionner avec cette image.
Dans le mythe classique, Narcisse est un jeune homme d’une beauté exceptionnelle. Il rejette tous les amours, jusqu’à tomber amoureux de son propre reflet dans l’eau. Incapable de se détacher de cette image, il meurt, consumé par ce désir impossible. Ce mythe parle de l’amour de soi, mais aussi de l’illusion, de l’image, et de l’identité projetée.
Plotin développe une idée centrale :
Le monde sensible est un reflet, une image imparfaite du monde intelligible.
Dans les Ennéades (notamment I.6, II.4, V.8), Plotin explique que :
L’âme humaine est issue de l’Un et tend vers lui.
Mais lorsqu’elle se détourne de l’Un pour contempler le monde sensible (comme Narcisse regardant l’eau), elle se perd dans une image extérieure, mouvante, illusoire.
Cette contemplation de l’image extérieure produit une chute de l’âme vers la matière, vers l’illusion, la dispersion.
Ainsi, Narcisse incarne l’âme fascinée par le reflet du sensible, croyant y voir sa propre essence alors qu’elle ne regarde qu’une copie déformée de son être.
Plotin insiste sur un point essentiel :
L’âme qui s’identifie à son reflet (le corps, le sensible) s’égare.
Cela s’applique au mythe : Narcisse confond son image avec son essence. Pour Plotin :
Ce reflet n’est pas le vrai soi.
Il faut remonter de l’image à la source, c’est-à-dire se détourner du sensible pour retourner vers l’Intellect et l’Un.
Le désir de beauté, pour Plotin, n’est pas mauvais en soi. C’est un désir d’unité, de retour vers l’origine. Mais chez Narcisse, ce désir est mal orienté : il reste horizontal, tourné vers une image finie, au lieu d’être vertical, tourné vers l’absolu.
Plotin pense que notre identité véritable n’est pas dans notre individualité corporelle, mais dans notre participation à l’Un. Ce qu’on appelle "moi", au niveau empirique, est un masque (persona).
« Connais-toi toi-même » signifie, chez Plotin :
Connais-toi comme âme, et non comme image ou apparence.
Voilà encore un trait de la nouvelle économie psychique : il n'y a plus de division subjective, le sujet n'est plus divisé. C'est un sujet brut.
Parler de sujet divisé, c'est dire déjà qu'il s'interroge sur sa propre existence, qu'il introduit dans sa vie, dans sa façon de penser, une dialectique, une opposition, une réflexion, une façon de dire "Non ! ". Aujourd'hui, nous ne voyons plus guère l'expression de ce qui serait la division subjective.
"Du coup, ne pourrait on craindre qu'il n'y ait même plus de place pour un véritable sujet ?"
Il y a place pour un sujet, mais un sujet qui a perdu sa dimension spécifique. Ça n'est sûrement plus le sujetqui relève de cette ek-sistence, de cette extériorité interne, qui lui donnait un certain recul, un coup d'œil sur sa vie, sur le monde, sur ses relations, et des choix possibles. C'est devenu un sujet entier, compact, non divisé...
La disparition de ce lieu de la division subjective, de cette limite, cela nous ramène-t-il à un savoir purement instinctuel, à un être dont la conduite serait déterminée à l'avance ?
Cela serait l'idéal, cela constituerait, vous avez raison, une forme d'accomplissement, puisqu'il ne serait plus nécessaire de déterminer ou choisir ses actions : elles se trouveraient, comme chez l'animal, prédéterminées. Quel soulagement ! Il suffirait de se laisser porter !
Voilà quelque chose que l'ont pourrait aussi bien inscrire dans le champs du progrès. On n'a plus de ce côté là, du côté de la subjectivité, à s'en faire, puisque nous sommes en mesure de lever cette limite, même si, alors, un doute, bien sûr, s'insinue sur la réalité de notre monde. Comment savoir que l'ont est dans la réalité ?
Quand on se réveille le matin, comment sait-on que le rêve a cessé ?
C'est sans doute que l'ont reprend contact avec une forme de déception qui organise notre rapport à la réalité. Or si ce type de déception vient à faire défaut, si celle-ci n'est plus le support de la réalité qui est la notre, de sa validité, alors la question évidemment surgit : est-ce que l'ont est pas toujours dans le rêve, est-ce que l'ont est pas toujours dans le domaine où tout parait possible ?
Le regard narcissique est donc une fausse reconnaissance de soi :
On croit se voir, mais on se regarde à travers les yeux du monde, des autres, des images.
On s’attache à la surface au lieu de chercher la source.
Plotin propose l’inverse du destin de Narcisse :
Au lieu de se perdre dans l’image, il faut se retirer en soi-même.
Descendre dans l’âme, la purifier, et remonter vers l’Un.
C’est un chemin d’intériorité, d’ascèse et d’unification.
« Ne cherche pas à l’extérieur, rentre en toi-même : c’est au-dedans de l’homme qu’habite la vérité. »
il y a 8 mois
Mon obsession depuis ce matin, me voilà vidée

il y a 8 mois
N'est-ce pas ?

Raison de plus de lire Lacan (et Freud un peu) maintenant

Raison de plus de lire Lacan (et Freud un peu) maintenant
il y a 8 mois
Contrôle dans 2h jeune foutre

Comment j'ai pu être considéré comme bon en philo au lycée ?

il y a 8 mois
Oui je trouve aussi, mais c'est une base incontournable Freud j'ai l'impression

Et Lacan est toujours d'actualité sur la question traumatique avec le "niveau mental" (traduit de l'anglais) sur la capacité d'intégration

Et Lacan est toujours d'actualité sur la question traumatique avec le "niveau mental" (traduit de l'anglais) sur la capacité d'intégration
il y a 8 mois
Tu t'es remis de serial experiment lain ?

il y a 8 mois
HonoreDeBallsac
8 mois
Tu t'es remis de serial experiment lain ?

Oh non pas cet anime de l'enfer

il y a 8 mois
J'ai peurent des fillent

il y a 8 mois
HonoreDeBallsac
8 mois
Tu t'es remis de serial experiment lain ?

Comme le topic l'indique, c'est encore en cours
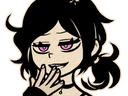
il y a 8 mois
il y a 8 mois












