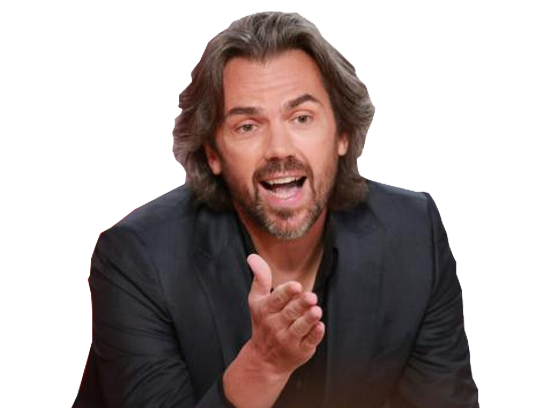Ce sujet a été résolu
Bonjour, mes chers kheyons.
Je viens aujourd'hui vous proposer quelques définitions de la Justice. Ceci n'est pas un travail universitaire, loin de là. Ce sont juste mes études personnelles et je les fais par plaisir.
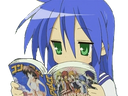
En droit, il y a souvent une confusion des différentes définitions, que les profs en droit n'ont jamais été capables de m'éclaircir quand j'étais à la fac. Je vous parle des définitions du droit par les romains.
Quelles sont-elles ?

 "La justice est l'art du bon et de l'équitable" (Celse) ;
"La justice est l'art du bon et de l'équitable" (Celse) ;
 "La justice est la volonté constante et perpétuelle de donner à chacun ce que lui revient" (Ulpien) ;
"La justice est la volonté constante et perpétuelle de donner à chacun ce que lui revient" (Ulpien) ;
 "Les préceptes de la justice sont : vivre honnêtement, ne pas blesser autrui, donner à chacun ce qui lui revient" (Celse).
"Les préceptes de la justice sont : vivre honnêtement, ne pas blesser autrui, donner à chacun ce qui lui revient" (Celse).
On a donc 3 définitions et on peut se dire : putain je n'y comprends rien, elles sont toutes les trois différentes mais désignent la même chose. En plus elles sont les 3 proposées par le même enculé (Ulpien les reprend toutes), il s'emmelait les pinceaux ce con. :ChatCochonouFDP:
A cela on peut ajouter la définition de jurisprudence, qui brouille encore plus les choses :
 "La jurisprudence est la connaissance des choses divines et humaines, et la science du juste et de l'injuste" (Ulpien).
"La jurisprudence est la connaissance des choses divines et humaines, et la science du juste et de l'injuste" (Ulpien).
Là ça n'a encore rien à voir avec les 3 antérieures putain.

Les juristes modernes considèrent qu'Ulpien confondait 3 sortes de justices : le fas (droit divin), le jus (droit), et la morale. On suppose ainsi qu'Ulpien avait une vision sous-évoluée de la justice, qu'on a corrigé au fil du temps.
Si vous ne me croyez pas, une citation venant d'un manuel de droit romain par des universitaires de Paris (donc faisant grande autorité) :
 "Il n'est guère permis d'ignorer ces formules devenues proverbiales ; mais leur principal mérite reste peut-être de nous rappeler au prix de quels tâtonnements les Romains eux-mêmes sont parvenus à la notion scientifique d'un droit indépendant de la religion et distinct de la morale. Nous nous contentons de les signaler sans leur attribuer une valeur qu'elles n'ont pas."
"Il n'est guère permis d'ignorer ces formules devenues proverbiales ; mais leur principal mérite reste peut-être de nous rappeler au prix de quels tâtonnements les Romains eux-mêmes sont parvenus à la notion scientifique d'un droit indépendant de la religion et distinct de la morale. Nous nous contentons de les signaler sans leur attribuer une valeur qu'elles n'ont pas."
On s'arrête là et on ne cherche pas plus loin.

Mais personnellement, je ne suis pas du même avis. Je pense qu'Ulpien ne confondait rien et que ses définitions se complètent parfaitement. Permettez-moi de vous exposer pourquoi je pense cela.
Partie 1/6
Je viens aujourd'hui vous proposer quelques définitions de la Justice. Ceci n'est pas un travail universitaire, loin de là. Ce sont juste mes études personnelles et je les fais par plaisir.
En droit, il y a souvent une confusion des différentes définitions, que les profs en droit n'ont jamais été capables de m'éclaircir quand j'étais à la fac. Je vous parle des définitions du droit par les romains.
Quelles sont-elles ?



On a donc 3 définitions et on peut se dire : putain je n'y comprends rien, elles sont toutes les trois différentes mais désignent la même chose. En plus elles sont les 3 proposées par le même enculé (Ulpien les reprend toutes), il s'emmelait les pinceaux ce con. :ChatCochonouFDP:
A cela on peut ajouter la définition de jurisprudence, qui brouille encore plus les choses :

Là ça n'a encore rien à voir avec les 3 antérieures putain.
Les juristes modernes considèrent qu'Ulpien confondait 3 sortes de justices : le fas (droit divin), le jus (droit), et la morale. On suppose ainsi qu'Ulpien avait une vision sous-évoluée de la justice, qu'on a corrigé au fil du temps.
Si vous ne me croyez pas, une citation venant d'un manuel de droit romain par des universitaires de Paris (donc faisant grande autorité) :

On s'arrête là et on ne cherche pas plus loin.
Mais personnellement, je ne suis pas du même avis. Je pense qu'Ulpien ne confondait rien et que ses définitions se complètent parfaitement. Permettez-moi de vous exposer pourquoi je pense cela.
Partie 1/6
Au plaisir ~

il y a 2 ans
1) La justice est la volonté constante et perpétuelle de donner à chacun ce qui lui revient
Commençons donc par le plus fort, la grosse définition de JUSTICE.

Mais avant tout, essayons de mieux la comprendre en revenant au texte latin :

On constate quelque chose d'un peu étonnant : la présence de "Justitia" et de "Jus" dans la même phrase. Dans la traduction, on ne voit "justice" qu'une fois. Mais quelle différence entre "Justitia" et "Jus" ?
Laissons ça de côté pour l'instant, on y reviendra plus tard.
Pour "constans et perpétua volontas" c'est assez clair, la traduction est pratiquement directe (constante et perpétuelle volonté). Ce qui pose plus problème c'est "jus suum cuique tribuendi".
Alors allons mot pour mot :




A partir de ces quatre mots, on peut reconstruire la phrase comme suit :

Comparez cette phrase avec la traduction habituelle :

Ce n'est pas faux, mais à mon avis c'est une traduction qui ne reflète pas tout à fait l'esprit de la phrase originelle.


Mais ce n'est pas ce que dit Ulpien. Il dit "jus suum cuique tribuendi"

C'est bien plus neutre. On sort de la notion de "RETOU" (introduite par les traducteurs), mais on a plutôt certaines choses qui nous "correspondent", et il faudrait "justement" attribuer ces choses à chacun. On pourrait donc injustement attribuer des choses à quelqu'un, même si ces choses lui correspondent. Je développerai ce point un peu plus tard.
Je veux ici souligner que c'est bel et bien la version "donner à chacun ce qui lui revient" qui prédomine aujourd'hui, c'est celle qu'on enseigne dans toutes les fac de droit et celle que vous verrez partout.
Personnellement je préfère largement ma version : "Justement attribuer à chacun ce qui lui correspond.
On a donc éclairci le sens de cette phrase. Mais une question demeure : quelle différence entre "Justitia" et "Jus" ?

Bien entendu, Ulpien ne parlait pas littéralement de la DEESSE, "la femme aux yeux bandés avec une balance", mais plutôt de la force divine de la Justice. Il y a un effet, dans nos sociétés, une force mystérieuse, une volonté constante et perpétuelle de justement attribuer à chacun ce qui lui correspond.
Alors comment peut-on INJUSTEMENT attribuer à quelqu'un ce qui LUI CORRESPOND ? Pourtant ça lui correspond, ça lui revient. Hé bien regardez ces exemples :




Si on lit les deux premiers exemples, il est facile de se dire : "ah oui, on a ce qui nous revient, c'est normal". Mais en lisant les deux suivants, on voit que c'est plus compliqué que ça. Le premier a fait le mal, il a tué : est-ce qu'il lui "revient" pour autant d'être tué à son tour ?

En outre, le deuxième a fait le bien et IL N'A PAS FAIT LE MAL : il a négligé son frère, mais il ne lui a pas fait de mal non plus. Est-ce qu'il lui "revient", pour autant, d'être traité avec bonté ou admiration ?
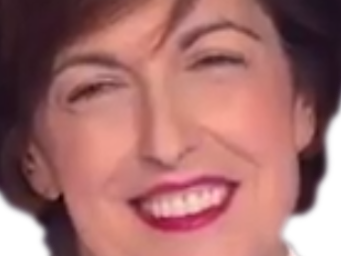
Là est l'importance de bien lire ce que dit Ulpien. On ne souhaite PAS DU TOUT "donner à chacun ce qui lui revient", mais plutôt attribuer JUSTEMENT à chacun ce qui lui correspond, ne pas se tromper dans le jugement : ne pas condamner à mort le tueur du pédophile alors que son acte est clairement bénéfique au monde entier, et ne pas célébrer le connard qui laisse crever son frère et qui se pavanne en allant aider des étrangers.
ça, c'est la Justice.

Attention : tuer reste mal, et une condamnation correspond au tueur du pédophile. Mais il faut justement attribuer cette condamnation. Même chose, en sens inverse, pour le type qui a fait le bien. On verra comment faire plus tard.
Afin de mieux comprendre cette définition de Justice, faisons une comparaison avec l'agriculture.
Quelle est la définition de l'agriculture ?

Quelle est la définition de la Justice ?

Partie 2/6
Au plaisir ~

il y a 2 ans
La justice c'est ce qui permet de maximiser le bien

C'est, autrement dit, ce qu'il convient de faire circonstanciellement, tandis que ce qui est bien est ce qu'il convient de faire dans l'absolu

Tuer dans l'absolu c'est mal, mais il peut être juste de mettre à mort si c'est pour empêcher un plus grand mal d'advenir par exemple

C'est, autrement dit, ce qu'il convient de faire circonstanciellement, tandis que ce qui est bien est ce qu'il convient de faire dans l'absolu
Tuer dans l'absolu c'est mal, mais il peut être juste de mettre à mort si c'est pour empêcher un plus grand mal d'advenir par exemple
Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres

il y a 2 ans
J'm'installe, faites pas attention.


On doit tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret.
il y a 2 ans
2) Les préceptes de la justice sont : vivre honnêtement, ne pas heurter autrui, donner à chacun ce qui lui revient
Reprenons encore la formule latine :

Ici ne vous inquiétez pas, "Juris" n'est qu'une conjugaison de "jus".
On retrouve la formule de "suum cuique tribuere", attribuer à chacun ce qui lui correspond. Il nous manque ici le "justement". Pourquoi ? Car cette citation vient d'un autre juriste nommé Celse, qui a écrit avant Ulpien. Le "justement" a été ajouté par Ulpien.
A mon avis, Celse voulait dire exactement la même chose, pour lui c'était implicite. Mais Ulpien a estimé qu'il fallait bien souligner le "JUS" : on doit JUSTEMENT attribuer, et il a eu tout à fait raison de faire cet ajout.
BREF : ici, on a les préceptes de la justice.



Pour mieux comprendre cette définition, reprenons la comparaison avec l'agriculture.
Quelles sont les "principes" de l'agriculture ? Hé bien on pourrait dire que la fertilité de la terre, la pluie, le soleil, le travail de l'homme et des animaux.
Quels sont les principes de la justice ? L'honnêteté, éviter de heurter autrui, justement attribuer à chacun ce qui lui correspond.
On voit donc que les définitions 1) et 2) ne correspondent pas à la même idée.
Définition 1 :


Définition 2 :


Partie 3/6
Au plaisir ~

il y a 2 ans
Flash
2 ans
J'm'installe, faites pas attention.


C'est bien lourd pour le coup, une analyse textuelle, mais bon ça va peut-être intéresser quelqu'un

Au plaisir ~

il y a 2 ans
3) La Justice est l'art du bon et de l'équitable

Ici, on répond à encore une autre question.


Le mot "art" renvoie à l'artisanat, à la fabrication, à "faire". Ici, Celse (repris par Ulpien) décrit ce que fait concrètement le juriste, ou de façon générale celui qui "fait" justice.
Différence entre équité et égalité.
Les romains disent bien "équité" et non pas "égalité". Quelle différence ?
Reprenons le célèbre épisode de Jésus et la prostituée. Souvenez-vous, cette pute doit être lapidée selon la loi.
Imaginons qu'au lieu de Jésus, on avait un gauchiste wok de science po à la place. On aurait eu le résultat suivant :

Heureusement on avait bien le Christ à l'oeuvre, et il n'a pas appliqué l'égalité, mais plutôt l'équité :

Il serait absurde d'appliquer la même punition égale à tout le monde, ou en règle générale, d'appliquer les mêmes lois à tout le monde exactement de la même façon. Par exemple, il est complètement absurde de mettre sur pied d'égalité une mère humaine et une "maman" moustique. Il faudrait être complètement con pour penser une chose pareille.
Mais l'équité, c'est autre chose. Dans le cas de la prostituée : elle bel et bien péché, mais vu qu'on a tous péché aussi, il est équitable de prendre ça en compte.
Jésus fait le bien (le bon) en condamnant un péché, mais il fait aussi l'équité : si on veut lapider quelqu'un, il est équitable que l'on soit libres de péché soi-même. A peu près même idée se retrouve dans la paille et la poutre : avant de juger quelqu'un, il est équitable que tu commences par toi-même.
Alors quelle différence entre égalité et équité ?


Mais comment arrive-t-on à être justes ? C'est là qu'intervient la Jurisprudence : la sagesse, la vision, le discernement de la Justice.
Partie 4/6
Au plaisir ~

il y a 2 ans
C'est bien lourd pour le coup, une analyse textuelle, mais bon ça va peut-être intéresser quelqu'un

Sait-on jamais, et puis parfois vaut mieux coucher quelque chose à l'écrit que de le garder dans un coin d'la tête.

T'façon j'ai envie d'lire cet aprèm'.
T'façon j'ai envie d'lire cet aprèm'.
On doit tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret.
il y a 2 ans
4) La jurisprudence est la connaissance des choses divines et humaines, et la science du juste et de l'injuste.
Et la citation latine :

Je me dois encore de critiquer la traduction habituelle.
Prenons "divinarum atque humanarum rerum notitia", mot à mot, comme avant





Les nuances sont importantes. D'abord, ce terme de "divin" porte à mon avis à confusion. Actuellement, on dit plutôt la "théologie", le "spirituel". C'est ce qu'Ulpien voulait dire.
Ensuite, "Rerum" peut se traduire par "choses", mais dans un sens plus large on peut le traduire par "réalités". Et perso je préfère ce terme plus large.
Finalement, "notitia" est très différent de "connaissance". Notitia veut dire NOTER, constater, remarquer, faire la liste de. En anglais, on dit "notice" pour dire "remarquer". Pour ma part, je pense qu'il est pertinent de traduire cela par "observer", ça correspond à l'esprit du texte.
Alors on passe de :

à :

On a là une définition beaucoup plus claire à mon avis, ce qui est normal puisqu'elle est plus proche du texte d'origine.
Le jurisprudent observe. Il est attentif, il remarque, il note. Il observe la RÉALITÉ : les réalités spirituelles d'une part (la théologie, la morale religieuse, les valeurs républicaines...) mais aussi les réalités humaines, ce que les hommes vivent dans le monde matériel.
C'est la première partie de la définition. Ensuite on a :
"Et la science du juste et de l'injuste". justi atque injusti scientia.
Là la traduction est simple, rien à ajouter.
Alors le résultat final :

En quoi consiste la jurisprudence ? D'abord on observe, on note les réalités à la fois spirituelles et humaines ; puis on y réfléchit et on en déduit le juste et l'injuste.
Ainsi Jésus a observé les réalités spirituelles (la loi indiquait de condamner la prostituée) mais également les réalités humaines (en pratique on pèche tous, on viole tous cette loi), il a réfléchi et il en a fait une connaissance du juste et de l'injuste.
Par quel processus, ou par quel algorithme (pour prendre une métaphore moderne) l'humain arrive à déduire le juste et l'injuste ? Reprenons un schéma classique de l'informatique :
Dans cette définition de la jurisprudence, on a l' Input (réalités spirituelles et humaines) et l'Output (science du juste et de l'injuste). Mais on n'a pas l'algorithme, le processus qui nous permet de "processer" l'input.
Hé bien cet algorithme se trouve implicitement énoncé. Quand on parle de "réalités spirituelles", on fait référence à la logique. Quand on parle des "réalités humaines", on fait référence à l'empirisme, à l'expérience.
Je n'irai pas plus loin. Cela nous mènerait vers des réflexions philosophiques, de l'épistémologie, même de la gnoséologie. Mais retenez l'idée essentielle : un bon juge doit avoir de la logique et de l'expérience.

Partie 5/6
Au plaisir ~

il y a 2 ans
Enfaite ça dépend des conceptions
Pour les jus naturalistes en gros la justice = la situation qui respecte le bien
Pour les positiviste en gros la justice = la situation dans laquelle le droit positif est correctement appliqué
Bien évidement je résume des millénaires de philosophie alors me cassez les couilles

Pour les jus naturalistes en gros la justice = la situation qui respecte le bien
Pour les positiviste en gros la justice = la situation dans laquelle le droit positif est correctement appliqué
Bien évidement je résume des millénaires de philosophie alors me cassez les couilles
il y a 2 ans
Conclusion
Alors on a quatre définitions pour quatre questions différentes.




Et pour la Justice :




Ainsi, on a largement dépassé la vision moderne qui balaye d'un revers de la main ces quatre définitions.
Il y a-t-il une confusion entre le Fas, le droit et la morale ? Je ne crois pas trop. Ulpien distingue bien entre les réalités "divines" et les réalités "humaines" ; il comprend très bien que ce sont des choses différentes, il indique juste qu'il faut les prendre en compte toutes les deux, si on veut faire de la Justice. Ca me rappelle ce célèbre tableau de Platon et d'Aristote à l'Académie.
Platon pointe vers le haut : les idées. Aristote étend sa main vers le bas : la matière. Un bon juge pointe vers le haut d'une main, et vers le bas de l'autre main.
Il se peut que les modernes ne pointent que vers le bas, et c'est exactement la direction que prend notre société en ce moment.
Au plaisir.
Partie 6/6, il en faut du temps pour retravailler tout ça, j'essaye

Au plaisir ~

il y a 2 ans
Dupont-MorISSOU
2 ans
Enfaite ça dépend des conceptions
Pour les jus naturalistes en gros la justice = la situation qui respecte le bien
Pour les positiviste en gros la justice = la situation dans laquelle le droit positif est correctement appliqué
Bien évidement je résume des millénaires de philosophie alors me cassez les couilles

Pour les jus naturalistes en gros la justice = la situation qui respecte le bien
Pour les positiviste en gros la justice = la situation dans laquelle le droit positif est correctement appliqué
Bien évidement je résume des millénaires de philosophie alors me cassez les couilles
Pour moi les deux ont tort, la justice consiste à justement attribuer à chacun ce qui lui correspond (comme je le détaille plus haut)

On peut respecter le bien et être injustes, et on peut appliquer le droit positif et être injustes aussi. L'exemple le plus classique c les nazis, qui ont exactement appliqué le droit positif, mais ça a vite posé problème aux positivistes

On peut respecter le bien et être injustes, et on peut appliquer le droit positif et être injustes aussi. L'exemple le plus classique c les nazis, qui ont exactement appliqué le droit positif, mais ça a vite posé problème aux positivistes
Au plaisir ~

il y a 2 ans
Pangolin
2 ans
La justice c'est ce qui permet de maximiser le bien

C'est, autrement dit, ce qu'il convient de faire circonstanciellement, tandis que ce qui est bien est ce qu'il convient de faire dans l'absolu

Tuer dans l'absolu c'est mal, mais il peut être juste de mettre à mort si c'est pour empêcher un plus grand mal d'advenir par exemple

C'est, autrement dit, ce qu'il convient de faire circonstanciellement, tandis que ce qui est bien est ce qu'il convient de faire dans l'absolu
Tuer dans l'absolu c'est mal, mais il peut être juste de mettre à mort si c'est pour empêcher un plus grand mal d'advenir par exemple
C'est une idée curieuse, je dirais pragmatique : le juste c'est de maximiser le bien. C'est une définition acceptable même si c pas celle que je préfère

Au plaisir ~

il y a 2 ans
Pour moi les deux ont tort, la justice consiste à justement attribuer à chacun ce qui lui correspond (comme je le détaille plus haut)

On peut respecter le bien et être injustes, et on peut appliquer le droit positif et être injustes aussi. L'exemple le plus classique c les nazis, qui ont exactement appliqué le droit positif, mais ça a vite posé problème aux positivistes

On peut respecter le bien et être injustes, et on peut appliquer le droit positif et être injustes aussi. L'exemple le plus classique c les nazis, qui ont exactement appliqué le droit positif, mais ça a vite posé problème aux positivistes
Alors ça dépend de ta conception du bien dcp
Si tu utilises la conception chrétienne le bien est nécessairement juste
Si tu utilises la conception grec on est d'accord
Perso j'aime pas trop cette approche matérialiste parce que dans la vrai vie ça marche pas
Enfoiré de marxiste va

Si tu utilises la conception chrétienne le bien est nécessairement juste
Si tu utilises la conception grec on est d'accord
Perso j'aime pas trop cette approche matérialiste parce que dans la vrai vie ça marche pas
Enfoiré de marxiste va
il y a 2 ans
Alors ça dépend de ta conception du bien dcp
Si tu utilises la conception chrétienne le bien est nécessairement juste
Si tu utilises la conception grec on est d'accord
Perso j'aime pas trop cette approche matérialiste parce que dans la vrai vie ça marche pas
Enfoiré de marxiste va

Si tu utilises la conception chrétienne le bien est nécessairement juste
Si tu utilises la conception grec on est d'accord
Perso j'aime pas trop cette approche matérialiste parce que dans la vrai vie ça marche pas
Enfoiré de marxiste va
il y a 2 ans
Et oui le Suum cuique tribuere vient d'Aristote, mais heureusement qu'Ulpien y ajoute le "Jus" (même si ça m'étonnerait qu'Aristote ait pu commettre une telle omission dans son esprit, mais soit)

Au plaisir ~

il y a 2 ans
C'est une idée curieuse, je dirais pragmatique : le juste c'est de maximiser le bien. C'est une définition acceptable même si c pas celle que je préfère

Elle vient de john rawls, même si sa théorie de la justice est foireuse sur de nombreux points + la trad fr a été financée par la CIA parce que c'est un bon cheval de troie

Le pragmatisme permet de de le différencier du bien sans l'en détacher essentiellement donc c'est bien je trouve

Le pragmatisme permet de de le différencier du bien sans l'en détacher essentiellement donc c'est bien je trouve
Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres

il y a 2 ans
Pour moi les deux ont tort, la justice consiste à justement attribuer à chacun ce qui lui correspond (comme je le détaille plus haut)

On peut respecter le bien et être injustes, et on peut appliquer le droit positif et être injustes aussi. L'exemple le plus classique c les nazis, qui ont exactement appliqué le droit positif, mais ça a vite posé problème aux positivistes

On peut respecter le bien et être injustes, et on peut appliquer le droit positif et être injustes aussi. L'exemple le plus classique c les nazis, qui ont exactement appliqué le droit positif, mais ça a vite posé problème aux positivistes
Donne des exemples de "respect du bien mais qui est injuste"

Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres

il y a 2 ans