Ce sujet a été résolu
je vais vous tout de meme raconter l'histoire de ce mec légendaire, Pancho Villa. Ce mec n'était pas juste un rebelle, un général ou un chef de gang, non, il était une légende vivante, un héros pour le peuple mexicain. Accrochez-vous, parce que ça va être épique !
Né en 1878 sous le blase de Doroteo Arango, notre Pancho grandit dans la dèche totale, au milieu des champs du Durango. À 15 balais, il bute l'ordure qui a agressé sa sœur et se tire dans les montagnes. Il devient bandit, vole les riches pour aider les pauvres, genre Robin des Bois version sombrero. C'est là qu'il prend son nom de guerre : Pancho Villa.
En 1910, c'est la révolution au Mexique. Pancho monte une armée avec des paysans et des anciens bandits et se lance dans la bagarre. Et il déchire, le bougre. Il gagne plein de batailles, dont celle de Zacatecas en 1914, une sacrée victoire pour la révolution. Il fait même copain-copain avec un autre révolutionnaire, Emiliano Zapata.
Mais ce qui fait de Pancho un vrai OG, c'est son attaque de la ville de Columbus, aux States, en 1916. Il était tellement vénère que le gouvernement américain ait reconnu le président Carranza, qu'il a dit "allez, on va leur montrer qui on est". C'était la première attaque sur le sol américain depuis la guerre de 1812, et ça a foutu un sacré bordel. Les ricains ont envoyé une expédition punitive pour lui mettre une raclée, mais Pancho, il a réussi à leur échapper. Il a même réussi à faire copain-copain avec le réalisateur américain D.W. Griffith qui a tourné un film sur lui !
Pancho, il était aussi un fin stratège : il avait une armée moderne, avec des armes à la pointe et même un train blindé ! Et en dehors de la guerre, notre Pancho, il savait vivre. Il adorait la bouffe, la tequila et les femmes. On raconte qu'il avait des tas de femmes et encore plus d'enfants.
Après la révolution, en 1920, il s'est retiré sur son ranch à Canutillo et a vécu tranquille jusqu'à son assassinat en 1923. Même mort, il reste une légende, un symbole de rébellion et de liberté.
Voilà les kheys, c'était l'histoire de Pancho Villa, un mec qui a écrit l'histoire à sa façon, un mec qui a refusé de se plier à l'oppression et qui a lutté pour la justice et la liberté. Un mec qui, malgré toutes les emmerdes, n'a jamais lâché l'affaire. Une putain de légende. Alors la prochaine fois que vous entendez parler de Pancho Villa, souvenez-vous qu'il était plus qu'un simple bandit : c'était un homme qui s'est battu pour son peuple et qui a marqué l'histoire.
Né en 1878 sous le blase de Doroteo Arango, notre Pancho grandit dans la dèche totale, au milieu des champs du Durango. À 15 balais, il bute l'ordure qui a agressé sa sœur et se tire dans les montagnes. Il devient bandit, vole les riches pour aider les pauvres, genre Robin des Bois version sombrero. C'est là qu'il prend son nom de guerre : Pancho Villa.
En 1910, c'est la révolution au Mexique. Pancho monte une armée avec des paysans et des anciens bandits et se lance dans la bagarre. Et il déchire, le bougre. Il gagne plein de batailles, dont celle de Zacatecas en 1914, une sacrée victoire pour la révolution. Il fait même copain-copain avec un autre révolutionnaire, Emiliano Zapata.
Mais ce qui fait de Pancho un vrai OG, c'est son attaque de la ville de Columbus, aux States, en 1916. Il était tellement vénère que le gouvernement américain ait reconnu le président Carranza, qu'il a dit "allez, on va leur montrer qui on est". C'était la première attaque sur le sol américain depuis la guerre de 1812, et ça a foutu un sacré bordel. Les ricains ont envoyé une expédition punitive pour lui mettre une raclée, mais Pancho, il a réussi à leur échapper. Il a même réussi à faire copain-copain avec le réalisateur américain D.W. Griffith qui a tourné un film sur lui !
Pancho, il était aussi un fin stratège : il avait une armée moderne, avec des armes à la pointe et même un train blindé ! Et en dehors de la guerre, notre Pancho, il savait vivre. Il adorait la bouffe, la tequila et les femmes. On raconte qu'il avait des tas de femmes et encore plus d'enfants.
Après la révolution, en 1920, il s'est retiré sur son ranch à Canutillo et a vécu tranquille jusqu'à son assassinat en 1923. Même mort, il reste une légende, un symbole de rébellion et de liberté.
Voilà les kheys, c'était l'histoire de Pancho Villa, un mec qui a écrit l'histoire à sa façon, un mec qui a refusé de se plier à l'oppression et qui a lutté pour la justice et la liberté. Un mec qui, malgré toutes les emmerdes, n'a jamais lâché l'affaire. Une putain de légende. Alors la prochaine fois que vous entendez parler de Pancho Villa, souvenez-vous qu'il était plus qu'un simple bandit : c'était un homme qui s'est battu pour son peuple et qui a marqué l'histoire.
il y a 3 ans
malheureusement non la en cherchant des images de sombrero je suis tombé sur Pancho Villa et j’avais lu sa biographie donc ça m’a motivé, même si il y aurait à dire sur Zapata aussi
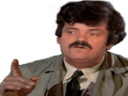
il y a 3 ans
Bon enfin en france !

Je vais vous parler de la porcelaine de Limoges. Vous savez, ce n'est pas juste de la vaisselle, c'est une véritable histoire, un art, un patrimoine français.

Tout a commencé en 1768, quand un gisement de kaolin, une argile blanche très pure, a été découvert à Saint-Yrieix-la-Perche, près de Limoges. Cette argile est l'ingrédient principal de la porcelaine dure, le nec plus ultra des porcelaines. Le roi Louis XVI a donc décidé de créer la Manufacture Royale de Limoges en 1771 pour exploiter cette ressource et produire de la porcelaine.

La porcelaine de Limoges est réputée pour sa grande résistance, sa finesse et sa translucidité. Sa blancheur immaculée permet de mettre en valeur les couleurs et les dorures qui la décorent. Elle est utilisée pour les services de table, les objets décoratifs, les bijoux...
La fabrication de la porcelaine est un processus long et complexe. D'abord, l'argile est mélangée à du feldspath et du quartz pour créer la pâte de porcelaine. Cette pâte est ensuite modelée à la main ou moulée pour donner sa forme à la pièce. Après une première cuisson à 900°C, la pièce est émaillée pour lui donner son aspect brillant et imperméable, puis elle est cuite une seconde fois à plus de 1400°C. Enfin, elle est décorée à la main, souvent avec des motifs en or ou en couleur, puis cuite une dernière fois pour fixer les décors.

Cette technique n'a pratiquement pas changé depuis le XVIIIe siècle. Il faut des années d'apprentissage pour devenir un bon porcelainier, et chaque pièce est unique, car elle porte la marque de l'artisan qui l'a créée. :
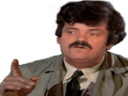
En 2017, la porcelaine de Limoges a reçu une Indication Géographique, ce qui signifie que seules les porcelaines fabriquées dans la région de Limoges peuvent porter ce nom. C'est une reconnaissance de la qualité de cet artisanat et une protection contre les contrefaçons.

Alors les gars, la prochaine fois que vous verrez une pièce en porcelaine de Limoges, vous saurez ce qu'il y a derrière : un savoir-faire, une histoire, une tradition. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos connaissances, et à nous dire ce que vous pensez de la porcelaine de Limoges. Vous en avez chez vous ?





Je vais vous parler de la porcelaine de Limoges. Vous savez, ce n'est pas juste de la vaisselle, c'est une véritable histoire, un art, un patrimoine français.
Tout a commencé en 1768, quand un gisement de kaolin, une argile blanche très pure, a été découvert à Saint-Yrieix-la-Perche, près de Limoges. Cette argile est l'ingrédient principal de la porcelaine dure, le nec plus ultra des porcelaines. Le roi Louis XVI a donc décidé de créer la Manufacture Royale de Limoges en 1771 pour exploiter cette ressource et produire de la porcelaine.

La porcelaine de Limoges est réputée pour sa grande résistance, sa finesse et sa translucidité. Sa blancheur immaculée permet de mettre en valeur les couleurs et les dorures qui la décorent. Elle est utilisée pour les services de table, les objets décoratifs, les bijoux...
La fabrication de la porcelaine est un processus long et complexe. D'abord, l'argile est mélangée à du feldspath et du quartz pour créer la pâte de porcelaine. Cette pâte est ensuite modelée à la main ou moulée pour donner sa forme à la pièce. Après une première cuisson à 900°C, la pièce est émaillée pour lui donner son aspect brillant et imperméable, puis elle est cuite une seconde fois à plus de 1400°C. Enfin, elle est décorée à la main, souvent avec des motifs en or ou en couleur, puis cuite une dernière fois pour fixer les décors.
Cette technique n'a pratiquement pas changé depuis le XVIIIe siècle. Il faut des années d'apprentissage pour devenir un bon porcelainier, et chaque pièce est unique, car elle porte la marque de l'artisan qui l'a créée. :
En 2017, la porcelaine de Limoges a reçu une Indication Géographique, ce qui signifie que seules les porcelaines fabriquées dans la région de Limoges peuvent porter ce nom. C'est une reconnaissance de la qualité de cet artisanat et une protection contre les contrefaçons.

Alors les gars, la prochaine fois que vous verrez une pièce en porcelaine de Limoges, vous saurez ce qu'il y a derrière : un savoir-faire, une histoire, une tradition. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos connaissances, et à nous dire ce que vous pensez de la porcelaine de Limoges. Vous en avez chez vous ?




il y a 3 ans
Excellent khey
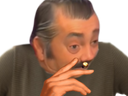 t'habites encore en Asie ou t'en as fini de tes pérégrinations ?
t'habites encore en Asie ou t'en as fini de tes pérégrinations ?

il y a 3 ans

Rockefeller2020
3 ans
Excellent khey
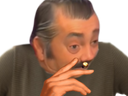 t'habites encore en Asie ou t'en as fini de tes pérégrinations ?
t'habites encore en Asie ou t'en as fini de tes pérégrinations ?

je suis en pologne la puis je vais vivre aux usa prochainement

il y a 3 ans

Rockefeller2020
3 ans
Dans quel état ? Toujours en tant quenseignant ?
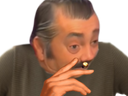
cracovie la et pour les usa je verrais. Non j’ai quitté la guyane l’année dernière maintenant je suis dans le commerce

il y a 3 ans
Salut les kheys,
Aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps et l'espace jusqu'en Asie centrale, pour parler d'un artisanat qui date de plusieurs siècles : la broderie Suzani de l'Ouzbékistan.
Alors, "Suzani", ça vient du mot persan "suzan" qui signifie "aiguille". Ça donne déjà une idée de l'artisanat en question, non ? En effet, la broderie Suzani est entièrement réalisée à la main. Imaginez un peu le travail, les heures de labeur, la précision de chaque point...
Historiquement, les Suzanis étaient brodés par les femmes dans le cadre d'un trousseau de mariage. C'était un véritable travail de groupe, où chaque femme d'une même famille s'affairait à broder une partie du tissu. Ça créait non seulement une œuvre d'art, mais aussi un lien entre les femmes de la famille.
Les motifs de ces broderies sont souvent géométriques et symboliques, représentant des étoiles, des fleurs, des fruits, des feuilles et parfois des oiseaux ou des poissons. Chaque motif a une signification : par exemple, la grenade symbolise la fertilité, les piments offrent une protection contre le mauvais œil, et les scorpions protègent contre les morsures.
Le processus de création d'un Suzani est assez complexe. Tout d'abord, le tissu de base est tendu sur un cadre. Ensuite, le dessin est esquissé à la main sur le tissu. Puis, l'artiste remplit le dessin avec du fil de soie ou de coton teint à la main, en utilisant différentes techniques de points pour donner de la texture et de la dimension à l'œuvre.
Les couleurs utilisées dans les Suzanis sont vives et audacieuses, souvent avec un contraste frappant pour donner à l'œuvre un aspect vivant et dynamique. Les teintures sont généralement naturelles, extraites de plantes, de fleurs, de baies et parfois même de coquillages et de minéraux.
Aujourd'hui, même si la tradition du trousseau a quasiment disparu, l'art de la broderie Suzani continue. Les Suzanis sont appréciés partout dans le monde pour leur beauté et leur qualité exceptionnelle. Ils sont utilisés pour décorer des coussins, des couvertures, des rideaux, des tentures murales et même des vêtements.
Voilà les kheys, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissiez les broderies Suzani ? Vous avez d'autres formes d'artisanat à partager ? Hâte de lire vos réponses et d'apprendre avec vous !

Aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps et l'espace jusqu'en Asie centrale, pour parler d'un artisanat qui date de plusieurs siècles : la broderie Suzani de l'Ouzbékistan.
Alors, "Suzani", ça vient du mot persan "suzan" qui signifie "aiguille". Ça donne déjà une idée de l'artisanat en question, non ? En effet, la broderie Suzani est entièrement réalisée à la main. Imaginez un peu le travail, les heures de labeur, la précision de chaque point...
Historiquement, les Suzanis étaient brodés par les femmes dans le cadre d'un trousseau de mariage. C'était un véritable travail de groupe, où chaque femme d'une même famille s'affairait à broder une partie du tissu. Ça créait non seulement une œuvre d'art, mais aussi un lien entre les femmes de la famille.
Les motifs de ces broderies sont souvent géométriques et symboliques, représentant des étoiles, des fleurs, des fruits, des feuilles et parfois des oiseaux ou des poissons. Chaque motif a une signification : par exemple, la grenade symbolise la fertilité, les piments offrent une protection contre le mauvais œil, et les scorpions protègent contre les morsures.
Le processus de création d'un Suzani est assez complexe. Tout d'abord, le tissu de base est tendu sur un cadre. Ensuite, le dessin est esquissé à la main sur le tissu. Puis, l'artiste remplit le dessin avec du fil de soie ou de coton teint à la main, en utilisant différentes techniques de points pour donner de la texture et de la dimension à l'œuvre.
Les couleurs utilisées dans les Suzanis sont vives et audacieuses, souvent avec un contraste frappant pour donner à l'œuvre un aspect vivant et dynamique. Les teintures sont généralement naturelles, extraites de plantes, de fleurs, de baies et parfois même de coquillages et de minéraux.
Aujourd'hui, même si la tradition du trousseau a quasiment disparu, l'art de la broderie Suzani continue. Les Suzanis sont appréciés partout dans le monde pour leur beauté et leur qualité exceptionnelle. Ils sont utilisés pour décorer des coussins, des couvertures, des rideaux, des tentures murales et même des vêtements.
Voilà les kheys, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissiez les broderies Suzani ? Vous avez d'autres formes d'artisanat à partager ? Hâte de lire vos réponses et d'apprendre avec vous !
il y a 3 ans
Je fav
il y a 3 ans
Je vais enfin vous parler d'un morceau d'histoire et de tradition qu'on peut littéralement porter aux pieds : les babouches ! Vous savez, ces fameux chaussons qui ont traversé les siècles sans prendre une ride et qu'on retrouve partout dans les contes de Mille et Une Nuits.
L'histoire de la babouche est intimement liée à celle du Maroc. Ces chaussures uniques étaient autrefois portées par les sultans et les rois, signe de noblesse et de pouvoir. D'ailleurs, saviez-vous que le mot "babouche" vient de l'arabe "babush" qui signifie "chaussure" ?
La babouche trouve ses origines dans la culture persane et elle a été introduite au Maroc vers le 12e siècle. C'est sous l'influence de la dynastie des Almoravides que les babouches ont commencé à se populariser au Maroc.
Au fil du temps, les babouches se sont imposées comme un accessoire incontournable de la mode marocaine, pour les hommes et pour les femmes. Historiquement, leur forme, leur couleur et leur design variaient en fonction de la région et du statut social de celui ou celle qui les portait. Par exemple, au 16ème siècle, seuls les souverains et les membres de la noblesse avaient le droit de porter des babouches jaunes, une couleur qui symbolisait la grandeur et la puissance. Les babouches des femmes, quant à elles, étaient souvent ornées de broderies et de perles pour indiquer leur statut de femmes mariées.
La babouche est aussi chargée de symbolisme dans la culture marocaine. Lorsqu'elles sont offertes en cadeau, elles sont généralement considérées comme un porte-bonheur. Par ailleurs, la babouche est un élément important lors des cérémonies de mariage au Maroc, où la mariée porte traditionnellement une paire de babouches blanches, symbole de pureté.
Aujourd'hui, malgré la modernisation et l'occidentalisation de la mode, la babouche reste un élément essentiel de l'identité culturelle marocaine. Elle est toujours aussi populaire et est portée aussi bien à la maison que lors de grandes occasions. Elle a même réussi à séduire les créateurs de mode internationaux, qui la réinventent en la mêlant à des styles plus contemporains.
La babouche est si ancrée dans la culture marocaine qu'elle est même présente dans certaines expressions. Par exemple, "tomber la babouche" signifie être surpris !
Les babouches sont traditionnellement fabriquées à partir de cuir de chèvre, de mouton ou de vache. Ce cuir est tanné selon une méthode ancestrale qui utilise du tanin végétal. Ensuite, il est teinté avec des couleurs naturelles, ce qui donne aux babouches ces teintes vibrantes et chatoyantes.
La fabrication des babouches est un véritable travail d'art. Chaque paire est fabriquée à la main par un artisan qualifié. Après avoir découpé le cuir, l'artisan assemble les pièces à l'aide de fil de coton. La semelle, aussi en cuir, est parfois doublée de caoutchouc pour plus de durabilité. Les motifs brodés qui ornent la babouche sont réalisés avec une précision remarquable, ce qui donne à chaque paire son caractère unique.
La babouche ne se contente pas d'être un simple accessoire de mode. Elle témoigne d'un patrimoine culturel et historique riche et précieux. Et si vous en portez, sachez que vous marchez littéralement sur des siècles de savoir-faire et de tradition !
Alors, qui parmi vous a déjà essayé les babouches ? Vous préférez les modèles traditionnels ou ceux plus contemporains ? Venez partager vos expériences et vos goûts, on en discute !

L'histoire de la babouche est intimement liée à celle du Maroc. Ces chaussures uniques étaient autrefois portées par les sultans et les rois, signe de noblesse et de pouvoir. D'ailleurs, saviez-vous que le mot "babouche" vient de l'arabe "babush" qui signifie "chaussure" ?
La babouche trouve ses origines dans la culture persane et elle a été introduite au Maroc vers le 12e siècle. C'est sous l'influence de la dynastie des Almoravides que les babouches ont commencé à se populariser au Maroc.
Au fil du temps, les babouches se sont imposées comme un accessoire incontournable de la mode marocaine, pour les hommes et pour les femmes. Historiquement, leur forme, leur couleur et leur design variaient en fonction de la région et du statut social de celui ou celle qui les portait. Par exemple, au 16ème siècle, seuls les souverains et les membres de la noblesse avaient le droit de porter des babouches jaunes, une couleur qui symbolisait la grandeur et la puissance. Les babouches des femmes, quant à elles, étaient souvent ornées de broderies et de perles pour indiquer leur statut de femmes mariées.
La babouche est aussi chargée de symbolisme dans la culture marocaine. Lorsqu'elles sont offertes en cadeau, elles sont généralement considérées comme un porte-bonheur. Par ailleurs, la babouche est un élément important lors des cérémonies de mariage au Maroc, où la mariée porte traditionnellement une paire de babouches blanches, symbole de pureté.
Aujourd'hui, malgré la modernisation et l'occidentalisation de la mode, la babouche reste un élément essentiel de l'identité culturelle marocaine. Elle est toujours aussi populaire et est portée aussi bien à la maison que lors de grandes occasions. Elle a même réussi à séduire les créateurs de mode internationaux, qui la réinventent en la mêlant à des styles plus contemporains.
La babouche est si ancrée dans la culture marocaine qu'elle est même présente dans certaines expressions. Par exemple, "tomber la babouche" signifie être surpris !
Les babouches sont traditionnellement fabriquées à partir de cuir de chèvre, de mouton ou de vache. Ce cuir est tanné selon une méthode ancestrale qui utilise du tanin végétal. Ensuite, il est teinté avec des couleurs naturelles, ce qui donne aux babouches ces teintes vibrantes et chatoyantes.
La fabrication des babouches est un véritable travail d'art. Chaque paire est fabriquée à la main par un artisan qualifié. Après avoir découpé le cuir, l'artisan assemble les pièces à l'aide de fil de coton. La semelle, aussi en cuir, est parfois doublée de caoutchouc pour plus de durabilité. Les motifs brodés qui ornent la babouche sont réalisés avec une précision remarquable, ce qui donne à chaque paire son caractère unique.
La babouche ne se contente pas d'être un simple accessoire de mode. Elle témoigne d'un patrimoine culturel et historique riche et précieux. Et si vous en portez, sachez que vous marchez littéralement sur des siècles de savoir-faire et de tradition !
Alors, qui parmi vous a déjà essayé les babouches ? Vous préférez les modèles traditionnels ou ceux plus contemporains ? Venez partager vos expériences et vos goûts, on en discute !
il y a 3 ans
Volutes
3 ans
Je désépingle pour le topic MàJ
Je ré-épinglerait (peut etre) après
Je ré-épinglerait (peut etre) après
je ne dis pas non pour une épingle pour un coup de boost
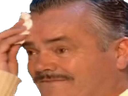
il y a 3 ans
Salut les kheys,
Je vous propose de vous embarquer pour un voyage à travers l'histoire et le patrimoine culturel de Hoi An, une ville magnifique située au Vietnam. Cet endroit est un trésor du patrimoine mondial de l'UNESCO et est particulièrement célèbre pour une spécialité artisanale : les lanternes traditionnelles.
La ville de Hoi An, anciennement appelée "Faifo", était un port de commerce majeur du XVème au XIXème siècle, attirant des commerçants du monde entier. Cette influence internationale est encore visible aujourd'hui, avec une architecture unique mélangeant des styles vietnamiens, chinois, japonais et français.
Cependant, ce qui distingue vraiment Hoi An, ce sont ses incroyables lanternes traditionnelles. Elles ont vu le jour au XVIème siècle, à une époque où les marchands japonais traversaient fréquemment la ville. Pour les remercier de leur visite, les habitants de Hoi An allumaient des lanternes, créant ainsi une atmosphère accueillante et chaleureuse.
Le processus de fabrication de ces lanternes est tout un art. Tout commence par le choix des matériaux. Les artisans utilisent du bambou pour la structure de la lanterne, et de la soie ou du papier pour le revêtement. Le bambou est d'abord coupé, plié et lié pour former la structure de la lanterne. Ensuite, la soie ou le papier est coupé selon le motif souhaité et fixé sur la structure en bambou. Enfin, la lanterne est peinte à la main, donnant ainsi naissance à une œuvre d'art unique en son genre.
Au-delà de leur rôle d'éclairage, ces lanternes sont un véritable symbole pour la population locale. Elles représentent le bonheur, la chance et la prospérité et sont censées illuminer le chemin dans l'obscurité, tout comme elles ont éclairé le chemin des marchands japonais il y a plusieurs siècles.
Chaque année, Hoi An organise un festival des lanternes où la ville s'illumine de mille feux. Des milliers de lanternes sont allumées et flottent sur la rivière, offrant un spectacle à couper le souffle.
C'est ça l'artisanat traditionnel, les kheys : c'est à la fois un savoir-faire, une histoire et un symbole. Et je suis ravi de partager cela avec vous. En attendant, n'hésitez pas à partager vos propres découvertes ou expériences de l'artisanat traditionnel.

Je vous propose de vous embarquer pour un voyage à travers l'histoire et le patrimoine culturel de Hoi An, une ville magnifique située au Vietnam. Cet endroit est un trésor du patrimoine mondial de l'UNESCO et est particulièrement célèbre pour une spécialité artisanale : les lanternes traditionnelles.
La ville de Hoi An, anciennement appelée "Faifo", était un port de commerce majeur du XVème au XIXème siècle, attirant des commerçants du monde entier. Cette influence internationale est encore visible aujourd'hui, avec une architecture unique mélangeant des styles vietnamiens, chinois, japonais et français.
Cependant, ce qui distingue vraiment Hoi An, ce sont ses incroyables lanternes traditionnelles. Elles ont vu le jour au XVIème siècle, à une époque où les marchands japonais traversaient fréquemment la ville. Pour les remercier de leur visite, les habitants de Hoi An allumaient des lanternes, créant ainsi une atmosphère accueillante et chaleureuse.
Le processus de fabrication de ces lanternes est tout un art. Tout commence par le choix des matériaux. Les artisans utilisent du bambou pour la structure de la lanterne, et de la soie ou du papier pour le revêtement. Le bambou est d'abord coupé, plié et lié pour former la structure de la lanterne. Ensuite, la soie ou le papier est coupé selon le motif souhaité et fixé sur la structure en bambou. Enfin, la lanterne est peinte à la main, donnant ainsi naissance à une œuvre d'art unique en son genre.
Au-delà de leur rôle d'éclairage, ces lanternes sont un véritable symbole pour la population locale. Elles représentent le bonheur, la chance et la prospérité et sont censées illuminer le chemin dans l'obscurité, tout comme elles ont éclairé le chemin des marchands japonais il y a plusieurs siècles.
Chaque année, Hoi An organise un festival des lanternes où la ville s'illumine de mille feux. Des milliers de lanternes sont allumées et flottent sur la rivière, offrant un spectacle à couper le souffle.
C'est ça l'artisanat traditionnel, les kheys : c'est à la fois un savoir-faire, une histoire et un symbole. Et je suis ravi de partager cela avec vous. En attendant, n'hésitez pas à partager vos propres découvertes ou expériences de l'artisanat traditionnel.
il y a 3 ans








