Ce sujet a été résolu
La gauche au pouvoir ont accepté les immigrés. Maintenant , cest le bordel.
Protège ton fric de la Dette: https://www.degiro.fr/par[...]079529&utm_source=mgm
il y a 3 mois
Sondage – 38 votes
Chong , finito
Chong , ils vont se relever .
Le nationalisme est en train d'exploser
Mon blog https://retsukoforum.neocities.org/ // youtube https://www.youtube.com/@retsukoforum
il y a 3 mois
Les japonais vont retomber dans l'impérialisme on va bien rigoler

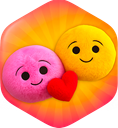

 Bientôt à l'AAH
Bientôt à l'AAH
 #EE50B9
#EE50B9
il y a 3 mois
il y a 3 mois
Chong2LaGalere
3 mois
La gauche au pouvoir ont accepté les immigrés. Maintenant , cest le bordel.
il y a 3 mois
Chong2LaGalere
3 mois
Bordel on a enfin la preuve que les aliens existent et personne en parle c'est quoi ce monde de merde
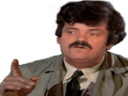
il y a 3 mois
Loin d'être finito.

JAPON RECESSION 1990
La majorité de la décennie 1990 s'est passé en récession pour le Japon. Avec des périodes de croissance économique courte et faibles. Pourtant, ce n'est pas comme si le Japon n'avait pas était en tête pour ce qui est de la croissance au sein de la sphère développée du monde. Malgré cela, l'industrie japonaise produisait moins en 1998 qu'en 1991. Sans oublier le sentiment de fatalisme et d'impuissance, comme si la possibilité de la politique à redresser la situation était quasiment nulle. On peut se demander comment est ce qu'un pays comme le Japon a pu connaître une crise aussi longue. Cela sert d'avertissement également dans le sens où si cela a pu arriver à un pays comme le Japon, cela pouvait arriver à tout le monde. Même l'URSS sous Staline n'avait pas connu une transformation économique comme celle qu'avait connu le Japon durant les années de forte croissance entre 1953 et 1973. En même pas 20 ans, un pays de base agricole a réussit à devenir le plus grand exportateur d'automobiles et d'acier au monde. A cela s'ajoute l'augmentation du niveau de vie général des japonais. Herman Kahn avait publié un ouvrage intitulé " L'Ascension japonaise". Il prédisait que les taux de croissance du Japon ferait de ce pays la première puissance économique mondiale en 2000. " Le Japon médaille d'or " fut écrit par Ezra Vogel à la fin des années 1970. Les automobiles et produits électroniques inondaient les marchés de l'Occident. L'ironie dans tout cela est qu'au moment où le Japon a commencé à vraiment être pris sérieusement par les Occidentaux, la croissance du Japon ralentissait et se terminait par la suite. Durant les années 1970 d'ailleurs, la croissance se ralentit dans quasiment tous les pays développés. En fait, même le Japon passe d'une croissance de 9% par an en moyenne durant les années 1960 à même pas 4% à partir de 1973, soit plus malgré tout que les Etats Unis et la plupart des pays d'Europe.
Le débat concernant la croissance du Japon se divisait entre ceux expliquant la croissance comme conséquence de bonne base, et un taux d'épargne élevé qui s'ajouterait à une bonne formation. Cette même approche adoptait une approche sociologique pour expliquer les succès du Japon. L'autre approche qui s'opposait à la première expliquait que le système économique développé par le Japon était simplement différent. Une forme de capitalisme qui serait à la fois innovatrice mais aussi meilleure, supérieure. Puis furent abordés les questions de la légitimité du marché libre, la pensée économique occidentale. Durant les années 1950 et 1960, le gouvernement japonais, via le ministère des Finances et celui du Commerce international de l'Industrie ( le MITI ). La croissance de l'économie était au moins partiellement canalisée par les plans stratégiques du gouvernement via afflux de prêts bancaires et de licences d'importation accordés à des secteurs et des entreprises favorisés. Quand l'Occident s'est mis à s'intéresser au Japon, le gouvernement japonais avait relâché son emprise. Mais l'image d'une économie dirigiste et centralisatrice, restait. Une autre caractéristique était les faveurs accordées aux entreprises principales, lesquelles se trouvaient à l'abri des pressions financières à court terme. Les membres des keiretsu, des groupes d'entreprises alliées, organisées autour d'une banque principale, détenaient les unes et les autres un très grand nombre d'actions des autres entreprises du groupe. Cela rendait les directions indépendantes des actionnaires extérieurs. Les entreprises japonaises n'avaient pas besoin qui plus est de s'inquiéter des cours de la Bourse ou même de la confiance des marchés car elles ne pratiquaient pas ou seulement exceptionnellement l'autofinancement par vente de titres. La banque principale leur prêtait de l'argent si besoin en était. Donc pas besoin de se soucier de la rentabilité.
Mais on pourrait se dire que si les prêts paraissent hasardeux, la banque risque de perdre des déposants. Mais au Japon, les déposants pensait comme dans la majorité des pays que l'Etat ne pourrait pas permettre qu'ils perdent leurs économies. Donc l'utilisation de leur argent par les banques, ils n'en faisaient pas attention. Du coup, on disait du Japon que c'était un pays capable de se projeter dans le long terme. De plus, les industries stratégiques avaient été ciblées par le gouvernement, c'est à dire celles servant grandement à la croissance japonaise. Ainsi le secteur privé était orienté vers ces industries. La période initiale de protection par rapport à la concurrence étrangère au cours de laquelle ces entreprises pouvaient perfectionner leurs techniques sur le marché intérieur. Puis il y avait la grande campagne d'exportation où sans avoir à prendre en compte la rentabilité, elles se taillaient leur part de marché et terrassaient leurs concurrent étrangers. Puis, quand la domination industrielle était dans ce secteur clairement assurée, le Japon passait à un autre secteur. Ainsi, ce pays passe de l'acier à l'automobile, puis aux magnétoscopes, puis aux semi conducteurs. Par la suite, ils passaient aux avions et aux ordinateurs. Mais il existait déjà des faiblesses dans ce système économique. On pouvait le voir à la fin des années 1980 que c'était du capitalisme de connivence dont il s'agissait. Cette dernière fut associée par la suite comme origine du mal être japonais. Au début des années 1990, la capitalisation boursière du Japon soit la valeur totale de toutes les actions de l'ensemble des entreprises du pays, était supérieure à celle des Etats Unis. Ces derniers avaient une population pourtant 2 fois supérieure à celle du Japon. De même pour ce qui est du PIB. La terre, qui n'est jamais bon marché dans un pays très peuplé, était devenu très cher.
Le terrain situé sous le palais impérial de Tokyo de 1 mile carré soit 1609 mètres carré valait plus que l'ensemble de la Californie. La prospérité du Japon se caractérisait bien sûr par un chômage très bas, par de la croissance rapide et également des profits élevés. Mais rien ne justifiait dans les données économiques fondamentales le triplement des prix fonciers et des valeurs boursières. Pourtant, de nombreux observateurs pensaient qu'il y avait quelque chose d'irrationnel dans ce boom financier et que les entreprises traditionnelles des secteurs à croissance lente ne devaient pas être évaluées comme valeurs en croissance avec coefficients de capitalisations des résultats de soixante et plus. Avant la crise japonaise, le monde avait déjà connu des bulles financières à l'instar de la crise de la tulipe ou de la crise de l'Internet. Mais les Japonais avaient cette réputation de vision à long terme. Certains étaient persuadés d'avoir affaire bien plus à une économie dirigiste et planifiée qu'à un mêlée générale d'un marché concurrentiel. C'est pour cela que l'étendue de la bulle peut surprendre. Sauf que la réputation sur l'investissement à long terme socialement contrôlée est très exagéré car les spéculateurs immobiliers, gagnant davantage en étant proches de Yakuzas ou en payant les politiciens, avaient un rôle important au Japon depuis longtemps. Les investissements spéculatifs dans l'immobilier arrivèrent presque à provoquer une crise bancaire durant les années 1970 mais une flambée inflationniste réduisant la valeur réelle des dettes des spéculateurs permit de redresser la situation. Cette bulle était une bulle spéculative comme il y en avait pas mal durant les années 1980. Leur point commun c'était le financement par des prêts bancaires majoritairement avec des offres de crédit à des opérateurs même ceux qui aiment le risque, avec des taux d'intérêts légèrement supérieurs à ceux du marché. Notamment le cas des sociétés de crédit immobilier d'Amérique.
A noter malgré tout que le Japon n'a pas connu d'année de chute économique aussi catastrophique que le Mexique en 1995, la Corée du Sud en 1998 ou encore l'Argentine en 2002 étant donné que son PIB réel n'a baissé que 2 années durant la décennie suivant l'éclatement de la bulle. Le problème résidait dans le fait que la croissance était resté inférieur à ce qu'elle avait été mais aussi à ce qu'on pouvait attendre par rapport au potentiel et à la capacité de l'économie japonaise. Seul durant l'année 1996, le Japon a eu une croissance aussi rapide que la moyenne des années 1980. Même si on considère le taux de croissance de la production potentielle du Japon, soit la production qu'il aurait pu réaliser en mobilisant toutes ses ressources, a chuté de moitié par rapport à 1991. Seule l'année 1996 a vu la production réelle augmenter aussi rapidement que la production potentielle. Les économistes ont eu recours à une expression de récession de la croissance pour décrire ce que vivaient les Japonais. Cela désigne une situation où l'économie croît mais insuffisamment pour utiliser les capacités nouvelles et donc cela signifie qu'il y a plus de travailleurs et de machines inoccupés. Les récession de la croissance sont rares généralement car les périodes de prospérité et de crises s'accélèrent. Mais le Japon a connut une récession de la croissance. Ce fut une dépression de la croissance. Cette baisse a eu lieu lentement. La population n'a pas exigé de mesures radicales au gouvernement dans son ensemble. Ce même gouvernement a vu dans la poursuite de la croissance économique une manière de justifier sa politique malgré une croissance inférieure à ce qu'elle aurait pu être. Mais les analystes japonais ont supposé que le Japon ne pouvait pas avoir une croissance plus rapide puisqu'il avait une croissance lente depuis longtemps. C'était un mix entre impuissance et suffisance. Sans oublier le fait qu'ils n'aient pas réfléchit au raisons réelles ayant entraîné ce drame.
JAPON RECESSION 1990
La majorité de la décennie 1990 s'est passé en récession pour le Japon. Avec des périodes de croissance économique courte et faibles. Pourtant, ce n'est pas comme si le Japon n'avait pas était en tête pour ce qui est de la croissance au sein de la sphère développée du monde. Malgré cela, l'industrie japonaise produisait moins en 1998 qu'en 1991. Sans oublier le sentiment de fatalisme et d'impuissance, comme si la possibilité de la politique à redresser la situation était quasiment nulle. On peut se demander comment est ce qu'un pays comme le Japon a pu connaître une crise aussi longue. Cela sert d'avertissement également dans le sens où si cela a pu arriver à un pays comme le Japon, cela pouvait arriver à tout le monde. Même l'URSS sous Staline n'avait pas connu une transformation économique comme celle qu'avait connu le Japon durant les années de forte croissance entre 1953 et 1973. En même pas 20 ans, un pays de base agricole a réussit à devenir le plus grand exportateur d'automobiles et d'acier au monde. A cela s'ajoute l'augmentation du niveau de vie général des japonais. Herman Kahn avait publié un ouvrage intitulé " L'Ascension japonaise". Il prédisait que les taux de croissance du Japon ferait de ce pays la première puissance économique mondiale en 2000. " Le Japon médaille d'or " fut écrit par Ezra Vogel à la fin des années 1970. Les automobiles et produits électroniques inondaient les marchés de l'Occident. L'ironie dans tout cela est qu'au moment où le Japon a commencé à vraiment être pris sérieusement par les Occidentaux, la croissance du Japon ralentissait et se terminait par la suite. Durant les années 1970 d'ailleurs, la croissance se ralentit dans quasiment tous les pays développés. En fait, même le Japon passe d'une croissance de 9% par an en moyenne durant les années 1960 à même pas 4% à partir de 1973, soit plus malgré tout que les Etats Unis et la plupart des pays d'Europe.
Le débat concernant la croissance du Japon se divisait entre ceux expliquant la croissance comme conséquence de bonne base, et un taux d'épargne élevé qui s'ajouterait à une bonne formation. Cette même approche adoptait une approche sociologique pour expliquer les succès du Japon. L'autre approche qui s'opposait à la première expliquait que le système économique développé par le Japon était simplement différent. Une forme de capitalisme qui serait à la fois innovatrice mais aussi meilleure, supérieure. Puis furent abordés les questions de la légitimité du marché libre, la pensée économique occidentale. Durant les années 1950 et 1960, le gouvernement japonais, via le ministère des Finances et celui du Commerce international de l'Industrie ( le MITI ). La croissance de l'économie était au moins partiellement canalisée par les plans stratégiques du gouvernement via afflux de prêts bancaires et de licences d'importation accordés à des secteurs et des entreprises favorisés. Quand l'Occident s'est mis à s'intéresser au Japon, le gouvernement japonais avait relâché son emprise. Mais l'image d'une économie dirigiste et centralisatrice, restait. Une autre caractéristique était les faveurs accordées aux entreprises principales, lesquelles se trouvaient à l'abri des pressions financières à court terme. Les membres des keiretsu, des groupes d'entreprises alliées, organisées autour d'une banque principale, détenaient les unes et les autres un très grand nombre d'actions des autres entreprises du groupe. Cela rendait les directions indépendantes des actionnaires extérieurs. Les entreprises japonaises n'avaient pas besoin qui plus est de s'inquiéter des cours de la Bourse ou même de la confiance des marchés car elles ne pratiquaient pas ou seulement exceptionnellement l'autofinancement par vente de titres. La banque principale leur prêtait de l'argent si besoin en était. Donc pas besoin de se soucier de la rentabilité.
Mais on pourrait se dire que si les prêts paraissent hasardeux, la banque risque de perdre des déposants. Mais au Japon, les déposants pensait comme dans la majorité des pays que l'Etat ne pourrait pas permettre qu'ils perdent leurs économies. Donc l'utilisation de leur argent par les banques, ils n'en faisaient pas attention. Du coup, on disait du Japon que c'était un pays capable de se projeter dans le long terme. De plus, les industries stratégiques avaient été ciblées par le gouvernement, c'est à dire celles servant grandement à la croissance japonaise. Ainsi le secteur privé était orienté vers ces industries. La période initiale de protection par rapport à la concurrence étrangère au cours de laquelle ces entreprises pouvaient perfectionner leurs techniques sur le marché intérieur. Puis il y avait la grande campagne d'exportation où sans avoir à prendre en compte la rentabilité, elles se taillaient leur part de marché et terrassaient leurs concurrent étrangers. Puis, quand la domination industrielle était dans ce secteur clairement assurée, le Japon passait à un autre secteur. Ainsi, ce pays passe de l'acier à l'automobile, puis aux magnétoscopes, puis aux semi conducteurs. Par la suite, ils passaient aux avions et aux ordinateurs. Mais il existait déjà des faiblesses dans ce système économique. On pouvait le voir à la fin des années 1980 que c'était du capitalisme de connivence dont il s'agissait. Cette dernière fut associée par la suite comme origine du mal être japonais. Au début des années 1990, la capitalisation boursière du Japon soit la valeur totale de toutes les actions de l'ensemble des entreprises du pays, était supérieure à celle des Etats Unis. Ces derniers avaient une population pourtant 2 fois supérieure à celle du Japon. De même pour ce qui est du PIB. La terre, qui n'est jamais bon marché dans un pays très peuplé, était devenu très cher.
Le terrain situé sous le palais impérial de Tokyo de 1 mile carré soit 1609 mètres carré valait plus que l'ensemble de la Californie. La prospérité du Japon se caractérisait bien sûr par un chômage très bas, par de la croissance rapide et également des profits élevés. Mais rien ne justifiait dans les données économiques fondamentales le triplement des prix fonciers et des valeurs boursières. Pourtant, de nombreux observateurs pensaient qu'il y avait quelque chose d'irrationnel dans ce boom financier et que les entreprises traditionnelles des secteurs à croissance lente ne devaient pas être évaluées comme valeurs en croissance avec coefficients de capitalisations des résultats de soixante et plus. Avant la crise japonaise, le monde avait déjà connu des bulles financières à l'instar de la crise de la tulipe ou de la crise de l'Internet. Mais les Japonais avaient cette réputation de vision à long terme. Certains étaient persuadés d'avoir affaire bien plus à une économie dirigiste et planifiée qu'à un mêlée générale d'un marché concurrentiel. C'est pour cela que l'étendue de la bulle peut surprendre. Sauf que la réputation sur l'investissement à long terme socialement contrôlée est très exagéré car les spéculateurs immobiliers, gagnant davantage en étant proches de Yakuzas ou en payant les politiciens, avaient un rôle important au Japon depuis longtemps. Les investissements spéculatifs dans l'immobilier arrivèrent presque à provoquer une crise bancaire durant les années 1970 mais une flambée inflationniste réduisant la valeur réelle des dettes des spéculateurs permit de redresser la situation. Cette bulle était une bulle spéculative comme il y en avait pas mal durant les années 1980. Leur point commun c'était le financement par des prêts bancaires majoritairement avec des offres de crédit à des opérateurs même ceux qui aiment le risque, avec des taux d'intérêts légèrement supérieurs à ceux du marché. Notamment le cas des sociétés de crédit immobilier d'Amérique.
A noter malgré tout que le Japon n'a pas connu d'année de chute économique aussi catastrophique que le Mexique en 1995, la Corée du Sud en 1998 ou encore l'Argentine en 2002 étant donné que son PIB réel n'a baissé que 2 années durant la décennie suivant l'éclatement de la bulle. Le problème résidait dans le fait que la croissance était resté inférieur à ce qu'elle avait été mais aussi à ce qu'on pouvait attendre par rapport au potentiel et à la capacité de l'économie japonaise. Seul durant l'année 1996, le Japon a eu une croissance aussi rapide que la moyenne des années 1980. Même si on considère le taux de croissance de la production potentielle du Japon, soit la production qu'il aurait pu réaliser en mobilisant toutes ses ressources, a chuté de moitié par rapport à 1991. Seule l'année 1996 a vu la production réelle augmenter aussi rapidement que la production potentielle. Les économistes ont eu recours à une expression de récession de la croissance pour décrire ce que vivaient les Japonais. Cela désigne une situation où l'économie croît mais insuffisamment pour utiliser les capacités nouvelles et donc cela signifie qu'il y a plus de travailleurs et de machines inoccupés. Les récession de la croissance sont rares généralement car les périodes de prospérité et de crises s'accélèrent. Mais le Japon a connut une récession de la croissance. Ce fut une dépression de la croissance. Cette baisse a eu lieu lentement. La population n'a pas exigé de mesures radicales au gouvernement dans son ensemble. Ce même gouvernement a vu dans la poursuite de la croissance économique une manière de justifier sa politique malgré une croissance inférieure à ce qu'elle aurait pu être. Mais les analystes japonais ont supposé que le Japon ne pouvait pas avoir une croissance plus rapide puisqu'il avait une croissance lente depuis longtemps. C'était un mix entre impuissance et suffisance. Sans oublier le fait qu'ils n'aient pas réfléchit au raisons réelles ayant entraîné ce drame.
il y a 3 mois
Ils se sont pris 2 bombes nucléaires dans la tronche.
Il faut imaginer une coopérative dont les membres savent qu'il y a une imperfection dans leur système. Une imperfection non nécessaire d'ailleurs. Il faut supposer que la coopérative a permis à ses membres d'emprunter des coupons supplémentaires auprès de la direction en cas de besoin,. Et le remboursement se fait à l'aide de coupons reçus lors des gardes d'enfants effectués plus tard. Le taux d'intérêts sur ce marché financier des bébés serait le taux de base bancaire de la direction de la coopérative de la parabole. Mais pour empêcher les membres d'abuser de ce pouvoir, la direction doit prévoir une pénalité, à savoir demander aux emprunteurs le remboursement de plus de coupons qu'ils n'en aurait emprunté. Les coupons garderaient des réserves de coupon moins importantes qu'auparavant avec ce nouveau système. Les responsables de la coopérative auraient acquis un nouvel instrument de gestion qui plus est. Si les membres de la coopérative signalaient qu'il était facile de trouver des baby sitters et difficile de trouver des enfants à garder, les termes de l'emprunt de coupon pourraient être assouplis, ce qui encouragerait plus de personnes à sortie. A l'inverse, si les baby sitters sont rares, les termes ne seraient pas assouplis mais durcis au contraire, ce qui encourage plus de gens à rester chez eux. Donc cette coopérative de nature plus complexe aurait une banque centrale en capacité de stimuler une économie déprimée en abaissant le taux d'intérêt et de refroidir une économie en surchauffe en relevant ce taux. Mais les taux étaient tombés à 0 au Japon et l'économie était déprimée.
Il faut imaginer une coopérative dont les membres savent qu'il y a une imperfection dans leur système. Une imperfection non nécessaire d'ailleurs. Il faut supposer que la coopérative a permis à ses membres d'emprunter des coupons supplémentaires auprès de la direction en cas de besoin,. Et le remboursement se fait à l'aide de coupons reçus lors des gardes d'enfants effectués plus tard. Le taux d'intérêts sur ce marché financier des bébés serait le taux de base bancaire de la direction de la coopérative de la parabole. Mais pour empêcher les membres d'abuser de ce pouvoir, la direction doit prévoir une pénalité, à savoir demander aux emprunteurs le remboursement de plus de coupons qu'ils n'en aurait emprunté. Les coupons garderaient des réserves de coupon moins importantes qu'auparavant avec ce nouveau système. Les responsables de la coopérative auraient acquis un nouvel instrument de gestion qui plus est. Si les membres de la coopérative signalaient qu'il était facile de trouver des baby sitters et difficile de trouver des enfants à garder, les termes de l'emprunt de coupon pourraient être assouplis, ce qui encouragerait plus de personnes à sortie. A l'inverse, si les baby sitters sont rares, les termes ne seraient pas assouplis mais durcis au contraire, ce qui encourage plus de gens à rester chez eux. Donc cette coopérative de nature plus complexe aurait une banque centrale en capacité de stimuler une économie déprimée en abaissant le taux d'intérêt et de refroidir une économie en surchauffe en relevant ce taux. Mais les taux étaient tombés à 0 au Japon et l'économie était déprimée.
il y a 3 mois
Ils se sont aussi pris des crises économiques notamment sur la période 1990.
BANQUE DU JAPON
La banque du Japon fut la première banque centrale fondée en dehors de la sphère occidentale. Sa date de création est de 1882. Les changements entraînés sur la système financier japonais sont importants. La rupture structurelle dans l'évolution des taux nominaux en 1885 en est une. Car la Banque du Japon a commencé à émettre des billets avec l'objectif avoué de lisser les taux comme la plupart des banques centrales en Occident à partir de 1914. La montée en puissance de la banque du Japon s'est effectué en particulier à partir des années 1920 lorsqu'elle a commencé à jouer un rôle de prêteur en dernier ressort même si son rôle durant la fin du XIXème siècle fut tout sauf négligeable. La loi sur les banques nationales en 1872 ainsi que celle sur les banques en 1890 accéléra les changements internes à la banque du Japon.
En raison de la politique monétaire laxiste durant la WW1, et de la forte croissance économique, les dépôts en banque avaient augmenté rapidement modifiant profondément les bilans du secteur bancaire. Le ratio fond propres/dette totale qui était élevé avant cette période, autour de 25%, diminua pour s'établir autour de 15 à 20% durant les années 1920. De nombreuses banques avaient accordé des prêts importantes aux industries en développement récent du fait de l'essor provoqué par la guerre. Une grande partie de ces prêts étaient devenus improductifs après guerre en raison du redémarrage de la concurrence internationale et de la crise économique en résultant. Les banques avaient en plus de cela étendu leurs réseaux de succursales durant la deuxième moitié des années 1910. L'accord entre les banques principales en 1918 sur le taux créditeur était la cause majeure de cela. Une augmentation de la marge entre le taux créditeur et le taux débiteur avait été le résultat de cet accord. Cette augmentation de la marge entre taux créditeur et taux débiteur avait été effectué avec l'objectif de stimuler la concurrence dans la collecte des dépôts. A l'inverse, la concurrence est devenue plus vive dans les années 1920 avec la croissance rapide des réseaux, la concurrence augmenta. Le ministère des Finances, dans ses Annuaires des Finances entre 1930 et 1942 a d'ailleurs fait donné un graphique intéressant à ce sujet sur l'évolution du nombre de banques au Japon entre 1893 et 1945.
Ibid donne également des informations intéressantes concernant d'une part l'évolution des ratios de solvabilité des banques commerciales entre 1894 et 1937 et d'autre part la progression des dépôts et développement des réseaux de succursales. Les effets combinés cette concurrence accrue au niveau interrégionale et de l'évolution des bilans ont entraîné une instabilité du système financier japonais durant les années 1920. L'écart entre le taux d'intérêt des prêts bancaires et le taux d'intérêts des obligations d'Etat qui sont considérés comme étant l'actif sûr par excellence. Avant la Première Guerre mondiale en effet, il y a 4 pics en 1900, 1904, 1907 et 1913. Ce sont les 4 épisodes de panique bancaire ayant marqué la période d'avant guerre. L'écart s'élève à chacune des paniques au dessus de 4%. On l'a vu également après la guerre en 1920 à l'occasion de la panique bancaire ayant eu lieu la même année. Cet écart des 4% se maintient autour de 4% à un niveau proche du niveau atteint à l'occasion de chacune crise et panique bancaire ce qui montre que le système financier japonais restait toujours dans une situation d'instabilité durant cette décennie.
Les différentes périodes de panique ne se reflètent pas. Ces données rendent compte de la fréquence des runs ayant caractérisé ces années là en particulier lors de la crise bancaire de 1927. L'écrémage des banques fut la conséquence direct de cette succession de crises. Seulement 424 banques commerciales en 1936 alors qu'il y en avait 1799 en 1922. 970 disparitions de banques venaient de fusions et 544 de faillites et liquidations volontaires. Il se trouve que le ministère des Finances japonais a encouragé cette politique de fusion via une politique d'incitation à la concentration bancaire. La politique de fusion avait été envisagé depuis les années 1890. Les premières mesures furent toutefois prise à partir des années 1920 seulement. Notamment avec la révision de la loi sur les banques en 1920. Ainsi que la procédure de fusion facilité pour les institutions bancaires par rapport aux autres entreprises. La limitation de nouvelles succursales était le fait du ministre des Finances en 1923 qui voulait qu'il y ait une limitation. Il s'agissait d'inciter les banques principales à acquérir des banques plus petites pour développer les réseaux d'agences. La loi bancaire de 1927 donne au gouvernement un moyen efficace de promotion des fusions bancaires. Cette loi faisait obligation aux banques d'atteindre un niveau de capital minimal d'un millions de yens avant l'an 1932. Or pour atteindre ces standards, beaucoup de banques étaient obligés de fusionner avec d'autres banques. Et c'est cette succession de fusions qui entraîna la forte croissance du nombre de succursales. Il s'agissait de concentrer les structures du marché pour stabiliser le système financier. Et donc densifier le réseau bancaire. Des prêts spéciaux étaient également accordés par la banque du Japon qui jouait un rôle de prêteur en dernier ressort à l'égard des banques privées durant les situations de crise et panique bancaire.
Parmi ces prêts spéciaux il y avait des crédits accordés au titre de lois particulières votées en réponse à des situations d'urgence à savoir la loi sur l'indemnisation des pertes liées à l'escompte des traites émises avant le tremblement de terre de 1923, la loi sur le prêt spécial de la Banque du Japon et sur l'indemnisation des pertes dus à la crise bancaire de Taiwan en 1927, enfin la loi sur le prêt à la Banque de Taiwan la même année. Au delà de ces crédits accordés au titre de lois particulière, il y avait des crédits accordés à l'initiative de la Banque du Japon elle même. Le tout attribués en dehors des conditions du marché. Ces prêts spéciaux représentaient 90% des prêts totaux de la Banque du Japon à l'économie japonaise durant les années 1920. Le modèle de prêt a drastiquement changé entre l'avant et l'après guerre. Ainsi avant la guerre, les actions de prêts n'ont pas énormément évolué en dépit des crises ce qui montre que le rôle de prêteur en dernier ressort n'avait pas encore été acquis. Plus, ce sont les banques ayant eu des affaires avec la Banque centrale qui bénéficiaient de 95% des prêts spéciaux totaux. Mais, dès 1882, date de sa fondation, des transactions furent effectués. Les dépôts courants, la gestion des comptes à découvert ainsi que les virements sur comptes courant étaient effectués par la Banque du Japon. Ces opérations étaient des transactions effectués avec les banques commerciales privées.
BANQUE DU JAPON
La banque du Japon fut la première banque centrale fondée en dehors de la sphère occidentale. Sa date de création est de 1882. Les changements entraînés sur la système financier japonais sont importants. La rupture structurelle dans l'évolution des taux nominaux en 1885 en est une. Car la Banque du Japon a commencé à émettre des billets avec l'objectif avoué de lisser les taux comme la plupart des banques centrales en Occident à partir de 1914. La montée en puissance de la banque du Japon s'est effectué en particulier à partir des années 1920 lorsqu'elle a commencé à jouer un rôle de prêteur en dernier ressort même si son rôle durant la fin du XIXème siècle fut tout sauf négligeable. La loi sur les banques nationales en 1872 ainsi que celle sur les banques en 1890 accéléra les changements internes à la banque du Japon.
En raison de la politique monétaire laxiste durant la WW1, et de la forte croissance économique, les dépôts en banque avaient augmenté rapidement modifiant profondément les bilans du secteur bancaire. Le ratio fond propres/dette totale qui était élevé avant cette période, autour de 25%, diminua pour s'établir autour de 15 à 20% durant les années 1920. De nombreuses banques avaient accordé des prêts importantes aux industries en développement récent du fait de l'essor provoqué par la guerre. Une grande partie de ces prêts étaient devenus improductifs après guerre en raison du redémarrage de la concurrence internationale et de la crise économique en résultant. Les banques avaient en plus de cela étendu leurs réseaux de succursales durant la deuxième moitié des années 1910. L'accord entre les banques principales en 1918 sur le taux créditeur était la cause majeure de cela. Une augmentation de la marge entre le taux créditeur et le taux débiteur avait été le résultat de cet accord. Cette augmentation de la marge entre taux créditeur et taux débiteur avait été effectué avec l'objectif de stimuler la concurrence dans la collecte des dépôts. A l'inverse, la concurrence est devenue plus vive dans les années 1920 avec la croissance rapide des réseaux, la concurrence augmenta. Le ministère des Finances, dans ses Annuaires des Finances entre 1930 et 1942 a d'ailleurs fait donné un graphique intéressant à ce sujet sur l'évolution du nombre de banques au Japon entre 1893 et 1945.
Ibid donne également des informations intéressantes concernant d'une part l'évolution des ratios de solvabilité des banques commerciales entre 1894 et 1937 et d'autre part la progression des dépôts et développement des réseaux de succursales. Les effets combinés cette concurrence accrue au niveau interrégionale et de l'évolution des bilans ont entraîné une instabilité du système financier japonais durant les années 1920. L'écart entre le taux d'intérêt des prêts bancaires et le taux d'intérêts des obligations d'Etat qui sont considérés comme étant l'actif sûr par excellence. Avant la Première Guerre mondiale en effet, il y a 4 pics en 1900, 1904, 1907 et 1913. Ce sont les 4 épisodes de panique bancaire ayant marqué la période d'avant guerre. L'écart s'élève à chacune des paniques au dessus de 4%. On l'a vu également après la guerre en 1920 à l'occasion de la panique bancaire ayant eu lieu la même année. Cet écart des 4% se maintient autour de 4% à un niveau proche du niveau atteint à l'occasion de chacune crise et panique bancaire ce qui montre que le système financier japonais restait toujours dans une situation d'instabilité durant cette décennie.
Les différentes périodes de panique ne se reflètent pas. Ces données rendent compte de la fréquence des runs ayant caractérisé ces années là en particulier lors de la crise bancaire de 1927. L'écrémage des banques fut la conséquence direct de cette succession de crises. Seulement 424 banques commerciales en 1936 alors qu'il y en avait 1799 en 1922. 970 disparitions de banques venaient de fusions et 544 de faillites et liquidations volontaires. Il se trouve que le ministère des Finances japonais a encouragé cette politique de fusion via une politique d'incitation à la concentration bancaire. La politique de fusion avait été envisagé depuis les années 1890. Les premières mesures furent toutefois prise à partir des années 1920 seulement. Notamment avec la révision de la loi sur les banques en 1920. Ainsi que la procédure de fusion facilité pour les institutions bancaires par rapport aux autres entreprises. La limitation de nouvelles succursales était le fait du ministre des Finances en 1923 qui voulait qu'il y ait une limitation. Il s'agissait d'inciter les banques principales à acquérir des banques plus petites pour développer les réseaux d'agences. La loi bancaire de 1927 donne au gouvernement un moyen efficace de promotion des fusions bancaires. Cette loi faisait obligation aux banques d'atteindre un niveau de capital minimal d'un millions de yens avant l'an 1932. Or pour atteindre ces standards, beaucoup de banques étaient obligés de fusionner avec d'autres banques. Et c'est cette succession de fusions qui entraîna la forte croissance du nombre de succursales. Il s'agissait de concentrer les structures du marché pour stabiliser le système financier. Et donc densifier le réseau bancaire. Des prêts spéciaux étaient également accordés par la banque du Japon qui jouait un rôle de prêteur en dernier ressort à l'égard des banques privées durant les situations de crise et panique bancaire.
Parmi ces prêts spéciaux il y avait des crédits accordés au titre de lois particulières votées en réponse à des situations d'urgence à savoir la loi sur l'indemnisation des pertes liées à l'escompte des traites émises avant le tremblement de terre de 1923, la loi sur le prêt spécial de la Banque du Japon et sur l'indemnisation des pertes dus à la crise bancaire de Taiwan en 1927, enfin la loi sur le prêt à la Banque de Taiwan la même année. Au delà de ces crédits accordés au titre de lois particulière, il y avait des crédits accordés à l'initiative de la Banque du Japon elle même. Le tout attribués en dehors des conditions du marché. Ces prêts spéciaux représentaient 90% des prêts totaux de la Banque du Japon à l'économie japonaise durant les années 1920. Le modèle de prêt a drastiquement changé entre l'avant et l'après guerre. Ainsi avant la guerre, les actions de prêts n'ont pas énormément évolué en dépit des crises ce qui montre que le rôle de prêteur en dernier ressort n'avait pas encore été acquis. Plus, ce sont les banques ayant eu des affaires avec la Banque centrale qui bénéficiaient de 95% des prêts spéciaux totaux. Mais, dès 1882, date de sa fondation, des transactions furent effectués. Les dépôts courants, la gestion des comptes à découvert ainsi que les virements sur comptes courant étaient effectués par la Banque du Japon. Ces opérations étaient des transactions effectués avec les banques commerciales privées.
il y a 3 mois
Bon ceci dit, le Japon pourrait être un exemple de pourquoi et comment il est plus facile pour un pays de survivre à 2 bombes nucléaires que de survivre à une immigration de masse en suivant les plans mondialistes.

Avant cela une loi sur l'émission de billets de banques convertible fut promulguée dès 1884, soit 2 ans après la création de la banque. La Banque du Japon allait devoir émettre des billets de banques convertibles en argent. L'émission de ces billets convertibles débuta dès 1885. Ainsi, il ne s'agissait pas d'étalon or contrairement à la majorité des pays européens mais d'un système fondé sur l'argent. Tout comme le système monétaire de la Chine qui était le principale partenaire commercial du Japon à ce moment là. Ce fut l'ère de l'étalon argent. Les devises fortes accumulés par le Japon reposaient sur l'argent en particulier. Il faudra attendre 1897 avant que le Japon ne passe à l'étalon or. Lorsque le système de l'étalon or s'effondre en 1917, il est abandonné par le Japon également avant que ce dernier ne reprenne ce système en 1930. On constate durant cette même période une évolution à la hausse des effectifs des employés de la banque. 5 directions étaient présentes lors de la fondation de la Banque du Japon en 1882. La direction du Trésor fut crée en 1883. De même qu'un autre service, un service de remboursement des billets de banques fut mis en place la même année. Une septième direction fut mis en place par la suite en 1888 avec la direction de la monnaie argent dans le but de gérer l'émission des billets de banques. Cette direction devint la direction du numéraire quand le Japon adopte l'étalon or en 1897 pour la première fois. Ensuite, 3 ans plus tard en 1890 la direction des opérations fut le nouveau nom de la direction de l'escompte. Il s'agissait de montrer que la Banque du Japon faisait des prêts aux banques privées sans pour autant recourir à l'escompte. Enfin, en 1898, ce fut la direction de l'inspection qui fut crée afin d'inspecter les autres services et bien sûr directions de la Banque du Japon. Egalement mis en place pour être chargé des études économiques.
Pour revenir à la croissances des effectifs employés notamment après la Première Guerre mondiale, cette forte croissance entraîna non seulement une nouvelle organisation, mais aussi la création de nouveaux services en plus des nouvelles directions déjà crées auparavant. Ainsi, le service des études crée en 1922 avait pour but d'examiner les règlements internes de la Banque du Japon ainsi que ses statues. Enfin, il sélectionnait les banques avec lesquels la Banque du Japon avait des relations d'affaires. On peut ajouter que ce service, de temps à autre, examinait des nantissements ainsi que des prêts spéciaux. Ensuite, 2 services furent crées en 1928, à savoir d'une part le service des supervisions et d'autre part le service des emprunts spéciaux. Il s'agissait pour le premier d'inspecter les banques qui étaient clientes de la Banque du Japon et pour la seconde de rembourser les prêts spéciaux aux banques. Des prêts effectués par la Banque du Japon dans une optique de stabilisation du système financier japonais.
Avant cela une loi sur l'émission de billets de banques convertible fut promulguée dès 1884, soit 2 ans après la création de la banque. La Banque du Japon allait devoir émettre des billets de banques convertibles en argent. L'émission de ces billets convertibles débuta dès 1885. Ainsi, il ne s'agissait pas d'étalon or contrairement à la majorité des pays européens mais d'un système fondé sur l'argent. Tout comme le système monétaire de la Chine qui était le principale partenaire commercial du Japon à ce moment là. Ce fut l'ère de l'étalon argent. Les devises fortes accumulés par le Japon reposaient sur l'argent en particulier. Il faudra attendre 1897 avant que le Japon ne passe à l'étalon or. Lorsque le système de l'étalon or s'effondre en 1917, il est abandonné par le Japon également avant que ce dernier ne reprenne ce système en 1930. On constate durant cette même période une évolution à la hausse des effectifs des employés de la banque. 5 directions étaient présentes lors de la fondation de la Banque du Japon en 1882. La direction du Trésor fut crée en 1883. De même qu'un autre service, un service de remboursement des billets de banques fut mis en place la même année. Une septième direction fut mis en place par la suite en 1888 avec la direction de la monnaie argent dans le but de gérer l'émission des billets de banques. Cette direction devint la direction du numéraire quand le Japon adopte l'étalon or en 1897 pour la première fois. Ensuite, 3 ans plus tard en 1890 la direction des opérations fut le nouveau nom de la direction de l'escompte. Il s'agissait de montrer que la Banque du Japon faisait des prêts aux banques privées sans pour autant recourir à l'escompte. Enfin, en 1898, ce fut la direction de l'inspection qui fut crée afin d'inspecter les autres services et bien sûr directions de la Banque du Japon. Egalement mis en place pour être chargé des études économiques.
Pour revenir à la croissances des effectifs employés notamment après la Première Guerre mondiale, cette forte croissance entraîna non seulement une nouvelle organisation, mais aussi la création de nouveaux services en plus des nouvelles directions déjà crées auparavant. Ainsi, le service des études crée en 1922 avait pour but d'examiner les règlements internes de la Banque du Japon ainsi que ses statues. Enfin, il sélectionnait les banques avec lesquels la Banque du Japon avait des relations d'affaires. On peut ajouter que ce service, de temps à autre, examinait des nantissements ainsi que des prêts spéciaux. Ensuite, 2 services furent crées en 1928, à savoir d'une part le service des supervisions et d'autre part le service des emprunts spéciaux. Il s'agissait pour le premier d'inspecter les banques qui étaient clientes de la Banque du Japon et pour la seconde de rembourser les prêts spéciaux aux banques. Des prêts effectués par la Banque du Japon dans une optique de stabilisation du système financier japonais.
il y a 3 mois
Bordel on est plus tranquille nulle part

https://www.youtube.com/watch?v=JtgoBgllvrQ
https://youtu.be/E0bFSrcY[...]_sGncyT5SY8F5Jh5rV63cbsUm
il y a 3 mois
En quelques semaines ils en ont marre ayaaa.

https://x.com/fleshsimulator/status/1967862091970384317
il y a 3 mois
Nastasya
3 mois
Les japonais vont retomber dans l'impérialisme on va bien rigoler

Unité 731 remake

Créateur du délire "n'existe pas"
il y a 3 mois
JVCucks
3 mois
pas facile de remonter la pente ils ne baisent plus

peuple de cucks, finito
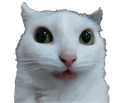
il y a 3 mois
Anthony_A3
3 mois
Ils se sont pris 2 bombes nucléaires dans la tronche.
Il faut imaginer une coopérative dont les membres savent qu'il y a une imperfection dans leur système. Une imperfection non nécessaire d'ailleurs. Il faut supposer que la coopérative a permis à ses membres d'emprunter des coupons supplémentaires auprès de la direction en cas de besoin,. Et le remboursement se fait à l'aide de coupons reçus lors des gardes d'enfants effectués plus tard. Le taux d'intérêts sur ce marché financier des bébés serait le taux de base bancaire de la direction de la coopérative de la parabole. Mais pour empêcher les membres d'abuser de ce pouvoir, la direction doit prévoir une pénalité, à savoir demander aux emprunteurs le remboursement de plus de coupons qu'ils n'en aurait emprunté. Les coupons garderaient des réserves de coupon moins importantes qu'auparavant avec ce nouveau système. Les responsables de la coopérative auraient acquis un nouvel instrument de gestion qui plus est. Si les membres de la coopérative signalaient qu'il était facile de trouver des baby sitters et difficile de trouver des enfants à garder, les termes de l'emprunt de coupon pourraient être assouplis, ce qui encouragerait plus de personnes à sortie. A l'inverse, si les baby sitters sont rares, les termes ne seraient pas assouplis mais durcis au contraire, ce qui encourage plus de gens à rester chez eux. Donc cette coopérative de nature plus complexe aurait une banque centrale en capacité de stimuler une économie déprimée en abaissant le taux d'intérêt et de refroidir une économie en surchauffe en relevant ce taux. Mais les taux étaient tombés à 0 au Japon et l'économie était déprimée.
Il faut imaginer une coopérative dont les membres savent qu'il y a une imperfection dans leur système. Une imperfection non nécessaire d'ailleurs. Il faut supposer que la coopérative a permis à ses membres d'emprunter des coupons supplémentaires auprès de la direction en cas de besoin,. Et le remboursement se fait à l'aide de coupons reçus lors des gardes d'enfants effectués plus tard. Le taux d'intérêts sur ce marché financier des bébés serait le taux de base bancaire de la direction de la coopérative de la parabole. Mais pour empêcher les membres d'abuser de ce pouvoir, la direction doit prévoir une pénalité, à savoir demander aux emprunteurs le remboursement de plus de coupons qu'ils n'en aurait emprunté. Les coupons garderaient des réserves de coupon moins importantes qu'auparavant avec ce nouveau système. Les responsables de la coopérative auraient acquis un nouvel instrument de gestion qui plus est. Si les membres de la coopérative signalaient qu'il était facile de trouver des baby sitters et difficile de trouver des enfants à garder, les termes de l'emprunt de coupon pourraient être assouplis, ce qui encouragerait plus de personnes à sortie. A l'inverse, si les baby sitters sont rares, les termes ne seraient pas assouplis mais durcis au contraire, ce qui encourage plus de gens à rester chez eux. Donc cette coopérative de nature plus complexe aurait une banque centrale en capacité de stimuler une économie déprimée en abaissant le taux d'intérêt et de refroidir une économie en surchauffe en relevant ce taux. Mais les taux étaient tombés à 0 au Japon et l'économie était déprimée.
Et ils se sont relevés à chaque fois, mais là ils vont tombés. Pourtant ils voyagent, viennent en France, ils voient ce qu’il se passe avec les Africains.
Y a que les chinois qui arrivent à les dresser.
Y a que les chinois qui arrivent à les dresser.
il y a 3 mois
Chong2LaGalere
3 mois
La gauche au pouvoir ont accepté les immigrés. Maintenant , cest le bordel.
Y a rien
L'islam n'est pas du tout là plus grosse religion du pays en termes de nouveaux adhérant, les sectes divers et varier font bien mieux.

Y a de grosses sectes de tarax au Japon, mais ça reste mieux que cette religion de baiseur de chèvre.
Le reste c'est juste des touristes qui foutent la merde, au final ce sont les mêmes vidéos qui tournent en boucle, les Japon est en train d'augmenter les prix d'absolument tout juste pour les touristes
 , on va pas ce mentir il crache pas sur ces petit 16% du PIB
, on va pas ce mentir il crache pas sur ces petit 16% du PIB
L'islam n'est pas du tout là plus grosse religion du pays en termes de nouveaux adhérant, les sectes divers et varier font bien mieux.
Y a de grosses sectes de tarax au Japon, mais ça reste mieux que cette religion de baiseur de chèvre.
Le reste c'est juste des touristes qui foutent la merde, au final ce sont les mêmes vidéos qui tournent en boucle, les Japon est en train d'augmenter les prix d'absolument tout juste pour les touristes
il y a 3 mois
Nastasya
3 mois
Les japonais vont retomber dans l'impérialisme on va bien rigoler

Espérons.


https://bfmtv.me Juif qui parle, bouche qui ment.
il y a 3 mois



































