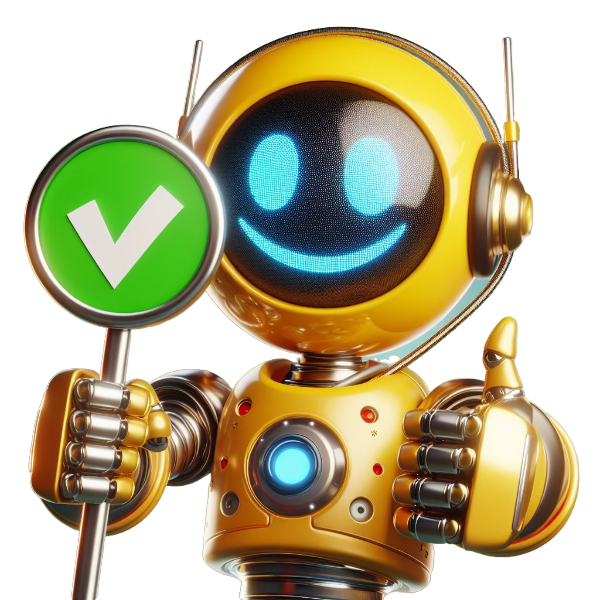Ce sujet a été résolu
Le guide de dressage de femmes: https://onche.org/topic/4[...]-dresser-sa-magalax/:page:
il y a 4 mois
DarkChouffin
4 mois
A l'batard !
Elle était technique celle-là !
Il est rapide

Comment j'me suis fait niquer putain
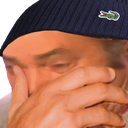
Elle était technique celle-là !
Il est rapide
Comment j'me suis fait niquer putain
T'as des idées noires keyou ? Plutôt que de faire une connerie, passe discuter en MP.
il y a 4 mois
Tellement facile
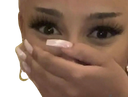
Ayaaaa j'ai mis 15secondes à comprendre le gif

Le guide de dressage de femmes: https://onche.org/topic/4[...]-dresser-sa-magalax/:page:
il y a 4 mois
Poste + on ne saura jamais vraiment + il aurait fallu un test ADN + même ça ça aurait pu être fake

il y a 4 mois
A l'batard !
Elle était technique celle-là !
Il est rapide

Comment j'me suis fait niquer putain
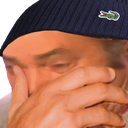
Elle était technique celle-là !
Il est rapide
Comment j'me suis fait niquer putain
Et une victime de plus du grand POCqueur DarkChouffin
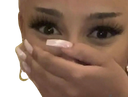
Créateur du délire "n'existe pas"
il y a 4 mois
Et une victime de plus du grand POCqueur DarkChouffin
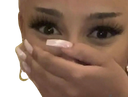
Bien joué
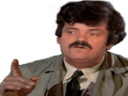
T'as des idées noires keyou ? Plutôt que de faire une connerie, passe discuter en MP.
il y a 4 mois
« Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » (Matthieu 7:8)
il y a 4 mois
Post.

Il s'insère dans la schéma de la Théorie Générale : Demande supplémentaire de finance, hausse du taux d'inérêt, baisse de M2, offre de monnaie à placer ( déthésaurisation ). Puis, parmi les sources indirectes, c'est le crédit bancaire qui prédomine. Cette offre de monnaie de la part des banques peut dépendre du taux d'intérêt ou de la politique - autonome? - de distribution du crédit de la part des banques ou plus généralement de la politique monétaire.Cet accent mis par Keynes sur les contraintes financières de la croissance économique a une résonance très moderne. Plus personne actuellement ne doute de la position clef détenue par les banques. La théorie de la finance ou le modèle du circuit permettent de réconcilier les schémas théoriques keynésiens traditionnels avec la réalité contemporaine du financement bancaire de l'économie. A travers ces textes, la variable explicative principale du niveau d'investissement semble moins être le taux d'intérêt, c'est à dire le coût des ressources, que leur disponibilité. Keynes rompt ainsi avec l'économie de marché financier ou de capitaux qui caractérisait la " Théorie Générale " et s'engage dans une problématique d'économie de crédit ou fondée sur la banque.
Il s'insère dans la schéma de la Théorie Générale : Demande supplémentaire de finance, hausse du taux d'inérêt, baisse de M2, offre de monnaie à placer ( déthésaurisation ). Puis, parmi les sources indirectes, c'est le crédit bancaire qui prédomine. Cette offre de monnaie de la part des banques peut dépendre du taux d'intérêt ou de la politique - autonome? - de distribution du crédit de la part des banques ou plus généralement de la politique monétaire.Cet accent mis par Keynes sur les contraintes financières de la croissance économique a une résonance très moderne. Plus personne actuellement ne doute de la position clef détenue par les banques. La théorie de la finance ou le modèle du circuit permettent de réconcilier les schémas théoriques keynésiens traditionnels avec la réalité contemporaine du financement bancaire de l'économie. A travers ces textes, la variable explicative principale du niveau d'investissement semble moins être le taux d'intérêt, c'est à dire le coût des ressources, que leur disponibilité. Keynes rompt ainsi avec l'économie de marché financier ou de capitaux qui caractérisait la " Théorie Générale " et s'engage dans une problématique d'économie de crédit ou fondée sur la banque.
il y a 4 mois
Post.

MACROECONOMIE MONETAIRE ET FINANCIERE Livre : Macroéconomie monétaire et financière. Théories, institutions, politiques. Jean François Goux.
Le système bancaire.
Les institutions financières monétaires françaises et européennes.
Avant 1999 on pouvait distinguer 3 composantes de ce système en France, à savoir le Trésor, les institutions bancaires et financières et la Banque de France. A cela s'ajoute depuis le système européen de banques centrales, dit SEBC. La BCE désigne ces organismes sous le nom d'institutions financières monétaires, IFM. Les IFM ont 3 grandes catégories d'établissements. Les banques centrales. Ensuite les établissements de crédit résidents au sens du droit communautaire. Ils sont définis comme des entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à consentir des crédits. Enfin l'ensemble des autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts à vue et/ou des substituts proches et à consentir des crédits ou à effectuer des placements en titre.
Des procédures de contrôle ont été mis en place par le SEBC, de vérification et de mise à jour aussi des établissements de crédit formant le secteur des IFM.
Les banques centrales : le cas de la banque de France.
Au fur et à mesure que les billets devenaient une vraie monnaie, le priviliège d'émission a été accordé de façon graduel à une seule banque. C'est le résultat d'une double tendance, le développement du monopole et accroissement des pouvoirs de l'Etat. Elle est nette dans le cas de la France mais cela s'est produit dans la plupart des autres pays, y compris aux USA. La Banque de France est créée le 13 février 1800 sous Bonaparte pour favoriser l'activité économique via l'émission de billets payables à vue et au porteur en contrepartie de l'escompte d'effets de commerce. Ses statuts fondamentaux datent de 1808. C'était un établissement privé sous forme de société anonyme à l'époque. Le tout administré par un gouverneur et 2 sous gouverneurs, nommés par décret. La conseil général, composé de 15 personnes choisies par les assemblées d'actionnaires parmi l'aristocratie financière, doivent les assister. Le droit de vote est réservé seulement aux actionnaires les plus importantes. Ce sont les fameux 200 familles. La Banque de Frnace fonctionnait à la fois comme banque ordinaire et à la fois comme banque d'émission. Son monopole, en tant que banque d'émission, ne date que de 1848. Jusqu'en 1870, elle a bénéficié d'une liberté complète d'émission. Après 1870 : plafond légal. En 1928, la loi du 28 juin abroge le principe du maximum légal. Le principale de la proportion minimale obligatoire entre l'encaisse or de la banque et les montants de ses engagements à vue ( billets + comptes courants ), est adopté. La Banque a fonctionné comme ça jusqu'en 1936. Entre 1936 et 1945, il y a en renforcement du contrôle de l'Etat grâce à la nationalisation. La nationalisaiton s'est faite en 2 temps. D'abord il y a eu la loi du 24 juillet 1936. Ensuite il y a eu la loi du 2 décembre 1945.
Pour commencer par la loi du 24 juillet 1936, il y a plutôt eu ce qu'on peut appeler une démocratisation plus qu'une nationalisation car tous les actionnaires ont obtenus le droit de vote, un avantage certes illusoire. Le conseil des 15 régents est remplacé par un conseil de 23 membres dont 2 sont élus par les actionnaires seulement avec les autres nommés par l'Etat. C'est plus une étatisation qu'une nationalisation donc. Ensuite c'est lors de la loi du 2 décembre 1945 qu'a eu lieu la vraie nationalisation via expropriation des actionnaires. Les actions ont été transférées à l'Etat qui en devient propriétaire. Les anciens actionnaires sont indemnisés. On échange des actions contre des obligations. Par la suite la Banque de France devient une banque centrale nationale. On peut citer 1973 qui marque l'apogée des idées keynésiennes. La politique monétaire n'est à ce moment là qu'un des rouages de la politique économique. Mais la politique monétaire et la Banque centrale donc finit par s'émanciper avec l'émergence de la doctrine monétariste et le renouveau du libéralisme. EN 1936, c'est le stade de l'indépendance. Dans le cadre de l'UE, la Banque de France intègre le SEBC le 1 janvier 1999.
1973 est une date importante car la loi numéro 73 7 du 3 janvier et le décret n 73 102 du 30 janvier ont doté la banque d'une nouvelle charte fixant les règles après avoir énuméré les différentes fonctions de la banque. Les règles concernent son organisation. La charte définit aussi les opération qu'elle peut effectuer pour accomplir ses missions. Le premier alinéa de l'article 1 précise la mission d'ensemble de la Banque de France. " La Banque de France est l'institution qui, dans le cadre de la politique économique et financière de la nation, reçoit de l'Etat la mission de veiller sur la monnaie et le crédit. A ce titre, ele veille au bon fonctionnement du système bancaire. " L'article 25 supprime la possibilité pour la Banque de France d'acheter directement des titres de l'Etat. Cette mesure restera par la suite.
Pour ce qui est de l'organisation de la Banque de France il n'y a pas eu de changement particulièrement profond. Juste des aménagements et c'est toujours 1 gouverneur et 2 sous gouverneurs qui dirigent la Banque de France depuis. Ils sont nommés par décret en Conseil des ministres. Les pouvoirs du gouverneur ont juste été étendus. Aucune durée de mandat n'est prévue et il rst révocable à tout moment. La Banque de France n'est donc pas indépendante du gouvernement à ce moment là. Ses moyens d'intervention sont définis de façon suffisamment généraux pour que son action puisse s'adapter à toutes les évolutions avec souplesse. Mais elle garde une certaine dépendance vis à vis des pouvoirs publics. Elle n'offre donc pas les garanties souhaitées par les opérateurs financiers internationaux pour avoir une confiance totale dans la monnaie. Et ces statuts ne sont pas totalement conformes au traité de Maastricht.
C'est en 1993 que cela devient une institution monétaire indépendante, via la loi numéro 93 - 980 du 4 août 1993. C'est une rupture dans la tendance au renforcement des prérogatives de l'Etat et de l'influence de la politique économique au sein de l'organisme. Cela a pu être fait soit pour séduire les marchés financiers et stopper la spéculation contre le franc qui avait lieu à l'époque, soit pour s'affirmer face à la Bundesbank allemande, soit une mesure d'anticipation des mesures contenues dans le traité de Maastricht. Le premier objectif de la Banque de France était désormais la stabilité des prix. On le voyait dans le premier article. Article 1: La Banque de France définit et met en oeuvre la politique monétaire pour assurer la stabilité des prix. Elle accomplit sa mission dans le cadre de la politique monétaire dans le but d'assurer la stabilité des prix. Elle accomplit sa mission dans le cadre de la politique économique générale du gouvernement. "
La comparaison avec l'ancienne formulation fait ressortir une double restriction. D'une part la Banque était seule pour définir la politique monétaire et d'autre part le rôle donné à la politique monétaire se résumait à une action stabilisatrice des prix en dehors de tout objectif économique. On voit bien l'influence monétariste. La parité du franc et le régime de change restent du ressort du gouvernement. La Banque régularise le taux de change. Pour cela elle détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises. Il était interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprises publics. On le voit via l'article 3. Les restrictions de la loi de 1973 sont rappelées. On les trouve à partir de 1993 dans le CMF ( article L. 141 - 2.). Cette restriction est plus symbolique qu'effective car les procédures fed financement du déficit d'Etat ne font plus appel à la planche à billets depuis longtemps. Mais elle est coûteuse pour l'Etat qui désormais devait s'adresser aux marchés.
MACROECONOMIE MONETAIRE ET FINANCIERE Livre : Macroéconomie monétaire et financière. Théories, institutions, politiques. Jean François Goux.
Le système bancaire.
Les institutions financières monétaires françaises et européennes.
Avant 1999 on pouvait distinguer 3 composantes de ce système en France, à savoir le Trésor, les institutions bancaires et financières et la Banque de France. A cela s'ajoute depuis le système européen de banques centrales, dit SEBC. La BCE désigne ces organismes sous le nom d'institutions financières monétaires, IFM. Les IFM ont 3 grandes catégories d'établissements. Les banques centrales. Ensuite les établissements de crédit résidents au sens du droit communautaire. Ils sont définis comme des entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à consentir des crédits. Enfin l'ensemble des autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts à vue et/ou des substituts proches et à consentir des crédits ou à effectuer des placements en titre.
Des procédures de contrôle ont été mis en place par le SEBC, de vérification et de mise à jour aussi des établissements de crédit formant le secteur des IFM.
Les banques centrales : le cas de la banque de France.
Au fur et à mesure que les billets devenaient une vraie monnaie, le priviliège d'émission a été accordé de façon graduel à une seule banque. C'est le résultat d'une double tendance, le développement du monopole et accroissement des pouvoirs de l'Etat. Elle est nette dans le cas de la France mais cela s'est produit dans la plupart des autres pays, y compris aux USA. La Banque de France est créée le 13 février 1800 sous Bonaparte pour favoriser l'activité économique via l'émission de billets payables à vue et au porteur en contrepartie de l'escompte d'effets de commerce. Ses statuts fondamentaux datent de 1808. C'était un établissement privé sous forme de société anonyme à l'époque. Le tout administré par un gouverneur et 2 sous gouverneurs, nommés par décret. La conseil général, composé de 15 personnes choisies par les assemblées d'actionnaires parmi l'aristocratie financière, doivent les assister. Le droit de vote est réservé seulement aux actionnaires les plus importantes. Ce sont les fameux 200 familles. La Banque de Frnace fonctionnait à la fois comme banque ordinaire et à la fois comme banque d'émission. Son monopole, en tant que banque d'émission, ne date que de 1848. Jusqu'en 1870, elle a bénéficié d'une liberté complète d'émission. Après 1870 : plafond légal. En 1928, la loi du 28 juin abroge le principe du maximum légal. Le principale de la proportion minimale obligatoire entre l'encaisse or de la banque et les montants de ses engagements à vue ( billets + comptes courants ), est adopté. La Banque a fonctionné comme ça jusqu'en 1936. Entre 1936 et 1945, il y a en renforcement du contrôle de l'Etat grâce à la nationalisation. La nationalisaiton s'est faite en 2 temps. D'abord il y a eu la loi du 24 juillet 1936. Ensuite il y a eu la loi du 2 décembre 1945.
Pour commencer par la loi du 24 juillet 1936, il y a plutôt eu ce qu'on peut appeler une démocratisation plus qu'une nationalisation car tous les actionnaires ont obtenus le droit de vote, un avantage certes illusoire. Le conseil des 15 régents est remplacé par un conseil de 23 membres dont 2 sont élus par les actionnaires seulement avec les autres nommés par l'Etat. C'est plus une étatisation qu'une nationalisation donc. Ensuite c'est lors de la loi du 2 décembre 1945 qu'a eu lieu la vraie nationalisation via expropriation des actionnaires. Les actions ont été transférées à l'Etat qui en devient propriétaire. Les anciens actionnaires sont indemnisés. On échange des actions contre des obligations. Par la suite la Banque de France devient une banque centrale nationale. On peut citer 1973 qui marque l'apogée des idées keynésiennes. La politique monétaire n'est à ce moment là qu'un des rouages de la politique économique. Mais la politique monétaire et la Banque centrale donc finit par s'émanciper avec l'émergence de la doctrine monétariste et le renouveau du libéralisme. EN 1936, c'est le stade de l'indépendance. Dans le cadre de l'UE, la Banque de France intègre le SEBC le 1 janvier 1999.
1973 est une date importante car la loi numéro 73 7 du 3 janvier et le décret n 73 102 du 30 janvier ont doté la banque d'une nouvelle charte fixant les règles après avoir énuméré les différentes fonctions de la banque. Les règles concernent son organisation. La charte définit aussi les opération qu'elle peut effectuer pour accomplir ses missions. Le premier alinéa de l'article 1 précise la mission d'ensemble de la Banque de France. " La Banque de France est l'institution qui, dans le cadre de la politique économique et financière de la nation, reçoit de l'Etat la mission de veiller sur la monnaie et le crédit. A ce titre, ele veille au bon fonctionnement du système bancaire. " L'article 25 supprime la possibilité pour la Banque de France d'acheter directement des titres de l'Etat. Cette mesure restera par la suite.
Pour ce qui est de l'organisation de la Banque de France il n'y a pas eu de changement particulièrement profond. Juste des aménagements et c'est toujours 1 gouverneur et 2 sous gouverneurs qui dirigent la Banque de France depuis. Ils sont nommés par décret en Conseil des ministres. Les pouvoirs du gouverneur ont juste été étendus. Aucune durée de mandat n'est prévue et il rst révocable à tout moment. La Banque de France n'est donc pas indépendante du gouvernement à ce moment là. Ses moyens d'intervention sont définis de façon suffisamment généraux pour que son action puisse s'adapter à toutes les évolutions avec souplesse. Mais elle garde une certaine dépendance vis à vis des pouvoirs publics. Elle n'offre donc pas les garanties souhaitées par les opérateurs financiers internationaux pour avoir une confiance totale dans la monnaie. Et ces statuts ne sont pas totalement conformes au traité de Maastricht.
C'est en 1993 que cela devient une institution monétaire indépendante, via la loi numéro 93 - 980 du 4 août 1993. C'est une rupture dans la tendance au renforcement des prérogatives de l'Etat et de l'influence de la politique économique au sein de l'organisme. Cela a pu être fait soit pour séduire les marchés financiers et stopper la spéculation contre le franc qui avait lieu à l'époque, soit pour s'affirmer face à la Bundesbank allemande, soit une mesure d'anticipation des mesures contenues dans le traité de Maastricht. Le premier objectif de la Banque de France était désormais la stabilité des prix. On le voyait dans le premier article. Article 1: La Banque de France définit et met en oeuvre la politique monétaire pour assurer la stabilité des prix. Elle accomplit sa mission dans le cadre de la politique monétaire dans le but d'assurer la stabilité des prix. Elle accomplit sa mission dans le cadre de la politique économique générale du gouvernement. "
La comparaison avec l'ancienne formulation fait ressortir une double restriction. D'une part la Banque était seule pour définir la politique monétaire et d'autre part le rôle donné à la politique monétaire se résumait à une action stabilisatrice des prix en dehors de tout objectif économique. On voit bien l'influence monétariste. La parité du franc et le régime de change restent du ressort du gouvernement. La Banque régularise le taux de change. Pour cela elle détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises. Il était interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprises publics. On le voit via l'article 3. Les restrictions de la loi de 1973 sont rappelées. On les trouve à partir de 1993 dans le CMF ( article L. 141 - 2.). Cette restriction est plus symbolique qu'effective car les procédures fed financement du déficit d'Etat ne font plus appel à la planche à billets depuis longtemps. Mais elle est coûteuse pour l'Etat qui désormais devait s'adresser aux marchés.
il y a 4 mois
Post.

La Banque continuait d'être la seule habilitée à émettre la monnaie légale sous forme de billets. Elle assurer dans le cadre du partage des responsabilités instauré par la loi bancaire de 1984, la présidence de la commission bancaire et du comité des établissements de crédit, ce qui lui confère un rôle de surveillance du système bancaire et des mécanismes de paiement. Le conseil de la politique monétaire était une nouvelle instance surveillant l'évolution de la masse monétaire et définissant les opérations auxquelles la banque procédait, notamment sur le marché monétaire. Ce conseil détermine aussi les obligations que la politique monétaire peut conduire à poser aux établissements de crédit, par exemple les réserves obligatoires. Ce conseil comprend outre le gouverneur et les 2 sous gouverneurs, 6 membres choisis en raison de leurs compétences dans le domaine économique et monétaire. Pour ce qui est du conseil général, ses attributions étaient bien plus réduites par rapport aux textes antérieurs étant donné la mise en place du conseil de la politique monétaire. Le gouvernement est y représenté par un censeur qui a un droit de veto. Enfin, concernant le gouverneur, il préside 2 conseils. Il est nommé, ainsi que les 2 sou gouverneurs, via décret en conseil des ministres, le tout pour une durée de 6 ans. Il n'est pas révocable et en principe, donc il est totalement indépendant. La loi du 12 mai 1998 est aussi l'une des dates les plus importantes de la Banque de France. Cette loi s'appliquait à partir du 1 janvier 1999 et la plupart des prérogatives monétaires ont été transférées à la Banque centrale européenne. Le premier alinéa de l'article 1 précise : " La Banque de France fait partie intégrant du système européen de banques centrales, institué par l'article 4 A du traité instituant la communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui ci par le traité. "
Autrement dit, la Banque de France n'est plus qu'un rouage du SEBC. Elle continue malgré tout à émettre les billets, en euro, sur son territoire exclusivement, avec l'autorisation de la BCE. Le conseil de la politique monétaire, qui disparait, n'a plus qu'un rôle technique ou subalterne de mise en oeuvre de la politique monétaire élaborée au niveau du SEBC, sous le nom de Comité monétaire du Conseil général depuis 2007. En 2009, il disparaît définitivement. Le SEBC est institué en vertu de l'article 4 A du traité de Maastricht. Il est composé de la BCE et des banques centrales nationales des états membres de l'UE. On désigne par le terme d'eurosystème l'ensemble formé par la BCE et les BCN des pays membres ayant adopté l'euro. Il y a donc une différence entre l'eurosystème et le SEBC. Les objectifs du SEBC sont définis par l'article 127 du TFUE ( Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ). Cet article est l'ex article 105 du Traité de Maastricht. Il stipule que : " L'objectif principal du système européen de banques centrales, ci après dénommé SEBC, est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice à l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du TFUE. Cet article 3 qui est l'ex article 2 du TUE, précise que " l'Union oeuvre pour le développement durable de l'EUrope fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitivité, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.".
On en déduit que la BCE a 2 objectifs hiérarchisés car si objectif principal il y a, il y a forcément dans le même temps un objectif secondaire. L'objectif principale est la stabilité des prix. Pendant ce temps, l'objectif secondaire est le soutien aux politiques économiques générales de l'UE et par définition, selon l'article 3: la croissance, le plein emploi et la protection sociale. Les missions fondamentales consistent à définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'UE, conduire les opérations de change de façon conforme à l'article 219 du TFUE, détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres. Et enfin, promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. En plus de cela, le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités pour ce qui est du contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier via l'article 127 du TFUE. Le SEBC a aussi des fonctions consultatives dans différents domaines, ainsi qu'un rôle dans la collecte d'informations statistiques. Les organismes du SEBC, que ce soit la BCE, le conseil des gouvernements, le directoire, le président, les banques centrales nationales, sont indépendants des gouvernements et des institutions européennes. La BCE est l'organisme principal du SEBC dont elle est l'exécutif. Elle a une personnalité juridique. Le directoire et le conseil des gouverneurs sont ses organes de décision. Elle est dirigée par un président. Le directoire compte le président, le vice président, et 4 autres membres. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres. Les mandants ne sont pas renouvelables et ont une durée de 8 ans. Le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales de l'eurosystème. Le conseil des gouverneurs est l'organise de décision suprême de la BCE.
Selon le traité de Maastricht, les principales responsabilités des gouverneurs sont : Arrêter les grandes orientations et prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC. Et définir la politique monétaire. Pour ce qui est du conseil général, son rôle est modeste et avant tout prospectif. Il fait des missions reprises de l'Institut Monétaire Européen pendant la phase III de l'UME, pour les Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro. Aujourd'hui il sert avant tout d'antichambre pour les pays candidats à l'entrée dans l'eurosystème et qui, en attendant, participent au SME bis. Pour ce qui est du directoire, les principales responsabilités du directoire sont la mise en oeuvre de la politique monétaire conformément aux décisions et orientations du conseil des gouverneurs, l'exécution des affaires courantes de la BCE, la transmission des instructions nécessaires aux BCN de l'eurosystème, la préparation des réunions du conseil des gouverneurs. Enfin, exercer de certains pouvoirs délégués par le conseil des gouverneurs. Il y a une banque centrale par pays et elles font partie du SEBC. Ces banques agissent de façon conforme aux orientations de la BCE dans le cadre de l'eurosystème et notamment dans le domaine de la politique monétaire. Celles appartenant à l'eurosystème n'ont quasiment aucune autonomie, à part pour des fonctions très secondaires. Ce n'est pas le cas des banques centrales de pays n'étant pas dans la zone euro qui conservent toutes leurs prérogatives. Un gouverneur est là pour diriger les banques centrales nationales. Leurs statuts doivent être conformes aux principes du traité et particulièrement à ceux du SEBC.
La Banque continuait d'être la seule habilitée à émettre la monnaie légale sous forme de billets. Elle assurer dans le cadre du partage des responsabilités instauré par la loi bancaire de 1984, la présidence de la commission bancaire et du comité des établissements de crédit, ce qui lui confère un rôle de surveillance du système bancaire et des mécanismes de paiement. Le conseil de la politique monétaire était une nouvelle instance surveillant l'évolution de la masse monétaire et définissant les opérations auxquelles la banque procédait, notamment sur le marché monétaire. Ce conseil détermine aussi les obligations que la politique monétaire peut conduire à poser aux établissements de crédit, par exemple les réserves obligatoires. Ce conseil comprend outre le gouverneur et les 2 sous gouverneurs, 6 membres choisis en raison de leurs compétences dans le domaine économique et monétaire. Pour ce qui est du conseil général, ses attributions étaient bien plus réduites par rapport aux textes antérieurs étant donné la mise en place du conseil de la politique monétaire. Le gouvernement est y représenté par un censeur qui a un droit de veto. Enfin, concernant le gouverneur, il préside 2 conseils. Il est nommé, ainsi que les 2 sou gouverneurs, via décret en conseil des ministres, le tout pour une durée de 6 ans. Il n'est pas révocable et en principe, donc il est totalement indépendant. La loi du 12 mai 1998 est aussi l'une des dates les plus importantes de la Banque de France. Cette loi s'appliquait à partir du 1 janvier 1999 et la plupart des prérogatives monétaires ont été transférées à la Banque centrale européenne. Le premier alinéa de l'article 1 précise : " La Banque de France fait partie intégrant du système européen de banques centrales, institué par l'article 4 A du traité instituant la communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui ci par le traité. "
Autrement dit, la Banque de France n'est plus qu'un rouage du SEBC. Elle continue malgré tout à émettre les billets, en euro, sur son territoire exclusivement, avec l'autorisation de la BCE. Le conseil de la politique monétaire, qui disparait, n'a plus qu'un rôle technique ou subalterne de mise en oeuvre de la politique monétaire élaborée au niveau du SEBC, sous le nom de Comité monétaire du Conseil général depuis 2007. En 2009, il disparaît définitivement. Le SEBC est institué en vertu de l'article 4 A du traité de Maastricht. Il est composé de la BCE et des banques centrales nationales des états membres de l'UE. On désigne par le terme d'eurosystème l'ensemble formé par la BCE et les BCN des pays membres ayant adopté l'euro. Il y a donc une différence entre l'eurosystème et le SEBC. Les objectifs du SEBC sont définis par l'article 127 du TFUE ( Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ). Cet article est l'ex article 105 du Traité de Maastricht. Il stipule que : " L'objectif principal du système européen de banques centrales, ci après dénommé SEBC, est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice à l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du TFUE. Cet article 3 qui est l'ex article 2 du TUE, précise que " l'Union oeuvre pour le développement durable de l'EUrope fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitivité, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.".
On en déduit que la BCE a 2 objectifs hiérarchisés car si objectif principal il y a, il y a forcément dans le même temps un objectif secondaire. L'objectif principale est la stabilité des prix. Pendant ce temps, l'objectif secondaire est le soutien aux politiques économiques générales de l'UE et par définition, selon l'article 3: la croissance, le plein emploi et la protection sociale. Les missions fondamentales consistent à définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'UE, conduire les opérations de change de façon conforme à l'article 219 du TFUE, détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres. Et enfin, promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. En plus de cela, le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités pour ce qui est du contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier via l'article 127 du TFUE. Le SEBC a aussi des fonctions consultatives dans différents domaines, ainsi qu'un rôle dans la collecte d'informations statistiques. Les organismes du SEBC, que ce soit la BCE, le conseil des gouvernements, le directoire, le président, les banques centrales nationales, sont indépendants des gouvernements et des institutions européennes. La BCE est l'organisme principal du SEBC dont elle est l'exécutif. Elle a une personnalité juridique. Le directoire et le conseil des gouverneurs sont ses organes de décision. Elle est dirigée par un président. Le directoire compte le président, le vice président, et 4 autres membres. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres. Les mandants ne sont pas renouvelables et ont une durée de 8 ans. Le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales de l'eurosystème. Le conseil des gouverneurs est l'organise de décision suprême de la BCE.
Selon le traité de Maastricht, les principales responsabilités des gouverneurs sont : Arrêter les grandes orientations et prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC. Et définir la politique monétaire. Pour ce qui est du conseil général, son rôle est modeste et avant tout prospectif. Il fait des missions reprises de l'Institut Monétaire Européen pendant la phase III de l'UME, pour les Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro. Aujourd'hui il sert avant tout d'antichambre pour les pays candidats à l'entrée dans l'eurosystème et qui, en attendant, participent au SME bis. Pour ce qui est du directoire, les principales responsabilités du directoire sont la mise en oeuvre de la politique monétaire conformément aux décisions et orientations du conseil des gouverneurs, l'exécution des affaires courantes de la BCE, la transmission des instructions nécessaires aux BCN de l'eurosystème, la préparation des réunions du conseil des gouverneurs. Enfin, exercer de certains pouvoirs délégués par le conseil des gouverneurs. Il y a une banque centrale par pays et elles font partie du SEBC. Ces banques agissent de façon conforme aux orientations de la BCE dans le cadre de l'eurosystème et notamment dans le domaine de la politique monétaire. Celles appartenant à l'eurosystème n'ont quasiment aucune autonomie, à part pour des fonctions très secondaires. Ce n'est pas le cas des banques centrales de pays n'étant pas dans la zone euro qui conservent toutes leurs prérogatives. Un gouverneur est là pour diriger les banques centrales nationales. Leurs statuts doivent être conformes aux principes du traité et particulièrement à ceux du SEBC.
il y a 4 mois
Comment je me suis encore fait avoir par contre.

C'est aussi le cas pour la Banque de France. Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC au sein de l'eurosystème. C'est lui qui définit la politique monétaire y compris le cas échéant, ls décisions concernant les objectifs monétaires, les taux directeurs et les réserves obligatoires. Le directoire met en oeuvre la politique monétaire et donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales que celles ci sont chargées d'exécuter. Pour atteindre les objectifs du SEBC, la BCE et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants. Ils peuvent également intervenir sur le marché monétaire dans le cadre d'opérations d'open market que ce soit par achat ou vente ferme, ou prise en pension ou prêt ou emprunt de créances et de titres négociables. La BCE est habilitée à imposer aux établissements de crédit des états membres de l'UEM la constitution de réserves obligatoires auprès d'elle même ou des banques centrales nationales. La zone euro a connu 2 progrès significatifs, à savoir le MES et la supervision bancaire unifiée applicable à la zone euro à partir du premier mars 2014. Ce sont les premiers pas vers une union bancaire. Le MES est le mécanisme européen de stabilité. C'est un système de gestion des crises financières uniquement au sein de la zone euro. Il remplace le FESF, qui est le fonds de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité financière, notée MESF, qui étaient provisoires. C'est le 27 novembre 2012 que le nouveau système était entré en vigueur. Une institution financière internationale est créé via une simple modification du traité FUE. L'institution peut lever des fonds sur les marchés financiers pour aider sous conditions les états en difficulté, notamment pour participer au sauvetage des banques.
C'est une sorte de FMI mais à l'échelle européenne. Mais cela ne se fait pas gratuitement. Il y a des conditions. Et ces conditions incluent la coordination, la gouvernance et l'adhésion au traité sur la stabilité. Jusqu'à 2014, chaque pays avait son propre système de réglementation et de supervisions bancaires. En France, c'était l'autorité de contrôle prudentiel qui veillait au respect des règles par les banques voire éventuellement par les assurances. Or l'intégration dans la zone euro ne permettait pas cette séparation nationale sur le long terme. D'où la nécessité de mettre en place une supervision unique. Elle garantit à chaque pays que son voisin est soumis aux mêmes exigences et subira les mêmes mesures corrective en cas de défaillance. Cette instance est vue par certains comme nécessaires aussi pour permettre la recapitalisation directe de banques par le mécanisme européen de stabilité plutôt que par les Etats eux mêmes. Cela est censé dissocier les crises bancaires systémique des crises de dettes souveraines. Concernant la stabilité financière des banques, y compris en dehors de la zone euro pour les pays de l'UE acceptant le système, c'est la BCE qui exerce les missions de surveillance spécifiques. C'est elle qui gérera les EC et fera respecter les exigences en matière de fonds propres, d'endettement et de liquidité. Elle pourra obliger l'établissement à prendre des mesures correctives. Les autorités de surveillance nationales ne disparaissent pas mais elles s'occuperont des petites banques et des opérations courantes. Seules les plus grosses ( environ 200 ), seront supervisée directement par la BCE. L'accord, crée au sein de la BCE, un conseil de surveillance s'ajoutant aux autres institutions déjà présentes du SEB. C'est une instance collégiale prenant toutes les décisions importantes et exerçant ses pouvoirs en accord avec le conseil des gouverneurs de la BCE.
Pour ce qui est des institutions financières et bancaires françaises, il faut distinguer les banques au sens général du terme, des autres établissements de crédit et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, c'est à dire les OPCVM qui n'ont pas le statut d'établissement de crédit mais qui en dépendent souvent. Pour ce qui est des banques FBF, banques mutuelles et coopératives, caisses de crédit municipal, l'organisation d'aujourd'hui s'est faite en 6 étapes. D'abord 1945, ensuite 1966-1967, ensuite 1982, puis 1984, et puis 1987-1993 et enfin 1999-2000. Les banques en France se sont beaucoup développées durant la deuxième moitié du XIXème siècle grâce aux dépôts des entreprises et des particuliers. La tentation était grande d'utiliser ces fonds à court terme pour des opérations de longue durée, ce qui a entraîné des faillites ou des difficultés. La doctrine élaborée à l'époque pour lutter contre était l'utilisation de dépôt à vue uniquement pour des opérations à court terme via l'achat d'effets de commerce ou de créance. Mais la confusion entre activité des banques d'affaires et activités des banques de dépôts persiste jusqu'en 1945. La loi de 1945 a vu le jour parce qu'il y avait cette volonté de restituer le pouvoir monétaire à l'Etat via la nationalisation des 4 banques principales de dépôt. Il voit aussi dans cette loi du 2 décembre 1945 que 3 catégories de banques sont créées. Il y bien sûr les banques de dépôts et les banques d'affaires. Mais surtout il y a les banques de crédit à moyen et long terme. Aujourd'hui cela ne fonctionne plus de cette manière.
" Les banques de dépôts reçoivent du public des dépôts à vue ou à un terme qui ne peut être supérieure à deux ans. Elles ne peuvent détenir dans les entreprises autres que des banques, des établissements financiers ou des sociétés immobilières nécessaires à leur exploitation, des participations pour un montant dépassant 10% du capital de ces entreprises. L'ensemble de ces participations ne peut excéder 75% de leurs ressources propres, c'est à dire de leur capital et de leurs reserves, sauf autorisation accordée par la Comité des dépôts du Conseil national du crédit. "
" Les banques d'affaires sont celles dont l'activité principale est la prise et la gestion de participations dans des affaires existantes ou en formation et l'ouverture de crédits, sans limitation de durée, aux entreprises publiques ou privées qui bénéficient, ont bénéficié ou doivent bénéficier des dites participations. Elles ne peuvent investir dans celles ci que des fonds provenant de leurs ressources propres ou de dépôts, stipulés avec 2 ans au moins de terme ou de préavis. Elles ne peuvent ouvrir de comptes de dépôts qu'à leur personnel, aux entreprises qui ont fait l'objet d'ouverture de crédits ou bénéficié de participations aux personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçants pour l'exercice de leur activité professionnel.
Ensuite il y a eu la réforme de 1966 - 1967. Cette réforme avait pour objectif de supprimer ce cloisonnement qui était devenu un frein au développement de l’activité bancaire. Les gens à l'origine de la réforme voulaient adapter le système financier aux besoins d'investissement de l'économie et également manifester la volonté de retrait de l'Etat des circuits de financement au profit du secteur bancaire traditionnel dans une perspective libérale. Dans le mesure où l'Etat c'est à dire le FDES et le Trésor, se retirait, une pénurie de capitaux long risquait d'apparaître et c'était nécessaire dans ce cas de pratiquer la transformation, soit utiliser des ressources à court terme ou à vue pour des financements à long terme. La solution était possible en raison de la part de plus en plus importante de la monnaie scripturale et de la confiance quasi totale du public dans les banques à l'époque. Il fallait donc permettre aux banques d'affaires d'accéder plus facilement aux dépôts et de même, permettre aux banques de dépôts de participer plus activement à la vie économique. Il y avait aussi un souci de réanimer la concurrence au sein du secteur. La réforme a eu pour objet d'opérer un rapprochement entre les banques de dépôts et d'affaires et pas de supprime complètement la distinction entre les 2 car à l'époque les 2 catégories avaient encore une existence juridique. D'où l'unification des conditions de collectes des dépôts et l'octroi des crédits, l'extension de la faculté donnée aux banques de dépôts de prendre des participations. Enfin, en 1867, les limites de 10% et 75% ont été portées respectivement à 20% et à 100%.
C'est aussi le cas pour la Banque de France. Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC au sein de l'eurosystème. C'est lui qui définit la politique monétaire y compris le cas échéant, ls décisions concernant les objectifs monétaires, les taux directeurs et les réserves obligatoires. Le directoire met en oeuvre la politique monétaire et donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales que celles ci sont chargées d'exécuter. Pour atteindre les objectifs du SEBC, la BCE et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants. Ils peuvent également intervenir sur le marché monétaire dans le cadre d'opérations d'open market que ce soit par achat ou vente ferme, ou prise en pension ou prêt ou emprunt de créances et de titres négociables. La BCE est habilitée à imposer aux établissements de crédit des états membres de l'UEM la constitution de réserves obligatoires auprès d'elle même ou des banques centrales nationales. La zone euro a connu 2 progrès significatifs, à savoir le MES et la supervision bancaire unifiée applicable à la zone euro à partir du premier mars 2014. Ce sont les premiers pas vers une union bancaire. Le MES est le mécanisme européen de stabilité. C'est un système de gestion des crises financières uniquement au sein de la zone euro. Il remplace le FESF, qui est le fonds de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité financière, notée MESF, qui étaient provisoires. C'est le 27 novembre 2012 que le nouveau système était entré en vigueur. Une institution financière internationale est créé via une simple modification du traité FUE. L'institution peut lever des fonds sur les marchés financiers pour aider sous conditions les états en difficulté, notamment pour participer au sauvetage des banques.
C'est une sorte de FMI mais à l'échelle européenne. Mais cela ne se fait pas gratuitement. Il y a des conditions. Et ces conditions incluent la coordination, la gouvernance et l'adhésion au traité sur la stabilité. Jusqu'à 2014, chaque pays avait son propre système de réglementation et de supervisions bancaires. En France, c'était l'autorité de contrôle prudentiel qui veillait au respect des règles par les banques voire éventuellement par les assurances. Or l'intégration dans la zone euro ne permettait pas cette séparation nationale sur le long terme. D'où la nécessité de mettre en place une supervision unique. Elle garantit à chaque pays que son voisin est soumis aux mêmes exigences et subira les mêmes mesures corrective en cas de défaillance. Cette instance est vue par certains comme nécessaires aussi pour permettre la recapitalisation directe de banques par le mécanisme européen de stabilité plutôt que par les Etats eux mêmes. Cela est censé dissocier les crises bancaires systémique des crises de dettes souveraines. Concernant la stabilité financière des banques, y compris en dehors de la zone euro pour les pays de l'UE acceptant le système, c'est la BCE qui exerce les missions de surveillance spécifiques. C'est elle qui gérera les EC et fera respecter les exigences en matière de fonds propres, d'endettement et de liquidité. Elle pourra obliger l'établissement à prendre des mesures correctives. Les autorités de surveillance nationales ne disparaissent pas mais elles s'occuperont des petites banques et des opérations courantes. Seules les plus grosses ( environ 200 ), seront supervisée directement par la BCE. L'accord, crée au sein de la BCE, un conseil de surveillance s'ajoutant aux autres institutions déjà présentes du SEB. C'est une instance collégiale prenant toutes les décisions importantes et exerçant ses pouvoirs en accord avec le conseil des gouverneurs de la BCE.
Pour ce qui est des institutions financières et bancaires françaises, il faut distinguer les banques au sens général du terme, des autres établissements de crédit et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, c'est à dire les OPCVM qui n'ont pas le statut d'établissement de crédit mais qui en dépendent souvent. Pour ce qui est des banques FBF, banques mutuelles et coopératives, caisses de crédit municipal, l'organisation d'aujourd'hui s'est faite en 6 étapes. D'abord 1945, ensuite 1966-1967, ensuite 1982, puis 1984, et puis 1987-1993 et enfin 1999-2000. Les banques en France se sont beaucoup développées durant la deuxième moitié du XIXème siècle grâce aux dépôts des entreprises et des particuliers. La tentation était grande d'utiliser ces fonds à court terme pour des opérations de longue durée, ce qui a entraîné des faillites ou des difficultés. La doctrine élaborée à l'époque pour lutter contre était l'utilisation de dépôt à vue uniquement pour des opérations à court terme via l'achat d'effets de commerce ou de créance. Mais la confusion entre activité des banques d'affaires et activités des banques de dépôts persiste jusqu'en 1945. La loi de 1945 a vu le jour parce qu'il y avait cette volonté de restituer le pouvoir monétaire à l'Etat via la nationalisation des 4 banques principales de dépôt. Il voit aussi dans cette loi du 2 décembre 1945 que 3 catégories de banques sont créées. Il y bien sûr les banques de dépôts et les banques d'affaires. Mais surtout il y a les banques de crédit à moyen et long terme. Aujourd'hui cela ne fonctionne plus de cette manière.
" Les banques de dépôts reçoivent du public des dépôts à vue ou à un terme qui ne peut être supérieure à deux ans. Elles ne peuvent détenir dans les entreprises autres que des banques, des établissements financiers ou des sociétés immobilières nécessaires à leur exploitation, des participations pour un montant dépassant 10% du capital de ces entreprises. L'ensemble de ces participations ne peut excéder 75% de leurs ressources propres, c'est à dire de leur capital et de leurs reserves, sauf autorisation accordée par la Comité des dépôts du Conseil national du crédit. "
" Les banques d'affaires sont celles dont l'activité principale est la prise et la gestion de participations dans des affaires existantes ou en formation et l'ouverture de crédits, sans limitation de durée, aux entreprises publiques ou privées qui bénéficient, ont bénéficié ou doivent bénéficier des dites participations. Elles ne peuvent investir dans celles ci que des fonds provenant de leurs ressources propres ou de dépôts, stipulés avec 2 ans au moins de terme ou de préavis. Elles ne peuvent ouvrir de comptes de dépôts qu'à leur personnel, aux entreprises qui ont fait l'objet d'ouverture de crédits ou bénéficié de participations aux personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçants pour l'exercice de leur activité professionnel.
Ensuite il y a eu la réforme de 1966 - 1967. Cette réforme avait pour objectif de supprimer ce cloisonnement qui était devenu un frein au développement de l’activité bancaire. Les gens à l'origine de la réforme voulaient adapter le système financier aux besoins d'investissement de l'économie et également manifester la volonté de retrait de l'Etat des circuits de financement au profit du secteur bancaire traditionnel dans une perspective libérale. Dans le mesure où l'Etat c'est à dire le FDES et le Trésor, se retirait, une pénurie de capitaux long risquait d'apparaître et c'était nécessaire dans ce cas de pratiquer la transformation, soit utiliser des ressources à court terme ou à vue pour des financements à long terme. La solution était possible en raison de la part de plus en plus importante de la monnaie scripturale et de la confiance quasi totale du public dans les banques à l'époque. Il fallait donc permettre aux banques d'affaires d'accéder plus facilement aux dépôts et de même, permettre aux banques de dépôts de participer plus activement à la vie économique. Il y avait aussi un souci de réanimer la concurrence au sein du secteur. La réforme a eu pour objet d'opérer un rapprochement entre les banques de dépôts et d'affaires et pas de supprime complètement la distinction entre les 2 car à l'époque les 2 catégories avaient encore une existence juridique. D'où l'unification des conditions de collectes des dépôts et l'octroi des crédits, l'extension de la faculté donnée aux banques de dépôts de prendre des participations. Enfin, en 1867, les limites de 10% et 75% ont été portées respectivement à 20% et à 100%.
il y a 4 mois