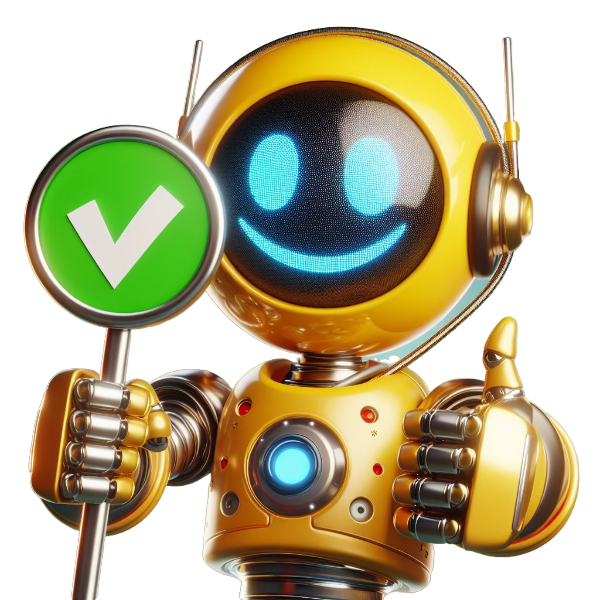Ce sujet a été résolu
Je lis le préambule de Constitution de 1946 (IVème République), qui EST EN VIGUEUR.
Je répète, ce préambule fait partie de notre Constitution actuelle, donc c'est théoriquement applicable là maintenant.

Hé bien nous trouvons un passage fort intéressant à l'alinéa 9 :
"Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité"
En somme, notre constitution est radicalement anti-monopoles privés.
Dommage que ça ne soit pas appliqué

Je répète, ce préambule fait partie de notre Constitution actuelle, donc c'est théoriquement applicable là maintenant.
Hé bien nous trouvons un passage fort intéressant à l'alinéa 9 :
"Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité"
En somme, notre constitution est radicalement anti-monopoles privés.
Dommage que ça ne soit pas appliqué
Au plaisir ~

il y a 4 mois
En même temps la constitution française se résume à l'article 49.3 aujourd'hui. Y'a strictement rien qui y est respecté sauf ce truc-là, qui est d'ailleurs utilisé contre son esprit originel puisqu'il était là pour permettre au gouvernement de court-circuiter les assemblées parce qu'il avait l'assentiment populaire.

Et toc la mauvaise foi

il y a 4 mois
Sneaky
4 mois
En même temps la constitution française se résume à l'article 49.3 aujourd'hui. Y'a strictement rien qui y est respecté sauf ce truc-là, qui est d'ailleurs utilisé contre son esprit originel puisqu'il était là pour permettre au gouvernement de court-circuiter les assemblées parce qu'il avait l'assentiment populaire.

Oui

Au plaisir ~

il y a 4 mois
Putaso
4 mois
Je lis le préambule de Constitution de 1946 (IVème République), qui EST EN VIGUEUR.
Je répète, ce préambule fait partie de notre Constitution actuelle, donc c'est théoriquement applicable là maintenant.

Hé bien nous trouvons un passage fort intéressant à l'alinéa 9 :
"Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité"
En somme, notre constitution est radicalement anti-monopoles privés.
Dommage que ça ne soit pas appliqué

Je répète, ce préambule fait partie de notre Constitution actuelle, donc c'est théoriquement applicable là maintenant.
Hé bien nous trouvons un passage fort intéressant à l'alinéa 9 :
"Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité"
En somme, notre constitution est radicalement anti-monopoles privés.
Dommage que ça ne soit pas appliqué
C'est extrêmement puissant mine de rien. Ce petit alinéa peut démolir des multinationales.
Je vous aime tous


Tu ne fais pas exception
il y a 4 mois
C'est extrêmement puissant mine de rien. Ce petit alinéa peut démolir des multinationales.
Il faudrait s'en servir m

Au plaisir ~

il y a 4 mois
Il faudrait s'en servir m

C'est même interdit de ne pas s'en servir
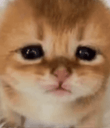
Je vous aime tous


Tu ne fais pas exception
il y a 4 mois
Topic intéressant l'auteur.

Cela me rappelle certains cours de microéconomie et autres.

100 fiches de micro et macro économie.
Cartel.
En situation d'oligopole, les entreprises peuvent s'entendre pour restreindre la concurrence en formant un cartel. L'oligopole est une situation de marché où un petit nombre d'entreprises fait face à un grand nombre d'acheteurs et où les décisions d'une entreprise ont des conséquence sur toutes les autres. Pour éviter une concurrence préjudiciable, les producteurs peuvent s'entendre entre eux pour restreindre leur production et augmenter le prix de vente. La collusion ou l'entente peut être soit implicite soit explicite. A la fin du XIXème siècle, les grandes entreprises allemandes avaient fait ce genre de collusion. On trouvait cela aussi entre les pays producteurs de pétrole à la création de l'OPEP en 1960. Pour que les entreprises aient intérêt à former un cartel, il faut que la demande soit peu élastique au prix pour éviter que les gains tirés d'un prix élevé soit annulés par une forte baisse des ventes. Que le cartel contrôle la quasi totalité du marché pour que des entreprises non membres du cartel ne vendent pas à des prix plus faibles, réduisant les parts de marché du cartel. Les coûts d'organisation du cartel soient faibles, et la détection des entreprises ne respectant pas l'accord efficace. Que le bien produit soit homogène car des biens différenciés rendent le contrôle du prix de vente plus difficile. Que les sanctions financières prises par les pouvoirs publics en cas de découverte du cartel soient peu importantes. Enfin, que la détection des ' tricheurs ', des entreprises qui ne respectent pas l'accord, soit aisée.
Les producteurs formant un cartel créent un organisme commun déterminant la répartition de la production, le prix de vente et le partage des profits. Le cartel se comporte comme un monopole à plusieurs établissements. Il maximise son profit quand les quantités produites par les entreprises membres sont telles que la recette marginale est égale au coût marginal de chaque entreprise. Comme la recette marginale est identique pour toutes les entreprises, les quantités produites par chaque entreprise doivent être telles que le coût marginal de chaque entreprise soit identique. Si toutes les entreprises ont le même coût marginal, la production est la même pour chaque entreprise. Si les coûts marginaux sont différents, les entreprises dont les coûts sont plus élevés se voient attribuer un volume de production plus faible. Le profit réparti se prorata de la production de chaque entreprise. Le cartel doit mettre en place un contrôle pour éviter que des entreprises ne se comportent en ' passager clandestin ', ne soient incitées soit à profiter du prix élevé pour augmenter leur volume de production, soit à baisser leur prix pour accroître leurs parts de marché. Les cartels sont généralement interdits par les pouvoirs publics car suspectés de réduire le bien être collectif en restreignant la concurrence. Le Sherman Act de 1890 pour les USA et l'article 81 du TUE pour l'Europe sanctionnent ces ententes même si c'est difficile de les détecter la plupart des cas quand elles sont tacites en particulier. La distinction entre entente illégale et légale n'est pas assez précise. Certaines entreprises peuvent être tentées de rompre l'accord pour augmenter leur profit. La formation de cartel nécessite souvent des coûts de surveillance élevée pour détecter les tricheurs. Si le marché est contestable et si le cartel réalise des profits importants, de nouvelles entreprises peuvent arriver sur le marché et vendre moins cher.
Le cartel peut être stable sous certaines conditions. Que le faible nombre d'entreprises pour pour détecter plus facilement les tricheurs 2 : capacités de production utilisées à 100% pour ne pas avoir intérêt à augmenter la production. 3 : Nombre d'acheteurs élevés car dans ce cas c'est difficile de maintenir secret une baisse des prix et plus facile de détecter les tricheurs 4 : Produits peu différenciés, demande stable ou facile à anticiper pour maîtriser l'évolution des prix.; 5 : Coûts relativement stables. Dans les secteurs à progrès technique rapide, les innovations, en modifiant les coûts et les produits, rendent difficile la formation de cartels. Bien que les entreprises aient intérêt à faire ça, la stratégie n'est valable qu'à court terme. A long terme, la rupture de l'accord peut dégénérer en guerre des prix. Autant respecter l'accord. Les pouvoirs publics peuvent être également contrariants. Et la stratégie des entreprises membres du cartel également peuvent le contrarier. Sous certaines conditions ceci dit, le cartel peut être durable.
Le duopole.
C'est une structure de marché caractériser par 2 producteurs face à un très grand nombre d'acheteurs. En cas de coopérations, les 2 producteurs peuvent adopter des stratégies de quantités ou de prix. L'oligopole se caractérise par un petit nombre de producteurs face à un grand nombre d'acheteurs. Ces producteurs sont interdépendants car ils doivent tenir compte des décisions des autres ce qui n'est le cas ni en concurrence pure et parfaite, ni en situation de monopole. Le duopole est un cas particulier de l'oligopole dans lequel seuls deux producteurs approvisionnent la totalité du marché. Au XIXème siècle, des économistes avaient proposé des modèles de duopole dont les conclusions pouvaient être étendues aux oligopoles. Ces modèles reprennent certaines hypothèses de concurrence pure et parfaite notamment l'homogénéité des produits et la transparence. Mais ils s'écartent du modèle standard car les hypothèses d'atomicité et de libre entrée sur le marché ne sont pas vérifiées. Les duopoleurs peuvent décider de s'entendre ou pas. En cas de non coopération, ils font des stratégies de quantités ou des stratégies de prix, déterminent d'abord leur niveau de production ou d'abord leur prix. Dans le premier cas les producteurs influence par les quantités offertes les prix du marché sans être pour autant dans une situation de monopole car ils se concurrencent mutuellement et qu'il est difficile de ne pas tenir compte du comportement de l'autre producteur. Le prix et donc le profit, dépendent de la production des 2 producteurs. Les entreprises A et B doivent déterminer le niveau de leur production en tenant compte de la production de l'autre. La fonction de réaction de A permet de connaître les quantités de A en fonction de celles de B, de telle sorte que la recette marginale de A soit égale à son coût et que le profit de A soit maximum.
Les stratégies de quantités sont diverses: adaptation passive au niveau de production de chaque producteur ( duopole de Cournot ), relations hiérarchisées entre les 2 producteurs ( duopole de Stackelberg ), volonté de domination des deux firmes ( duopole de Bowley ). Les stratégies des prix ( duopole de Bertrand ) conduisent à la guerre des prix et à la disparition d'une des deux entreprises. Dans le duopole de Cournot en 1838 chaque producteur décide de son volume de production en fonction de la production de l'autre, de telle sorte que son profit soit maximum. En utilisant sa fonction de réaction, chacun sait quel volume de production il doit offrir compte tenu du volume de l'autre. L'équilibre du marché est atteint, après des ajustements successifs, quand aucun des duopoleurs n'a plus intérêt à modifier son niveau de production. Le duopole de Stackelberg en 1934 part de l'hypothèse qu'un des protagonistes est dominant et que l'autre s'adapte à la décision du dominant. La firme leader fixe la première son volume de production de sorte que son profit soit maximum en tenant compte de la réaction de l'autre firme à son volume de production. Cette stratégie permet par rapport au monopole de Cournot une hausse de la production de la firme dominante et de son profit au détriment de la firme dominée. L'équilibre est stable. Les firmes peuvent aussi vouloir dominer toutes les 2. Cette stratégie analysée par Bownley conduit à l'instabilité du marché car chaque intervenant détermine son niveau de production maximisant son profit en pensant que le second producteur s'adaptera à sa production alors que ce n'est pas le cas. En résulte une situation de surproduction débouchant soit sur une entente, soit sur une guerre des prix.
Cela me rappelle certains cours de microéconomie et autres.
100 fiches de micro et macro économie.
Cartel.
En situation d'oligopole, les entreprises peuvent s'entendre pour restreindre la concurrence en formant un cartel. L'oligopole est une situation de marché où un petit nombre d'entreprises fait face à un grand nombre d'acheteurs et où les décisions d'une entreprise ont des conséquence sur toutes les autres. Pour éviter une concurrence préjudiciable, les producteurs peuvent s'entendre entre eux pour restreindre leur production et augmenter le prix de vente. La collusion ou l'entente peut être soit implicite soit explicite. A la fin du XIXème siècle, les grandes entreprises allemandes avaient fait ce genre de collusion. On trouvait cela aussi entre les pays producteurs de pétrole à la création de l'OPEP en 1960. Pour que les entreprises aient intérêt à former un cartel, il faut que la demande soit peu élastique au prix pour éviter que les gains tirés d'un prix élevé soit annulés par une forte baisse des ventes. Que le cartel contrôle la quasi totalité du marché pour que des entreprises non membres du cartel ne vendent pas à des prix plus faibles, réduisant les parts de marché du cartel. Les coûts d'organisation du cartel soient faibles, et la détection des entreprises ne respectant pas l'accord efficace. Que le bien produit soit homogène car des biens différenciés rendent le contrôle du prix de vente plus difficile. Que les sanctions financières prises par les pouvoirs publics en cas de découverte du cartel soient peu importantes. Enfin, que la détection des ' tricheurs ', des entreprises qui ne respectent pas l'accord, soit aisée.
Les producteurs formant un cartel créent un organisme commun déterminant la répartition de la production, le prix de vente et le partage des profits. Le cartel se comporte comme un monopole à plusieurs établissements. Il maximise son profit quand les quantités produites par les entreprises membres sont telles que la recette marginale est égale au coût marginal de chaque entreprise. Comme la recette marginale est identique pour toutes les entreprises, les quantités produites par chaque entreprise doivent être telles que le coût marginal de chaque entreprise soit identique. Si toutes les entreprises ont le même coût marginal, la production est la même pour chaque entreprise. Si les coûts marginaux sont différents, les entreprises dont les coûts sont plus élevés se voient attribuer un volume de production plus faible. Le profit réparti se prorata de la production de chaque entreprise. Le cartel doit mettre en place un contrôle pour éviter que des entreprises ne se comportent en ' passager clandestin ', ne soient incitées soit à profiter du prix élevé pour augmenter leur volume de production, soit à baisser leur prix pour accroître leurs parts de marché. Les cartels sont généralement interdits par les pouvoirs publics car suspectés de réduire le bien être collectif en restreignant la concurrence. Le Sherman Act de 1890 pour les USA et l'article 81 du TUE pour l'Europe sanctionnent ces ententes même si c'est difficile de les détecter la plupart des cas quand elles sont tacites en particulier. La distinction entre entente illégale et légale n'est pas assez précise. Certaines entreprises peuvent être tentées de rompre l'accord pour augmenter leur profit. La formation de cartel nécessite souvent des coûts de surveillance élevée pour détecter les tricheurs. Si le marché est contestable et si le cartel réalise des profits importants, de nouvelles entreprises peuvent arriver sur le marché et vendre moins cher.
Le cartel peut être stable sous certaines conditions. Que le faible nombre d'entreprises pour pour détecter plus facilement les tricheurs 2 : capacités de production utilisées à 100% pour ne pas avoir intérêt à augmenter la production. 3 : Nombre d'acheteurs élevés car dans ce cas c'est difficile de maintenir secret une baisse des prix et plus facile de détecter les tricheurs 4 : Produits peu différenciés, demande stable ou facile à anticiper pour maîtriser l'évolution des prix.; 5 : Coûts relativement stables. Dans les secteurs à progrès technique rapide, les innovations, en modifiant les coûts et les produits, rendent difficile la formation de cartels. Bien que les entreprises aient intérêt à faire ça, la stratégie n'est valable qu'à court terme. A long terme, la rupture de l'accord peut dégénérer en guerre des prix. Autant respecter l'accord. Les pouvoirs publics peuvent être également contrariants. Et la stratégie des entreprises membres du cartel également peuvent le contrarier. Sous certaines conditions ceci dit, le cartel peut être durable.
Le duopole.
C'est une structure de marché caractériser par 2 producteurs face à un très grand nombre d'acheteurs. En cas de coopérations, les 2 producteurs peuvent adopter des stratégies de quantités ou de prix. L'oligopole se caractérise par un petit nombre de producteurs face à un grand nombre d'acheteurs. Ces producteurs sont interdépendants car ils doivent tenir compte des décisions des autres ce qui n'est le cas ni en concurrence pure et parfaite, ni en situation de monopole. Le duopole est un cas particulier de l'oligopole dans lequel seuls deux producteurs approvisionnent la totalité du marché. Au XIXème siècle, des économistes avaient proposé des modèles de duopole dont les conclusions pouvaient être étendues aux oligopoles. Ces modèles reprennent certaines hypothèses de concurrence pure et parfaite notamment l'homogénéité des produits et la transparence. Mais ils s'écartent du modèle standard car les hypothèses d'atomicité et de libre entrée sur le marché ne sont pas vérifiées. Les duopoleurs peuvent décider de s'entendre ou pas. En cas de non coopération, ils font des stratégies de quantités ou des stratégies de prix, déterminent d'abord leur niveau de production ou d'abord leur prix. Dans le premier cas les producteurs influence par les quantités offertes les prix du marché sans être pour autant dans une situation de monopole car ils se concurrencent mutuellement et qu'il est difficile de ne pas tenir compte du comportement de l'autre producteur. Le prix et donc le profit, dépendent de la production des 2 producteurs. Les entreprises A et B doivent déterminer le niveau de leur production en tenant compte de la production de l'autre. La fonction de réaction de A permet de connaître les quantités de A en fonction de celles de B, de telle sorte que la recette marginale de A soit égale à son coût et que le profit de A soit maximum.
Les stratégies de quantités sont diverses: adaptation passive au niveau de production de chaque producteur ( duopole de Cournot ), relations hiérarchisées entre les 2 producteurs ( duopole de Stackelberg ), volonté de domination des deux firmes ( duopole de Bowley ). Les stratégies des prix ( duopole de Bertrand ) conduisent à la guerre des prix et à la disparition d'une des deux entreprises. Dans le duopole de Cournot en 1838 chaque producteur décide de son volume de production en fonction de la production de l'autre, de telle sorte que son profit soit maximum. En utilisant sa fonction de réaction, chacun sait quel volume de production il doit offrir compte tenu du volume de l'autre. L'équilibre du marché est atteint, après des ajustements successifs, quand aucun des duopoleurs n'a plus intérêt à modifier son niveau de production. Le duopole de Stackelberg en 1934 part de l'hypothèse qu'un des protagonistes est dominant et que l'autre s'adapte à la décision du dominant. La firme leader fixe la première son volume de production de sorte que son profit soit maximum en tenant compte de la réaction de l'autre firme à son volume de production. Cette stratégie permet par rapport au monopole de Cournot une hausse de la production de la firme dominante et de son profit au détriment de la firme dominée. L'équilibre est stable. Les firmes peuvent aussi vouloir dominer toutes les 2. Cette stratégie analysée par Bownley conduit à l'instabilité du marché car chaque intervenant détermine son niveau de production maximisant son profit en pensant que le second producteur s'adaptera à sa production alors que ce n'est pas le cas. En résulte une situation de surproduction débouchant soit sur une entente, soit sur une guerre des prix.
il y a 3 mois
Monopole et intervention publique.
Parfois quand le monopole ne permet pas de parvenir à une situation optimale pour la collectivité, l'intervention publique est justifiée. Quand les rendements sont croissants, quand le volume de production doit être élevé pour atteindre la zone des rendements décroissants, la petite entreprise n'est pas rentable et pour dégager un profit, en concurrence pure et parfaite, le prix, égal au coût marginal, doit être supérieur au coût moyen. Or le coût marginal n'est supérieur au coût moyen que dans la zone des rendements décroissants, quand le coût moyen augmente. Lorsque les coûts fixes sont élevés, le volume de production nécessaire pour attendre cette zone est très élevée. La petite entreprise ne parvient pas donc à produire assez pour dégager un profit. Tel n'est pas le cas du monopole dont le volume de production est important et qui atteint plus facilement la zone de rendements décroissants. De toute façons, le monopole peut dégager un profit même si le coût marginal est inférieur au coût moyen, à condition que le coût moyen soit inférieur au prix auquel les consommateurs sont prêts à acheter. L'innovation, la découverte de nouveaux procédés technologiques ou de nouveaux produits créent pour l'entreprise une situation de monopole d'innovation bien analysée par J.A. Schumpeter. Ce monopole est à l'origine d'un processus de destruction créatrice, inhérent au dynamisme de l'économie. Il est temporaire et disparait lorsque les autres entreprises imitent l'entreprise innovatrice. Le monopole vent plus cher et produit moins que l'entreprise en concurrence pure et parfaite. Protégé de la concurrence, il n'est pas incité à innover et à réduire ses coûts. Le prix de vente risque de rester durablement élevé, alors qu'en concurrence pure et parfaite, il baisse jusqu'au minimum du coût moyen. En vendant plus cher et en produisant moins, le monopole réduit le surplus de la collectivité et par conséquent, le bien être collectif.
De plus, la " charge morte " qui mesure cette perte de surplus ne donne qu'une mesure incomplète du coût social du monopole. Il faut aussi tenir compte des dépenses engagées par le monopole pour maintenir son pouvoir de marché : lobbying auprès des autorités publiques ou investissements en surcapacité pour se donner la possibilité de baisser le prix de vente en cas d'arriver de concurrents. Ces dépenses pourraient être utilisées plus efficacement. La stratégie de maximisation du profit par le monopole conduit, par conséquent à un équilibre sous optimal pour la collectivité. Quand il s'agit d'un monopole naturel, l'Etat peut créer des monopoles publics s'il estime que certains biens et services comme l'eau, le gaz, l'électricité, doivent être fournis à la collectivités à des prix inférieurs à ceux pratiqués par un monopole privé. L'Etat peut imposer au monopole une tarification au coût marginal pour supprimer la charge morte, tout en lui versant une subvention si le coût moyen est supérieur au coût marginal. D'autres stratégies sont possibles : tarification au coût moyen ce qui annule le profit ou discrimination par les prix selon les clientèles. néanmoins, ces politiques nécessitent une bonne connaissance des coûts du monopole et de demande des utilisateurs. De plus, la gestion peut engendrer des coûts bureaucratiques. Dans le cadre européen, les pays doivent déréglementer et libéraliser leurs services publics en réseau ( gaz, électricité, télécommunications, transports ferroviaires à. Les procédures de mise aux enchères ( concessions accordées à l'entreprise privée la plus performante ), très utilisées dans des secteurs comme la distribution de l'eau ou la collecte des déchets, visent à faire jouer la concurrence. Il est aussi possible de conserver le monopole pour les infrastructures et d'ouvrir à des opérateurs privés l'exploitation du service . Dans ces cas, les autorités de régulation ont pour mission le contrôle des prix pratiqués.
Les autorités publiques doivent à la fois préserver la concurrence en rendant le marché contestable sans renoncer aux objectifs d'intérêt général.
A. La politique de concurrence.
La demande du consommateur.
La demande dépend d'abord ru prix du produit. Dans la majorité des cas, la demande est une fonction décroissante du prix ( demande et prix varient en sens inverse ). Cette fonction est généralement appelée loi de la demande par les économistes. La demande dépend aussi du revenu. Si le revenu du consommateur diminue, il achètera certainement moins de vêtements. Dans la majorité des cas, la demande est donc fonction croissante du revenu. Les 2 varient dans le même sens. La demande dépend aussi du prix des biens substituables, qui son des biens concurrents permettant des satisfaire les mêmes besoins. La demande est généralement fonction croissante du prix des produits substituables. Elle dépend aussi du prix des produits complémentaires. Si le prix des chaussures de ski augmente fortement, la demande de ce bien va diminuer et entraîner dans sa baisse la demande des produits complémentaires, les skis et les bâtons de ski par exemple. Dans la plupart des cas, la demande est donc fonction décroissante du prix des produits complémentaires ( demande et prix des produis complémentaires varient dans le sens inverse ). Elle dépend enfin des anticipations. Si le consommateur pense que le prix des automobiles ou des logements va augmenter dans un avenir assez proche, il peut être amené à faire ses achats maintenant. La demande est aussi une fonction croissante du prix quand le cours d'une action augmente et que les spéculateurs anticipent que l'augmentation va se poursuivre.
La fonction de demande représente l'évolution de la demande en fonction du prix de vente du produit : D = f ( px ); Dans la majorité des cas, la demande est une fonction décroissante du prix. On peut tracer des courbes d'indifférence et une ligne de budget à partir de tout cela. Si le prix des jeans diminue, la pente de la ligne de budget se modifie et le choix du consommateur change. Si le revenu et les prix des autres biens sont inchangées, la courbe reliant tous les optimums du consommateur pour chaque prix du jean représente la fonction de demande. La pente de cette courbe dépend de degré d'élasticité de demande par rapport au prix. Si quelqu'un est prêt à acheter un produit jusqu'à 100 euros mais obtient le produit pour 50 euros, la différence entre ce qu'il était disposé à payer et ce qu'il a payé est appelé son surplus. Puisque les intentions d'achat se sont réalisées que si le prix est égal ou inférieur au prix intentionnel, le consommateur obtient généralement un surplus. Ce surplus peut se mesurer en unités monétaire. La demande a donc de nombreux déterminants qu'il est difficile d'isoler. Il vaut mieux analyser l'action de toutes ces variables sur la demande.
Parfois quand le monopole ne permet pas de parvenir à une situation optimale pour la collectivité, l'intervention publique est justifiée. Quand les rendements sont croissants, quand le volume de production doit être élevé pour atteindre la zone des rendements décroissants, la petite entreprise n'est pas rentable et pour dégager un profit, en concurrence pure et parfaite, le prix, égal au coût marginal, doit être supérieur au coût moyen. Or le coût marginal n'est supérieur au coût moyen que dans la zone des rendements décroissants, quand le coût moyen augmente. Lorsque les coûts fixes sont élevés, le volume de production nécessaire pour attendre cette zone est très élevée. La petite entreprise ne parvient pas donc à produire assez pour dégager un profit. Tel n'est pas le cas du monopole dont le volume de production est important et qui atteint plus facilement la zone de rendements décroissants. De toute façons, le monopole peut dégager un profit même si le coût marginal est inférieur au coût moyen, à condition que le coût moyen soit inférieur au prix auquel les consommateurs sont prêts à acheter. L'innovation, la découverte de nouveaux procédés technologiques ou de nouveaux produits créent pour l'entreprise une situation de monopole d'innovation bien analysée par J.A. Schumpeter. Ce monopole est à l'origine d'un processus de destruction créatrice, inhérent au dynamisme de l'économie. Il est temporaire et disparait lorsque les autres entreprises imitent l'entreprise innovatrice. Le monopole vent plus cher et produit moins que l'entreprise en concurrence pure et parfaite. Protégé de la concurrence, il n'est pas incité à innover et à réduire ses coûts. Le prix de vente risque de rester durablement élevé, alors qu'en concurrence pure et parfaite, il baisse jusqu'au minimum du coût moyen. En vendant plus cher et en produisant moins, le monopole réduit le surplus de la collectivité et par conséquent, le bien être collectif.
De plus, la " charge morte " qui mesure cette perte de surplus ne donne qu'une mesure incomplète du coût social du monopole. Il faut aussi tenir compte des dépenses engagées par le monopole pour maintenir son pouvoir de marché : lobbying auprès des autorités publiques ou investissements en surcapacité pour se donner la possibilité de baisser le prix de vente en cas d'arriver de concurrents. Ces dépenses pourraient être utilisées plus efficacement. La stratégie de maximisation du profit par le monopole conduit, par conséquent à un équilibre sous optimal pour la collectivité. Quand il s'agit d'un monopole naturel, l'Etat peut créer des monopoles publics s'il estime que certains biens et services comme l'eau, le gaz, l'électricité, doivent être fournis à la collectivités à des prix inférieurs à ceux pratiqués par un monopole privé. L'Etat peut imposer au monopole une tarification au coût marginal pour supprimer la charge morte, tout en lui versant une subvention si le coût moyen est supérieur au coût marginal. D'autres stratégies sont possibles : tarification au coût moyen ce qui annule le profit ou discrimination par les prix selon les clientèles. néanmoins, ces politiques nécessitent une bonne connaissance des coûts du monopole et de demande des utilisateurs. De plus, la gestion peut engendrer des coûts bureaucratiques. Dans le cadre européen, les pays doivent déréglementer et libéraliser leurs services publics en réseau ( gaz, électricité, télécommunications, transports ferroviaires à. Les procédures de mise aux enchères ( concessions accordées à l'entreprise privée la plus performante ), très utilisées dans des secteurs comme la distribution de l'eau ou la collecte des déchets, visent à faire jouer la concurrence. Il est aussi possible de conserver le monopole pour les infrastructures et d'ouvrir à des opérateurs privés l'exploitation du service . Dans ces cas, les autorités de régulation ont pour mission le contrôle des prix pratiqués.
Les autorités publiques doivent à la fois préserver la concurrence en rendant le marché contestable sans renoncer aux objectifs d'intérêt général.
A. La politique de concurrence.
La demande du consommateur.
La demande dépend d'abord ru prix du produit. Dans la majorité des cas, la demande est une fonction décroissante du prix ( demande et prix varient en sens inverse ). Cette fonction est généralement appelée loi de la demande par les économistes. La demande dépend aussi du revenu. Si le revenu du consommateur diminue, il achètera certainement moins de vêtements. Dans la majorité des cas, la demande est donc fonction croissante du revenu. Les 2 varient dans le même sens. La demande dépend aussi du prix des biens substituables, qui son des biens concurrents permettant des satisfaire les mêmes besoins. La demande est généralement fonction croissante du prix des produits substituables. Elle dépend aussi du prix des produits complémentaires. Si le prix des chaussures de ski augmente fortement, la demande de ce bien va diminuer et entraîner dans sa baisse la demande des produits complémentaires, les skis et les bâtons de ski par exemple. Dans la plupart des cas, la demande est donc fonction décroissante du prix des produits complémentaires ( demande et prix des produis complémentaires varient dans le sens inverse ). Elle dépend enfin des anticipations. Si le consommateur pense que le prix des automobiles ou des logements va augmenter dans un avenir assez proche, il peut être amené à faire ses achats maintenant. La demande est aussi une fonction croissante du prix quand le cours d'une action augmente et que les spéculateurs anticipent que l'augmentation va se poursuivre.
La fonction de demande représente l'évolution de la demande en fonction du prix de vente du produit : D = f ( px ); Dans la majorité des cas, la demande est une fonction décroissante du prix. On peut tracer des courbes d'indifférence et une ligne de budget à partir de tout cela. Si le prix des jeans diminue, la pente de la ligne de budget se modifie et le choix du consommateur change. Si le revenu et les prix des autres biens sont inchangées, la courbe reliant tous les optimums du consommateur pour chaque prix du jean représente la fonction de demande. La pente de cette courbe dépend de degré d'élasticité de demande par rapport au prix. Si quelqu'un est prêt à acheter un produit jusqu'à 100 euros mais obtient le produit pour 50 euros, la différence entre ce qu'il était disposé à payer et ce qu'il a payé est appelé son surplus. Puisque les intentions d'achat se sont réalisées que si le prix est égal ou inférieur au prix intentionnel, le consommateur obtient généralement un surplus. Ce surplus peut se mesurer en unités monétaire. La demande a donc de nombreux déterminants qu'il est difficile d'isoler. Il vaut mieux analyser l'action de toutes ces variables sur la demande.
il y a 3 mois
CONCURRENCE PARFAITE ET MONOPOLE
Le producteur cherche à maximiser le profit. La condition d'équilibre est la même quelle que soit la structure du marché. Le profit augmente tant que la recette marginal est supérieure au coût marginal. Le profit est donc maximum quand Rm = Cm. L'évolution du coût marginal est indépendante de la structure du marché. En revanche, la recette marginale car elle dépend du prix lui même déterminé par l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché, dépend donc du mode de fonctionnement de ce marché. Si le marché est parfaitement concurrentiel, le prix est une donnée constante qui s'impose à la firme individuelle quelle que soit sa production. On montre dans ce cas que la recette marginale est égale au prix. Le profit est maximum quand le prix est égal au coût marginal. Mais cet équilibre ne se maintient pas à long terme car tant que des profits restent, d'autres producteurs sont attirés car ils augmentent l'offre totale sur le marché entraînant une baisse du prix jusqu'à ce que ce prix soit égal au coût moyen minimum de longue période. donc les profits s'annulent. Le monopole a un certain pouvoir d'intervention sur le prix quant à lui car confronté à la demande totale sur le marché directement. Cette demande est décroissante en fonction du prix. Il se déplace le long de la courbe de demande pour choisir le prix et la quantité qui maximisent son profit. Le monopole fixe un prix supérieur au coût marginal et donc il vend plus cher, produit moins et réalise plus de profits qu'un marché concurrentiel. Ces super profits restent en longue période si le monopole est à l'abri des entrées sur le marché.
Il existe plusieurs conditions pour la concurrence parfaite. D'abord l'atomicité car il existe un grand nombre de producteurs et d'acheteurs sur le marché. Aucun agent particulier n'a un poids suffisant pour influencer les résultats du marché. De plus, la mobilité car les biens et les facteurs de productions sont parfaitement mobiles. Et le capital et le travail peuvent se déplacer librement sans délai d'un marché à un autre ou d'une entreprise à une autre. Ensuite, il faut évoquer l'homogénéité car toutes les entreprises produisent un même produit homogène. Les acheteurs le voient donc comme identiques. Ils sont indifférents à l'entreprise auquel il achètent le produit. La concurrence ne concerne donc que sur les caractéristiques spécifiques de leur produit et elle ne peut se faire qu'à travers les prix. Puis, il faut qu'il y ait libre entrée et que donc n'importe quel acheteur, producteur, ou agent soit libre à n'importe quel moment de participer ou ne pas participer à l'activité du marché. Cela veut dire qu'il y a aucune réglementation qui limite les conditions dans lesquelles on peut pratiquer une activité. Enfin, la transparence car l'information des différentes agents intervenant sur le marché est parfaite, c'est à dire disponible immédiatement et sans coût. Cela veut dire que tout le monde connaît en même temps toutes les quantités offertes et demandées par les agents aux différents prix. A cela il faut ajouter les conditions concernant le comportement des agents économiques, à savoir la rationalité et les hypothèses sur les préférences.
La caractéristique essentielle d'un marché en concurrence parfaite est la manière dont se forment les prix car chaque entreprise n'a pas de pouvoir de décision sur les prix. Car il y a trop d'entreprises sur le marché et son poids est trop faible. Elle doit donc pratiquer le prix du marché. Impossible d'avoir un prix inférieur car l'information est parfaite et donc les entreprises peuvent faire de même. Le résultat est donc une diminution des profits. De même, une augmentation des prix ferait perdre à l'entreprise sa clientèle pour des raisons évidentes. L'entreprise concurrentielle prend donc le prix comme une donnée extérieure. Elle est price taker, soit preneuse de prix. Le monopole, lui, est price maker, c'est à dire qu'il fait le prix.
Le prix du bien qui est échange sur le marché n'est pas fixé par les entreprises mais déterminé par l'équilibre entre offre et demande. L'offre d'un bien est une fonction décroissante du prix. L'offre d'un bien par les producteurs est une fonction croissante du prix. Car l'entreprise cherche à maximiser son profit. Mais si le prix de vente augmente pour un coût donné, chaque unité produite entraîne un profit plus élevé. L'entreprise est incitée à produire plus jusqu'au moment où la hausse des coûts entraînée par le développement de la production compensera l'augmentation du prix. L'offre du produit est donc une fonction croissante du prix. Il existe un prix pour lequel l'offre est égale à la demande. Ce prix est déterminé par la libre négociation entre offreurs et demandeurs. Le fonctionnement de la loi de l'offre et de la demande suppose une parfaite flexibilité des prix. Car ce sont les mouvements de prix qui sont susceptibles de rétablir l'équilibre suite à un changement quelconque dans les conditions du marché. Au point d'équilibre concurrentiel, il existe un prix de marché unique pour les unités échangées. La courbe montre que les acheteurs sont disposés à payer un prix nettement plus élevé P& pour obtenir une quantité Q1, P2 pour obtenir Q2, etc. La dernière unité acheté au point E est payée au prix que les acheteurs étaient disposés à payer mais les autres sont payés à un prix inférieur. C'est le surplus du consommateur. Pour chaque unité achetée, le consommateur gagne la différence entre le prix qu'il était prêt à payer et le prix de marché. De même, les producteurs vendent toutes les unités au prix unique équilibrant le marché.
Mais la courbe d'offre indique qu'ils seraient disposés à accepter un prix inférieur à toutes les unités situées à gauche du point d'équilibre. Donc, pour chaque unité, les producteurs gagnent la différence entre prix du marché et prix auquel ils étaient disposés à vendre. Les échanges se développent précisément parce que les acheteurs et les vendeurs en retirent un avantage net, donc une différence entre satisfactions qu'ils en retirent et coût d'opportunité. des ressources qu'ils sacrifient. L'échange s'arrête au point d'équilibre quand les gains mutuels de l'échange ont été épuisés. L'entreprise cherche à maximiser son profit qui est la différence entre recettes et coûts de production. En parlant de recettes, il existe plusieurs types de recettes différentes, à savoir la recette totale, la recette marginal et la recette moyenne. La recette totale notée RT est égale au produit des quantités vendues noté X par le prix de vente noté P. Soit : RT = P x X. De son côté, la recette marginale, notée Rm, associée à la vente d'un produit parfaitement divisible est la variation de la recette totale entraînée par une variation infiniment petite de la quantité vendues. C'est donc de la dérivée de la recette totale par rapport à la quantité. On note donc : Rm = dRT/dX. Enfin, la recette moyenne notée RM est la recette par unité de bien. Cette recette est donc identique par définition au prix unitaire. On note donc : RM = RT/X = P x X/X = P.
Pour un bien imparfaitement divisible, Rm est la variation de la recette totale pour une unité de bien supplémentaire. Il existe entre RM et Rm la même relation qu'entre toutes les variables marginales et moyennes. Concrètement quand la recette moyenne augmente, cela veut dire que la recette marginale lui est supérieure et inversement. Quand RM est constante, elle est égale à Rm. Dans le cadre d'une concurrence pure et parfaite, le prix est une donnée pour l'entreprise. Cela signifie que quelle que soit la quantité produite par le producteur individuel, le prix sera identique au prix du marché. La recette moyenne qui est identique au prix reste constante tandis que la recette marginale est également égale au prix et constante. L'entreprise peut écouler n'importe quelle quantité sur le marché à la condition de vendre au prix du marché. L'entreprise choisit donc le volume de productions maximisant son profit. Lorsqu'on développe la production, la recette totale augmente, mais le coût total également. Lorsqu'on développe la production, la recette totale augmente, mais le coût total également. Tant que l'augmentation de la recette marginale est supérieur à l'augmentation du coût marginal, le profit augmente et la production doit augmenter. A l'inverse, si le coût marginal devient supérieur à la recette marginale, cela veut dire qu'une unité supplémentaire de production augmente le coût plus que la recette et réduit donc le profit. Il faut réduire donc la production. Donc le profit est maximum lorsque la recette marginale est égale au coût marginal. le profit est maximum quand al recette marginale est égale au coût marginal dans sa partie croissante et non pas décroissante. Quant Cm est décroissant il est inférieur au coût moyen. Egaliser le prix au coût marginal dans cette phase implique forcément un prix de vente inférieur au coût moyen et donc une perte. Le seul point d'équilibre est celui se situant dans la partie croissante de Cm.
Le producteur cherche à maximiser le profit. La condition d'équilibre est la même quelle que soit la structure du marché. Le profit augmente tant que la recette marginal est supérieure au coût marginal. Le profit est donc maximum quand Rm = Cm. L'évolution du coût marginal est indépendante de la structure du marché. En revanche, la recette marginale car elle dépend du prix lui même déterminé par l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché, dépend donc du mode de fonctionnement de ce marché. Si le marché est parfaitement concurrentiel, le prix est une donnée constante qui s'impose à la firme individuelle quelle que soit sa production. On montre dans ce cas que la recette marginale est égale au prix. Le profit est maximum quand le prix est égal au coût marginal. Mais cet équilibre ne se maintient pas à long terme car tant que des profits restent, d'autres producteurs sont attirés car ils augmentent l'offre totale sur le marché entraînant une baisse du prix jusqu'à ce que ce prix soit égal au coût moyen minimum de longue période. donc les profits s'annulent. Le monopole a un certain pouvoir d'intervention sur le prix quant à lui car confronté à la demande totale sur le marché directement. Cette demande est décroissante en fonction du prix. Il se déplace le long de la courbe de demande pour choisir le prix et la quantité qui maximisent son profit. Le monopole fixe un prix supérieur au coût marginal et donc il vend plus cher, produit moins et réalise plus de profits qu'un marché concurrentiel. Ces super profits restent en longue période si le monopole est à l'abri des entrées sur le marché.
Il existe plusieurs conditions pour la concurrence parfaite. D'abord l'atomicité car il existe un grand nombre de producteurs et d'acheteurs sur le marché. Aucun agent particulier n'a un poids suffisant pour influencer les résultats du marché. De plus, la mobilité car les biens et les facteurs de productions sont parfaitement mobiles. Et le capital et le travail peuvent se déplacer librement sans délai d'un marché à un autre ou d'une entreprise à une autre. Ensuite, il faut évoquer l'homogénéité car toutes les entreprises produisent un même produit homogène. Les acheteurs le voient donc comme identiques. Ils sont indifférents à l'entreprise auquel il achètent le produit. La concurrence ne concerne donc que sur les caractéristiques spécifiques de leur produit et elle ne peut se faire qu'à travers les prix. Puis, il faut qu'il y ait libre entrée et que donc n'importe quel acheteur, producteur, ou agent soit libre à n'importe quel moment de participer ou ne pas participer à l'activité du marché. Cela veut dire qu'il y a aucune réglementation qui limite les conditions dans lesquelles on peut pratiquer une activité. Enfin, la transparence car l'information des différentes agents intervenant sur le marché est parfaite, c'est à dire disponible immédiatement et sans coût. Cela veut dire que tout le monde connaît en même temps toutes les quantités offertes et demandées par les agents aux différents prix. A cela il faut ajouter les conditions concernant le comportement des agents économiques, à savoir la rationalité et les hypothèses sur les préférences.
La caractéristique essentielle d'un marché en concurrence parfaite est la manière dont se forment les prix car chaque entreprise n'a pas de pouvoir de décision sur les prix. Car il y a trop d'entreprises sur le marché et son poids est trop faible. Elle doit donc pratiquer le prix du marché. Impossible d'avoir un prix inférieur car l'information est parfaite et donc les entreprises peuvent faire de même. Le résultat est donc une diminution des profits. De même, une augmentation des prix ferait perdre à l'entreprise sa clientèle pour des raisons évidentes. L'entreprise concurrentielle prend donc le prix comme une donnée extérieure. Elle est price taker, soit preneuse de prix. Le monopole, lui, est price maker, c'est à dire qu'il fait le prix.
Le prix du bien qui est échange sur le marché n'est pas fixé par les entreprises mais déterminé par l'équilibre entre offre et demande. L'offre d'un bien est une fonction décroissante du prix. L'offre d'un bien par les producteurs est une fonction croissante du prix. Car l'entreprise cherche à maximiser son profit. Mais si le prix de vente augmente pour un coût donné, chaque unité produite entraîne un profit plus élevé. L'entreprise est incitée à produire plus jusqu'au moment où la hausse des coûts entraînée par le développement de la production compensera l'augmentation du prix. L'offre du produit est donc une fonction croissante du prix. Il existe un prix pour lequel l'offre est égale à la demande. Ce prix est déterminé par la libre négociation entre offreurs et demandeurs. Le fonctionnement de la loi de l'offre et de la demande suppose une parfaite flexibilité des prix. Car ce sont les mouvements de prix qui sont susceptibles de rétablir l'équilibre suite à un changement quelconque dans les conditions du marché. Au point d'équilibre concurrentiel, il existe un prix de marché unique pour les unités échangées. La courbe montre que les acheteurs sont disposés à payer un prix nettement plus élevé P& pour obtenir une quantité Q1, P2 pour obtenir Q2, etc. La dernière unité acheté au point E est payée au prix que les acheteurs étaient disposés à payer mais les autres sont payés à un prix inférieur. C'est le surplus du consommateur. Pour chaque unité achetée, le consommateur gagne la différence entre le prix qu'il était prêt à payer et le prix de marché. De même, les producteurs vendent toutes les unités au prix unique équilibrant le marché.
Mais la courbe d'offre indique qu'ils seraient disposés à accepter un prix inférieur à toutes les unités situées à gauche du point d'équilibre. Donc, pour chaque unité, les producteurs gagnent la différence entre prix du marché et prix auquel ils étaient disposés à vendre. Les échanges se développent précisément parce que les acheteurs et les vendeurs en retirent un avantage net, donc une différence entre satisfactions qu'ils en retirent et coût d'opportunité. des ressources qu'ils sacrifient. L'échange s'arrête au point d'équilibre quand les gains mutuels de l'échange ont été épuisés. L'entreprise cherche à maximiser son profit qui est la différence entre recettes et coûts de production. En parlant de recettes, il existe plusieurs types de recettes différentes, à savoir la recette totale, la recette marginal et la recette moyenne. La recette totale notée RT est égale au produit des quantités vendues noté X par le prix de vente noté P. Soit : RT = P x X. De son côté, la recette marginale, notée Rm, associée à la vente d'un produit parfaitement divisible est la variation de la recette totale entraînée par une variation infiniment petite de la quantité vendues. C'est donc de la dérivée de la recette totale par rapport à la quantité. On note donc : Rm = dRT/dX. Enfin, la recette moyenne notée RM est la recette par unité de bien. Cette recette est donc identique par définition au prix unitaire. On note donc : RM = RT/X = P x X/X = P.
Pour un bien imparfaitement divisible, Rm est la variation de la recette totale pour une unité de bien supplémentaire. Il existe entre RM et Rm la même relation qu'entre toutes les variables marginales et moyennes. Concrètement quand la recette moyenne augmente, cela veut dire que la recette marginale lui est supérieure et inversement. Quand RM est constante, elle est égale à Rm. Dans le cadre d'une concurrence pure et parfaite, le prix est une donnée pour l'entreprise. Cela signifie que quelle que soit la quantité produite par le producteur individuel, le prix sera identique au prix du marché. La recette moyenne qui est identique au prix reste constante tandis que la recette marginale est également égale au prix et constante. L'entreprise peut écouler n'importe quelle quantité sur le marché à la condition de vendre au prix du marché. L'entreprise choisit donc le volume de productions maximisant son profit. Lorsqu'on développe la production, la recette totale augmente, mais le coût total également. Lorsqu'on développe la production, la recette totale augmente, mais le coût total également. Tant que l'augmentation de la recette marginale est supérieur à l'augmentation du coût marginal, le profit augmente et la production doit augmenter. A l'inverse, si le coût marginal devient supérieur à la recette marginale, cela veut dire qu'une unité supplémentaire de production augmente le coût plus que la recette et réduit donc le profit. Il faut réduire donc la production. Donc le profit est maximum lorsque la recette marginale est égale au coût marginal. le profit est maximum quand al recette marginale est égale au coût marginal dans sa partie croissante et non pas décroissante. Quant Cm est décroissant il est inférieur au coût moyen. Egaliser le prix au coût marginal dans cette phase implique forcément un prix de vente inférieur au coût moyen et donc une perte. Le seul point d'équilibre est celui se situant dans la partie croissante de Cm.
il y a 3 mois
Cela signifie que la condition d'équilibre du producteur est double. Les conditions de l'équilibre sont faciles à démontrer. Car le profit Pi est Pi = RT - CT. 2 conditions sont nécessaires pour que cette fonction soit maximale. La dérivée première de Pi par rapport à X doit être nulle tandis que la dérivée seconde doit être négative. La dérivée première de Pi par rapport à la dérivée de RT soit Rm moins la déricée de CT soit Cm. Elle est donc nulle lorsque Rm - Cm = O, d'où Rm = Cm, ce qui constitue la première condition. La deuxième condition de Pi est la dérivée première soit la dérivée de Rm ( Cm par rapport à X. Elle est donc égale à la dérivée de Rm moins la dérivée de Cm. Or la dérivée de Rm est nulle car Rm est constante en concurrence parfaite. La dérivée seconde de Pi est donc égale à - (dCm/cS ). Elle doit être négative. Donc dCm/dX doit être positif ce qui signifie en claire que le rythme de variation de Cm est positif. Autrement dit, Cm est croissante. C'est la deuxième condition.
La courbe de coût marginale est aussi la courbe d'offre du producteur individuel. Car celle ci indique bien quelle quantité sera offerte par l'entreprise pour tel prix. Mais cette courbe d'offre ne comporte que la partie de la courbe de coût marginal qui est supérieure au coût moyen. En dessous du poitn A, le prix devient inférieur au co^put moyen et l'entreprise fait des pertes et l'offre s'annule donc en dessous de ce point. Le point A représente donc le seuil de rentabilité. On trouve une raison supplémentaire de penser que l'entreprise rationnelle produit toujours dans une phase où productivités marginale et moyenne sont décroissantes donc où le coût marginal et le coût moyen sont croissants. Mais il est admis qu'en courte période, l'entreprise peut supporter des pertes si elles proviennent de coûts fixes qu'on peut amortir en longue période. Le producteur doit alors seulement couvrir les coûts variables sur courte période et la totalité des coûts sur longue période. Cela donne la courbe représentant le coût variable moyen noté CVM qui est plus faible que le coût moyen total car le CVM ne comprend pas les coûts fixes. Le point B représente le seuil de fermeture et en deçà, l'entreprise ne couvre pas les coûts variables et l'activité doit être abandonné même en courte période. Au delà de ce point, l'activité est poursuivie, même si non rentable à court terme car on veut atteindre puis dépasser le seuil de rentabilité à long terme. La courbe d'offre du producteur est donc croissante avec le prix tandis que la courbe d'offre totale du marché aussi appelé de la branche ou de l'industrie est la somme des offres des producteurs particuliers aux prix différents. Elle est donc elle aussi croissante.
La pente effective de la courbe d'offre de la branche est plus forte que celle de la courbe obtenue en additionnant les offres individuelles. L'augmentation de la production d'une entreprise isolée n'a pas d'effet sur le coût des facteurs mais l'augmentation de la production de l'ensemble des entreprises provoque une demande supplémentaire de facteurs et fait monter les prix et donc les coûts de production. Aussi, les profits et donc la production offerte progressent moins vite le long de la courbe d'offre de la branche que le long d'une courbe d'offre individuelle. Quant au marché de concurrence en longue période, tous les facteurs sont variables et donc les entreprises présentes dans la branche peuvent développer leurs moyens de production et d'autres entreprises peuvent entrer sur le marché. La courbe de coût moyen de longue période noé CMLP est la courbe qui endivisionne les courbes de courte période. En longue période, lr profit est maximum quand la recette marginale et donc le prix est égale au coût marginal de longue période. La courbe d'offre du producteur en longue période est donc la partie de la courbe Cm LP qui est supérieure à la courbe CMLP. Autour du point E, la courbe CmLP a une pente plus faible que la courbe de coût marginal de courte période correspondante. Donc la réaction à la production, soit l'élasticité à une variation de prix est bien plus faible au courte qu'en longue période. En effet, le coût marginal augmente moins vite en longue période grâce aux économies d'échelles elles mêmes rendues possible par le développement de tous les facteurs de production. L'augmentation de la production est donc plus rentable en longue qu'en courte période. Le fait que d'autres entreprises attirées par les profits réalisés par les producteurs déjà en place vont entrer sur le marché accentue cet événement. Car au niveau de la branche, la capacité de réaction de l'offre aux variations de prix est renforcée.
L'offre du producteur individuel ainsi que l'offre de la branche sont toujours plus élastiques en longue qu'en courte période. L'offre reste croissante à long terme car en l'absence d'indivisibilité des facteurs de production, si tous les facteurs sont réellement variables, les rendements d'échelles devraient devenir et rester constants à long terme. Si les entreprises avaient toujours la possibilité de reproduire à l'identique les méthode utilisées au moment où on atteint le coût minimum en longue période, elle pourraient développer leur production à l'infini sans augmenter leur coût moyen. Donc à long terme, le coût moyen devrait être constant, et le coût marginal identique au coût moyen tandis que la courbe d'offre devrait être un e droite horizontale à partir de X0. Si l'offre reste croissante à long terme, c'est qu'il y a encore des facteurs fixes même en longue période rendant la reproduction à l'identique impossible. Cela oblige à accepter des coûts qui sont croissants. C'est du au fait qu'on peut souvent reproduire à l'identique des combinaisons quantitatives de facteurs en revanche on peut rarement espérer reproduire à l'identique les aspects qualitatifs de ces combinaisons à savoir l'époque, la motivation des travailleurs, l'efficacité des individus, les qualités des gestionnaires, les emplacements, etc. Et donc une fois que le coût moyen minimum de longue période et donc l'efficacité maximale de la combinaison des facteurs de production, l'entreprise ne peut plus faire aussi bien si elle doit développer sa production, et elle n'échappe pas aux rendements décroissants.
Parmi les critiques du modèle de la concurrence parfaite, on trouve l'économiste australien Steve Keen dans son ouvrage intitulé : "L'imposture économique" L'équilibre de la firme concurrentielle repose sur 2 hypothèses. A savoir une demande à la firme horizontale et une courbe d'offre croissante correspondant à la partie croissante de la courbe de coût marginal. Mais ces 2 hypothèses sont contestables. La théorie microéconomique suppose que le producteur concurrentiel est un price taker. Qu'il offre la quantité de son choix à la seule condition de respecter le prix de marché. Ce n'est possible que si la demande à la firme est élastique donc horizontale. Quelle que soit la quantité offerte par la firme, la production de cette dernière n'aura pas d'influence sur le prix. Dans ce cas la recette marginale et la recette moyenne sont constantes, confondues et égales au prix. RM = rm = P. Mais l'économiste George Stigler ancien prix Nobel en 1982 a montré que cette théorie est mathématiquement fausse : " Perfect competition historically contemplated " dans le Journal of Political Economy, vol 35, n 1, 1957. Stigler développe la forume de la recette marginale d'une firme i. Si q désigne la production de la firme, Q le production totale du marché et P, le prix de marché on a : Rm = P + qi ( dP/dQ1 ). Ce qui donne en simplifiant : Rm = P + qi dQ/dq1. Donc Rm = P uniquement si dQ/dqi = 0. Pour que la recette marginale de la firme i soit constante il faut que la variation de la quantité produite par la firme ne fasse pas varier la quantité produite sur le marché ( dQ/dqi + 0 ). Ce qui est faux. Car si un boulanger produit une baguette de pain supplémentaire, il y a forcément une baguette de plus sur le marché. Stigler rappelle que dQ/dqi = 1 soit une augmentation de la production d'une entreprise quelconque entraînant une variation identique de la production totale.
La courbe de coût marginale est aussi la courbe d'offre du producteur individuel. Car celle ci indique bien quelle quantité sera offerte par l'entreprise pour tel prix. Mais cette courbe d'offre ne comporte que la partie de la courbe de coût marginal qui est supérieure au coût moyen. En dessous du poitn A, le prix devient inférieur au co^put moyen et l'entreprise fait des pertes et l'offre s'annule donc en dessous de ce point. Le point A représente donc le seuil de rentabilité. On trouve une raison supplémentaire de penser que l'entreprise rationnelle produit toujours dans une phase où productivités marginale et moyenne sont décroissantes donc où le coût marginal et le coût moyen sont croissants. Mais il est admis qu'en courte période, l'entreprise peut supporter des pertes si elles proviennent de coûts fixes qu'on peut amortir en longue période. Le producteur doit alors seulement couvrir les coûts variables sur courte période et la totalité des coûts sur longue période. Cela donne la courbe représentant le coût variable moyen noté CVM qui est plus faible que le coût moyen total car le CVM ne comprend pas les coûts fixes. Le point B représente le seuil de fermeture et en deçà, l'entreprise ne couvre pas les coûts variables et l'activité doit être abandonné même en courte période. Au delà de ce point, l'activité est poursuivie, même si non rentable à court terme car on veut atteindre puis dépasser le seuil de rentabilité à long terme. La courbe d'offre du producteur est donc croissante avec le prix tandis que la courbe d'offre totale du marché aussi appelé de la branche ou de l'industrie est la somme des offres des producteurs particuliers aux prix différents. Elle est donc elle aussi croissante.
La pente effective de la courbe d'offre de la branche est plus forte que celle de la courbe obtenue en additionnant les offres individuelles. L'augmentation de la production d'une entreprise isolée n'a pas d'effet sur le coût des facteurs mais l'augmentation de la production de l'ensemble des entreprises provoque une demande supplémentaire de facteurs et fait monter les prix et donc les coûts de production. Aussi, les profits et donc la production offerte progressent moins vite le long de la courbe d'offre de la branche que le long d'une courbe d'offre individuelle. Quant au marché de concurrence en longue période, tous les facteurs sont variables et donc les entreprises présentes dans la branche peuvent développer leurs moyens de production et d'autres entreprises peuvent entrer sur le marché. La courbe de coût moyen de longue période noé CMLP est la courbe qui endivisionne les courbes de courte période. En longue période, lr profit est maximum quand la recette marginale et donc le prix est égale au coût marginal de longue période. La courbe d'offre du producteur en longue période est donc la partie de la courbe Cm LP qui est supérieure à la courbe CMLP. Autour du point E, la courbe CmLP a une pente plus faible que la courbe de coût marginal de courte période correspondante. Donc la réaction à la production, soit l'élasticité à une variation de prix est bien plus faible au courte qu'en longue période. En effet, le coût marginal augmente moins vite en longue période grâce aux économies d'échelles elles mêmes rendues possible par le développement de tous les facteurs de production. L'augmentation de la production est donc plus rentable en longue qu'en courte période. Le fait que d'autres entreprises attirées par les profits réalisés par les producteurs déjà en place vont entrer sur le marché accentue cet événement. Car au niveau de la branche, la capacité de réaction de l'offre aux variations de prix est renforcée.
L'offre du producteur individuel ainsi que l'offre de la branche sont toujours plus élastiques en longue qu'en courte période. L'offre reste croissante à long terme car en l'absence d'indivisibilité des facteurs de production, si tous les facteurs sont réellement variables, les rendements d'échelles devraient devenir et rester constants à long terme. Si les entreprises avaient toujours la possibilité de reproduire à l'identique les méthode utilisées au moment où on atteint le coût minimum en longue période, elle pourraient développer leur production à l'infini sans augmenter leur coût moyen. Donc à long terme, le coût moyen devrait être constant, et le coût marginal identique au coût moyen tandis que la courbe d'offre devrait être un e droite horizontale à partir de X0. Si l'offre reste croissante à long terme, c'est qu'il y a encore des facteurs fixes même en longue période rendant la reproduction à l'identique impossible. Cela oblige à accepter des coûts qui sont croissants. C'est du au fait qu'on peut souvent reproduire à l'identique des combinaisons quantitatives de facteurs en revanche on peut rarement espérer reproduire à l'identique les aspects qualitatifs de ces combinaisons à savoir l'époque, la motivation des travailleurs, l'efficacité des individus, les qualités des gestionnaires, les emplacements, etc. Et donc une fois que le coût moyen minimum de longue période et donc l'efficacité maximale de la combinaison des facteurs de production, l'entreprise ne peut plus faire aussi bien si elle doit développer sa production, et elle n'échappe pas aux rendements décroissants.
Parmi les critiques du modèle de la concurrence parfaite, on trouve l'économiste australien Steve Keen dans son ouvrage intitulé : "L'imposture économique" L'équilibre de la firme concurrentielle repose sur 2 hypothèses. A savoir une demande à la firme horizontale et une courbe d'offre croissante correspondant à la partie croissante de la courbe de coût marginal. Mais ces 2 hypothèses sont contestables. La théorie microéconomique suppose que le producteur concurrentiel est un price taker. Qu'il offre la quantité de son choix à la seule condition de respecter le prix de marché. Ce n'est possible que si la demande à la firme est élastique donc horizontale. Quelle que soit la quantité offerte par la firme, la production de cette dernière n'aura pas d'influence sur le prix. Dans ce cas la recette marginale et la recette moyenne sont constantes, confondues et égales au prix. RM = rm = P. Mais l'économiste George Stigler ancien prix Nobel en 1982 a montré que cette théorie est mathématiquement fausse : " Perfect competition historically contemplated " dans le Journal of Political Economy, vol 35, n 1, 1957. Stigler développe la forume de la recette marginale d'une firme i. Si q désigne la production de la firme, Q le production totale du marché et P, le prix de marché on a : Rm = P + qi ( dP/dQ1 ). Ce qui donne en simplifiant : Rm = P + qi dQ/dq1. Donc Rm = P uniquement si dQ/dqi = 0. Pour que la recette marginale de la firme i soit constante il faut que la variation de la quantité produite par la firme ne fasse pas varier la quantité produite sur le marché ( dQ/dqi + 0 ). Ce qui est faux. Car si un boulanger produit une baguette de pain supplémentaire, il y a forcément une baguette de plus sur le marché. Stigler rappelle que dQ/dqi = 1 soit une augmentation de la production d'une entreprise quelconque entraînant une variation identique de la production totale.
il y a 3 mois
Dans ce cas, la courbe de demande à la firme n'est pas un droite horizontale mais une droite qui a une pente négative comme c'est le cas dans le modèle du monopole. La théorie de la concurrence parfaite est donc mathématiquement fausse. Il faut appliquer le modèle du monopole à toutes les firmes. Le profit est maximum quand le prix de marché est égal au coût marginal et l'offre optimale de la firme pour chaque prix de marché est donc la quantité indiquée par la courbe de coût marginal ( Cm , dans sa partie croissante et supérieure au coût moyen. Cette courbe qui est supposée nécessairement croissante à partie d'un certain niveau de production, car elle suit une évolution symétrique à celle de la courbe du produit marginal ( Pm ) exprimant la loi des rendements factoriels décroissants. L'existance d'une courbe d'offre croissante en fonction du prix suppose que le produit marginal soit continuement décroissant. Or cette hypothèse est remise en cause par Piero Sraffa il y a un siècle dans " Economic Journal " ayant pour titre : " The law of return under competitive conditions ". vol 36, n 144, 1926. Il soutient que le produit marginal est constant au niveau de la firme ou au niveau d'une branche d'activité particulière. S'ensuite que le coût marginal est également constant et qu'il n'y a plus d'offre croissante en fonction du prix. Dans le modèle néoclassique, il est supposé que l'entrepreneur rationnel pousse l'utilisation du travail soit le facteur variable jusqu'au point au moins où le capital qui est le facteur fixe est utilisé pleinement. Au delà, chaque unité de travail supplémentaire aurait une quantité décroissante de capital.
Cela entraîne donc un produit marginal décroissant. Mais Sraffa constate qu'on ne peut pas considérer un facteur comme fixe sauf si on raisonne au niveau de l'ensemble du secteur agricole ou industriel et pas au niveau d'une firme ou branche particulière. Le capital et le travail peuvent se déplacer d'une entreprise à une autre ou d'un produit à un autre, à savoir de la culture du mais à celle de l'avoine, de la construction de scooters à celle de moto, etc... Car le producteur au sein d'une branche peut toujours disposer de travail ou de capital pour augmneter la production d'un bien en particulier. Ainsi, le plein emploi des facteurs est possible au niveau de l'industrie globalement, donc toutes les branches. Mais pas au niveau d'une branche particulière. Donc la théorie de l'offre doit être rejugée. Tout progression de la production augmente la demande globale de travail et accroît les salaires. La distribution et le niveau des revenus, le coût relatif capital/travail, l'arbitrage travail/loisir sont changés. La demande d'investissement et de consommation sont donc effectés aussi. Cela veut dire que toute variation de l'offre entraîne une variation de la demande qui a un effet sur l'offre. L'idée d'une fonction de demande et d'une fonction d'offre se croisant pour déterminer le prix d'équilibre n'a pas de sens.
En effet, cela supposerait 2 fonctions entièrement indépendantes. Or en économie, offre et demande sont dépendants l'un de l'autre. Ainsi, il est estimé par Sraffa qu'il n'y a pas de capital fixe et donc pas de rendements marginaux décroissants. Les entreprises peuvent accroître leur production à produit marginal et coût marginal constants. Si le coût marginal est constant, une firme n'a pas besoin d'une hausse du prix pour décider une augmentation de production. Tant que le prix de marché est au dessus du coût marginal constant, toute production supplémentaire améliore le profit. Les producteurs développent leur production tant qu'ils trouvent des clients pour l'acheter et sans augmenter les prix. La courbe d'offre néoclassique n'a donc pas lieu d'être car les firmes n'offrent pas une quantité de biens croissantes avec le prix mais produisent à coûts et prix constants en ajoutant une marge de profit à leur coût moyen, et ce tant qu'il y a de la demande. Cela rappelle la théorie classique des prix naturels ayant pour origine Richard Cantillon en 1732, à savoir que le prix de long terme est déterminé par le coût moyen de production et qu'à court terme, les prix fluctuent autoru de ce prix naturel en fonction du rapport entre l'offre et la demande. Dans la majorité des entreprises, le capital n'est pas pleinement utilisé même durant des périodes de croissances élevées car il reste des capacités de production en réserver pour augmenter la production à la marge en améliorant le taux d'utilisation des capacités. Les enquêtes sur els fonctions de coûts et les modes de fixation des prix qui sont utilisés dans les entreprises invalident la théorie néoclassique du coût marginal croissant et de la courbe d'offre croissante. Ces enquêtes et études donnent plutôt raison à la théorie de Sraffa qui veut qu'il y ait un coût stable ainsi qu'une production offerte à un prix couvrant le coût et une marge de profit tant qu'il y a de la demande.
Cela entraîne donc un produit marginal décroissant. Mais Sraffa constate qu'on ne peut pas considérer un facteur comme fixe sauf si on raisonne au niveau de l'ensemble du secteur agricole ou industriel et pas au niveau d'une firme ou branche particulière. Le capital et le travail peuvent se déplacer d'une entreprise à une autre ou d'un produit à un autre, à savoir de la culture du mais à celle de l'avoine, de la construction de scooters à celle de moto, etc... Car le producteur au sein d'une branche peut toujours disposer de travail ou de capital pour augmneter la production d'un bien en particulier. Ainsi, le plein emploi des facteurs est possible au niveau de l'industrie globalement, donc toutes les branches. Mais pas au niveau d'une branche particulière. Donc la théorie de l'offre doit être rejugée. Tout progression de la production augmente la demande globale de travail et accroît les salaires. La distribution et le niveau des revenus, le coût relatif capital/travail, l'arbitrage travail/loisir sont changés. La demande d'investissement et de consommation sont donc effectés aussi. Cela veut dire que toute variation de l'offre entraîne une variation de la demande qui a un effet sur l'offre. L'idée d'une fonction de demande et d'une fonction d'offre se croisant pour déterminer le prix d'équilibre n'a pas de sens.
En effet, cela supposerait 2 fonctions entièrement indépendantes. Or en économie, offre et demande sont dépendants l'un de l'autre. Ainsi, il est estimé par Sraffa qu'il n'y a pas de capital fixe et donc pas de rendements marginaux décroissants. Les entreprises peuvent accroître leur production à produit marginal et coût marginal constants. Si le coût marginal est constant, une firme n'a pas besoin d'une hausse du prix pour décider une augmentation de production. Tant que le prix de marché est au dessus du coût marginal constant, toute production supplémentaire améliore le profit. Les producteurs développent leur production tant qu'ils trouvent des clients pour l'acheter et sans augmenter les prix. La courbe d'offre néoclassique n'a donc pas lieu d'être car les firmes n'offrent pas une quantité de biens croissantes avec le prix mais produisent à coûts et prix constants en ajoutant une marge de profit à leur coût moyen, et ce tant qu'il y a de la demande. Cela rappelle la théorie classique des prix naturels ayant pour origine Richard Cantillon en 1732, à savoir que le prix de long terme est déterminé par le coût moyen de production et qu'à court terme, les prix fluctuent autoru de ce prix naturel en fonction du rapport entre l'offre et la demande. Dans la majorité des entreprises, le capital n'est pas pleinement utilisé même durant des périodes de croissances élevées car il reste des capacités de production en réserver pour augmenter la production à la marge en améliorant le taux d'utilisation des capacités. Les enquêtes sur els fonctions de coûts et les modes de fixation des prix qui sont utilisés dans les entreprises invalident la théorie néoclassique du coût marginal croissant et de la courbe d'offre croissante. Ces enquêtes et études donnent plutôt raison à la théorie de Sraffa qui veut qu'il y ait un coût stable ainsi qu'une production offerte à un prix couvrant le coût et une marge de profit tant qu'il y a de la demande.
il y a 3 mois
MONOPOLE
Le monopole est une entreprise seule à produire un bien particulier ou un service. Cette entreprise doit satisfaire la demande du marché correspondant dans sa totalité. Quand on passe du modèle de la concurrence parfaite à celui du monopole, on abandonne l'hypothèse d'atomicité avec un grand nombre de producteurs. Certains types de monopoles ne durent que car d'autres entreprises sont empêchés d'entrer sur le marché. L'hypothèse de libre accès au marché est abandonné.
Il y a 3 types de monopole. D'abord le monopole naturel qui existe grâce à la taille du marché et aux conditions techniques favorables. Tout cela fait que des entreprises concurrentes ne sont pas rentables. Le processus concurrentiel lui même via élimination des producteurs les moins performants et par concentration progressive, débouche sur la constitution inéluctable d'un monopole. De plus, la présence de rendements croissants en longue période peut contribuer à l'apparition de monopoles. Ensuite on a le monopole légal, où il n'existe que il y a des obstacles législatifs ou réglementaires à l'entrée de concurrents sur le marché. Si d'autres entreprises peuvent de façon rentable entrer sur un marché, donc pas de monopole naturel et savent produire le bien qui y est échangé, soit pas de monopole d'innovation, il n'y a pas de raison pour qu'elles n'entrent pas dans ce marché si l'accès est libre. Enfin, le monopole d'innovation contient des entreprises qui créer un nouveau produit suite à une innovation technique et qui se trouve seul à fabriquer et vendre ce produit durant un certain temps. Tout comme le monopole naturel, il est le résultat du processus concurrentiel. Mais il est toujours temporaire car d'autres entreprises finissent par adopter l'innovation et à entrer sur le marché également. Le monopole est le seul offreur sur le marché. Il fait donc face à la totalité de la demande sur ce marché. La différence entre demande de marché et demande de firme n'existe pas. Le prix n'est pas fixé par le marché mais par l'entreprise qui négocie avec les acheteurs à elle seule. Le prix n'est plus indépendant du niveau de production avec demande à la firme parfaitement élastique mais une variable qui décroît avec la quantité produite, donc une courbe de demande décroissante.
L'objectif d'un monopole est l'augmentation du profit. Tant que la recette totale augmente plus vite que le coût total, le profit augmente. Donc la recette marginale est supérieure au coût marginal. Quand Rm = Cm, le profit est au max. Comme en situation concurrentiel, la situation d'équilibre est la même pour un monopole. Mais la conséquence est que la recette moyenne n'est pas égale à la recette moyenne donc au prix. Car la recette moyenne est le prix de vente unitaire. C'est la courbe de demande qui la représente. Vu que le monopole est seul vendeur, sa courbe de demande est la demande de marché qui est décroissante avec le prix. La recette moyenne d'un monopole est par conséquent décroissant. Si cette recette moyenne est décroissante, cela veut dire que la recette marginale l'est également tout en restant inférieur à la recette moyenne. C'est la relation entre variables marginales et variables moyennes. Le monopole fixe un prix supérieur au coût marginal et un prix supérieur à celui fixé par un marché concurrentiel. Il s'éloigne d'une allocation optimale au sens de Pareto. Le prix étant plus élevé, la quantité échangée sera moindre à demande inchangée qu'en situation de concurrence. La courbe de coût marginal du monopole est équivalente à la somme des courbes d'offre individuelle. Elle représente donc l'offre total du marché concurrentiel dans sa partie supérieure au coût moyen. Le point d'équilibre entre offre et demande du marché concurrentiel est donc E c. On vérifie qu'en ce point, le prix est plus faible et la quantité plus important qu'en E m. Le monopole produit donc moins de richesses. Le prix à payer est globalement plus cher à l'acheter. Une firme concurrentielle ne peut sur longue période rester dans une phase de rendements croissants car elle réalise des pertes. Dans cette phase, le coût moyen est supérieur au coût marginal. Comme le prix du marché concurrentiel est égal au coût margina, il est inférieur au coût moyen et on produit à perte.
Le monopole est une entreprise seule à produire un bien particulier ou un service. Cette entreprise doit satisfaire la demande du marché correspondant dans sa totalité. Quand on passe du modèle de la concurrence parfaite à celui du monopole, on abandonne l'hypothèse d'atomicité avec un grand nombre de producteurs. Certains types de monopoles ne durent que car d'autres entreprises sont empêchés d'entrer sur le marché. L'hypothèse de libre accès au marché est abandonné.
Il y a 3 types de monopole. D'abord le monopole naturel qui existe grâce à la taille du marché et aux conditions techniques favorables. Tout cela fait que des entreprises concurrentes ne sont pas rentables. Le processus concurrentiel lui même via élimination des producteurs les moins performants et par concentration progressive, débouche sur la constitution inéluctable d'un monopole. De plus, la présence de rendements croissants en longue période peut contribuer à l'apparition de monopoles. Ensuite on a le monopole légal, où il n'existe que il y a des obstacles législatifs ou réglementaires à l'entrée de concurrents sur le marché. Si d'autres entreprises peuvent de façon rentable entrer sur un marché, donc pas de monopole naturel et savent produire le bien qui y est échangé, soit pas de monopole d'innovation, il n'y a pas de raison pour qu'elles n'entrent pas dans ce marché si l'accès est libre. Enfin, le monopole d'innovation contient des entreprises qui créer un nouveau produit suite à une innovation technique et qui se trouve seul à fabriquer et vendre ce produit durant un certain temps. Tout comme le monopole naturel, il est le résultat du processus concurrentiel. Mais il est toujours temporaire car d'autres entreprises finissent par adopter l'innovation et à entrer sur le marché également. Le monopole est le seul offreur sur le marché. Il fait donc face à la totalité de la demande sur ce marché. La différence entre demande de marché et demande de firme n'existe pas. Le prix n'est pas fixé par le marché mais par l'entreprise qui négocie avec les acheteurs à elle seule. Le prix n'est plus indépendant du niveau de production avec demande à la firme parfaitement élastique mais une variable qui décroît avec la quantité produite, donc une courbe de demande décroissante.
L'objectif d'un monopole est l'augmentation du profit. Tant que la recette totale augmente plus vite que le coût total, le profit augmente. Donc la recette marginale est supérieure au coût marginal. Quand Rm = Cm, le profit est au max. Comme en situation concurrentiel, la situation d'équilibre est la même pour un monopole. Mais la conséquence est que la recette moyenne n'est pas égale à la recette moyenne donc au prix. Car la recette moyenne est le prix de vente unitaire. C'est la courbe de demande qui la représente. Vu que le monopole est seul vendeur, sa courbe de demande est la demande de marché qui est décroissante avec le prix. La recette moyenne d'un monopole est par conséquent décroissant. Si cette recette moyenne est décroissante, cela veut dire que la recette marginale l'est également tout en restant inférieur à la recette moyenne. C'est la relation entre variables marginales et variables moyennes. Le monopole fixe un prix supérieur au coût marginal et un prix supérieur à celui fixé par un marché concurrentiel. Il s'éloigne d'une allocation optimale au sens de Pareto. Le prix étant plus élevé, la quantité échangée sera moindre à demande inchangée qu'en situation de concurrence. La courbe de coût marginal du monopole est équivalente à la somme des courbes d'offre individuelle. Elle représente donc l'offre total du marché concurrentiel dans sa partie supérieure au coût moyen. Le point d'équilibre entre offre et demande du marché concurrentiel est donc E c. On vérifie qu'en ce point, le prix est plus faible et la quantité plus important qu'en E m. Le monopole produit donc moins de richesses. Le prix à payer est globalement plus cher à l'acheter. Une firme concurrentielle ne peut sur longue période rester dans une phase de rendements croissants car elle réalise des pertes. Dans cette phase, le coût moyen est supérieur au coût marginal. Comme le prix du marché concurrentiel est égal au coût margina, il est inférieur au coût moyen et on produit à perte.
il y a 3 mois
CONCURRENCE IMPARFAITE ET MARCHES CONTESTABLES
La concurrence parfaite et le monopole sont des cas extrêmes, que l'on rencontre rarement dans le monde réel où règnent plutôt des situations intermédiaires de concurrence plus ou moins imparfaite. En premier lieu, même sur un marché concurrentiel, les producteurs peuvent s'entendre, fixer le prix comme s'il y avait un monopole et se partager la production et les super profits associés au monopole. Mais la théorie du cartel montre que les coûts de négociation et de surveillance de ce type d'accord rendent les ententes difficiles et éphémères. Une autre façon de limiter la concurrence consiste à différencier son produit des autres biens vendus sur le même marché. Si la firme parvient à convaincre une partie de la clientèle que son produit a des caractéristiques uniques, que ce soit au niveau de la marque, la qualité, l'esthétique, etc...., elle détient un certain pouvoir de monopole sur ce produit. Il se développe alors une concurrence monopolistique où chaque entreprise peut fixer un prix différent des autres, mais où une vive concurrence s'exerce pour distinguer son produit des produits voisins. Enfin, la concurrence s'exerce pour distinguer son produit des produits voisins. Enfin, la concurrence peut être réduite en situation d'oligopole, où quelques entreprises dominent le marché et ont un poids suffisant pour en influencer le fonctionnement. Les firmes adoptent alors un comportement stratégique : leurs décisions dépendent de la façon dont elles anticipent les réactions de leurs concurrents.
Dans les trois structures précédentes, entente, concurrence monopolistique, oligopole, la concurrence est limitée par une réduction directe ou indirecte du nombre de producteurs indépendants, et on s'éloigne de la tarification au coût original qui est censée garantir l'allocation optimale des ressources. Cependant, la théorie des marchés contestables montre que le nombre de producteurs n'est pas le critère déterminant du degré de concurrence : seule importe vraiment la contestabilité du marché, c'est à dire la possibilité pour des firmes extérieures d'y entrer et d'en sortir sans coûts élevés. Si le marché est contestable, quelle que soit sa structure, la menace d'entrée des concurrents potentiels contraint les firmes déjà en place à s'approcher des conditions de fonctionnement de la concurrence parfaite et de la tarification au coût marginal.
LE CARTEL
L'incitation à constituer un cartel ou une entente entre producteurs concurrentiels est claire. On vient de montrer qu'un monopole qui prendrait le contrôle de toutes les entreprises présentes sur un marché concurrentiel réaliserait un profit supérieur aux profits cumulés par toutes ces entreprises. Du point de vue de la branche dans son ensemble, l'équilibre du monopole est plus rentable que l'équilibre concurrentiel. Les producteurs sont donc incités à passer un accord entre eux de façon à limiter la concurrence. Plus précisément, l'accord de cartel consiste à réduire la production et à élever le prix par rapport à l'équilibre concurrentiel, pour atteindre ou s'approcher le plus possible le point d'équilibre du monopole, qui maximise le profit dans la branche. Bien entendu, l'accord doit préciser comment le profit supplémentaire ainsi réalisé au détriment des acheteurs sera réparti entre les différents producteurs. Autrement dit, il faut définit des quotas, c'est à dire la part de la production totale du cartel qui sera assurée par chacun des producteurs. Il apparaît ainsi que tout le marché concurrentiel aurait intérêt à recréer les conditions de marché du monopole par l'entente entre les producteurs. C'est pourquoi, dans le souci de protéger les consommateurs, les ententes entre producteurs sont, en règle général, interdites et sanctionnées par la loi. Mais l'interdiction légale ne constitue pas le principal obstacle aux cartes. En effet, dans un état de droit, il n'est pas aisé d'établir la preuve dune entente entre producteurs. Rien n'interdit à ceux ci de se réunir et de discuter sans laisser de traces matérielles du résultat de leurs réunions. Cependant, les cartels ne prolifèrent pas en raison des coûts de transaction et de surveillance élevés qu'ils imposent aux entreprises.
LES COUTS DU CARTEL. Coûts de renégociation.
En premier lieu, les coûts de négociation de l'accord de cartel augmentent rapidement avec le nombre de producteurs. Si les intérêts de tous les producteurs convergent tant qu'il s'agit d'élever le prix, en revanche, ils sont divergents lorsqu'il s'agit de déterminer des quotas. La négociation des quotas ne va donc pas de soi et un accord quelconque n'est envisageable que si le nombre des parties prenantes à la discussion reste limité. Par conséquent, en raison des coûts de négociation élevés, un cartel est improbable sur un marché concurrentiel caractérisé par un nombre élevé des producteurs.
Coûts de surveillance.
Même si le nombre de producteurs n'empêche pas de conclure un accord de cartel, les coûts de surveillance de cet accord peuvent être dissuasifs. En effet, chaque producteurs a intérêt à conclure l'accord pour maximiser le profit total du cartel, mais il a également intérêt à tricher pour accaparer une part de ce profit plus importante que prévue. Ainsi, une fois qu'un prix supérieur au prix d'équilibre concurrentiel a été fixé, chaque entreprise est incitée à pratiquer un prix légèrement inférieur au prix du cartel ou à octroyer des remises occultes pour capter une partie de la clientèle des autres membres du cartel. On peut également tricher sans agir sur les prix, mais en produisant et vendant plus que le quota fixé dans l'accord. Tous les producteurs sont incités à tricher. Donc s'il n'existe pas une surveillance étroite de leurs décisions par les autres membres du cartel, toutes les entreprises tricheront et l'on reviendra ainsi à la concurrence. Le cartel n'est viable que si la surveillance de l'accord est aisément réalisable pour chaque participant, et à un coût qui ne dépasse pas l'avantage retiré du cartel. Cela encore suppose un nombre limité de producteurs, ainsi qu'un nombre limité de points de vente.
La précarité du cartel.
A long terme, si l'accord n'a pas déjà volé en éclats à la suite des tricheries des uns et des autres, un problème supplémentaire se pose au cartel. Les superprofits qu'il réalise atteint d'autres producteurs dans la branche et cela tend à reproduire les conditions de la concurrence; Même si l'on parvient à intégrer les nouveaux venus dans l'accord, le profit de chacun se trouvera réduit, soit par réduction du prix de vente sur le marché si on laisse l'offre totale augmenter, soit par réduction des quotas individuels. Or, le mouvement des entrées sur le marché ne s'arrête pas tant que les profits sont positifs. En conséquence, à long terme, le marché retourne vers les conditions de la concurrence. Le cartel n'est pas viable, sauf s'il est protégé des nouveaux entrants par une réglementation limitant l'accès au marché. La théorie du cartel montre ainsi qu'un cartel peut être couronné de succès à court terme, mais pas en permanence. L'expérience confirme assez largement cette conclusion. La théorie du cartel a le mérite d'attirer l'attention sur l'incitation permanente des producteurs à s'entendre pour limiter la concurrence sur les prix. Si cette incitation ne débouche pas sur des accords explicites en raison des dispositions légales et surtout des coûts de négociation et de surveillance de tels accords, elle peut néanmoins contribuer à une entente implicite entre les producteurs. En effet, si le nombre de producteurs sur le marché permet à chacun de savoir assez rapidement quels sont les prix pratiqués par les uns et les autres, les entreprises peuvent tacitement s'entendre pour éviter une guerre permanente des prix qui réduirait simplement leurs profits. Il est possible de favoriser le respect d'une entente implicite de ce type en faisant porter une partie du coût de surveillance des concurrents par les acheteurs eux mêmes.
La concurrence parfaite et le monopole sont des cas extrêmes, que l'on rencontre rarement dans le monde réel où règnent plutôt des situations intermédiaires de concurrence plus ou moins imparfaite. En premier lieu, même sur un marché concurrentiel, les producteurs peuvent s'entendre, fixer le prix comme s'il y avait un monopole et se partager la production et les super profits associés au monopole. Mais la théorie du cartel montre que les coûts de négociation et de surveillance de ce type d'accord rendent les ententes difficiles et éphémères. Une autre façon de limiter la concurrence consiste à différencier son produit des autres biens vendus sur le même marché. Si la firme parvient à convaincre une partie de la clientèle que son produit a des caractéristiques uniques, que ce soit au niveau de la marque, la qualité, l'esthétique, etc...., elle détient un certain pouvoir de monopole sur ce produit. Il se développe alors une concurrence monopolistique où chaque entreprise peut fixer un prix différent des autres, mais où une vive concurrence s'exerce pour distinguer son produit des produits voisins. Enfin, la concurrence s'exerce pour distinguer son produit des produits voisins. Enfin, la concurrence peut être réduite en situation d'oligopole, où quelques entreprises dominent le marché et ont un poids suffisant pour en influencer le fonctionnement. Les firmes adoptent alors un comportement stratégique : leurs décisions dépendent de la façon dont elles anticipent les réactions de leurs concurrents.
Dans les trois structures précédentes, entente, concurrence monopolistique, oligopole, la concurrence est limitée par une réduction directe ou indirecte du nombre de producteurs indépendants, et on s'éloigne de la tarification au coût original qui est censée garantir l'allocation optimale des ressources. Cependant, la théorie des marchés contestables montre que le nombre de producteurs n'est pas le critère déterminant du degré de concurrence : seule importe vraiment la contestabilité du marché, c'est à dire la possibilité pour des firmes extérieures d'y entrer et d'en sortir sans coûts élevés. Si le marché est contestable, quelle que soit sa structure, la menace d'entrée des concurrents potentiels contraint les firmes déjà en place à s'approcher des conditions de fonctionnement de la concurrence parfaite et de la tarification au coût marginal.
LE CARTEL
L'incitation à constituer un cartel ou une entente entre producteurs concurrentiels est claire. On vient de montrer qu'un monopole qui prendrait le contrôle de toutes les entreprises présentes sur un marché concurrentiel réaliserait un profit supérieur aux profits cumulés par toutes ces entreprises. Du point de vue de la branche dans son ensemble, l'équilibre du monopole est plus rentable que l'équilibre concurrentiel. Les producteurs sont donc incités à passer un accord entre eux de façon à limiter la concurrence. Plus précisément, l'accord de cartel consiste à réduire la production et à élever le prix par rapport à l'équilibre concurrentiel, pour atteindre ou s'approcher le plus possible le point d'équilibre du monopole, qui maximise le profit dans la branche. Bien entendu, l'accord doit préciser comment le profit supplémentaire ainsi réalisé au détriment des acheteurs sera réparti entre les différents producteurs. Autrement dit, il faut définit des quotas, c'est à dire la part de la production totale du cartel qui sera assurée par chacun des producteurs. Il apparaît ainsi que tout le marché concurrentiel aurait intérêt à recréer les conditions de marché du monopole par l'entente entre les producteurs. C'est pourquoi, dans le souci de protéger les consommateurs, les ententes entre producteurs sont, en règle général, interdites et sanctionnées par la loi. Mais l'interdiction légale ne constitue pas le principal obstacle aux cartes. En effet, dans un état de droit, il n'est pas aisé d'établir la preuve dune entente entre producteurs. Rien n'interdit à ceux ci de se réunir et de discuter sans laisser de traces matérielles du résultat de leurs réunions. Cependant, les cartels ne prolifèrent pas en raison des coûts de transaction et de surveillance élevés qu'ils imposent aux entreprises.
LES COUTS DU CARTEL. Coûts de renégociation.
En premier lieu, les coûts de négociation de l'accord de cartel augmentent rapidement avec le nombre de producteurs. Si les intérêts de tous les producteurs convergent tant qu'il s'agit d'élever le prix, en revanche, ils sont divergents lorsqu'il s'agit de déterminer des quotas. La négociation des quotas ne va donc pas de soi et un accord quelconque n'est envisageable que si le nombre des parties prenantes à la discussion reste limité. Par conséquent, en raison des coûts de négociation élevés, un cartel est improbable sur un marché concurrentiel caractérisé par un nombre élevé des producteurs.
Coûts de surveillance.
Même si le nombre de producteurs n'empêche pas de conclure un accord de cartel, les coûts de surveillance de cet accord peuvent être dissuasifs. En effet, chaque producteurs a intérêt à conclure l'accord pour maximiser le profit total du cartel, mais il a également intérêt à tricher pour accaparer une part de ce profit plus importante que prévue. Ainsi, une fois qu'un prix supérieur au prix d'équilibre concurrentiel a été fixé, chaque entreprise est incitée à pratiquer un prix légèrement inférieur au prix du cartel ou à octroyer des remises occultes pour capter une partie de la clientèle des autres membres du cartel. On peut également tricher sans agir sur les prix, mais en produisant et vendant plus que le quota fixé dans l'accord. Tous les producteurs sont incités à tricher. Donc s'il n'existe pas une surveillance étroite de leurs décisions par les autres membres du cartel, toutes les entreprises tricheront et l'on reviendra ainsi à la concurrence. Le cartel n'est viable que si la surveillance de l'accord est aisément réalisable pour chaque participant, et à un coût qui ne dépasse pas l'avantage retiré du cartel. Cela encore suppose un nombre limité de producteurs, ainsi qu'un nombre limité de points de vente.
La précarité du cartel.
A long terme, si l'accord n'a pas déjà volé en éclats à la suite des tricheries des uns et des autres, un problème supplémentaire se pose au cartel. Les superprofits qu'il réalise atteint d'autres producteurs dans la branche et cela tend à reproduire les conditions de la concurrence; Même si l'on parvient à intégrer les nouveaux venus dans l'accord, le profit de chacun se trouvera réduit, soit par réduction du prix de vente sur le marché si on laisse l'offre totale augmenter, soit par réduction des quotas individuels. Or, le mouvement des entrées sur le marché ne s'arrête pas tant que les profits sont positifs. En conséquence, à long terme, le marché retourne vers les conditions de la concurrence. Le cartel n'est pas viable, sauf s'il est protégé des nouveaux entrants par une réglementation limitant l'accès au marché. La théorie du cartel montre ainsi qu'un cartel peut être couronné de succès à court terme, mais pas en permanence. L'expérience confirme assez largement cette conclusion. La théorie du cartel a le mérite d'attirer l'attention sur l'incitation permanente des producteurs à s'entendre pour limiter la concurrence sur les prix. Si cette incitation ne débouche pas sur des accords explicites en raison des dispositions légales et surtout des coûts de négociation et de surveillance de tels accords, elle peut néanmoins contribuer à une entente implicite entre les producteurs. En effet, si le nombre de producteurs sur le marché permet à chacun de savoir assez rapidement quels sont les prix pratiqués par les uns et les autres, les entreprises peuvent tacitement s'entendre pour éviter une guerre permanente des prix qui réduirait simplement leurs profits. Il est possible de favoriser le respect d'une entente implicite de ce type en faisant porter une partie du coût de surveillance des concurrents par les acheteurs eux mêmes.
il y a 3 mois
LA CONCURRENCE MONOPOLISTIQUE
La concurrence monopolistique désigne une situation où un grand nombre d'entreprises concurrentes parviennent à acquérir un certain pouvoir de monopole, c'est à dire une demande à la firme imparfaitement élastique, grâce à une différenciation de leur produit.
L'hétérogénéité du produite, facteur de monopole.
La différenciation du produit.
Si la taille du marché et les conditions techniques de production entraînent la présence d'un nombre relativement important de producteurs, le marché est, au moins en partie, de nature concurrentielle. Mais en même temps, comme vient de le rappeler la théorie du cartel, les entreprises concurrentielles sont également incitées à limiter la concurrence par les prix dans la mesure où cette dernière réduit la rentabilité de la branche dans son ensemble. Elles peuvent donc chercher à développer une concurrence hors prix en jouant sur les autres caractéristiques du produit. Cette stratégie consiste à différencier leur produit de ceux proposés par les concurrents, de façon à convaincre la clientèle qu'il est en quelque sorte unique. Si cette politique de différenciation du produit réussit, l'entreprise acquiert une sorte de monopole sur son produit. Ce mélange de concurrence et de monopole a amené Edward Charmberlin à décrire ce type de situation par les termes de concurrence monopolistique. Dans : " The Theory of monopolistic Competition " Publié en 1933. Sur le plan théorique, le modèle de la concurrence monopolistique retient donc toutes les hypothèses de la concurrence parfaite, sauf une : l'homogénéité du produit.
Les techniques de différentiation.
La différenciation rend les produits hétérogènes, bien qu'ils soient sur un même marché, destinés au même usage, les acheteurs ne les considèrent plus comme identiques en raison de caractéristiques associées au produit et qui sont spécifiques à chaque entreprise particulière. Cette différenciation prend plusieurs formes. D'abord la différenciation dans l'environnement du produit : services liés au produit, service après vente, sourire de le marchande, etc.... Ensuite la différenciation objective du produit : action sur la couleur, l'esthétique, la résistance, etc.... Puis, la différenciation subjective du produit : il s'agit de convaincre la clientèle que le produit est plus à la mode ou branché que les autres, ou encore du prestige de la marque, etc.... Le développement des stratégies de différenciation incite naturellement les entreprises à faire un usage croissant des différents moyens de communication et notamment de la publicité.
L'équilibre de la firme en concurrence monopolistique.
En courte période, l'équilibre de la firme en concurrence monopolistique peut être décrit comme celui d'un monopole. En effet, si la politique de différenciation est réussie, l'entreprise n'est plus confrontée à une demande parfaitement élastique, comme en concurrence parfaite, mais à une demande décroissante, plus ou moins élastique selon le succès de la différenciation. Plus les clients potentiels sont convaincus que la firme est la seule à produire un ensemble spécifique de caractéristiques associées au produit et dont ils ont besoin, plus leur demande est rigide ( insensible à au prix ( demande à la firme proche d'une droite verticale à. Au contraire, plus ils pensent que les autres produits disponibles sur le même marché peuvent être substitués à celui de la firme, plus leur demande à la firme est élastique par rapport au prix ( demande à la firme proche d'une droite horizontale ). L'entreprise dispose donc d'un pouvoir de fixation simultané du prix et de la quantité, comme un monopole. Ce pouvoir n'est limité à court terme que par le degré d'élasticité de la demande. En courte période donc, l'équilibre de la firme est le point E qui sur une figure reprenant l'équilibre du monopole. En longue période, en revanche, la situation de la firme se distingue nettement de celle d'un monopole pur. En effet, les profits des autres monopoles réalisés par la firme qui a réussi sa politique de différenciation attirent d'autres entreprises.

La concurrence monopolistique désigne une situation où un grand nombre d'entreprises concurrentes parviennent à acquérir un certain pouvoir de monopole, c'est à dire une demande à la firme imparfaitement élastique, grâce à une différenciation de leur produit.
L'hétérogénéité du produite, facteur de monopole.
La différenciation du produit.
Si la taille du marché et les conditions techniques de production entraînent la présence d'un nombre relativement important de producteurs, le marché est, au moins en partie, de nature concurrentielle. Mais en même temps, comme vient de le rappeler la théorie du cartel, les entreprises concurrentielles sont également incitées à limiter la concurrence par les prix dans la mesure où cette dernière réduit la rentabilité de la branche dans son ensemble. Elles peuvent donc chercher à développer une concurrence hors prix en jouant sur les autres caractéristiques du produit. Cette stratégie consiste à différencier leur produit de ceux proposés par les concurrents, de façon à convaincre la clientèle qu'il est en quelque sorte unique. Si cette politique de différenciation du produit réussit, l'entreprise acquiert une sorte de monopole sur son produit. Ce mélange de concurrence et de monopole a amené Edward Charmberlin à décrire ce type de situation par les termes de concurrence monopolistique. Dans : " The Theory of monopolistic Competition " Publié en 1933. Sur le plan théorique, le modèle de la concurrence monopolistique retient donc toutes les hypothèses de la concurrence parfaite, sauf une : l'homogénéité du produit.
Les techniques de différentiation.
La différenciation rend les produits hétérogènes, bien qu'ils soient sur un même marché, destinés au même usage, les acheteurs ne les considèrent plus comme identiques en raison de caractéristiques associées au produit et qui sont spécifiques à chaque entreprise particulière. Cette différenciation prend plusieurs formes. D'abord la différenciation dans l'environnement du produit : services liés au produit, service après vente, sourire de le marchande, etc.... Ensuite la différenciation objective du produit : action sur la couleur, l'esthétique, la résistance, etc.... Puis, la différenciation subjective du produit : il s'agit de convaincre la clientèle que le produit est plus à la mode ou branché que les autres, ou encore du prestige de la marque, etc.... Le développement des stratégies de différenciation incite naturellement les entreprises à faire un usage croissant des différents moyens de communication et notamment de la publicité.
L'équilibre de la firme en concurrence monopolistique.
En courte période, l'équilibre de la firme en concurrence monopolistique peut être décrit comme celui d'un monopole. En effet, si la politique de différenciation est réussie, l'entreprise n'est plus confrontée à une demande parfaitement élastique, comme en concurrence parfaite, mais à une demande décroissante, plus ou moins élastique selon le succès de la différenciation. Plus les clients potentiels sont convaincus que la firme est la seule à produire un ensemble spécifique de caractéristiques associées au produit et dont ils ont besoin, plus leur demande est rigide ( insensible à au prix ( demande à la firme proche d'une droite verticale à. Au contraire, plus ils pensent que les autres produits disponibles sur le même marché peuvent être substitués à celui de la firme, plus leur demande à la firme est élastique par rapport au prix ( demande à la firme proche d'une droite horizontale ). L'entreprise dispose donc d'un pouvoir de fixation simultané du prix et de la quantité, comme un monopole. Ce pouvoir n'est limité à court terme que par le degré d'élasticité de la demande. En courte période donc, l'équilibre de la firme est le point E qui sur une figure reprenant l'équilibre du monopole. En longue période, en revanche, la situation de la firme se distingue nettement de celle d'un monopole pur. En effet, les profits des autres monopoles réalisés par la firme qui a réussi sa politique de différenciation attirent d'autres entreprises.
il y a 3 mois
Si seulement c'était la seule chose qui ne soit pas appliquer dans la constitution

3émé régiment matricule R3-14, from humain to Astartes, pour le régiment et pour l'empereur

il y a 3 mois