Ce sujet a été résolu
Si oui, je m'efforcerai d'y répondre de la manière la plus claire et la plus concise.
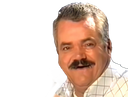
C'est que de l'amour putain !

il y a un mois
Explique moi clairement le théorème des résidus stp
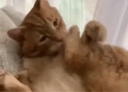
Il est doux à tout âge de se laisser guider par la fantaisie.
il y a un mois
PatrickSebasti1
1 mois
Si oui, je m'efforcerai d'y répondre de la manière la plus claire et la plus concise.
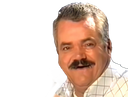
Tu fais un métier en rapport avec les maths ?
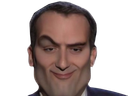
il y a un mois
PatrickSebasti1
1 mois
Si oui, je m'efforcerai d'y répondre de la manière la plus claire et la plus concise.
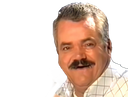
Tu fais un métier en rapport avec les maths ?
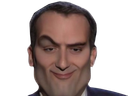
il y a un mois
BlueLadyShow
1 mois
Explique moi clairement le théorème des résidus stp
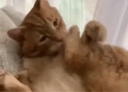
Je vais partir du principe que tu sais déjà ce qu'est une fonction holomorphe et une fonction méromorphe.
Quand tu as une fonction complexe f(z), et si f(z)dz est une forme différentielle exacte (c'est-à-dire si elle possède une primitive), alors on peut facilement montrer que l'intégrale de f(z)dz sur tout lacet est nulle (car elle sera égale à la différence des valeurs de la primitive aux extrémités du lacet, mais lacet = courbe fermée et donc ces deux extrémités sont les mêmes et donc la différence sera nulle).
Si f est holomorphe (sur C disons), alors f(z)dz est exacte (il suffit de considérer une primitive de f).
C'est aussi le cas toute fonction complexe de la forme f(z)=1/(z^n) lorsque n est plus grand que 2 (car alors une primitive de f(z)dz sera F(z) = 1/((-n+1)z^(n-1))
Le seul hic, c'est pour une fonction complexe de la forme f(z) = 1/z. Alors f(z)dz n'est pas primitivable sur C (car alors sa primitive serait un logarithme complexe, qui n'est pas défini de manière univoque).
Et effectivement, l'intégrale de cette fonction le long d'un lacet tournant autour de zéro sera égale à 2i*pi*Ind où Ind est l'indice du lacet (le nombre de tours qu'il fait autour de zéro).
Comme une fonction méromorphe sur C est une combinaison linéaire des trois types de fonctions énumérés ci-dessus, on en déduit que l'intégrale d'une fonction méromorphe f sur un lacet vaudra 2i*pi*Ind*Res où Res est justement le coefficient de 1/z dans le développement de cette fonction.
Quand tu as une fonction complexe f(z), et si f(z)dz est une forme différentielle exacte (c'est-à-dire si elle possède une primitive), alors on peut facilement montrer que l'intégrale de f(z)dz sur tout lacet est nulle (car elle sera égale à la différence des valeurs de la primitive aux extrémités du lacet, mais lacet = courbe fermée et donc ces deux extrémités sont les mêmes et donc la différence sera nulle).
Si f est holomorphe (sur C disons), alors f(z)dz est exacte (il suffit de considérer une primitive de f).
C'est aussi le cas toute fonction complexe de la forme f(z)=1/(z^n) lorsque n est plus grand que 2 (car alors une primitive de f(z)dz sera F(z) = 1/((-n+1)z^(n-1))
Le seul hic, c'est pour une fonction complexe de la forme f(z) = 1/z. Alors f(z)dz n'est pas primitivable sur C (car alors sa primitive serait un logarithme complexe, qui n'est pas défini de manière univoque).
Et effectivement, l'intégrale de cette fonction le long d'un lacet tournant autour de zéro sera égale à 2i*pi*Ind où Ind est l'indice du lacet (le nombre de tours qu'il fait autour de zéro).
Comme une fonction méromorphe sur C est une combinaison linéaire des trois types de fonctions énumérés ci-dessus, on en déduit que l'intégrale d'une fonction méromorphe f sur un lacet vaudra 2i*pi*Ind*Res où Res est justement le coefficient de 1/z dans le développement de cette fonction.
C'est que de l'amour putain !

il y a un mois
Tu fais un métier en rapport avec les maths ?
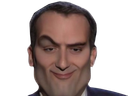
J'étais prof par le passé.
C'est que de l'amour putain !

il y a un mois
J'étais prof par le passé.
Pourquoi c'est plus d'actualité ?
il y a un mois
Je vais partir du principe que tu sais déjà ce qu'est une fonction holomorphe et une fonction méromorphe.
Quand tu as une fonction complexe f(z), et si f(z)dz est une forme différentielle exacte (c'est-à-dire si elle possède une primitive), alors on peut facilement montrer que l'intégrale de f(z)dz sur tout lacet est nulle (car elle sera égale à la différence des valeurs de la primitive aux extrémités du lacet, mais lacet = courbe fermée et donc ces deux extrémités sont les mêmes et donc la différence sera nulle).
Si f est holomorphe (sur C disons), alors f(z)dz est exacte (il suffit de considérer une primitive de f).
C'est aussi le cas toute fonction complexe de la forme f(z)=1/(z^n) lorsque n est plus grand que 2 (car alors une primitive de f(z)dz sera F(z) = 1/((-n+1)z^(n-1))
Le seul hic, c'est pour une fonction complexe de la forme f(z) = 1/z. Alors f(z)dz n'est pas primitivable sur C (car alors sa primitive serait un logarithme complexe, qui n'est pas défini de manière univoque).
Et effectivement, l'intégrale de cette fonction le long d'un lacet tournant autour de zéro sera égale à 2i*pi*Ind où Ind est l'indice du lacet (le nombre de tours qu'il fait autour de zéro).
Comme une fonction méromorphe sur C est une combinaison linéaire des trois types de fonctions énumérés ci-dessus, on en déduit que l'intégrale d'une fonction méromorphe f sur un lacet vaudra 2i*pi*Ind*Res où Res est justement le coefficient de 1/z dans le développement de cette fonction.
Quand tu as une fonction complexe f(z), et si f(z)dz est une forme différentielle exacte (c'est-à-dire si elle possède une primitive), alors on peut facilement montrer que l'intégrale de f(z)dz sur tout lacet est nulle (car elle sera égale à la différence des valeurs de la primitive aux extrémités du lacet, mais lacet = courbe fermée et donc ces deux extrémités sont les mêmes et donc la différence sera nulle).
Si f est holomorphe (sur C disons), alors f(z)dz est exacte (il suffit de considérer une primitive de f).
C'est aussi le cas toute fonction complexe de la forme f(z)=1/(z^n) lorsque n est plus grand que 2 (car alors une primitive de f(z)dz sera F(z) = 1/((-n+1)z^(n-1))
Le seul hic, c'est pour une fonction complexe de la forme f(z) = 1/z. Alors f(z)dz n'est pas primitivable sur C (car alors sa primitive serait un logarithme complexe, qui n'est pas défini de manière univoque).
Et effectivement, l'intégrale de cette fonction le long d'un lacet tournant autour de zéro sera égale à 2i*pi*Ind où Ind est l'indice du lacet (le nombre de tours qu'il fait autour de zéro).
Comme une fonction méromorphe sur C est une combinaison linéaire des trois types de fonctions énumérés ci-dessus, on en déduit que l'intégrale d'une fonction méromorphe f sur un lacet vaudra 2i*pi*Ind*Res où Res est justement le coefficient de 1/z dans le développement de cette fonction.
Tu es vraiment brillant, tu devrais redevenir prof, on a besoin de ton cerveau
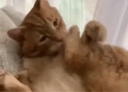
Il est doux à tout âge de se laisser guider par la fantaisie.
il y a un mois
Tu es vraiment brillant, tu devrais redevenir prof, on a besoin de ton cerveau
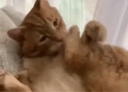
No pussy no work
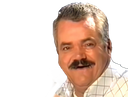
C'est que de l'amour putain !

il y a un mois
Friteausucre
1 mois
Explique moi la loi de poisson
C'est une loi probabiliste utilisée pour modéliser le nombre de fois qu'un évènement arrive dans un intervalle donné.
Par exemple: si tu notes N le nombres de fois que tu baiseras cette année, alors N pourra être modélisé par une loi de Poisson.
Par exemple: si tu notes N le nombres de fois que tu baiseras cette année, alors N pourra être modélisé par une loi de Poisson.
C'est que de l'amour putain !

il y a un mois
J'étais prof par le passé.
T'es sûr que tu réponds pas avec l'ia ?


il y a un mois
Le but de ce topic n'est pas de parler de ma petite personne, c'est un sujet bien médiocre comparé aux mathématiques.
C'est que de l'amour putain !

il y a un mois
Ce n'est pas une vraie question parce que tu connais déjà la réponse.
C'est que de l'amour putain !

il y a un mois
T'es sûr que tu réponds pas avec l'ia ?


Excuse-moi de t'avoir remballé comme ça mais c'est insultant ta remarque.
C'est que de l'amour putain !

il y a un mois
Pepe
1 mois
le théorème de Lagrange sur les groupes

Bah si H est un sous-groupe d'un groupe G,
alors G peut-être partitionné en classes d'équivalences modulo H, qui sont toutes de cardinal H.
Donc le cardinal de H divise celui de G.
et #G/#H est égal au cardinal de l'ensemble quotient G/H.
D'ailleurs si par exemple on prend pour H le groupe engendré par un élément g,
alors cela prouve que le cardinal de H, c'est-à-dire l'ordre de g, divise le cardinal de G.
Et donc g^(#G) = 1.
C'est comme ça qu'on démontre le petit théorème de Fermat:
si x est premier à p (c'est-à-dire x est inversible dans Z/pZ) alors
x^(p-1) est congru à 1 modulo p (si p est premier)
car le groupe des éléments inversibles de Z/pZ est de cardinal p-1.
Dans le cas où p ne serait pas premier, ça donnerait:
x^(phi(p)) congru à 1 modulo p
où phi(p) est l'indicatrice d'Euler.
alors G peut-être partitionné en classes d'équivalences modulo H, qui sont toutes de cardinal H.
Donc le cardinal de H divise celui de G.
et #G/#H est égal au cardinal de l'ensemble quotient G/H.
D'ailleurs si par exemple on prend pour H le groupe engendré par un élément g,
alors cela prouve que le cardinal de H, c'est-à-dire l'ordre de g, divise le cardinal de G.
Et donc g^(#G) = 1.
C'est comme ça qu'on démontre le petit théorème de Fermat:
si x est premier à p (c'est-à-dire x est inversible dans Z/pZ) alors
x^(p-1) est congru à 1 modulo p (si p est premier)
car le groupe des éléments inversibles de Z/pZ est de cardinal p-1.
Dans le cas où p ne serait pas premier, ça donnerait:
x^(phi(p)) congru à 1 modulo p
où phi(p) est l'indicatrice d'Euler.
C'est que de l'amour putain !

il y a un mois
Bah si H est un sous-groupe d'un groupe G,
alors G peut-être partitionné en classes d'équivalences modulo H, qui sont toutes de cardinal H.
Donc le cardinal de H divise celui de G.
et #G/#H est égal au cardinal de l'ensemble quotient G/H.
D'ailleurs si par exemple on prend pour H le groupe engendré par un élément g,
alors cela prouve que le cardinal de H, c'est-à-dire l'ordre de g, divise le cardinal de G.
Et donc g^(#G) = 1.
C'est comme ça qu'on démontre le petit théorème de Fermat:
si x est premier à p (c'est-à-dire x est inversible dans Z/pZ) alors
x^(p-1) est congru à 1 modulo p (si p est premier)
car le groupe des éléments inversibles de Z/pZ est de cardinal p-1.
Dans le cas où p ne serait pas premier, ça donnerait:
x^(phi(p)) congru à 1 modulo p
où phi(p) est l'indicatrice d'Euler.
alors G peut-être partitionné en classes d'équivalences modulo H, qui sont toutes de cardinal H.
Donc le cardinal de H divise celui de G.
et #G/#H est égal au cardinal de l'ensemble quotient G/H.
D'ailleurs si par exemple on prend pour H le groupe engendré par un élément g,
alors cela prouve que le cardinal de H, c'est-à-dire l'ordre de g, divise le cardinal de G.
Et donc g^(#G) = 1.
C'est comme ça qu'on démontre le petit théorème de Fermat:
si x est premier à p (c'est-à-dire x est inversible dans Z/pZ) alors
x^(p-1) est congru à 1 modulo p (si p est premier)
car le groupe des éléments inversibles de Z/pZ est de cardinal p-1.
Dans le cas où p ne serait pas premier, ça donnerait:
x^(phi(p)) congru à 1 modulo p
où phi(p) est l'indicatrice d'Euler.
C'est pas évident pour moi que l'ordre de H divise toujours celui de G
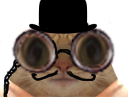
Comment ça se fait que ça marche pour tout G et H ?
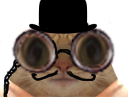
Comment ça se fait que ça marche pour tout G et H ?
il y a un mois
PatrickSebasti1
1 mois
Si oui, je m'efforcerai d'y répondre de la manière la plus claire et la plus concise.
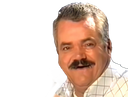
Oui , pourquoi j'ai toujours était une bite en math ?
Genre en primaire je comprenais pas les mutiplication par 10
Genre en primaire je comprenais pas les mutiplication par 10
il y a un mois
C'est pas évident pour moi que l'ordre de H divise toujours celui de G
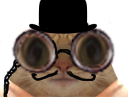
Comment ça se fait que ça marche pour tout G et H ?
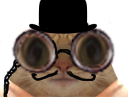
Comment ça se fait que ça marche pour tout G et H ?
Si g est un élément de G, on note gH sa classe à droite modulo H (c'est-à-dire l'ensemble des éléments de la forme gh, où h appartient à H).
1) Alors tout élément de G appartient à un des gH (c'est évident, puisque si x est un élément de G, alors x appartient à xH).
2) De plus, tous les gH sont de même cardinal, à savoir le cardinal de H. Pourquoi ? Parce que l'application qui va de H dans gH et qui à h associe gh est bijective.
3) Enfin, si je considères deux classes xH et yH, alors soit leur intersection est vide, soit elles sont égales.
1) et 3) suffisent à dire que l'ensemble des gH forme une partition de G.
Et d'après 2), tous les éléments de cette partition ont le même cardinal.
C'est donc comme si tu divisais un ensemble en un certain nombre de sous-ensembles, tous de même taille.
La taille commune à ces sous-ensembles divise la taille de l'ensemble.
(Si le nombre de français était égal au nombre d'allemands qui était égal au nombre d'espagnols etc... Alors le nombre de français diviserait le nombre d'européens)
1) Alors tout élément de G appartient à un des gH (c'est évident, puisque si x est un élément de G, alors x appartient à xH).
2) De plus, tous les gH sont de même cardinal, à savoir le cardinal de H. Pourquoi ? Parce que l'application qui va de H dans gH et qui à h associe gh est bijective.
3) Enfin, si je considères deux classes xH et yH, alors soit leur intersection est vide, soit elles sont égales.
1) et 3) suffisent à dire que l'ensemble des gH forme une partition de G.
Et d'après 2), tous les éléments de cette partition ont le même cardinal.
C'est donc comme si tu divisais un ensemble en un certain nombre de sous-ensembles, tous de même taille.
La taille commune à ces sous-ensembles divise la taille de l'ensemble.
(Si le nombre de français était égal au nombre d'allemands qui était égal au nombre d'espagnols etc... Alors le nombre de français diviserait le nombre d'européens)
C'est que de l'amour putain !

il y a un mois























