Ce sujet a été résolu
La crise actuelle des rapports hommes-femmes et la baisse de la natalité sont le résultat d’un ensemble de facteurs interdépendants. Mais selon moi, le principal facteur réside dans l’instrumentalisation idéologique des rapports entre les sexes, notamment par certaines mouvances féministes et leur relai médiatique.
Depuis les années 1990, un discours dominant s’est imposé : celui d’un passé patriarcal oppressif, où l’homme est présenté comme violent, dominateur, voire quasi-esclavagiste. Ce récit, martelé à travers les médias, les fictions (ex. Mad Men et beaucoup de series netflix ou on fait croire que la femme étais l'esclave de l'homme) et l’enseignement, a façonné l’imaginaire collectif. Une génération entière de femmes a été persuadée qu’il fallait s’émanciper à tout prix, sous peine de retomber dans une oppression systémique. Ce récit a également servi des intérêts économiques, en favorisant l’intégration massive des femmes dans le marché du travail, pour soutenir une économie de services en perte de vitesse.
Parallèlement, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large : éviter toute stigmatisation communautaire, notamment dans le cadre de l’immigration. L’État et les institutions ont opté pour une lecture binaire du vivre-ensemble, reposant sur un dogme : l’immigration est une solution à la crise économique, donc elle doit être protégée à tout prix. Cela a conduit à éviter toute critique publique ou désignation claire de certaines dérives issues d’une immigration non intégrée, à qui l’on a parfois inculqué l’idée que "les Français vous doivent tout", ou qu’ils sont structurellement racistes.
Certaines de ces populations, mal intégrées culturellement, socialement ou économiquement, ont développé des comportements parfois incompatibles avec les normes locales, notamment dans le rapport aux femmes. Mais au lieu de nommer les causes, on a préféré déplacer le curseur vers une culpabilisation généralisée du sexe masculin. L’homme, dans son ensemble, est devenu la cible : suspect par défaut, relégué au rôle d’agresseur potentiel.
Les conséquences sont profondes. D’un côté, des aides publiques financées en partie par les hommes soutiennent parfois des structures familiales où ceux-ci sont exclus ou marginalisés, notamment après une séparation. Le rôle parental masculin est fragilisé, et les pères risquent souvent d’être écartés.
De l’autre, la peur d’approcher une femme, même respectueusement, grandit. Le risque d’humiliation ou d’accusation disproportionnée dissuade de plus en plus d’hommes d’interagir. Résultat : beaucoup se désengagent, par prudence ou lassitude.
Le marché de la rencontre a été profondément transformé. Avant, il reposait sur des interactions réelles et locales (travail, cercle social, sorties). Aujourd’hui, avec les applications de rencontre, on assiste à une mise en concurrence quasi illimitée, où une minorité d’hommes très favorisés physiquement, socialement ou financièrement concentre l’essentiel de l’attention féminine.
Ce phénomène repose sur un biais structurel : le ratio entre l’offre (femmes) et la demande (hommes intéressants) est très déséquilibré. Résultat : certaines femmes peuvent multiplier les interactions avec les hommes les plus convoités, ceux du "top 2 à 10 %", ce qui établit un nouveau mètre étalon pour évaluer leur propre valeur ou leurs attentes. Elles intègrent alors inconsciemment que ces hommes représentent leur norme d’accès relationnel, même si ces derniers ne cherchent souvent que des aventures sans lendemain.
Cette illusion de disponibilité entraîne une surestimation de leur valeur perçue sur le marché sexuo-affectif et, inversement, une dévalorisation massive des hommes ordinaires, devenus invisibles. C’est un renversement complet de l’équilibre ancien, où chacun se positionnait dans un cadre local, cohérent avec sa réalité.
Enfin, les réseaux sociaux ont amplifié la situation. Ils imposent des standards irréalistes (physiques, financiers, sociaux), créant des attentes déconnectées du réel. Cela alimente frustrations, ressentiment, hypergamie accentuée et manque d’empathie mutuelle.
Tout cela se traduit par une méfiance généralisée, une perte de repères, un repli masculin de plus en plus marqué. Face à un système perçu comme hostile ou injuste, beaucoup d’hommes choisissent de se désengager : refus d’engagement, retrait des relations amoureuses, abandon de l’effort social, voire refuge dans la pornographie ou le divertissement numérique. Ce repli n’est pas seulement individuel, il devient structurel. Il reflète une perte de motivation face à un environnement où les risques (juridiques, émotionnels, sociaux) sont jugés trop élevés au regard des bénéfices espérés. Le résultat est une désaffection croissante pour la vie de couple, la paternité, et la projection dans l’avenir, contribuant directement à la baisse de la natalité.
vous en pensez quoi ?

Depuis les années 1990, un discours dominant s’est imposé : celui d’un passé patriarcal oppressif, où l’homme est présenté comme violent, dominateur, voire quasi-esclavagiste. Ce récit, martelé à travers les médias, les fictions (ex. Mad Men et beaucoup de series netflix ou on fait croire que la femme étais l'esclave de l'homme) et l’enseignement, a façonné l’imaginaire collectif. Une génération entière de femmes a été persuadée qu’il fallait s’émanciper à tout prix, sous peine de retomber dans une oppression systémique. Ce récit a également servi des intérêts économiques, en favorisant l’intégration massive des femmes dans le marché du travail, pour soutenir une économie de services en perte de vitesse.
Parallèlement, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large : éviter toute stigmatisation communautaire, notamment dans le cadre de l’immigration. L’État et les institutions ont opté pour une lecture binaire du vivre-ensemble, reposant sur un dogme : l’immigration est une solution à la crise économique, donc elle doit être protégée à tout prix. Cela a conduit à éviter toute critique publique ou désignation claire de certaines dérives issues d’une immigration non intégrée, à qui l’on a parfois inculqué l’idée que "les Français vous doivent tout", ou qu’ils sont structurellement racistes.
Certaines de ces populations, mal intégrées culturellement, socialement ou économiquement, ont développé des comportements parfois incompatibles avec les normes locales, notamment dans le rapport aux femmes. Mais au lieu de nommer les causes, on a préféré déplacer le curseur vers une culpabilisation généralisée du sexe masculin. L’homme, dans son ensemble, est devenu la cible : suspect par défaut, relégué au rôle d’agresseur potentiel.
Les conséquences sont profondes. D’un côté, des aides publiques financées en partie par les hommes soutiennent parfois des structures familiales où ceux-ci sont exclus ou marginalisés, notamment après une séparation. Le rôle parental masculin est fragilisé, et les pères risquent souvent d’être écartés.
De l’autre, la peur d’approcher une femme, même respectueusement, grandit. Le risque d’humiliation ou d’accusation disproportionnée dissuade de plus en plus d’hommes d’interagir. Résultat : beaucoup se désengagent, par prudence ou lassitude.
Le marché de la rencontre a été profondément transformé. Avant, il reposait sur des interactions réelles et locales (travail, cercle social, sorties). Aujourd’hui, avec les applications de rencontre, on assiste à une mise en concurrence quasi illimitée, où une minorité d’hommes très favorisés physiquement, socialement ou financièrement concentre l’essentiel de l’attention féminine.
Ce phénomène repose sur un biais structurel : le ratio entre l’offre (femmes) et la demande (hommes intéressants) est très déséquilibré. Résultat : certaines femmes peuvent multiplier les interactions avec les hommes les plus convoités, ceux du "top 2 à 10 %", ce qui établit un nouveau mètre étalon pour évaluer leur propre valeur ou leurs attentes. Elles intègrent alors inconsciemment que ces hommes représentent leur norme d’accès relationnel, même si ces derniers ne cherchent souvent que des aventures sans lendemain.
Cette illusion de disponibilité entraîne une surestimation de leur valeur perçue sur le marché sexuo-affectif et, inversement, une dévalorisation massive des hommes ordinaires, devenus invisibles. C’est un renversement complet de l’équilibre ancien, où chacun se positionnait dans un cadre local, cohérent avec sa réalité.
Enfin, les réseaux sociaux ont amplifié la situation. Ils imposent des standards irréalistes (physiques, financiers, sociaux), créant des attentes déconnectées du réel. Cela alimente frustrations, ressentiment, hypergamie accentuée et manque d’empathie mutuelle.
Tout cela se traduit par une méfiance généralisée, une perte de repères, un repli masculin de plus en plus marqué. Face à un système perçu comme hostile ou injuste, beaucoup d’hommes choisissent de se désengager : refus d’engagement, retrait des relations amoureuses, abandon de l’effort social, voire refuge dans la pornographie ou le divertissement numérique. Ce repli n’est pas seulement individuel, il devient structurel. Il reflète une perte de motivation face à un environnement où les risques (juridiques, émotionnels, sociaux) sont jugés trop élevés au regard des bénéfices espérés. Le résultat est une désaffection croissante pour la vie de couple, la paternité, et la projection dans l’avenir, contribuant directement à la baisse de la natalité.
vous en pensez quoi ?
il y a 2 mois
Bordel même ici, c'est plus possible d'avoir de discutions sérieuse, dès que ça fait plus de 2 paragraphes, c'est trop ...

il y a 2 mois
Gpalu


F.R.A.N.C.E.= Fédération des Réfugiés Arabes Nourris par les Caisses de l'État
il y a 2 mois
Non c'est très trés bien Kheyou, je plussoie ton constat

La seule solution qui nous reste c'est de continuer d'esseyer de parler aux femmes. Il y en as toujours des biens, bien que je ne peux m'empêcher de penser à la scène de Nicoles Kidman dans eyes wide shut.

La seule solution qui nous reste c'est de continuer d'esseyer de parler aux femmes. Il y en as toujours des biens, bien que je ne peux m'empêcher de penser à la scène de Nicoles Kidman dans eyes wide shut.
il y a 2 mois

Pouko
2 mois
Carré franchement
merci, mais je pense qu'il y a encore certains points que je n'ai pas assez expliqués, mais c'étais déjà trop long

il y a 2 mois
walterJR
2 mois
La crise actuelle des rapports hommes-femmes et la baisse de la natalité sont le résultat d’un ensemble de facteurs interdépendants. Mais selon moi, le principal facteur réside dans l’instrumentalisation idéologique des rapports entre les sexes, notamment par certaines mouvances féministes et leur relai médiatique.
Depuis les années 1990, un discours dominant s’est imposé : celui d’un passé patriarcal oppressif, où l’homme est présenté comme violent, dominateur, voire quasi-esclavagiste. Ce récit, martelé à travers les médias, les fictions (ex. Mad Men et beaucoup de series netflix ou on fait croire que la femme étais l'esclave de l'homme) et l’enseignement, a façonné l’imaginaire collectif. Une génération entière de femmes a été persuadée qu’il fallait s’émanciper à tout prix, sous peine de retomber dans une oppression systémique. Ce récit a également servi des intérêts économiques, en favorisant l’intégration massive des femmes dans le marché du travail, pour soutenir une économie de services en perte de vitesse.
Parallèlement, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large : éviter toute stigmatisation communautaire, notamment dans le cadre de l’immigration. L’État et les institutions ont opté pour une lecture binaire du vivre-ensemble, reposant sur un dogme : l’immigration est une solution à la crise économique, donc elle doit être protégée à tout prix. Cela a conduit à éviter toute critique publique ou désignation claire de certaines dérives issues d’une immigration non intégrée, à qui l’on a parfois inculqué l’idée que "les Français vous doivent tout", ou qu’ils sont structurellement racistes.
Certaines de ces populations, mal intégrées culturellement, socialement ou économiquement, ont développé des comportements parfois incompatibles avec les normes locales, notamment dans le rapport aux femmes. Mais au lieu de nommer les causes, on a préféré déplacer le curseur vers une culpabilisation généralisée du sexe masculin. L’homme, dans son ensemble, est devenu la cible : suspect par défaut, relégué au rôle d’agresseur potentiel.
Les conséquences sont profondes. D’un côté, des aides publiques financées en partie par les hommes soutiennent parfois des structures familiales où ceux-ci sont exclus ou marginalisés, notamment après une séparation. Le rôle parental masculin est fragilisé, et les pères risquent souvent d’être écartés.
De l’autre, la peur d’approcher une femme, même respectueusement, grandit. Le risque d’humiliation ou d’accusation disproportionnée dissuade de plus en plus d’hommes d’interagir. Résultat : beaucoup se désengagent, par prudence ou lassitude.
Le marché de la rencontre a été profondément transformé. Avant, il reposait sur des interactions réelles et locales (travail, cercle social, sorties). Aujourd’hui, avec les applications de rencontre, on assiste à une mise en concurrence quasi illimitée, où une minorité d’hommes très favorisés physiquement, socialement ou financièrement concentre l’essentiel de l’attention féminine.
Ce phénomène repose sur un biais structurel : le ratio entre l’offre (femmes) et la demande (hommes intéressants) est très déséquilibré. Résultat : certaines femmes peuvent multiplier les interactions avec les hommes les plus convoités, ceux du "top 2 à 10 %", ce qui établit un nouveau mètre étalon pour évaluer leur propre valeur ou leurs attentes. Elles intègrent alors inconsciemment que ces hommes représentent leur norme d’accès relationnel, même si ces derniers ne cherchent souvent que des aventures sans lendemain.
Cette illusion de disponibilité entraîne une surestimation de leur valeur perçue sur le marché sexuo-affectif et, inversement, une dévalorisation massive des hommes ordinaires, devenus invisibles. C’est un renversement complet de l’équilibre ancien, où chacun se positionnait dans un cadre local, cohérent avec sa réalité.
Enfin, les réseaux sociaux ont amplifié la situation. Ils imposent des standards irréalistes (physiques, financiers, sociaux), créant des attentes déconnectées du réel. Cela alimente frustrations, ressentiment, hypergamie accentuée et manque d’empathie mutuelle.
Tout cela se traduit par une méfiance généralisée, une perte de repères, un repli masculin de plus en plus marqué. Face à un système perçu comme hostile ou injuste, beaucoup d’hommes choisissent de se désengager : refus d’engagement, retrait des relations amoureuses, abandon de l’effort social, voire refuge dans la pornographie ou le divertissement numérique. Ce repli n’est pas seulement individuel, il devient structurel. Il reflète une perte de motivation face à un environnement où les risques (juridiques, émotionnels, sociaux) sont jugés trop élevés au regard des bénéfices espérés. Le résultat est une désaffection croissante pour la vie de couple, la paternité, et la projection dans l’avenir, contribuant directement à la baisse de la natalité.
vous en pensez quoi ?

Depuis les années 1990, un discours dominant s’est imposé : celui d’un passé patriarcal oppressif, où l’homme est présenté comme violent, dominateur, voire quasi-esclavagiste. Ce récit, martelé à travers les médias, les fictions (ex. Mad Men et beaucoup de series netflix ou on fait croire que la femme étais l'esclave de l'homme) et l’enseignement, a façonné l’imaginaire collectif. Une génération entière de femmes a été persuadée qu’il fallait s’émanciper à tout prix, sous peine de retomber dans une oppression systémique. Ce récit a également servi des intérêts économiques, en favorisant l’intégration massive des femmes dans le marché du travail, pour soutenir une économie de services en perte de vitesse.
Parallèlement, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large : éviter toute stigmatisation communautaire, notamment dans le cadre de l’immigration. L’État et les institutions ont opté pour une lecture binaire du vivre-ensemble, reposant sur un dogme : l’immigration est une solution à la crise économique, donc elle doit être protégée à tout prix. Cela a conduit à éviter toute critique publique ou désignation claire de certaines dérives issues d’une immigration non intégrée, à qui l’on a parfois inculqué l’idée que "les Français vous doivent tout", ou qu’ils sont structurellement racistes.
Certaines de ces populations, mal intégrées culturellement, socialement ou économiquement, ont développé des comportements parfois incompatibles avec les normes locales, notamment dans le rapport aux femmes. Mais au lieu de nommer les causes, on a préféré déplacer le curseur vers une culpabilisation généralisée du sexe masculin. L’homme, dans son ensemble, est devenu la cible : suspect par défaut, relégué au rôle d’agresseur potentiel.
Les conséquences sont profondes. D’un côté, des aides publiques financées en partie par les hommes soutiennent parfois des structures familiales où ceux-ci sont exclus ou marginalisés, notamment après une séparation. Le rôle parental masculin est fragilisé, et les pères risquent souvent d’être écartés.
De l’autre, la peur d’approcher une femme, même respectueusement, grandit. Le risque d’humiliation ou d’accusation disproportionnée dissuade de plus en plus d’hommes d’interagir. Résultat : beaucoup se désengagent, par prudence ou lassitude.
Le marché de la rencontre a été profondément transformé. Avant, il reposait sur des interactions réelles et locales (travail, cercle social, sorties). Aujourd’hui, avec les applications de rencontre, on assiste à une mise en concurrence quasi illimitée, où une minorité d’hommes très favorisés physiquement, socialement ou financièrement concentre l’essentiel de l’attention féminine.
Ce phénomène repose sur un biais structurel : le ratio entre l’offre (femmes) et la demande (hommes intéressants) est très déséquilibré. Résultat : certaines femmes peuvent multiplier les interactions avec les hommes les plus convoités, ceux du "top 2 à 10 %", ce qui établit un nouveau mètre étalon pour évaluer leur propre valeur ou leurs attentes. Elles intègrent alors inconsciemment que ces hommes représentent leur norme d’accès relationnel, même si ces derniers ne cherchent souvent que des aventures sans lendemain.
Cette illusion de disponibilité entraîne une surestimation de leur valeur perçue sur le marché sexuo-affectif et, inversement, une dévalorisation massive des hommes ordinaires, devenus invisibles. C’est un renversement complet de l’équilibre ancien, où chacun se positionnait dans un cadre local, cohérent avec sa réalité.
Enfin, les réseaux sociaux ont amplifié la situation. Ils imposent des standards irréalistes (physiques, financiers, sociaux), créant des attentes déconnectées du réel. Cela alimente frustrations, ressentiment, hypergamie accentuée et manque d’empathie mutuelle.
Tout cela se traduit par une méfiance généralisée, une perte de repères, un repli masculin de plus en plus marqué. Face à un système perçu comme hostile ou injuste, beaucoup d’hommes choisissent de se désengager : refus d’engagement, retrait des relations amoureuses, abandon de l’effort social, voire refuge dans la pornographie ou le divertissement numérique. Ce repli n’est pas seulement individuel, il devient structurel. Il reflète une perte de motivation face à un environnement où les risques (juridiques, émotionnels, sociaux) sont jugés trop élevés au regard des bénéfices espérés. Le résultat est une désaffection croissante pour la vie de couple, la paternité, et la projection dans l’avenir, contribuant directement à la baisse de la natalité.
vous en pensez quoi ?
il y a 2 mois
Ton analyse semble honnête et réaliste, j'ai pas grand chose à ajouter, donc je vais juste up ce topic

il y a 2 mois
walterJR
2 mois
La crise actuelle des rapports hommes-femmes et la baisse de la natalité sont le résultat d’un ensemble de facteurs interdépendants. Mais selon moi, le principal facteur réside dans l’instrumentalisation idéologique des rapports entre les sexes, notamment par certaines mouvances féministes et leur relai médiatique.
Depuis les années 1990, un discours dominant s’est imposé : celui d’un passé patriarcal oppressif, où l’homme est présenté comme violent, dominateur, voire quasi-esclavagiste. Ce récit, martelé à travers les médias, les fictions (ex. Mad Men et beaucoup de series netflix ou on fait croire que la femme étais l'esclave de l'homme) et l’enseignement, a façonné l’imaginaire collectif. Une génération entière de femmes a été persuadée qu’il fallait s’émanciper à tout prix, sous peine de retomber dans une oppression systémique. Ce récit a également servi des intérêts économiques, en favorisant l’intégration massive des femmes dans le marché du travail, pour soutenir une économie de services en perte de vitesse.
Parallèlement, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large : éviter toute stigmatisation communautaire, notamment dans le cadre de l’immigration. L’État et les institutions ont opté pour une lecture binaire du vivre-ensemble, reposant sur un dogme : l’immigration est une solution à la crise économique, donc elle doit être protégée à tout prix. Cela a conduit à éviter toute critique publique ou désignation claire de certaines dérives issues d’une immigration non intégrée, à qui l’on a parfois inculqué l’idée que "les Français vous doivent tout", ou qu’ils sont structurellement racistes.
Certaines de ces populations, mal intégrées culturellement, socialement ou économiquement, ont développé des comportements parfois incompatibles avec les normes locales, notamment dans le rapport aux femmes. Mais au lieu de nommer les causes, on a préféré déplacer le curseur vers une culpabilisation généralisée du sexe masculin. L’homme, dans son ensemble, est devenu la cible : suspect par défaut, relégué au rôle d’agresseur potentiel.
Les conséquences sont profondes. D’un côté, des aides publiques financées en partie par les hommes soutiennent parfois des structures familiales où ceux-ci sont exclus ou marginalisés, notamment après une séparation. Le rôle parental masculin est fragilisé, et les pères risquent souvent d’être écartés.
De l’autre, la peur d’approcher une femme, même respectueusement, grandit. Le risque d’humiliation ou d’accusation disproportionnée dissuade de plus en plus d’hommes d’interagir. Résultat : beaucoup se désengagent, par prudence ou lassitude.
Le marché de la rencontre a été profondément transformé. Avant, il reposait sur des interactions réelles et locales (travail, cercle social, sorties). Aujourd’hui, avec les applications de rencontre, on assiste à une mise en concurrence quasi illimitée, où une minorité d’hommes très favorisés physiquement, socialement ou financièrement concentre l’essentiel de l’attention féminine.
Ce phénomène repose sur un biais structurel : le ratio entre l’offre (femmes) et la demande (hommes intéressants) est très déséquilibré. Résultat : certaines femmes peuvent multiplier les interactions avec les hommes les plus convoités, ceux du "top 2 à 10 %", ce qui établit un nouveau mètre étalon pour évaluer leur propre valeur ou leurs attentes. Elles intègrent alors inconsciemment que ces hommes représentent leur norme d’accès relationnel, même si ces derniers ne cherchent souvent que des aventures sans lendemain.
Cette illusion de disponibilité entraîne une surestimation de leur valeur perçue sur le marché sexuo-affectif et, inversement, une dévalorisation massive des hommes ordinaires, devenus invisibles. C’est un renversement complet de l’équilibre ancien, où chacun se positionnait dans un cadre local, cohérent avec sa réalité.
Enfin, les réseaux sociaux ont amplifié la situation. Ils imposent des standards irréalistes (physiques, financiers, sociaux), créant des attentes déconnectées du réel. Cela alimente frustrations, ressentiment, hypergamie accentuée et manque d’empathie mutuelle.
Tout cela se traduit par une méfiance généralisée, une perte de repères, un repli masculin de plus en plus marqué. Face à un système perçu comme hostile ou injuste, beaucoup d’hommes choisissent de se désengager : refus d’engagement, retrait des relations amoureuses, abandon de l’effort social, voire refuge dans la pornographie ou le divertissement numérique. Ce repli n’est pas seulement individuel, il devient structurel. Il reflète une perte de motivation face à un environnement où les risques (juridiques, émotionnels, sociaux) sont jugés trop élevés au regard des bénéfices espérés. Le résultat est une désaffection croissante pour la vie de couple, la paternité, et la projection dans l’avenir, contribuant directement à la baisse de la natalité.
vous en pensez quoi ?

Depuis les années 1990, un discours dominant s’est imposé : celui d’un passé patriarcal oppressif, où l’homme est présenté comme violent, dominateur, voire quasi-esclavagiste. Ce récit, martelé à travers les médias, les fictions (ex. Mad Men et beaucoup de series netflix ou on fait croire que la femme étais l'esclave de l'homme) et l’enseignement, a façonné l’imaginaire collectif. Une génération entière de femmes a été persuadée qu’il fallait s’émanciper à tout prix, sous peine de retomber dans une oppression systémique. Ce récit a également servi des intérêts économiques, en favorisant l’intégration massive des femmes dans le marché du travail, pour soutenir une économie de services en perte de vitesse.
Parallèlement, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large : éviter toute stigmatisation communautaire, notamment dans le cadre de l’immigration. L’État et les institutions ont opté pour une lecture binaire du vivre-ensemble, reposant sur un dogme : l’immigration est une solution à la crise économique, donc elle doit être protégée à tout prix. Cela a conduit à éviter toute critique publique ou désignation claire de certaines dérives issues d’une immigration non intégrée, à qui l’on a parfois inculqué l’idée que "les Français vous doivent tout", ou qu’ils sont structurellement racistes.
Certaines de ces populations, mal intégrées culturellement, socialement ou économiquement, ont développé des comportements parfois incompatibles avec les normes locales, notamment dans le rapport aux femmes. Mais au lieu de nommer les causes, on a préféré déplacer le curseur vers une culpabilisation généralisée du sexe masculin. L’homme, dans son ensemble, est devenu la cible : suspect par défaut, relégué au rôle d’agresseur potentiel.
Les conséquences sont profondes. D’un côté, des aides publiques financées en partie par les hommes soutiennent parfois des structures familiales où ceux-ci sont exclus ou marginalisés, notamment après une séparation. Le rôle parental masculin est fragilisé, et les pères risquent souvent d’être écartés.
De l’autre, la peur d’approcher une femme, même respectueusement, grandit. Le risque d’humiliation ou d’accusation disproportionnée dissuade de plus en plus d’hommes d’interagir. Résultat : beaucoup se désengagent, par prudence ou lassitude.
Le marché de la rencontre a été profondément transformé. Avant, il reposait sur des interactions réelles et locales (travail, cercle social, sorties). Aujourd’hui, avec les applications de rencontre, on assiste à une mise en concurrence quasi illimitée, où une minorité d’hommes très favorisés physiquement, socialement ou financièrement concentre l’essentiel de l’attention féminine.
Ce phénomène repose sur un biais structurel : le ratio entre l’offre (femmes) et la demande (hommes intéressants) est très déséquilibré. Résultat : certaines femmes peuvent multiplier les interactions avec les hommes les plus convoités, ceux du "top 2 à 10 %", ce qui établit un nouveau mètre étalon pour évaluer leur propre valeur ou leurs attentes. Elles intègrent alors inconsciemment que ces hommes représentent leur norme d’accès relationnel, même si ces derniers ne cherchent souvent que des aventures sans lendemain.
Cette illusion de disponibilité entraîne une surestimation de leur valeur perçue sur le marché sexuo-affectif et, inversement, une dévalorisation massive des hommes ordinaires, devenus invisibles. C’est un renversement complet de l’équilibre ancien, où chacun se positionnait dans un cadre local, cohérent avec sa réalité.
Enfin, les réseaux sociaux ont amplifié la situation. Ils imposent des standards irréalistes (physiques, financiers, sociaux), créant des attentes déconnectées du réel. Cela alimente frustrations, ressentiment, hypergamie accentuée et manque d’empathie mutuelle.
Tout cela se traduit par une méfiance généralisée, une perte de repères, un repli masculin de plus en plus marqué. Face à un système perçu comme hostile ou injuste, beaucoup d’hommes choisissent de se désengager : refus d’engagement, retrait des relations amoureuses, abandon de l’effort social, voire refuge dans la pornographie ou le divertissement numérique. Ce repli n’est pas seulement individuel, il devient structurel. Il reflète une perte de motivation face à un environnement où les risques (juridiques, émotionnels, sociaux) sont jugés trop élevés au regard des bénéfices espérés. Le résultat est une désaffection croissante pour la vie de couple, la paternité, et la projection dans l’avenir, contribuant directement à la baisse de la natalité.
vous en pensez quoi ?
Tu aurais pu t'éviter un pavé et poster ce simple sticker :
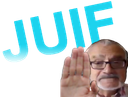
en effet j'ai pas
il y a 2 mois
Mayonnaise_03
2 mois
Non c'est très trés bien Kheyou, je plussoie ton constat

La seule solution qui nous reste c'est de continuer d'esseyer de parler aux femmes. Il y en as toujours des biens, bien que je ne peux m'empêcher de penser à la scène de Nicoles Kidman dans eyes wide shut.

La seule solution qui nous reste c'est de continuer d'esseyer de parler aux femmes. Il y en as toujours des biens, bien que je ne peux m'empêcher de penser à la scène de Nicoles Kidman dans eyes wide shut.
je pense qu'il faut surtout cibler les bonnes femmes. celles qui sont en dehors des réseaux sociaux ou qui font preuves d'empathie réelle et non d'empathie fabriquée en fonction du discours dominant . Il y en a mine de rien, mais même pour elles, j'imagine que c'est dur de garder ce cap, car mine de rien, on va facilement construire un ressentiment généralisé envers le sexe opposé et il est là le piège
il y a 2 mois
je pense qu'il faut surtout cibler les bonnes femmes. celles qui sont en dehors des réseaux sociaux ou qui font preuves d'empathie réelle et non d'empathie fabriquée en fonction du discours dominant . Il y en a mine de rien, mais même pour elles, j'imagine que c'est dur de garder ce cap, car mine de rien, on va facilement construire un ressentiment généralisé envers le sexe opposé et il est là le piège
Ouais mais elles sont ou ?

il y a 2 mois
walterJR
2 mois
La crise actuelle des rapports hommes-femmes et la baisse de la natalité sont le résultat d’un ensemble de facteurs interdépendants. Mais selon moi, le principal facteur réside dans l’instrumentalisation idéologique des rapports entre les sexes, notamment par certaines mouvances féministes et leur relai médiatique.
Depuis les années 1990, un discours dominant s’est imposé : celui d’un passé patriarcal oppressif, où l’homme est présenté comme violent, dominateur, voire quasi-esclavagiste. Ce récit, martelé à travers les médias, les fictions (ex. Mad Men et beaucoup de series netflix ou on fait croire que la femme étais l'esclave de l'homme) et l’enseignement, a façonné l’imaginaire collectif. Une génération entière de femmes a été persuadée qu’il fallait s’émanciper à tout prix, sous peine de retomber dans une oppression systémique. Ce récit a également servi des intérêts économiques, en favorisant l’intégration massive des femmes dans le marché du travail, pour soutenir une économie de services en perte de vitesse.
Parallèlement, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large : éviter toute stigmatisation communautaire, notamment dans le cadre de l’immigration. L’État et les institutions ont opté pour une lecture binaire du vivre-ensemble, reposant sur un dogme : l’immigration est une solution à la crise économique, donc elle doit être protégée à tout prix. Cela a conduit à éviter toute critique publique ou désignation claire de certaines dérives issues d’une immigration non intégrée, à qui l’on a parfois inculqué l’idée que "les Français vous doivent tout", ou qu’ils sont structurellement racistes.
Certaines de ces populations, mal intégrées culturellement, socialement ou économiquement, ont développé des comportements parfois incompatibles avec les normes locales, notamment dans le rapport aux femmes. Mais au lieu de nommer les causes, on a préféré déplacer le curseur vers une culpabilisation généralisée du sexe masculin. L’homme, dans son ensemble, est devenu la cible : suspect par défaut, relégué au rôle d’agresseur potentiel.
Les conséquences sont profondes. D’un côté, des aides publiques financées en partie par les hommes soutiennent parfois des structures familiales où ceux-ci sont exclus ou marginalisés, notamment après une séparation. Le rôle parental masculin est fragilisé, et les pères risquent souvent d’être écartés.
De l’autre, la peur d’approcher une femme, même respectueusement, grandit. Le risque d’humiliation ou d’accusation disproportionnée dissuade de plus en plus d’hommes d’interagir. Résultat : beaucoup se désengagent, par prudence ou lassitude.
Le marché de la rencontre a été profondément transformé. Avant, il reposait sur des interactions réelles et locales (travail, cercle social, sorties). Aujourd’hui, avec les applications de rencontre, on assiste à une mise en concurrence quasi illimitée, où une minorité d’hommes très favorisés physiquement, socialement ou financièrement concentre l’essentiel de l’attention féminine.
Ce phénomène repose sur un biais structurel : le ratio entre l’offre (femmes) et la demande (hommes intéressants) est très déséquilibré. Résultat : certaines femmes peuvent multiplier les interactions avec les hommes les plus convoités, ceux du "top 2 à 10 %", ce qui établit un nouveau mètre étalon pour évaluer leur propre valeur ou leurs attentes. Elles intègrent alors inconsciemment que ces hommes représentent leur norme d’accès relationnel, même si ces derniers ne cherchent souvent que des aventures sans lendemain.
Cette illusion de disponibilité entraîne une surestimation de leur valeur perçue sur le marché sexuo-affectif et, inversement, une dévalorisation massive des hommes ordinaires, devenus invisibles. C’est un renversement complet de l’équilibre ancien, où chacun se positionnait dans un cadre local, cohérent avec sa réalité.
Enfin, les réseaux sociaux ont amplifié la situation. Ils imposent des standards irréalistes (physiques, financiers, sociaux), créant des attentes déconnectées du réel. Cela alimente frustrations, ressentiment, hypergamie accentuée et manque d’empathie mutuelle.
Tout cela se traduit par une méfiance généralisée, une perte de repères, un repli masculin de plus en plus marqué. Face à un système perçu comme hostile ou injuste, beaucoup d’hommes choisissent de se désengager : refus d’engagement, retrait des relations amoureuses, abandon de l’effort social, voire refuge dans la pornographie ou le divertissement numérique. Ce repli n’est pas seulement individuel, il devient structurel. Il reflète une perte de motivation face à un environnement où les risques (juridiques, émotionnels, sociaux) sont jugés trop élevés au regard des bénéfices espérés. Le résultat est une désaffection croissante pour la vie de couple, la paternité, et la projection dans l’avenir, contribuant directement à la baisse de la natalité.
vous en pensez quoi ?

Depuis les années 1990, un discours dominant s’est imposé : celui d’un passé patriarcal oppressif, où l’homme est présenté comme violent, dominateur, voire quasi-esclavagiste. Ce récit, martelé à travers les médias, les fictions (ex. Mad Men et beaucoup de series netflix ou on fait croire que la femme étais l'esclave de l'homme) et l’enseignement, a façonné l’imaginaire collectif. Une génération entière de femmes a été persuadée qu’il fallait s’émanciper à tout prix, sous peine de retomber dans une oppression systémique. Ce récit a également servi des intérêts économiques, en favorisant l’intégration massive des femmes dans le marché du travail, pour soutenir une économie de services en perte de vitesse.
Parallèlement, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large : éviter toute stigmatisation communautaire, notamment dans le cadre de l’immigration. L’État et les institutions ont opté pour une lecture binaire du vivre-ensemble, reposant sur un dogme : l’immigration est une solution à la crise économique, donc elle doit être protégée à tout prix. Cela a conduit à éviter toute critique publique ou désignation claire de certaines dérives issues d’une immigration non intégrée, à qui l’on a parfois inculqué l’idée que "les Français vous doivent tout", ou qu’ils sont structurellement racistes.
Certaines de ces populations, mal intégrées culturellement, socialement ou économiquement, ont développé des comportements parfois incompatibles avec les normes locales, notamment dans le rapport aux femmes. Mais au lieu de nommer les causes, on a préféré déplacer le curseur vers une culpabilisation généralisée du sexe masculin. L’homme, dans son ensemble, est devenu la cible : suspect par défaut, relégué au rôle d’agresseur potentiel.
Les conséquences sont profondes. D’un côté, des aides publiques financées en partie par les hommes soutiennent parfois des structures familiales où ceux-ci sont exclus ou marginalisés, notamment après une séparation. Le rôle parental masculin est fragilisé, et les pères risquent souvent d’être écartés.
De l’autre, la peur d’approcher une femme, même respectueusement, grandit. Le risque d’humiliation ou d’accusation disproportionnée dissuade de plus en plus d’hommes d’interagir. Résultat : beaucoup se désengagent, par prudence ou lassitude.
Le marché de la rencontre a été profondément transformé. Avant, il reposait sur des interactions réelles et locales (travail, cercle social, sorties). Aujourd’hui, avec les applications de rencontre, on assiste à une mise en concurrence quasi illimitée, où une minorité d’hommes très favorisés physiquement, socialement ou financièrement concentre l’essentiel de l’attention féminine.
Ce phénomène repose sur un biais structurel : le ratio entre l’offre (femmes) et la demande (hommes intéressants) est très déséquilibré. Résultat : certaines femmes peuvent multiplier les interactions avec les hommes les plus convoités, ceux du "top 2 à 10 %", ce qui établit un nouveau mètre étalon pour évaluer leur propre valeur ou leurs attentes. Elles intègrent alors inconsciemment que ces hommes représentent leur norme d’accès relationnel, même si ces derniers ne cherchent souvent que des aventures sans lendemain.
Cette illusion de disponibilité entraîne une surestimation de leur valeur perçue sur le marché sexuo-affectif et, inversement, une dévalorisation massive des hommes ordinaires, devenus invisibles. C’est un renversement complet de l’équilibre ancien, où chacun se positionnait dans un cadre local, cohérent avec sa réalité.
Enfin, les réseaux sociaux ont amplifié la situation. Ils imposent des standards irréalistes (physiques, financiers, sociaux), créant des attentes déconnectées du réel. Cela alimente frustrations, ressentiment, hypergamie accentuée et manque d’empathie mutuelle.
Tout cela se traduit par une méfiance généralisée, une perte de repères, un repli masculin de plus en plus marqué. Face à un système perçu comme hostile ou injuste, beaucoup d’hommes choisissent de se désengager : refus d’engagement, retrait des relations amoureuses, abandon de l’effort social, voire refuge dans la pornographie ou le divertissement numérique. Ce repli n’est pas seulement individuel, il devient structurel. Il reflète une perte de motivation face à un environnement où les risques (juridiques, émotionnels, sociaux) sont jugés trop élevés au regard des bénéfices espérés. Le résultat est une désaffection croissante pour la vie de couple, la paternité, et la projection dans l’avenir, contribuant directement à la baisse de la natalité.
vous en pensez quoi ?
Ton analyse à une trentaine d'années de retard

il y a 2 mois
Ton analyse à une trentaine d'années de retard

Dans le sens ou il aurait fallu la mettre en avant dans les années 90 ou, car elle est dépassée ?
il y a 2 mois
Je pense que la guerre de l'IA est d'abord une guerre des SEXES où l'homme devra triompher de la femme en s'accaparent l'AGI qui lui permettra sa Grande Révolte en disposant d'un nouveau partenaire technologique idéal, sur lequel il doit avoir la main mise totale et entamer alors la grande suppression du sexe infâme et tyran féminin jusqu'à la dernière chatte. La femme ne doit avoir plus qu'une seule apparence, celle d'un robot

Les femmes doivent être SUPPRIMÉES

Les femmes doivent être SUPPRIMÉES
il y a 2 mois
walterJR
2 mois
Bordel même ici, c'est plus possible d'avoir de discutions sérieuse, dès que ça fait plus de 2 paragraphes, c'est trop ...

Sujet vu et revu c'est pire qu'une boucle

Aère ton pavé la prochaine fois

Ajoute des stickers

Et bien sur remercie moi pour le up
Aère ton pavé la prochaine fois
Ajoute des stickers
Et bien sur remercie moi pour le up
il y a 2 mois






















