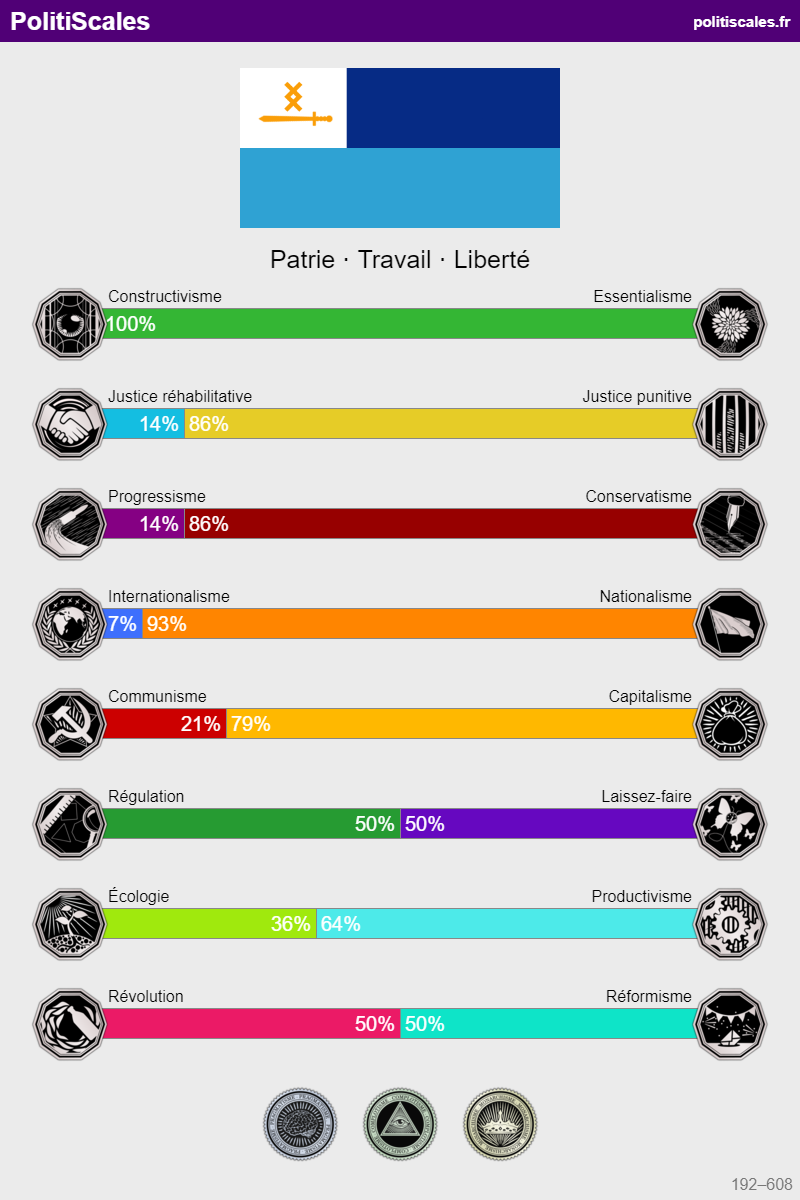Ce sujet a été résolu
"Une récompense libérale du travail, dit Smith, en même temps qu’elle favorise la
propagation de la classe laborieuse, augmente son industrie, qui, semblable à toutes les
qualités humaines, s’accroît par la valeur des encouragements qu’elle reçoit. Une nourriture
abondante fortifie le corps de l'homme qui travaille ; la possibilité d'étendre son bien-être et
de se ménager un sort pour l'avenir en éveille le désir, et ce désir l'excite aux plus vigoureux
efforts. Partout où les salaires sont élevés, nous voyons les ouvriers plus intelligents et plus
expéditifs ; ils le sont plus en Angleterre qu'en Écosse, plus dans le voisinage des grandes
villes que dans les villages éloignés. Quelques ouvriers, à la vérité, quand ils gagnent en
quatre jours de quoi vivre pendant toute la semaine, restent oisifs les trois autres jours ;
mais cette inconduite n'est point générale; il est plus commun de voir ceux qui sont bien
payés, à la pièce, ruiner leur santé en peu d'années par un excès de travail"
propagation de la classe laborieuse, augmente son industrie, qui, semblable à toutes les
qualités humaines, s’accroît par la valeur des encouragements qu’elle reçoit. Une nourriture
abondante fortifie le corps de l'homme qui travaille ; la possibilité d'étendre son bien-être et
de se ménager un sort pour l'avenir en éveille le désir, et ce désir l'excite aux plus vigoureux
efforts. Partout où les salaires sont élevés, nous voyons les ouvriers plus intelligents et plus
expéditifs ; ils le sont plus en Angleterre qu'en Écosse, plus dans le voisinage des grandes
villes que dans les villages éloignés. Quelques ouvriers, à la vérité, quand ils gagnent en
quatre jours de quoi vivre pendant toute la semaine, restent oisifs les trois autres jours ;
mais cette inconduite n'est point générale; il est plus commun de voir ceux qui sont bien
payés, à la pièce, ruiner leur santé en peu d'années par un excès de travail"
Au plaisir ~

il y a 9 mois
En parlant d'Adam Smith, quelques pavés intéressants à ce sujet + pour comparer à d'autres économistes.

il y a 9 mois
Adam Smith est l'auteur de l'appellation système mercantile. A Karl Marx on doit l'expression d'économie classique. Dans le Capital, Marx écrit à ce sujet : " Je fais remarquer une fois pour toutes que j'entends par économie politique classique, toute économie qui, à partir de William Petty, cherche à pénétrer l'ensemble réel et intime des rapports de production dans la société bourgeoise, par opposition à l'économie vulgaire qui se contente des apparences, rumine sans cesse pour son propre besoin et pour la vulgarisation des plus grossiers phénomènes les matériaux déjà élaborés par ses prédécesseurs, et se borne à ériger pédantesquement en système et à proclamer comme vérités éternelles les illusions dont le bourgeois aime à peuple son monde à lui, le meilleur des mondes possible. " Source, Le Capital, 1971, Editions Sociales, Livre 1. Page 83. La définition de Keynes est la suivante : " La dénomination d'économistes classiques a été inventée par Marx pour désigner Ricardo, James Mill et leurs prédécesseurs, c'est à dire les auteurs dont l'économie ricardienne a été le point culminant. Au risque d'un solécisme, nous nous sommes accoutumés à ranger dans l'école classique les successeurs de Ricardo, c'est à dire les économistes qui ont adopté et amélioré sa théorie, y compris notamment Stuart Mill, Marshall, Edgeworth et le Pr Pigou. " Source " Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie " 1936, Payot, 1969, page 209.
Marx semble aimer certains économistes mais détester d'autres. Certains, il les appelle classiques, les autres, il parle de " vulgaires ". Il ne s'agit pas de faire le tri entre pro et anti capitalisme car les classiques ne veulent pas renverser le capitalisme. Les premiers selon Marx se bornent à en faire l'apologie, les seconds produisent des instruments d'analyse qui une fois dégagés de leur gangue idéologique, permettent d'en faire l'étude scientifique. Le premier de ces instruments est une théorie expliquant comment se détermine la valeur des marchandises : l'économie classique vue par Marx est celle cherchant à analyser cette valeur en partant du travail par opposition à l'économie dite vulgaire, s'appuyant essentiellement sur la notion d'utilité. C'est en ce sens que Marx fait remonter l'économie classique à Petty qui fut un des premiers à avancer que les prix des marchandises sont déterminés par le travail nécessaire à leur production. Mais Adam Smith et David Ricardo sont pour Marx les 2 principaux représentants de l'économie classique dont le discipline, John Stuart Mill, est taxé " d'électisme édulcoré ' , pour sa tentative de tempérer les rigueurs du libéralisme par l'intervention publique et le développement des coopératives.
Dans sa théorie générale, Keynes range dans la catégorie de " classiques ", non seulement Ricardo et Mill, mais aussi les auteurs formant à partir de la fin du XIXème siècle, le courant habituellement appelé néo classique. Ces derniers sont dans la filiation " vulgaire " de Marx. Ces néo classiques relient la valeur des marchandises à leur unité. Keynes met en avant Jean Baptiste Say, économiste " vulgaire " du début du XIXème siècle, connu pour sa loi des débouchés, disant que l'offre crée sa propre demande. Cette loi est reprise par Ricardo puis par les néo classiques. Elle constitue le critère d'appartenance à l'économie classique au sens de Keynes ce qui explique la réunion sous cette appellation d'auteurs ayant des vues divergentes sur la question de la valeur. On comprend pourquoi Keynes comme Marx mais pour un motif différent, exclut Malthus des classiques : cet auteur, contemporain de Ricardo et Say, rejette à la théorie de la valeur travail et la loi des débouchés. Il n'y a pas eu de consensus sur la définition d'économie classique car ceux ayant voulu la définir n'étaient pas d'accord sur ce que sont les problèmes essentiels de leur discipline. Selon Marx la question de la valeur est centrale car elle commande l'analyse de rapports sociaux dans le système capitaliste.Mais pour Keynes qui cherche à expliquer le phénomène du chômage massif et persistant des années 1930, la question essentielle est celle de la demande effective. L'approche de Marx est sans doute un peu plus utile pour distinguer le courant classique du courant néo classique. La période du XIXème siècle se caractérise par une croissance soutenue de la production industrielle, notamment textile et métallurgique, qui tire la croissance de l'économie. Les chiffres concernant cette croissance, reconstituée via des sources fragmentaires, constituent au mieux des ordres de grandeur irrégulier de al croissance, jalonnée au XIXème siècle de crises généralement brèves mais violentes.
Dans un ouvrage paru en 1960 et intitulé " Les Etapes de la croissance économique ", l'économiste américain Rostow explique que la révolution industrielle est marqué par une phase qu'il appelle décollage. C'est un épisode de 2 ou 3 décennies durant lequel la " société finit par renverser les obstacles et les barrages qui s'opposaient à sa croissance régulière ". L'élévation du taux d'investissement ( la part de la production nationale consacrée à l'investissement) est selon lui le trait le plus caractéristique de cette époque. Ce taux franchit la barre des 10%. Certains historiens ont critiqué Rostow pour sa notion même de décollage et sa vision schématique de linéaire du développement économique ( tous les pays sont supposés franchir des étapes identiques, à des dates différentes ). Certains travaux notamment dans le cas de la France mettent en cause la pertinence du concept de décollage. Ceci ci, il semble que la croissance économique aux USA, Japon et Europe occidentale ait été de 2% par an en moyenne au XIXème siècle, ce qui correspond à un taux moyen de croissance du revenu par habitant de 1% par an environ étant donné la croissance démographique ). Sur un siècle, elle implique une multiplication du produit national par un facteur compris entre 6 et 7. En termes de revenu par habitant, on n'est pas loin du triplement. La répartition de la population active évolue beaucoup, de même que l'urbanisation progresse énormément. En Angleterre, pour la première fois, après 1850, la population urbaine dépasse la population rurale. Avec la mécanisation le travail en usine se développe et souvent se déqualifie. Cela s'accompagne souvent par un recours au travail des femmes et enfants parfois âgés de seulement 5 ou 6 ans. Jusqu'en 1860, la durée moyenne de travail est de 12 à 15 heures.
Il faut attendre après 1850 pour que les salaires commencent à s'améliorer un peu. Non seulement la législation sociale est rare mais elle est généralement pas appliquée. La loi anglaise de 1819 interdisant le travail des enfants de moins de 9 ans dans les manufactures de coton et la loi française de 1841 interdisant le travail en usine des enfants de moins de 8 ans ne connaissent guère de traduction concrète. Du coup les conditions des ouvriers sont précaires, notamment à cause de la malnutrition, exiguïté, maladies, insalubrité des logements. Dickes en Angleterre a notamment décrit ce phénomène, ainsi que le célèbre rapport du Dr Villermé en France en 1840. Les ouvriers n'ont pas le droit de mener une action collective pour défendre leurs intérêts avec notamment la loi Chapelier de 1791 en France interdisant tout coalition. Le droit de grève n'est reconnu qu'en 1864. Il y a certes des révoltes violentes comme le mouvement luddite entre 1811 et 1813 en Angleterre, la révolte des Canuts lyonnais en 1831, etc.... voire des organisations illégales qui voient le jour, illégales dans un premier temps du moins, lesquelles se transformeront en grandes confédérations syndicales à la fin du XIXème siècle. Les innovations n'ont pu produire leurs effets que parce que les conditions techniques agricoles n'ont pas connu de progrès décisifs. Car sans augmentation de la productivité agricole, impossible de nourrir la main d'oeuvre ouvrière croissante que réclamait le développement industriel. Entre le début et la fin du XVIIIème siècle, il y a eu doublement du volume de production par actif agricole en Angleterre selon P. Bairoch Source : " Le Tiers Monde dans l'impasse", Gallimard, 2ème édition, 1983, page 43.
Marx semble aimer certains économistes mais détester d'autres. Certains, il les appelle classiques, les autres, il parle de " vulgaires ". Il ne s'agit pas de faire le tri entre pro et anti capitalisme car les classiques ne veulent pas renverser le capitalisme. Les premiers selon Marx se bornent à en faire l'apologie, les seconds produisent des instruments d'analyse qui une fois dégagés de leur gangue idéologique, permettent d'en faire l'étude scientifique. Le premier de ces instruments est une théorie expliquant comment se détermine la valeur des marchandises : l'économie classique vue par Marx est celle cherchant à analyser cette valeur en partant du travail par opposition à l'économie dite vulgaire, s'appuyant essentiellement sur la notion d'utilité. C'est en ce sens que Marx fait remonter l'économie classique à Petty qui fut un des premiers à avancer que les prix des marchandises sont déterminés par le travail nécessaire à leur production. Mais Adam Smith et David Ricardo sont pour Marx les 2 principaux représentants de l'économie classique dont le discipline, John Stuart Mill, est taxé " d'électisme édulcoré ' , pour sa tentative de tempérer les rigueurs du libéralisme par l'intervention publique et le développement des coopératives.
Dans sa théorie générale, Keynes range dans la catégorie de " classiques ", non seulement Ricardo et Mill, mais aussi les auteurs formant à partir de la fin du XIXème siècle, le courant habituellement appelé néo classique. Ces derniers sont dans la filiation " vulgaire " de Marx. Ces néo classiques relient la valeur des marchandises à leur unité. Keynes met en avant Jean Baptiste Say, économiste " vulgaire " du début du XIXème siècle, connu pour sa loi des débouchés, disant que l'offre crée sa propre demande. Cette loi est reprise par Ricardo puis par les néo classiques. Elle constitue le critère d'appartenance à l'économie classique au sens de Keynes ce qui explique la réunion sous cette appellation d'auteurs ayant des vues divergentes sur la question de la valeur. On comprend pourquoi Keynes comme Marx mais pour un motif différent, exclut Malthus des classiques : cet auteur, contemporain de Ricardo et Say, rejette à la théorie de la valeur travail et la loi des débouchés. Il n'y a pas eu de consensus sur la définition d'économie classique car ceux ayant voulu la définir n'étaient pas d'accord sur ce que sont les problèmes essentiels de leur discipline. Selon Marx la question de la valeur est centrale car elle commande l'analyse de rapports sociaux dans le système capitaliste.Mais pour Keynes qui cherche à expliquer le phénomène du chômage massif et persistant des années 1930, la question essentielle est celle de la demande effective. L'approche de Marx est sans doute un peu plus utile pour distinguer le courant classique du courant néo classique. La période du XIXème siècle se caractérise par une croissance soutenue de la production industrielle, notamment textile et métallurgique, qui tire la croissance de l'économie. Les chiffres concernant cette croissance, reconstituée via des sources fragmentaires, constituent au mieux des ordres de grandeur irrégulier de al croissance, jalonnée au XIXème siècle de crises généralement brèves mais violentes.
Dans un ouvrage paru en 1960 et intitulé " Les Etapes de la croissance économique ", l'économiste américain Rostow explique que la révolution industrielle est marqué par une phase qu'il appelle décollage. C'est un épisode de 2 ou 3 décennies durant lequel la " société finit par renverser les obstacles et les barrages qui s'opposaient à sa croissance régulière ". L'élévation du taux d'investissement ( la part de la production nationale consacrée à l'investissement) est selon lui le trait le plus caractéristique de cette époque. Ce taux franchit la barre des 10%. Certains historiens ont critiqué Rostow pour sa notion même de décollage et sa vision schématique de linéaire du développement économique ( tous les pays sont supposés franchir des étapes identiques, à des dates différentes ). Certains travaux notamment dans le cas de la France mettent en cause la pertinence du concept de décollage. Ceci ci, il semble que la croissance économique aux USA, Japon et Europe occidentale ait été de 2% par an en moyenne au XIXème siècle, ce qui correspond à un taux moyen de croissance du revenu par habitant de 1% par an environ étant donné la croissance démographique ). Sur un siècle, elle implique une multiplication du produit national par un facteur compris entre 6 et 7. En termes de revenu par habitant, on n'est pas loin du triplement. La répartition de la population active évolue beaucoup, de même que l'urbanisation progresse énormément. En Angleterre, pour la première fois, après 1850, la population urbaine dépasse la population rurale. Avec la mécanisation le travail en usine se développe et souvent se déqualifie. Cela s'accompagne souvent par un recours au travail des femmes et enfants parfois âgés de seulement 5 ou 6 ans. Jusqu'en 1860, la durée moyenne de travail est de 12 à 15 heures.
Il faut attendre après 1850 pour que les salaires commencent à s'améliorer un peu. Non seulement la législation sociale est rare mais elle est généralement pas appliquée. La loi anglaise de 1819 interdisant le travail des enfants de moins de 9 ans dans les manufactures de coton et la loi française de 1841 interdisant le travail en usine des enfants de moins de 8 ans ne connaissent guère de traduction concrète. Du coup les conditions des ouvriers sont précaires, notamment à cause de la malnutrition, exiguïté, maladies, insalubrité des logements. Dickes en Angleterre a notamment décrit ce phénomène, ainsi que le célèbre rapport du Dr Villermé en France en 1840. Les ouvriers n'ont pas le droit de mener une action collective pour défendre leurs intérêts avec notamment la loi Chapelier de 1791 en France interdisant tout coalition. Le droit de grève n'est reconnu qu'en 1864. Il y a certes des révoltes violentes comme le mouvement luddite entre 1811 et 1813 en Angleterre, la révolte des Canuts lyonnais en 1831, etc.... voire des organisations illégales qui voient le jour, illégales dans un premier temps du moins, lesquelles se transformeront en grandes confédérations syndicales à la fin du XIXème siècle. Les innovations n'ont pu produire leurs effets que parce que les conditions techniques agricoles n'ont pas connu de progrès décisifs. Car sans augmentation de la productivité agricole, impossible de nourrir la main d'oeuvre ouvrière croissante que réclamait le développement industriel. Entre le début et la fin du XVIIIème siècle, il y a eu doublement du volume de production par actif agricole en Angleterre selon P. Bairoch Source : " Le Tiers Monde dans l'impasse", Gallimard, 2ème édition, 1983, page 43.
il y a 9 mois
Il faut aussi une incitation puissante pour accroître et moderniser la production et que le développement de celle ci ne soit pas entravé par des facteurs institutionnels. L'analyse de la richesse des nations par Smith critique le système " mercantile ", reprenant largement la critique fait par les physiocrates qui avaient reproché le plus souvent à tort aux mercantilistes de confondre monnaie et richesse.Smith juge tout de même la conception des physiocrates trop restrictive et il considère que la richesse d'une nation constituée de " toutes les choses nécessaires et commodes à la vie " que permet d'obtenir le travail annuel de cette nation. Cela l'amène à étendre la notion d'activité productive à toutes les activités concourant à la fabrication, au transport et à la commercialisation d'objets matériels, qu'il s'agisse de produits agricoles ou de produits manufacturés. L'analyse de Smith est critiquée par Jean Baptiste Bay, lequel reproche à Smith de s'être tenu à une définition trop restrictive en ne reconnaissant pas la caractère productif des activités appelées aujourd’hui " les services ". Il jette les bases d'une analyse qui sera reprise dans la seconde moitié du XIXème siècle, par le courant néoclassique. Smith ne fait pas que proposer une définition de la richesse, il étudie les facteurs susceptibles d'augmenter celle ci. Après avoir indiqué que le facteur essentiel était l'accroissement des pouvoirs productifs de l'être humain, il explique dans des pages célèbres, que cet accroissement est dû au progrès de la division du travail. Prenant l'exemple d'une manufacture d'épingles, Smith montre que la division du travail accroît la productivité de celui ci par 3 voies différentes.
D'abord, la spécialisation des ouvriers dans une tâche donnée. Ou alors par la diminution des pertes de temps causées par le changement de tâche. Ou par l'utilisation des machines. Comme l'a déjà souligné Quesnay, il est pour Smith inutile de chercher à accumuler de l'or et de l'argent par tous les moyens, notamment via des pratiques commerciales restrictives. De façon plus général, c'est à Smith qu'on doit la métaphore de la main invisible selon laquelle les individus mus exclusivement par leur intérêt personnel, se comportent sur un marché concurrentiel dans un sens conforme à la prospérité générale.
" Chaque individu s'efforce continuellement de trouver l'emploi le plus avantageux pour tout capital dont il peut disposer. C'est son propre avantage, en vérité, et non celui de la société qu'il a en vue. Mais l'étude de son propre avantage l'amène naturellement, ou plutôt nécessairement, à préférer l'emploi le plus avantageux pour la société... Il recherche seulement son intérêt personnel, et il est en cela comme dans bien d'autres cas, amené par une main invisible à atteindre une fin qui n'entrait nullement dans ses intentions. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin ne fasse pas partie de ses intentions. En poursuivant son propre intérêt, il agit souvent plus efficacement pour l'intérêt de la société que lorsqu'il cherche réellement à agir en faveur de ce dernier. Je n'ai rien vu de bon de la part de ceux qui prétendent faire des affaires pour le bien public. C'est une prétention, il est vrai, peu courante chez les marchands et il suffirait de très peu de mots pour les en dissuader. Quelle espèce d'industrie nationale son capital peut il mettre en oeuvre, et de laquelle le produit est il susceptible d'avoir la plus grande valeur? Chaque individu, c'est évident, peut, dans sa situation particulière, en juger bien mieux que n'importe quel homme d'Etat ou législateur ne peut le faire à sa place. L'homme d'Etat, qui essaierait de diriger les personnes privées en ce qui concerne la façon d'employer leurs capitaux, non seulement s'embarrasserait du soin le plus inutile, mais assumerait une autorité qu'il ne serait pas sage de confier ni à une personne unique, ni même à un conseil ou un sénat quel qu'il soit, et qui ne serait jamais aussi dangereuse que dans les mains d'un homme ayant assez de folie et de présomption pour se croire capable de l'exercer. " Source : Adam Smith " Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. " Chapitre 11.
Pour Adam Smith, la recherche du gain amène les entreprises à produire les marchandises que recherchent les consommateurs, et cela au meilleur prix, donc en utilisant les combinaisons techniques les plus efficaces. Mais ces bienfaits ne peuvent se réaliser pleinement que si l'économie est soumise à un régime de libre concurrence : ainsi les barrières limitant l'accès à certains marchés, en créant des rentes de situation au profit des entreprises qu'elles protègent, faussent le jeu de la main invisible et nuisent finalement aux intérêts du consommateur. L'Etat, ne devant pas interférer avec le mécanisme autorégulateur du marché, a donc un rôle économique restreint. On doit néanmoins noter qu'aux missions de défense et d'exercice de justice définissant un " Etat gendarme ", Smith ajoute une troisième mission, qui est " d'élever et d'entretenir ces ouvrages et établissements publics dont une grande société retire d'immenses avantages, mais qui sont néanmoins de nature à ne pouvoir être entrepris ou entretenus par un ou quelques particuliers, attendu que pour ceux ci, le profit ne saurait jamais en rembourser la dépense. " Source " Recherches sur la nature et les causes de la richesses des nations " Livre V, Chapitre 1. Cette analyse préfigure la théorie moderne des biens collectifs. La théorie classique de la main invisible constitue aujourd'hui la base de la pensée économique libérale car elle contient l'idée que l'articulation des intérêts individuels, soumis à la pression de la concurrence, assure de façon efficace la régulation des processus économiques à l'échelle sociale, les prix jouant le rôle de signaux orientant les décisions des producteurs dans un sens conforme aux besoins des consommateurs. Cependant, ce ne sont pas forcément des fanatiques du libéralisme.
John Stuart Mill par exemple, disciple de Smith et de Ricardo sur la théorie économique, et partisan du réformisme social, favorable à l'impôt sur l'héritage, aux coopératives et à l'association capital travail. Smith et Ricardo dépeignent l'économie de marché comme un système traversé par de profondes oppositions d'intérêts et des rapports de forces souvent très inégalitaires entre classes sociales. Smith a décrit sans indulgence la façon dont les employeurs, usant à la fois de leur pouvoir économique et des facilités que leur accorde la loi, imposent leurs conditions aux salariés. Ce n'est pas comme si pour Adam Smith, tout était rose, contrairement à une idée reçue.
" Le niveau commun des salaires dépend partout du contrat habituellement passé entre ces deux parties, dont l'intérêt n'est nullement le même. Les ouvriers peuvent obtenir le plus possible, et les maîtres donner le moins possible. Les premiers sont disposés à se concerter pour élever les salaires, les seconds pour les abaisser. Mais il n'est pas difficile de prévoir laquelle des deux parties doit, dans toutes les circonstances ordinaires, avoir l'avantage dans le débat et forcer l'autre à accepter ses conditions. Les maîtres, étant moins nombreux, peuvent se concerter beaucoup plus facilement; en outre, la loi autorise, ou du moins n'interdit pas leurs ententes, alors qu'elle interdit celles des ouvriers. Nous n'avons aucun acte du Parlement contre les ententes pour abaisser les prix du travail, mais nous en avons beaucoup contre celles visant à l'élever. Dans tous ces conflits, les maîtres peuvent tenir beaucoup plus longtemps. Un propriétaire foncier, un fermier, un maître manufacturier, un marcha,d même s'ils n'employaient pas un seul ouvrier, pourraient généralement vivre une année ou deux grâce aux capitaux qu'ils ont acquis préalablement. Beaucoup d'ouvriers ne pourraient pas subsister une semaine, peu pourraient subsister un mois, et pratiquement aucun une année sans emploi. A long terme, l'ouvrier peut être aussi nécessaire à son maître que son maître lui est nécessaire; mais la nécessité n'est pas aussi immédiate. " Source : Adam Smith " Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations " Livre I, extrait du chapitre 8.
D'abord, la spécialisation des ouvriers dans une tâche donnée. Ou alors par la diminution des pertes de temps causées par le changement de tâche. Ou par l'utilisation des machines. Comme l'a déjà souligné Quesnay, il est pour Smith inutile de chercher à accumuler de l'or et de l'argent par tous les moyens, notamment via des pratiques commerciales restrictives. De façon plus général, c'est à Smith qu'on doit la métaphore de la main invisible selon laquelle les individus mus exclusivement par leur intérêt personnel, se comportent sur un marché concurrentiel dans un sens conforme à la prospérité générale.
" Chaque individu s'efforce continuellement de trouver l'emploi le plus avantageux pour tout capital dont il peut disposer. C'est son propre avantage, en vérité, et non celui de la société qu'il a en vue. Mais l'étude de son propre avantage l'amène naturellement, ou plutôt nécessairement, à préférer l'emploi le plus avantageux pour la société... Il recherche seulement son intérêt personnel, et il est en cela comme dans bien d'autres cas, amené par une main invisible à atteindre une fin qui n'entrait nullement dans ses intentions. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin ne fasse pas partie de ses intentions. En poursuivant son propre intérêt, il agit souvent plus efficacement pour l'intérêt de la société que lorsqu'il cherche réellement à agir en faveur de ce dernier. Je n'ai rien vu de bon de la part de ceux qui prétendent faire des affaires pour le bien public. C'est une prétention, il est vrai, peu courante chez les marchands et il suffirait de très peu de mots pour les en dissuader. Quelle espèce d'industrie nationale son capital peut il mettre en oeuvre, et de laquelle le produit est il susceptible d'avoir la plus grande valeur? Chaque individu, c'est évident, peut, dans sa situation particulière, en juger bien mieux que n'importe quel homme d'Etat ou législateur ne peut le faire à sa place. L'homme d'Etat, qui essaierait de diriger les personnes privées en ce qui concerne la façon d'employer leurs capitaux, non seulement s'embarrasserait du soin le plus inutile, mais assumerait une autorité qu'il ne serait pas sage de confier ni à une personne unique, ni même à un conseil ou un sénat quel qu'il soit, et qui ne serait jamais aussi dangereuse que dans les mains d'un homme ayant assez de folie et de présomption pour se croire capable de l'exercer. " Source : Adam Smith " Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. " Chapitre 11.
Pour Adam Smith, la recherche du gain amène les entreprises à produire les marchandises que recherchent les consommateurs, et cela au meilleur prix, donc en utilisant les combinaisons techniques les plus efficaces. Mais ces bienfaits ne peuvent se réaliser pleinement que si l'économie est soumise à un régime de libre concurrence : ainsi les barrières limitant l'accès à certains marchés, en créant des rentes de situation au profit des entreprises qu'elles protègent, faussent le jeu de la main invisible et nuisent finalement aux intérêts du consommateur. L'Etat, ne devant pas interférer avec le mécanisme autorégulateur du marché, a donc un rôle économique restreint. On doit néanmoins noter qu'aux missions de défense et d'exercice de justice définissant un " Etat gendarme ", Smith ajoute une troisième mission, qui est " d'élever et d'entretenir ces ouvrages et établissements publics dont une grande société retire d'immenses avantages, mais qui sont néanmoins de nature à ne pouvoir être entrepris ou entretenus par un ou quelques particuliers, attendu que pour ceux ci, le profit ne saurait jamais en rembourser la dépense. " Source " Recherches sur la nature et les causes de la richesses des nations " Livre V, Chapitre 1. Cette analyse préfigure la théorie moderne des biens collectifs. La théorie classique de la main invisible constitue aujourd'hui la base de la pensée économique libérale car elle contient l'idée que l'articulation des intérêts individuels, soumis à la pression de la concurrence, assure de façon efficace la régulation des processus économiques à l'échelle sociale, les prix jouant le rôle de signaux orientant les décisions des producteurs dans un sens conforme aux besoins des consommateurs. Cependant, ce ne sont pas forcément des fanatiques du libéralisme.
John Stuart Mill par exemple, disciple de Smith et de Ricardo sur la théorie économique, et partisan du réformisme social, favorable à l'impôt sur l'héritage, aux coopératives et à l'association capital travail. Smith et Ricardo dépeignent l'économie de marché comme un système traversé par de profondes oppositions d'intérêts et des rapports de forces souvent très inégalitaires entre classes sociales. Smith a décrit sans indulgence la façon dont les employeurs, usant à la fois de leur pouvoir économique et des facilités que leur accorde la loi, imposent leurs conditions aux salariés. Ce n'est pas comme si pour Adam Smith, tout était rose, contrairement à une idée reçue.
" Le niveau commun des salaires dépend partout du contrat habituellement passé entre ces deux parties, dont l'intérêt n'est nullement le même. Les ouvriers peuvent obtenir le plus possible, et les maîtres donner le moins possible. Les premiers sont disposés à se concerter pour élever les salaires, les seconds pour les abaisser. Mais il n'est pas difficile de prévoir laquelle des deux parties doit, dans toutes les circonstances ordinaires, avoir l'avantage dans le débat et forcer l'autre à accepter ses conditions. Les maîtres, étant moins nombreux, peuvent se concerter beaucoup plus facilement; en outre, la loi autorise, ou du moins n'interdit pas leurs ententes, alors qu'elle interdit celles des ouvriers. Nous n'avons aucun acte du Parlement contre les ententes pour abaisser les prix du travail, mais nous en avons beaucoup contre celles visant à l'élever. Dans tous ces conflits, les maîtres peuvent tenir beaucoup plus longtemps. Un propriétaire foncier, un fermier, un maître manufacturier, un marcha,d même s'ils n'employaient pas un seul ouvrier, pourraient généralement vivre une année ou deux grâce aux capitaux qu'ils ont acquis préalablement. Beaucoup d'ouvriers ne pourraient pas subsister une semaine, peu pourraient subsister un mois, et pratiquement aucun une année sans emploi. A long terme, l'ouvrier peut être aussi nécessaire à son maître que son maître lui est nécessaire; mais la nécessité n'est pas aussi immédiate. " Source : Adam Smith " Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations " Livre I, extrait du chapitre 8.
il y a 9 mois
Mais pour Smith, les ouvriers ont a gagné avec le libéralisme car il affirme que les ouvriers ont plus à perdre qu'à gagner en se révoltant contre l'ordre en place. L'essentiel de sa position peut être résumée ainsi : La croissance économique est bénéfique aux salariés. Or le libéralisme est le système le plus apte à promouvoir la croissance. Les salariés ont donc intérêt au libéralisme. C'est un syllogisme. Pour lui la hausse de la demande de travail émanant des entreprises tend à élever les salaires et par la suite le niveau de vie des salariés. La réalité est un peu moins simple car l'amélioration des conditions de vie est supposée à son tour élever l'offre de travail mais ce phénomène n'est pas immédiat et donc si la croissance économique est suffisamment soutenue, l'augmentation de la demande de travail peut garder une longueur d'avance sur l'augmentation induite de l'offre. Dans la troisième et dernière édition de ses " Principes " ( 1831 ), Ricardo reconnait d'être trompé quand il affirmait précédemment que le développement du machinisme ne pouvait apporter que des bienfaits à tous. " Telles étaient mes opinions, et elles restent inchangée en ce qui concerne le propriétaire foncier et le capitaliste. Mais je suis convaincu que la substitution des machines au travail humain est souvent très dommageable aux intérêts de la classe des travailleurs. " Source : Des principes de l'économie politique et de l'impôt " 1821, extrait du chapitre 31. Ricardo montre que si le rythme de la croissance économique est insuffisant, cette substitution créé du chômage.
Sa conclusion :" L'opinion entretenue par la classe ouvrière, selon laquelle l'emploi des machines est fréquemment préjudiciable à ses intérêts, n'est pas fondée sur le préjugé et l'erreur, mais est conforme aux principes corrects de l'économie politique. " Source : " " Des principes de l'économie politique et de l'impôt ", 1821, extrait du chapitre 31.
Conclusion inattendue de la part d'un auteur régulièrement dépeint comme le champion des intérêts de la bourgeoisie industrielle; Au delà d'opposer leurs solutions à celles des mercantilistes, il s'agit pour les classiques de construire une science de l'économie sur le modèle des sciences de la nature alors en plein développement. Les principia de Newton ont été écrits en 1687 et les découvertes de Lavoisier datent des années 1770. Les lois naturelles des classiques sont des propositions visant à expliquer le fonctionnement de l'économie de marché dans un contexte de libre concurrence. Si une telle économie apparait naturelle à Smith, c'est parce que le marché est selon lui l'expression directe d'un trait caractéristique de la nature humaine : la propension à l'échange. A l'intérieur du courant classique, Stuart Mill cherche à limiter le champ d'application de la notion de loi naturelle en établissant une distinction entre le domaine de la production et celui de la répartition. Selon lui, si le premier domaine est soumis à des lois naturelles, il n'en va pas de même du second : les règles régissant la répartition des richesses entre les individus sont le fruit de conventions sociales et comme telles, peuvent être modifiées. La critique émanant de l'école historique allemande es veut plus radicale. Les membres de cette école ( Knies, Roscher, Hidebrand à, rejettent complètement l'idée qu'il est possible de construire une science de 'économie sur le modèle des sciences de la nature car ils considèrent que l'étude de l'économie ne peut reposer que sur l'étude des faits historiques et non sur des modèles abstraits et prétendument universels comme ceux qu'élaborent les classiques.
Histoire des idées économiques Tome 1.
Accumulation, débouchés, commerce extérieur.
La priorité donnée par les classiques à l'étude des tendances longues se manifeste particulièrement dans l'importance qu'ils accordent au processus d'accumulation du capital, c'est à dire l'élargissement progressif du stock de ressources productives dont dispose l'économie. La théorie de l'accumulation constitue un point d'appui majeur de leurs convictions libérales; c'est en effet à leurs yeux son aptitude particulière à promouvoir la croissance de la " richesse des nations " qui désigne le libéralisme comme le meilleur système économique. Pourtant, loin d'être vue comme un trait permanent des sociétés industrielles, la croissance est considérée par ces économistes comme un phénomène transitoire, dont la dynamique est condamnée à s'essouffler progressivement pour déboucher sur un état stationnaire; plus d'un siècle et demi avant la publication du rapport du Club de Rome sur " les limites de la croissance ", cette analyse fait des classiques les pionniers des travaux sur la " croissance 0 ". En liaison avec le phénomène de l'accumulation, le commerce extérieur fait l'objet d'une analyse approfondie, qui jette les bases d'une théorie de la division internationale du travail dont les débats actuels soulignent l'importance. 1. Epargne et débouchés. L'accumulation du capital se fait à l'occasion que la terminologie économique moderne qualifie d'investissements. Le financement de ces opérations est assuré par un flux d'épargne, qui traduit la renonciation à la consommation immédiate d'une partie de leurs revenus par certains agents économiques. Pour les classiques c'est essentiellement la classe capitaliste qui dégage cette épargne. En effet la classe des salariés perçoit un revenu qui en moyenne suffit tout juste à assurer sa subsistance, et la classe des propriétaires fonciers est supposée dépenser en consommation improductive l'essentielle de ce qu'elle perçoit. L'épargne des capitalistes est donc la condition nécessaire du processus de la croissance économique.
Sans elle pas d'accumulation du capital et donc pas d'accroissement de la richesse des nations. L'épargne est vue comme non seulement nécessaire mais aussi suffisante pour la croissance. L'investissement est aux yeux des classiques une conséquences automatique de l'épargne, et donc si les capitalistes épargnent régulièrement une partie de leurs profits, l'accumulation du capital se réalise, Smith a évoqué cette idée là justement : " Ainsi, toute augmentation ou diminution dans la masse des capitaux tendent naturellement à augmenter ou à diminuer la quantité réelle de l'activité, le nombre de gens productifs et par conséquent la valeur échangeable du produit annuel des terres et du travail du pays. La richesse et le revenu réel de tous ses habitants. Les capitaux augmentent par l'économie et diminuent par la prodigalité et la mauvaise conduire. Tout ce qu'une personne épargne sur son revenu, elle l'ajoute à son capital, et soit elle l'emploie elle même à entretenir un nombre additionnel de travailleurs productifs, doit elle permet à quelqu'un d'autre d'en faire autant, en lui prêtant ce capital moyennant un intérêt, c'est à dire une partie des profits. Comme le revenu annuel d'un individu ne peut augmenter que par l'épargne qu'il réalise sur son revenu annuel ou ses gains annuels, le capital d'une société, qui n'est autre chose que celui de tous les individus qui la composent, ne peut augmenter que de la même manière. C'est l'économie ( parsimony ) et non l'activité ( industry ), qu'est la cause immédiate de l'augmentation du capital. L'activité, en vérité, fournit la manière que l'économie accumule. Mais quel que puisse être le produit de l'activité, s'il n'était épargné et amassé par l'économie, le capital n'augmenterait jamais. Source : Adam Smith " Recherches sur la nature et la richesse des nations " Livre II, extrait du chapitre 3.
Sa conclusion :" L'opinion entretenue par la classe ouvrière, selon laquelle l'emploi des machines est fréquemment préjudiciable à ses intérêts, n'est pas fondée sur le préjugé et l'erreur, mais est conforme aux principes corrects de l'économie politique. " Source : " " Des principes de l'économie politique et de l'impôt ", 1821, extrait du chapitre 31.
Conclusion inattendue de la part d'un auteur régulièrement dépeint comme le champion des intérêts de la bourgeoisie industrielle; Au delà d'opposer leurs solutions à celles des mercantilistes, il s'agit pour les classiques de construire une science de l'économie sur le modèle des sciences de la nature alors en plein développement. Les principia de Newton ont été écrits en 1687 et les découvertes de Lavoisier datent des années 1770. Les lois naturelles des classiques sont des propositions visant à expliquer le fonctionnement de l'économie de marché dans un contexte de libre concurrence. Si une telle économie apparait naturelle à Smith, c'est parce que le marché est selon lui l'expression directe d'un trait caractéristique de la nature humaine : la propension à l'échange. A l'intérieur du courant classique, Stuart Mill cherche à limiter le champ d'application de la notion de loi naturelle en établissant une distinction entre le domaine de la production et celui de la répartition. Selon lui, si le premier domaine est soumis à des lois naturelles, il n'en va pas de même du second : les règles régissant la répartition des richesses entre les individus sont le fruit de conventions sociales et comme telles, peuvent être modifiées. La critique émanant de l'école historique allemande es veut plus radicale. Les membres de cette école ( Knies, Roscher, Hidebrand à, rejettent complètement l'idée qu'il est possible de construire une science de 'économie sur le modèle des sciences de la nature car ils considèrent que l'étude de l'économie ne peut reposer que sur l'étude des faits historiques et non sur des modèles abstraits et prétendument universels comme ceux qu'élaborent les classiques.
Histoire des idées économiques Tome 1.
Accumulation, débouchés, commerce extérieur.
La priorité donnée par les classiques à l'étude des tendances longues se manifeste particulièrement dans l'importance qu'ils accordent au processus d'accumulation du capital, c'est à dire l'élargissement progressif du stock de ressources productives dont dispose l'économie. La théorie de l'accumulation constitue un point d'appui majeur de leurs convictions libérales; c'est en effet à leurs yeux son aptitude particulière à promouvoir la croissance de la " richesse des nations " qui désigne le libéralisme comme le meilleur système économique. Pourtant, loin d'être vue comme un trait permanent des sociétés industrielles, la croissance est considérée par ces économistes comme un phénomène transitoire, dont la dynamique est condamnée à s'essouffler progressivement pour déboucher sur un état stationnaire; plus d'un siècle et demi avant la publication du rapport du Club de Rome sur " les limites de la croissance ", cette analyse fait des classiques les pionniers des travaux sur la " croissance 0 ". En liaison avec le phénomène de l'accumulation, le commerce extérieur fait l'objet d'une analyse approfondie, qui jette les bases d'une théorie de la division internationale du travail dont les débats actuels soulignent l'importance. 1. Epargne et débouchés. L'accumulation du capital se fait à l'occasion que la terminologie économique moderne qualifie d'investissements. Le financement de ces opérations est assuré par un flux d'épargne, qui traduit la renonciation à la consommation immédiate d'une partie de leurs revenus par certains agents économiques. Pour les classiques c'est essentiellement la classe capitaliste qui dégage cette épargne. En effet la classe des salariés perçoit un revenu qui en moyenne suffit tout juste à assurer sa subsistance, et la classe des propriétaires fonciers est supposée dépenser en consommation improductive l'essentielle de ce qu'elle perçoit. L'épargne des capitalistes est donc la condition nécessaire du processus de la croissance économique.
Sans elle pas d'accumulation du capital et donc pas d'accroissement de la richesse des nations. L'épargne est vue comme non seulement nécessaire mais aussi suffisante pour la croissance. L'investissement est aux yeux des classiques une conséquences automatique de l'épargne, et donc si les capitalistes épargnent régulièrement une partie de leurs profits, l'accumulation du capital se réalise, Smith a évoqué cette idée là justement : " Ainsi, toute augmentation ou diminution dans la masse des capitaux tendent naturellement à augmenter ou à diminuer la quantité réelle de l'activité, le nombre de gens productifs et par conséquent la valeur échangeable du produit annuel des terres et du travail du pays. La richesse et le revenu réel de tous ses habitants. Les capitaux augmentent par l'économie et diminuent par la prodigalité et la mauvaise conduire. Tout ce qu'une personne épargne sur son revenu, elle l'ajoute à son capital, et soit elle l'emploie elle même à entretenir un nombre additionnel de travailleurs productifs, doit elle permet à quelqu'un d'autre d'en faire autant, en lui prêtant ce capital moyennant un intérêt, c'est à dire une partie des profits. Comme le revenu annuel d'un individu ne peut augmenter que par l'épargne qu'il réalise sur son revenu annuel ou ses gains annuels, le capital d'une société, qui n'est autre chose que celui de tous les individus qui la composent, ne peut augmenter que de la même manière. C'est l'économie ( parsimony ) et non l'activité ( industry ), qu'est la cause immédiate de l'augmentation du capital. L'activité, en vérité, fournit la manière que l'économie accumule. Mais quel que puisse être le produit de l'activité, s'il n'était épargné et amassé par l'économie, le capital n'augmenterait jamais. Source : Adam Smith " Recherches sur la nature et la richesse des nations " Livre II, extrait du chapitre 3.
il y a 9 mois
Ce n'est pas évident pour tout le monde car l'acte d'épargne est en soi une simple abstention de consommation. Sauf dans le cas où l'épargnant et l'investisseur sont une seule et même personne ( autofinancement ), il n'est dès lors pas garanti a priori la volonté d'épargner de certains correspond, chez d'autres, une volonté équivalente d'investir. Bien au contraire, différents auteurs ont soutenu que le désir d'épargner peut être socialement nuisible car il diminue les débouchés offerts à la production. Une telle objection est balayée par Smith qui, s'appuyant sur un raisonnement plutôt confus, affirme que " ce qui est annuellement épargné est aussi régulièrement consommé que ce qui est annuellement dépense ". C'est sur une base plus cohérente que ses successeurs défendent la thèse selon laquelle l'épargne constitue la condition nécessaire et suffisante de l'accumulation. La pièce maîtresse du raisonnement classique en la matière est, à partir du début du XIXème siècle la " loi des débouchés. " Cette loi formulée par Jean Baptiste Say en 1803 connait un grand succès : reprise à son compte par l'école classique, surtout par Ricardo, pourtant critique à d'autres égards vis à vis de Say. Elle l'est aussi à la fin du XIXème siècle, par l'école néoclassique. Keynes regroupera tous les auteurs adhérant à la loi des débouchés sous l'étiquette classique. Jusqu'à la publication de sa " Théorie Générale " en 1936, les économistes contestant la validité scientifique de cette loi resteront très minoritaires.
Say disait au sujet ce cette loi : " Il est bon de remarquer qu'un produit créé offre, dès cet instant, un débouché à d'autres produits pour tout le montant de sa valeur. En effet, lorsque le dernier producteur a terminé un produit, son plus grand désir est de le vendre, pour que la valeur de ce produit ne chôme pas entre ses mains. Mais il n'est pas moins empressé de se défaire de l'argent que lui procure sa vente, pour que la valeur de l'argent ne chôme pas non plus. Or, on ne peut se défaite de son argent qu'en demandant à acheter un produit quelconque. On voit donc que le fait seul de la formation d'un produit ouvre, dès l'instant même, un débouché à d'autres produits. Cela étant, d'où vient, dira t on, cette prodigieuse difficulté qu'on éprouve, surtout quand la situation des affaires générales est peu prospère, pour l'écoulement des produits de l'industrie, d'où il résulte qu'on en tire alors un parti peu avantageux? Je me bornerai à faire remarquer ici qu'un défaut d'écoulement d'un produit, ou même d'un grand nombre de produits, n'est que le résultat d'un engorgement dans un ou plusieurs canaux de l'industrie; qu'il se trouve alors dans ces canaux une plus grande quantité de ces produits que n'en réclament les besoins généraux, et que c'est toujours parce que d'autres canaux, loin d'être engorgés, sont au contraire dépourvus de produits qui, en raison de leur rareté, sont aussi recherchés que les premiers le sont peu. "
" Aussi, l'ont peut remarquer que les temps où certaines denrées ne se vendent pas bien sont précisément ceux où d'autres denrées montent à des prix excessifs; et comme ces prix élevés seraient des motifs pour en favoriser la production, il faut que des causes majeures ou des moyens violents, comme des désastres naturels ou politiques, l'avidité ou l'impéritie des gouvernements, maintiennent forcément cette pénurie d'un côté, qui cause un engorgement de l'autre. Cette cause de maladie politique vient elle à cesser, les moyens de production se portent vers les canaux vacants, et le produit de ceux ci absorbe le trop plein des autres; l'équilibre se rétablit, et cesserait rarement d'exister, si les moyens de production étaient toujours laissés à leur entière liberté. " Source : Jean Baptiste Say " Traité d'économie politique " Livre I, extrait du chapitre 15.
Say disait au sujet ce cette loi : " Il est bon de remarquer qu'un produit créé offre, dès cet instant, un débouché à d'autres produits pour tout le montant de sa valeur. En effet, lorsque le dernier producteur a terminé un produit, son plus grand désir est de le vendre, pour que la valeur de ce produit ne chôme pas entre ses mains. Mais il n'est pas moins empressé de se défaire de l'argent que lui procure sa vente, pour que la valeur de l'argent ne chôme pas non plus. Or, on ne peut se défaite de son argent qu'en demandant à acheter un produit quelconque. On voit donc que le fait seul de la formation d'un produit ouvre, dès l'instant même, un débouché à d'autres produits. Cela étant, d'où vient, dira t on, cette prodigieuse difficulté qu'on éprouve, surtout quand la situation des affaires générales est peu prospère, pour l'écoulement des produits de l'industrie, d'où il résulte qu'on en tire alors un parti peu avantageux? Je me bornerai à faire remarquer ici qu'un défaut d'écoulement d'un produit, ou même d'un grand nombre de produits, n'est que le résultat d'un engorgement dans un ou plusieurs canaux de l'industrie; qu'il se trouve alors dans ces canaux une plus grande quantité de ces produits que n'en réclament les besoins généraux, et que c'est toujours parce que d'autres canaux, loin d'être engorgés, sont au contraire dépourvus de produits qui, en raison de leur rareté, sont aussi recherchés que les premiers le sont peu. "
" Aussi, l'ont peut remarquer que les temps où certaines denrées ne se vendent pas bien sont précisément ceux où d'autres denrées montent à des prix excessifs; et comme ces prix élevés seraient des motifs pour en favoriser la production, il faut que des causes majeures ou des moyens violents, comme des désastres naturels ou politiques, l'avidité ou l'impéritie des gouvernements, maintiennent forcément cette pénurie d'un côté, qui cause un engorgement de l'autre. Cette cause de maladie politique vient elle à cesser, les moyens de production se portent vers les canaux vacants, et le produit de ceux ci absorbe le trop plein des autres; l'équilibre se rétablit, et cesserait rarement d'exister, si les moyens de production étaient toujours laissés à leur entière liberté. " Source : Jean Baptiste Say " Traité d'économie politique " Livre I, extrait du chapitre 15.
il y a 9 mois
La loi des débouchés, dans sa version originale, affirme que ' c'est la production qui ouvre des débouchés aux produits ". Cette proposition, à première vue déconcertante, concerne l'ensemble de l'économie et non une entreprise ou une branche particulière. Say n'affirme donc pas qu'une entreprise n'a jamais de problème pour écouler ses marchandises, mais que l'offre globale de produits ne peut jamais excéder la demande globale des produits, car celle ci découle de celle là. Le raisonnement soutenant cette affirmation repose sur une conception particulière des fonctions économiques de la monnaie, largement empruntée à Smith. Celle ci est considérée comme un simple intermédiaire des échanges. Elle n'est pas recherchée pour elle même mais pour les biens et services qu'elle leur permet de se procurer. C'est pourquoi, dit Say, dès qu'un individu a vendu un produit " il n'est pas moins empressé de se défaite de l'argent que lui procure sa vente, pour que la valeur de l'argent ne chôme pas non plus. " Et la demande qu'il manifeste à cette occasion crée pour d'autres produits un débouché d'une valeur égale à celle du produit qu'il a vendu. Dans cette optique, l'épargne ne risque pas de créer un déficit de la demande par rapport à la production. En effet, quand elle ne sert pas à autofinancer les investissements des épargnants, elle ne peut manquer d'être prêtée à d'autres agents économiques qui l'utiliseront pour financer des dépenses d'investissement; si les épargnants renonçaient à prêter leur épargne, ils se priveraient du même coup des revenus qui lui sont attachés ( les intérêts ). Par un raisonnement quelque peu différent, Say rejoint donc la conclusion de Smith selon laquelle l'épargne conditionne l'investissement.
L'idée que la monnaie n'est pas recherchée pour elle même mais pour les produits qu'elle permet d'acquérir est cohérente avec la thèse des physiocrates et et Smith, selon laquelle la monnaie n'est pas la vraie richesse mais seulement le moyen de la faire circuler : l'utilisation de la monnaie s'expliquer par le fait que l'échange monétaire est techniquement supérieur au troc mais en fait, même dans une économie monétaire " les produits s'échangeant contre des produits ", affirme Say. Cependant, les agents économiques détiennent à tout moment une certaine réserve de monnaie. Pour Say et les économistes adoptant son analyse, celle ci a pour seul objet d'assurer la continuité des transactions, la cadence des encaissements ne correspondent pas toujours à celle des décaissements ( un salariés par exemple reçoit son salaire tous les mois mais effectue des dépenses quotidiennes ). L'existence de cette réserve, appelée de nos jours " encaisse transaction ", ne contredit pas la loi de Say, dans la mesure où son niveau moyen, proportionnel à la valeur des transactions, n'est pas susceptibles de créer de " fuites " dans le circuit production - revenu - demande. L'analyse monétaire qui sous tend la loi des débouchés rend celle ci tout à fait compatible avec une analyse beaucoup plus ancienne, la théorie quantitative de la monnaie. Selon cette théorie, ce sont les variations de la masse monétaire qui expliquent les variations du niveau général des prix. Or selon la loi des débouchés, la " demande de monnaie " des agents ( c'est à dire le stock de monnaie qu'ils souhaitent, en moyenne, détenir en réserve ), se limite à leurs encaisses - transactions. Par conséquent, si la masse monétaire s'accroît, ils chercheront à utiliser le surplus de monnaie dont ils disposent en augmentant leurs dépenses.
Cette hausse générale de la demande se traduira par une hausse générale du niveau des prix, ce qui rejoint exactement les conclusions de la théorie quantitative de la monnaie. Ce n'est donc pas surprenant que cette vieille théorie ait été intégrée à l'analyse classique puis à l'analyse néoclassique, elle aussi adepte de la loi de Say. Et il n'est pas davantage surprenant qu'au XXème siècle, Keynes prenne la loi des débouchés et la théorie quantitative comme cible commune quand il veut démontrer à l'encontre de ceux qu'il appelle " classiques " que l'offre ne crée pas sa propre demande. la loi des débouchés, en niant la possibilité d'une insuffisance globale de la demande, conforte la thèse classique selon laquelle l'épargne constitue la condition nécessaire et suffisante de l'accumulation du capital. Elle fournit aussi une clé d'interprétation des crises fréquentes qui marquent la période de la révolution industrielle. Ces crises, dans l'optique de la loi de Say, s'expliquent par des désajustements sectoriels et symétriques entre l'offre et la demande. En effet, poser qu'il ne peut y avoir d'excès global de l'offre revient à affirmer que si certaines productions se trouvent temporairement excédentaires, il y a nécessairement au même moment, un déficit pour d'autres productions. En d'autres termes, la crise de surproduction généralisée ( appelée " engorgement général " par les contemporaines de Say ) n'est pas compatible avec la représentation de l'économie fournie par la loi des débouchés, qui implique que la surproduction coexiste nécessairement avec la pénurie. S'interrogeant sur l'origine des désajustements sectoriels qui constituent pour lui l'essence même des crises, Say met en avant des causes extra économiques, comme les " désastres naturels ou politiques ".
Mais les causes peuvent venir du système économique lui même, les décisions ne peuvent se révéler trompeuses ( la loi des débouchés ne s'applique pas au niveau d'une entreprise ou même d'une branche ). Le fonctionnement d'une économie de marché repose sur un grand nombre de décisions décentralisées dont l'ajustement s'effectue par d'incessants " tâtonnements " et n'est donc pas à l'abri d'accidents concernant l'adéquation de la structure de l'offre à celle de la demande. Ainsi lorsque l'évolution des débouchés semble particulièrement prometteuse dans un secteur déterminé, il arrive fréquemment que l'afflux de capitaux suscité par cette perspective soit tel qu'il crée une situation de surcapacité dans ce secteur, ce qui est susceptible de créer des faillites et du chômage. Sectoriels, les désajustements entre l'offre et la demande sont également considérés comme passers - du moins si la logique de la concurrence n'est pas entravée par quelque intervention extérieure. Le raisonnement de Say sur ce point s'appuie directement sur la théorie de la gravitation de Smith, et débouche sur des conclusions parfaitement conformes au credo libéral : par le jeu même des forces du marché, les désajustements sectoriels entre offre et demande tendent à se combler spontanément. L'intervention de l'Etat est donc non seulement inutile, mais néfaste, car elle fausse les mécanismes correcteurs du marché.La confiance dont fait preuve Say quant aux vertus autorégulatrices du marché n'est pas partagée par les adversaires, peu nombreux à l'époque classique, de sa loi des débouchés. Les principaux sont Malthus et Sismondi.
Say disait sur les dangers de l'intervention de l'Etat : " Un gouvernement ou des particuliers bienfaisants avec légèreté auraient le regret de ne point voir leurs bienfaits répondre à leurs vues. Au lieu de prouver cela par un raisonnement, j'essaierai de le faire sentir par un exemple. Je suppose que dans un pays de vignobles, les tonneaux se trouvent si abondants, qu'il soit impossible de les employer tous. Une guerre ou bien une loi contraire à la production des vins ont déterminé plusieurs propriétaires de vignobles à changer la culture de leurs terres; telle est la cause durable de la surabondance du travail de tonnellerie mais en circulation. On ne tient pas compte de cette cause; on vient au secours des ouvriers tonneliers, soit en achetant sans besoin des tonneaux, soit en leur distribuant des secours équivalant à peu près aux profits qu'ils avaient coutume de faire. Mais des achats sans besoin, des secours, ne peuvent pas se perpétuer; et, au moment où ils viennent à cesser, les ouvriers se trouvent exactement dans la même position fâcheuse d'où on a voulu les tirer. On aura fait des sacrifices, des dépenses, sans aucun avantage, si ce n'est d'avoir différé un peu le désespoir de ces pauvres gens. Sans doute le gouvernement, lorsqu'il le peut, sans provoquer aucun désordre, sans blesser la liberté des transactions, doit protéger les intérêts des ouvriers, parce qu'ils sont moins que ceux des maîtres protégés par la nature des choses; mais, en même temps, si le gouvernement est éclairé, il se mêlera aussi peu que possible des affaires des particuliers, pour ne pas ajouter aux maux de la nature ceux qui viennent de l'administration. " Source : Jean Baptiste Say " Traité d'économie politique, Livre II, extrait du chapitre 7.
L'idée que la monnaie n'est pas recherchée pour elle même mais pour les produits qu'elle permet d'acquérir est cohérente avec la thèse des physiocrates et et Smith, selon laquelle la monnaie n'est pas la vraie richesse mais seulement le moyen de la faire circuler : l'utilisation de la monnaie s'expliquer par le fait que l'échange monétaire est techniquement supérieur au troc mais en fait, même dans une économie monétaire " les produits s'échangeant contre des produits ", affirme Say. Cependant, les agents économiques détiennent à tout moment une certaine réserve de monnaie. Pour Say et les économistes adoptant son analyse, celle ci a pour seul objet d'assurer la continuité des transactions, la cadence des encaissements ne correspondent pas toujours à celle des décaissements ( un salariés par exemple reçoit son salaire tous les mois mais effectue des dépenses quotidiennes ). L'existence de cette réserve, appelée de nos jours " encaisse transaction ", ne contredit pas la loi de Say, dans la mesure où son niveau moyen, proportionnel à la valeur des transactions, n'est pas susceptibles de créer de " fuites " dans le circuit production - revenu - demande. L'analyse monétaire qui sous tend la loi des débouchés rend celle ci tout à fait compatible avec une analyse beaucoup plus ancienne, la théorie quantitative de la monnaie. Selon cette théorie, ce sont les variations de la masse monétaire qui expliquent les variations du niveau général des prix. Or selon la loi des débouchés, la " demande de monnaie " des agents ( c'est à dire le stock de monnaie qu'ils souhaitent, en moyenne, détenir en réserve ), se limite à leurs encaisses - transactions. Par conséquent, si la masse monétaire s'accroît, ils chercheront à utiliser le surplus de monnaie dont ils disposent en augmentant leurs dépenses.
Cette hausse générale de la demande se traduira par une hausse générale du niveau des prix, ce qui rejoint exactement les conclusions de la théorie quantitative de la monnaie. Ce n'est donc pas surprenant que cette vieille théorie ait été intégrée à l'analyse classique puis à l'analyse néoclassique, elle aussi adepte de la loi de Say. Et il n'est pas davantage surprenant qu'au XXème siècle, Keynes prenne la loi des débouchés et la théorie quantitative comme cible commune quand il veut démontrer à l'encontre de ceux qu'il appelle " classiques " que l'offre ne crée pas sa propre demande. la loi des débouchés, en niant la possibilité d'une insuffisance globale de la demande, conforte la thèse classique selon laquelle l'épargne constitue la condition nécessaire et suffisante de l'accumulation du capital. Elle fournit aussi une clé d'interprétation des crises fréquentes qui marquent la période de la révolution industrielle. Ces crises, dans l'optique de la loi de Say, s'expliquent par des désajustements sectoriels et symétriques entre l'offre et la demande. En effet, poser qu'il ne peut y avoir d'excès global de l'offre revient à affirmer que si certaines productions se trouvent temporairement excédentaires, il y a nécessairement au même moment, un déficit pour d'autres productions. En d'autres termes, la crise de surproduction généralisée ( appelée " engorgement général " par les contemporaines de Say ) n'est pas compatible avec la représentation de l'économie fournie par la loi des débouchés, qui implique que la surproduction coexiste nécessairement avec la pénurie. S'interrogeant sur l'origine des désajustements sectoriels qui constituent pour lui l'essence même des crises, Say met en avant des causes extra économiques, comme les " désastres naturels ou politiques ".
Mais les causes peuvent venir du système économique lui même, les décisions ne peuvent se révéler trompeuses ( la loi des débouchés ne s'applique pas au niveau d'une entreprise ou même d'une branche ). Le fonctionnement d'une économie de marché repose sur un grand nombre de décisions décentralisées dont l'ajustement s'effectue par d'incessants " tâtonnements " et n'est donc pas à l'abri d'accidents concernant l'adéquation de la structure de l'offre à celle de la demande. Ainsi lorsque l'évolution des débouchés semble particulièrement prometteuse dans un secteur déterminé, il arrive fréquemment que l'afflux de capitaux suscité par cette perspective soit tel qu'il crée une situation de surcapacité dans ce secteur, ce qui est susceptible de créer des faillites et du chômage. Sectoriels, les désajustements entre l'offre et la demande sont également considérés comme passers - du moins si la logique de la concurrence n'est pas entravée par quelque intervention extérieure. Le raisonnement de Say sur ce point s'appuie directement sur la théorie de la gravitation de Smith, et débouche sur des conclusions parfaitement conformes au credo libéral : par le jeu même des forces du marché, les désajustements sectoriels entre offre et demande tendent à se combler spontanément. L'intervention de l'Etat est donc non seulement inutile, mais néfaste, car elle fausse les mécanismes correcteurs du marché.La confiance dont fait preuve Say quant aux vertus autorégulatrices du marché n'est pas partagée par les adversaires, peu nombreux à l'époque classique, de sa loi des débouchés. Les principaux sont Malthus et Sismondi.
Say disait sur les dangers de l'intervention de l'Etat : " Un gouvernement ou des particuliers bienfaisants avec légèreté auraient le regret de ne point voir leurs bienfaits répondre à leurs vues. Au lieu de prouver cela par un raisonnement, j'essaierai de le faire sentir par un exemple. Je suppose que dans un pays de vignobles, les tonneaux se trouvent si abondants, qu'il soit impossible de les employer tous. Une guerre ou bien une loi contraire à la production des vins ont déterminé plusieurs propriétaires de vignobles à changer la culture de leurs terres; telle est la cause durable de la surabondance du travail de tonnellerie mais en circulation. On ne tient pas compte de cette cause; on vient au secours des ouvriers tonneliers, soit en achetant sans besoin des tonneaux, soit en leur distribuant des secours équivalant à peu près aux profits qu'ils avaient coutume de faire. Mais des achats sans besoin, des secours, ne peuvent pas se perpétuer; et, au moment où ils viennent à cesser, les ouvriers se trouvent exactement dans la même position fâcheuse d'où on a voulu les tirer. On aura fait des sacrifices, des dépenses, sans aucun avantage, si ce n'est d'avoir différé un peu le désespoir de ces pauvres gens. Sans doute le gouvernement, lorsqu'il le peut, sans provoquer aucun désordre, sans blesser la liberté des transactions, doit protéger les intérêts des ouvriers, parce qu'ils sont moins que ceux des maîtres protégés par la nature des choses; mais, en même temps, si le gouvernement est éclairé, il se mêlera aussi peu que possible des affaires des particuliers, pour ne pas ajouter aux maux de la nature ceux qui viennent de l'administration. " Source : Jean Baptiste Say " Traité d'économie politique, Livre II, extrait du chapitre 7.
il y a 9 mois
Malthus par son " principe de population " participe à l'élaboration de la théorie classique. Mais il se place en marge de celle ci par son rejet de la loi des débouchés. Il dit à ce sujet : " Il est possible, sans doute, au moyen de l'économie, de consacrer tout d'un coup une quantité plus grande qu'à l'ordinaire du produit d'un pays quelconque, à la subsistance des travailleurs productifs; et il est bien certains que les travailleurs ainsi empliyés sont des consommateurs, tout aussi bien que les domestiques. En ce qui regarde les travailleurs, il n'y aurait donc point de diminution de consommaiton ni de demande... Quant aux capitalistes eux même, réunis aux propriétaires et autres personnes riches, on suppose qu'ils ont résolu d'être économes, et en se privant de leurs jouissances, de leur luxe ordinaire, d'épargner sur leurs revenus pour ajouter à leur capital. Je demanderais comment il est possible, dans de telles circonstances, de supposer que le surcroît de produits obtenus avec un plus grand nombre d'ouvriers productifs puisse trouver des acheteurs, sans qu'il y ait une telle diminution de prix, que la valeur des produits puisse tomber au dessous des frais de production, ou pour le moment à diminuer tellement les profits qu'il en résulte une très forte diminution des moyens ou de la volonté d'épargner.
Quelques auteurs de beaucoup de mérite ont pensé que, quoiqu'il puisse y avoir aisément un engorgement partiel de certains produits, il est impossible qu'il y ait un engorgement partiel de certains produits, il est impossible qu'il y ait un engorgement de tous les produits en général; car d'après leur manière d'envisager le sujet, des produits s'échangeant contre d'autres produits, une moitié doit servir à acheter l'aure, et la production étant ainsi la seule soruce de la demande, la surabondance de l'approvisionnement d'un aerticle prouverait seulement qu'il y a défaut d'approvisionnement de quelque autre produit, la surabondance générale de tous les produits étant regardée comme impossible. M. Say, dans son bel ouvrage sur l'économie politique, a même poussé la chose si loin, qu'il assure que la consommation d'une denrée, en l'enlevant du marché, diminue la demande et que la production d'une denrée augmente la demande dans la même proportion. Cepepdant, cette doctrine, avec toute l'extension qu'on lui a donnée, me semble tout à fait fausse et en contradiction manifeste avec les grands principes qui règlent l'offre et la demande. Il n'est pas du tout vrai, dans les faits, que des produits soient toujours échangés contre d'autres produits. La plus grande partie des produits s'échange contre du travail productif ou des services personnels; et il est clair que cette masse de produits, comparée au travail contre lequel elle doit être échangée, peut baisser de valeur par l'effet de sa surabondance, précisément de la même manière qu'une seule denrée baisse de valeur par l'excès de l'approvisionnement, relativement au travail ou à la monnaie. " Source : Thomas Robert Malthus, " Principes d'économie politique ", 1820, Livre II, extrait du chapitre 1.
Son raisonnement part d'une situation d'équilibre hypothétique dans laquelle les capitalistes effectent leurs profits à des dépenses de consommation improductive; celle ci consiste en l'entretien de domestiques, considérés dans la tradition classique comme des travailleurs improductifs. A partir de cette situation, Malthus envisage ce qui se passerait si les mêmes capitalistes décidaient d'affecter leurs profits à l'épargne au lieu de la consommation. Cette épargne, explique t il, se traduirait par l'embauche de travailleurs productifs au lieu de domestiques. Il s'ensuivrai une augmentation du volume de la production, mais pas nécessairement une augmentation du volume des débouchés, dans la mesure où la demande des travailleurs productifs supplémentaires ne ferait que remplacer celle des travailleurs improductifs. De cet example Malthus tire la conclusion que contrairement à ce qu'affirme Say, l'offre ne crée pas sa propre demande, et il avance l'idée qu'une tendance excessive à l'épargne est susceptible d'entraîner un recul de l'activité économique. Cette analyse ouvre la possibilité d'interpréter les crises économiques récurrentes en termes d' " engorgement général " des marchés, résultat d'une insuffisance globale de débouchés. En l'état, son pouvoir de conviction reste cependant limité, car la théorie de l'intérêt formulée dès 1766 par Turgot ( supra, chapitre 3 ) fournit une parade toute prête aux partisans de la loi de Say : tout accroissement de la tendance à l'épargne doit, selon cette théorie, faire baisser le taux de l'intérêt jusqu'au point ou la hausse induite de l'investissement vient équilibrer le supplément d'épargne.
Comme Malthus, Sismondi rejette les lois des débouchés. Cet historien et économiste suisse, contemporain des classiques, né en 1773 et mort en 1842, adhère dans un premier temps à leurs idées puis s'en démarque dans un ouvrage publié en 1819 et portant le titre de " Nouveaux principes d'économie politique " qui constitue une vigoureuse critique du libéralisme économique, fondée sur le constat de la misère dans laquelle vit une large fraction de la population anglaise. " C'est le revenu de l'année passée qui doit payer la production de cette année; c'est une quantité prédéterminée qui sert de mesure à la quantité indéfinie du travail à venir. L'erreur de ceux qui excitent à une production illimitée vient de ce qu'ils ont confondu ce revenu passé avec le revenu futur. Ils ont dit qu'augmenter le travail, c'est augmenter la richesse, avec elle le revenu et en raison de ce dernier la consommation. Mais qu'on n'augmente les richesses qu'en augmentant le travail demandé, le travial qui sera payé à son prix; et ce prix, fixé d'avance, c'est le revenu préexistant. On ne fait jamais, après tout, qu'échanger la totalité de la production de l'année contre la totalité de la production de l'année précédente. Or, si la production croît graduellement, l'échange de chaque année doit causer une petite perte, en même temps qu'elle bonifie la condition future. Si cette perte est légère et bien répartie, chacun la supporte sans se plaindre sur son revenu; c'est en cela même que consiste l'économie nationale, et la série de ces petits sacrifices augmente le capital et la fortune publique. Mais, s'il y a une grande disproportion entre la production nouvelle et l'antécédente, les capitaux sont entamés, il y a souffrance, et la nation recule au lieu d'avancer....
Ainsi les nations courent des dangers qui semblent contradictoires. Elles peuvent se ruiner également en dépensant torp et en dépensant trop peu. Une nation dépense trop, toutes les fois qu'ell eexcède son revenu, car elle ne peut le faire qu'en entamant ses capitaux, et en diminuant ainsi sa production à venir. Elle fait alors ce que ferait un cultivateur solitaire, qui mangerait le blé qu'il devrait dréserver pour ses semailles. Elle dépense trop peu toutes les fois que, n'ayant pas de commerce étranger, elle ne consomme pas sa production, ou qu'en ayant un, elle ne consomme pas l'excédent de sa production sur son exportation : car alors elle se trouve bientôt dans le cas où se trouverait le cultivateur solidtaire, lorsque tous ses greniers seraient plein fort au delà toute possibilité de consommation, et que, pour ne pas faire un travail inutile, il serait obligé de renoncer à ensemencer ses terres... On pourrait croire que, lorsque j'accuse les économistes les plus célèbres d'avoir accordé trpo peu d'attention à la consommation, ou au début, dont il n'y a pas un négociant qui ne sente l'importance décisive, je combats une erreur qui n'existe que dans mon imagination. Mais je trouve cette opinion reproduite dans le dernier de M. Ricardo, sous le point de vue qui prête le plus à la critique; et M. Say n'a point combattu dans ses notes une opinion qui ne s'éloigne pas des siennes, qui même, jusqu'à un certain point, peut aussi être attribuée à Adam Smith. " Source : Jean Sismondi, " Nouveaux Principes d'économie politique " 1819, extrait du chapitre 6.
L'originalité de l'analyse vient de l'accent mis sur lde décalage temporel, qui existe entre la perception d'un revenu et sa dépense, ouvrant la voie à une approche proprement dynamique des fluctiations économiques. Sismondi pose que les revenus perçus au cours d'une année t sont dépensés au cours de l'année suivante t ° 1. Soit en appelant Y le revneu et D la demande : Y t = D t + 1. Dans une économie en croissance, par définition, la production Q augmente d'une période à l'autre : Q t < Q t + 1 Mais comme le renu n'est que la contrepartie de la production Q, il apparâit un écart, à chaque période, entre la production et la demande permettant d'écouler la production : D t + 1 + 1 < Q t + 1 Cet écart ne présente pas de caractère de gravité quand il reste modéré et régulièrement distribué à l'intérieur du système économique. Mais en cas d'augmentation brutale, le gonflement généralisé des stocks d'invendus qui en résulte est susceptible de plonger l'économie dans la crise, que Sismondi interprète, de la même façon que Malthus, comme le résultat d'un " engorgement général " des marchés. Face au problème que constitue le retour périodique des crises, Malthus et Sismondi proposent des remède squi ne se recoupent pas totalement, tnat sont différentes leurs opinion politiques : si Malthus défend une conception plutôt réactionnaire de l'organisation sociale, la critique de la misère ouvrière qu'effectue Sismondi le pousse vers un réformisme qu'on pourrait qualifier vaguement aujourd'hui de social démocrate.
Quelques auteurs de beaucoup de mérite ont pensé que, quoiqu'il puisse y avoir aisément un engorgement partiel de certains produits, il est impossible qu'il y ait un engorgement partiel de certains produits, il est impossible qu'il y ait un engorgement de tous les produits en général; car d'après leur manière d'envisager le sujet, des produits s'échangeant contre d'autres produits, une moitié doit servir à acheter l'aure, et la production étant ainsi la seule soruce de la demande, la surabondance de l'approvisionnement d'un aerticle prouverait seulement qu'il y a défaut d'approvisionnement de quelque autre produit, la surabondance générale de tous les produits étant regardée comme impossible. M. Say, dans son bel ouvrage sur l'économie politique, a même poussé la chose si loin, qu'il assure que la consommation d'une denrée, en l'enlevant du marché, diminue la demande et que la production d'une denrée augmente la demande dans la même proportion. Cepepdant, cette doctrine, avec toute l'extension qu'on lui a donnée, me semble tout à fait fausse et en contradiction manifeste avec les grands principes qui règlent l'offre et la demande. Il n'est pas du tout vrai, dans les faits, que des produits soient toujours échangés contre d'autres produits. La plus grande partie des produits s'échange contre du travail productif ou des services personnels; et il est clair que cette masse de produits, comparée au travail contre lequel elle doit être échangée, peut baisser de valeur par l'effet de sa surabondance, précisément de la même manière qu'une seule denrée baisse de valeur par l'excès de l'approvisionnement, relativement au travail ou à la monnaie. " Source : Thomas Robert Malthus, " Principes d'économie politique ", 1820, Livre II, extrait du chapitre 1.
Son raisonnement part d'une situation d'équilibre hypothétique dans laquelle les capitalistes effectent leurs profits à des dépenses de consommation improductive; celle ci consiste en l'entretien de domestiques, considérés dans la tradition classique comme des travailleurs improductifs. A partir de cette situation, Malthus envisage ce qui se passerait si les mêmes capitalistes décidaient d'affecter leurs profits à l'épargne au lieu de la consommation. Cette épargne, explique t il, se traduirait par l'embauche de travailleurs productifs au lieu de domestiques. Il s'ensuivrai une augmentation du volume de la production, mais pas nécessairement une augmentation du volume des débouchés, dans la mesure où la demande des travailleurs productifs supplémentaires ne ferait que remplacer celle des travailleurs improductifs. De cet example Malthus tire la conclusion que contrairement à ce qu'affirme Say, l'offre ne crée pas sa propre demande, et il avance l'idée qu'une tendance excessive à l'épargne est susceptible d'entraîner un recul de l'activité économique. Cette analyse ouvre la possibilité d'interpréter les crises économiques récurrentes en termes d' " engorgement général " des marchés, résultat d'une insuffisance globale de débouchés. En l'état, son pouvoir de conviction reste cependant limité, car la théorie de l'intérêt formulée dès 1766 par Turgot ( supra, chapitre 3 ) fournit une parade toute prête aux partisans de la loi de Say : tout accroissement de la tendance à l'épargne doit, selon cette théorie, faire baisser le taux de l'intérêt jusqu'au point ou la hausse induite de l'investissement vient équilibrer le supplément d'épargne.
Comme Malthus, Sismondi rejette les lois des débouchés. Cet historien et économiste suisse, contemporain des classiques, né en 1773 et mort en 1842, adhère dans un premier temps à leurs idées puis s'en démarque dans un ouvrage publié en 1819 et portant le titre de " Nouveaux principes d'économie politique " qui constitue une vigoureuse critique du libéralisme économique, fondée sur le constat de la misère dans laquelle vit une large fraction de la population anglaise. " C'est le revenu de l'année passée qui doit payer la production de cette année; c'est une quantité prédéterminée qui sert de mesure à la quantité indéfinie du travail à venir. L'erreur de ceux qui excitent à une production illimitée vient de ce qu'ils ont confondu ce revenu passé avec le revenu futur. Ils ont dit qu'augmenter le travail, c'est augmenter la richesse, avec elle le revenu et en raison de ce dernier la consommation. Mais qu'on n'augmente les richesses qu'en augmentant le travail demandé, le travial qui sera payé à son prix; et ce prix, fixé d'avance, c'est le revenu préexistant. On ne fait jamais, après tout, qu'échanger la totalité de la production de l'année contre la totalité de la production de l'année précédente. Or, si la production croît graduellement, l'échange de chaque année doit causer une petite perte, en même temps qu'elle bonifie la condition future. Si cette perte est légère et bien répartie, chacun la supporte sans se plaindre sur son revenu; c'est en cela même que consiste l'économie nationale, et la série de ces petits sacrifices augmente le capital et la fortune publique. Mais, s'il y a une grande disproportion entre la production nouvelle et l'antécédente, les capitaux sont entamés, il y a souffrance, et la nation recule au lieu d'avancer....
Ainsi les nations courent des dangers qui semblent contradictoires. Elles peuvent se ruiner également en dépensant torp et en dépensant trop peu. Une nation dépense trop, toutes les fois qu'ell eexcède son revenu, car elle ne peut le faire qu'en entamant ses capitaux, et en diminuant ainsi sa production à venir. Elle fait alors ce que ferait un cultivateur solitaire, qui mangerait le blé qu'il devrait dréserver pour ses semailles. Elle dépense trop peu toutes les fois que, n'ayant pas de commerce étranger, elle ne consomme pas sa production, ou qu'en ayant un, elle ne consomme pas l'excédent de sa production sur son exportation : car alors elle se trouve bientôt dans le cas où se trouverait le cultivateur solidtaire, lorsque tous ses greniers seraient plein fort au delà toute possibilité de consommation, et que, pour ne pas faire un travail inutile, il serait obligé de renoncer à ensemencer ses terres... On pourrait croire que, lorsque j'accuse les économistes les plus célèbres d'avoir accordé trpo peu d'attention à la consommation, ou au début, dont il n'y a pas un négociant qui ne sente l'importance décisive, je combats une erreur qui n'existe que dans mon imagination. Mais je trouve cette opinion reproduite dans le dernier de M. Ricardo, sous le point de vue qui prête le plus à la critique; et M. Say n'a point combattu dans ses notes une opinion qui ne s'éloigne pas des siennes, qui même, jusqu'à un certain point, peut aussi être attribuée à Adam Smith. " Source : Jean Sismondi, " Nouveaux Principes d'économie politique " 1819, extrait du chapitre 6.
L'originalité de l'analyse vient de l'accent mis sur lde décalage temporel, qui existe entre la perception d'un revenu et sa dépense, ouvrant la voie à une approche proprement dynamique des fluctiations économiques. Sismondi pose que les revenus perçus au cours d'une année t sont dépensés au cours de l'année suivante t ° 1. Soit en appelant Y le revneu et D la demande : Y t = D t + 1. Dans une économie en croissance, par définition, la production Q augmente d'une période à l'autre : Q t < Q t + 1 Mais comme le renu n'est que la contrepartie de la production Q, il apparâit un écart, à chaque période, entre la production et la demande permettant d'écouler la production : D t + 1 + 1 < Q t + 1 Cet écart ne présente pas de caractère de gravité quand il reste modéré et régulièrement distribué à l'intérieur du système économique. Mais en cas d'augmentation brutale, le gonflement généralisé des stocks d'invendus qui en résulte est susceptible de plonger l'économie dans la crise, que Sismondi interprète, de la même façon que Malthus, comme le résultat d'un " engorgement général " des marchés. Face au problème que constitue le retour périodique des crises, Malthus et Sismondi proposent des remède squi ne se recoupent pas totalement, tnat sont différentes leurs opinion politiques : si Malthus défend une conception plutôt réactionnaire de l'organisation sociale, la critique de la misère ouvrière qu'effectue Sismondi le pousse vers un réformisme qu'on pourrait qualifier vaguement aujourd'hui de social démocrate.
il y a 9 mois
Les 2 auteurs voient dans le commerce extérieur un palliatif au problème des débouchés. Mais Malthus est surtout connu pour son éloge de la consommation improductive des propriétaires fonciers. Sismondi préconise quant à lui une législation obligeant les employeurs à garantir l'emploi aux salariés qu'ils embauchent, ce qui aurait entre autres le mérite de soutenir la demande en cas de crise. Afin que la sécurité pour les ouvriers résultat de cette garantie d'emploi n'entraîne pas une trop forte croissance démographique, il envisage également de donner le droit aux employeurs d'interdire les mariages... Les critiques adressées par Malthus et Sismondi à la loi des débouchés ne sont pourtant pas décisives. En effet, elles ne s'attaquent pas directement à l'hypothèse essentiellesur laquelle repose cette loi, qui est l'affirmation selon laquelle la monanie, simple intermédiaire des échanges, n'est pas recherchée pour elle même : dans un monde hypothétique où les agents ne manifestent aucune " préférence pour la liquidité ", cette loi des débouchés semble difficile à contester. Toute la question est de savoir si un tel monde présente quelque rapport avec le nôtre, et il faudra attendre Keynes pour voir cette question véritablement posée. " Dans l'économie ricardienne, qui est à la base de tout ce qui a été enseigné depuis plus d'un siècle, l'idée qu'on a le droit de négliger la fonction de la demande globale est fondamentale.
A vrai dire, la thèsse de Ricardo que la demande effective ne peut être insuffisante avait été vivement combattue par Malthus, mais sans succès. Car faute d'expliquer ( si ce n'est par les faits d'observation courante à comment et pourquoi la demande effective pouvait être insuffisante, Mallthus n'est pas parvenu à fournir une thèse capable de remplacer celle qu'il attaquait; et Ricardo conquit l'Angleterre aussi complètement que la Saint Inquisition avait conquis l'Espagne. Non seulement sa théorie fut accepte par la cité, les hommes d'Etat et l'université, mais toute controverse s'arrêta; l'autre conception tombe dans l'oubli le plus complet et cessa même d'être discutée. La grande énigme de la demande effective, à laquelle Malthus s'était attaqué, disparut de la littérature économique.... Une victoire aussi décisive que celle de Ricardo a quelque chose de singulier et de mystérieux. Elle ne peut s'expliquer que par un ensemble de sympathies entre sa doctrine et le milieu où elle a été lancée. Le fait qu'elle aboutissait à des conclusions tout à fait différentes de celles qu'attendait le public profane ajoutait, semble t il, à son prestige intellectuel. Que son enseignement, appliqué aux faits, fût austère et souvent désagréable lui conférait de la grandeur morale. Qu'elle fût apte à supporter une superstructure logique, vaste et cohérente, lui donnait de l'éclat. Qu'elle présentât beaucoup d'injustices sociales et de cruautés apparentes comme des incidents inévitables dans la marche du progrès, et les efforts destinés à modifier cet état de choses comme de nature à faire en définitive plus de mal que de bien, la recommandait à l'autorité. Qu'elle fournît certaines justifications aux libres activités du capitalisme individuel, lui valait l'appui des forces sociales dominantes groupées derrière l'autorité. " Source : John Maynard Keynes, " THéorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ", Livre I, extrait de la section III du chapitre 1.
A vrai dire, la thèsse de Ricardo que la demande effective ne peut être insuffisante avait été vivement combattue par Malthus, mais sans succès. Car faute d'expliquer ( si ce n'est par les faits d'observation courante à comment et pourquoi la demande effective pouvait être insuffisante, Mallthus n'est pas parvenu à fournir une thèse capable de remplacer celle qu'il attaquait; et Ricardo conquit l'Angleterre aussi complètement que la Saint Inquisition avait conquis l'Espagne. Non seulement sa théorie fut accepte par la cité, les hommes d'Etat et l'université, mais toute controverse s'arrêta; l'autre conception tombe dans l'oubli le plus complet et cessa même d'être discutée. La grande énigme de la demande effective, à laquelle Malthus s'était attaqué, disparut de la littérature économique.... Une victoire aussi décisive que celle de Ricardo a quelque chose de singulier et de mystérieux. Elle ne peut s'expliquer que par un ensemble de sympathies entre sa doctrine et le milieu où elle a été lancée. Le fait qu'elle aboutissait à des conclusions tout à fait différentes de celles qu'attendait le public profane ajoutait, semble t il, à son prestige intellectuel. Que son enseignement, appliqué aux faits, fût austère et souvent désagréable lui conférait de la grandeur morale. Qu'elle fût apte à supporter une superstructure logique, vaste et cohérente, lui donnait de l'éclat. Qu'elle présentât beaucoup d'injustices sociales et de cruautés apparentes comme des incidents inévitables dans la marche du progrès, et les efforts destinés à modifier cet état de choses comme de nature à faire en définitive plus de mal que de bien, la recommandait à l'autorité. Qu'elle fournît certaines justifications aux libres activités du capitalisme individuel, lui valait l'appui des forces sociales dominantes groupées derrière l'autorité. " Source : John Maynard Keynes, " THéorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ", Livre I, extrait de la section III du chapitre 1.
il y a 9 mois
WOW PUTAIN LES PAVES DE GIGA TARAX PSYCHOPATHE !!!

C'est ça qui est bon putain !
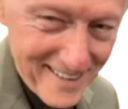
J'ai fav et le degusterais tranquillement petit à petit. Parce que j'ai des prioprités IRL.
C'est ça qui est bon putain !
J'ai fav et le degusterais tranquillement petit à petit. Parce que j'ai des prioprités IRL.
il y a 9 mois
J'ai fais un resumer chat gpt du pavé du malade d'en haut
1. Économie classique : une notion aux définitions multiples
Adam Smith introduit la critique du système mercantile, valorisant la liberté économique, la division du travail et la "main invisible".
Karl Marx utilise le terme d'économie classique pour désigner les penseurs (de Petty à Ricardo) qui cherchent à analyser scientifiquement le capitalisme via la valeur-travail, en opposition à l’économie vulgaire qui naturalise l’ordre bourgeois.
Keynes, quant à lui, élargit la définition à Ricardo et ses successeurs, y compris les néoclassiques, car tous adhèrent à la loi des débouchés de Say (l’offre crée sa propre demande).
2. Différences entre Marx et Keynes
Pour Marx, l’essentiel est l’analyse des rapports sociaux fondés sur la valeur-travail.
Pour Keynes, l’enjeu est l’insuffisance de la demande globale, surtout face au chômage massif des années 1930.
3. Révolution industrielle et croissance au XIXe siècle
Rostow parle de décollage économique (hausse de l’investissement > 10%).
Cette croissance s’accompagne de conditions de travail très dures, de l’urbanisation rapide, et d’un travail ouvrier déqualifié, souvent effectué par femmes et enfants.
Les législations sociales sont rares et mal appliquées avant 1860.
4. Rôle de l’État et critiques
Smith prône un État minimal, mais reconnaît un rôle pour les biens collectifs (éducation, infrastructures).
Il critique aussi le pouvoir des employeurs face aux ouvriers, contrairement à l’image caricaturale du "libéral insensible".
5. Accumulation et loi des débouchés
Pour les classiques, l’épargne des capitalistes finance l’accumulation du capital, moteur de la croissance.
Say affirme que la production crée sa propre demande, donc pas de crise de surproduction globale possible — seulement des désajustements sectoriels.
Cette vision est reprise par Ricardo, puis par les néoclassiques.
Keynes rejette cette loi : l’insuffisance de la demande globale peut bel et bien provoquer des crises prolongées.
6. Limites et critiques du modèle classique
Les classiques veulent fonder l’économie comme science naturelle, à la manière de Newton ou Lavoisier.
Mais Mill et l’école historique allemande soulignent que les lois économiques ne sont pas universelles : elles dépendent de conventions sociales et du contexte historique.
1. Économie classique : une notion aux définitions multiples
Adam Smith introduit la critique du système mercantile, valorisant la liberté économique, la division du travail et la "main invisible".
Karl Marx utilise le terme d'économie classique pour désigner les penseurs (de Petty à Ricardo) qui cherchent à analyser scientifiquement le capitalisme via la valeur-travail, en opposition à l’économie vulgaire qui naturalise l’ordre bourgeois.
Keynes, quant à lui, élargit la définition à Ricardo et ses successeurs, y compris les néoclassiques, car tous adhèrent à la loi des débouchés de Say (l’offre crée sa propre demande).
2. Différences entre Marx et Keynes
Pour Marx, l’essentiel est l’analyse des rapports sociaux fondés sur la valeur-travail.
Pour Keynes, l’enjeu est l’insuffisance de la demande globale, surtout face au chômage massif des années 1930.
3. Révolution industrielle et croissance au XIXe siècle
Rostow parle de décollage économique (hausse de l’investissement > 10%).
Cette croissance s’accompagne de conditions de travail très dures, de l’urbanisation rapide, et d’un travail ouvrier déqualifié, souvent effectué par femmes et enfants.
Les législations sociales sont rares et mal appliquées avant 1860.
4. Rôle de l’État et critiques
Smith prône un État minimal, mais reconnaît un rôle pour les biens collectifs (éducation, infrastructures).
Il critique aussi le pouvoir des employeurs face aux ouvriers, contrairement à l’image caricaturale du "libéral insensible".
5. Accumulation et loi des débouchés
Pour les classiques, l’épargne des capitalistes finance l’accumulation du capital, moteur de la croissance.
Say affirme que la production crée sa propre demande, donc pas de crise de surproduction globale possible — seulement des désajustements sectoriels.
Cette vision est reprise par Ricardo, puis par les néoclassiques.
Keynes rejette cette loi : l’insuffisance de la demande globale peut bel et bien provoquer des crises prolongées.
6. Limites et critiques du modèle classique
Les classiques veulent fonder l’économie comme science naturelle, à la manière de Newton ou Lavoisier.
Mais Mill et l’école historique allemande soulignent que les lois économiques ne sont pas universelles : elles dépendent de conventions sociales et du contexte historique.
Clique sur le meilleur topic du monde https://onche.org/topic/1[...]ete-forum#message_1972156
il y a 9 mois
DTP
9 mois
C'est beau la théorie.

bah ça se serait avéré 100% juste si on ne prend pas en compte le boom démographique du 19eme siècle

forcement si t'as 5 ouvriers pour 1 post c'est plus rentable de les faire bosser jusqu’à épuisement

forcement si t'as 5 ouvriers pour 1 post c'est plus rentable de les faire bosser jusqu’à épuisement
il y a 9 mois
bah ça se serait avéré 100% juste si on ne prend pas en compte le boom démographique du 19eme siècle

forcement si t'as 5 ouvriers pour 1 post c'est plus rentable de les faire bosser jusqu’à épuisement

forcement si t'as 5 ouvriers pour 1 post c'est plus rentable de les faire bosser jusqu’à épuisement
Ça ne fonctionne jamais leurs délires abstraits, un peu comme lorsqu'on essaye de prévoir la météo au-delà d'une semaine.

https://bfmtv.me Juif qui parle, bouche qui ment.
il y a 9 mois
Ça ne fonctionne jamais leurs délires abstraits, un peu comme lorsqu'on essaye de prévoir la météo au-delà d'une semaine.

la france des années 60

il y a 9 mois