Ce sujet a été résolu
Lui explique mieux . Bref regarder sa vidéo . Il explique juste l'exemple de l'action 'Tesla' ( sur côté et ça ne vaut pas son prix ). NVIDIA etc... Idem. ... Trump ce fou , peut se tirer une bal dans le pied si il sanctionne trop la Chine :
Protège ton fric de la Dette: https://www.degiro.fr/par[...]079529&utm_source=mgm
il y a un an
Sondage – 5 votes
Chong oui je pense Trump va devoir retirer sanctions sur la chine sinon krach boursier et krach du $
Chong , Trump est con , il va se crasher tout seul
Apple a décidé d'introduire l'IA chinoise de 'ali baba ' dans ses futurs iPhones . Car voilà , Apple sait que la chine est en avance dans l'IA . Trump est fou . Il va tuer ses entreprises. Et je parle même pas de tout les composants chinois dans une tesla. Elon Musk est fou aussi.
Protège ton fric de la Dette: https://www.degiro.fr/par[...]079529&utm_source=mgm
il y a un an
Chong2LaGalere
1 an
Apple a décidé d'introduire l'IA chinoise de 'ali baba ' dans ses futurs iPhones . Car voilà , Apple sait que la chine est en avance dans l'IA . Trump est fou . Il va tuer ses entreprises. Et je parle même pas de tout les composants chinois dans une tesla. Elon Musk est fou aussi.
Apple n'avait pas le choix en fait
il y a un an
il y a un an
Tesla ne peux pas se passer de la chine car les USA n’ont pas les technologies pour faire des voitures électriques compétitives, il est obligé d’acheter le matos en Chine

D’ailleurs les droits de douane qu’ils ont annoncé sur la Chine sont très inférieurs à ceux qu’ils ont mis sur les autres pays

D’ailleurs les droits de douane qu’ils ont annoncé sur la Chine sont très inférieurs à ceux qu’ils ont mis sur les autres pays
il y a un an
Chong2LaGalere
1 an
Lui explique mieux . Bref regarder sa vidéo . Il explique juste l'exemple de l'action 'Tesla' ( sur côté et ça ne vaut pas son prix ). NVIDIA etc... Idem. ... Trump ce fou , peut se tirer une bal dans le pied si il sanctionne trop la Chine :
Chong c'est vachement impressionnant. Les chinois comme les russes sont en avance sur nous. Et le pire c'est qu'on les traites comme des paria
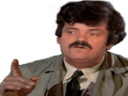
il y a un an
Apple n'avait pas le choix en fait
Tu peux développer
Comment interdire Huawei et autorisé un truc potentiellement 10x plus dangereux
Comment interdire Huawei et autorisé un truc potentiellement 10x plus dangereux
il y a un an
Nous l'Europe , on est hors sol , je pense il va nous mettre 25 % de droit douane + forcer l'Europe a reconstruire l'Ukraine ... Bref l'Europe auront dans le cul.
Protège ton fric de la Dette: https://www.degiro.fr/par[...]079529&utm_source=mgm
il y a un an
Chong c'est vachement impressionnant. Les chinois comme les russes sont en avance sur nous. Et le pire c'est qu'on les traites comme des paria
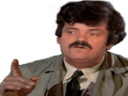
Les russes ont juste les moteurs d’avion/fusee et l’armement ou ils sont bons et aucun domaine où ils sont avec une grosse avance. On a surtout besoin des russes pour leur ressources naturelles.
La Chine par contre est en avance dans de plus en plus de domaines et va vraiment finir par nous dominer technologiquement sur tout les plans si on se sort pas les doigts du cul

La Chine par contre est en avance dans de plus en plus de domaines et va vraiment finir par nous dominer technologiquement sur tout les plans si on se sort pas les doigts du cul
il y a un an
Tu peux développer
Comment interdire Huawei et autorisé un truc potentiellement 10x plus dangereux
Comment interdire Huawei et autorisé un truc potentiellement 10x plus dangereux
Parce que Huawei n’était pas dangereux, ils ont démonté et analysé tout les équipements Hussein dans tout les sens et jamais rien trouvé , ils l’ont interdit car ils mettaient Apple en PLS + refusaient d’installer des backdoor pour les services US

il y a un an
Parce que Huawei n’était pas dangereux, ils ont démonté et analysé tout les équipements Hussein dans tout les sens et jamais rien trouvé , ils l’ont interdit car ils mettaient Apple en PLS + refusaient d’installer des backdoor pour les services US

Non je parlais de l ia
il y a un an
Les russes ont juste les moteurs d’avion/fusee et l’armement ou ils sont bons et aucun domaine où ils sont avec une grosse avance. On a surtout besoin des russes pour leur ressources naturelles.
La Chine par contre est en avance dans de plus en plus de domaines et va vraiment finir par nous dominer technologiquement sur tout les plans si on se sort pas les doigts du cul

La Chine par contre est en avance dans de plus en plus de domaines et va vraiment finir par nous dominer technologiquement sur tout les plans si on se sort pas les doigts du cul
Ca va être impossible pour l'Europe de rattraper la Chine... Ils sont dans le futur ..
Voici leurs futurs robots soldats tout terrain...
Imaginez ce truc avec une IA a reconnaissance faciale de l'ennemi et équipé d'un fusil d'assaut que son dos .. Nous sommes finito !
Et la robot de elon musk :
Protège ton fric de la Dette: https://www.degiro.fr/par[...]079529&utm_source=mgm
il y a un an
LE KRACH ASIATIQUE
La Thailande avait participé activement au miracle asiatique. C'est traditionnellement un pays exportateur de produits agricoles en particulier. Elle a commencé à devenir un pôle industriel important à partir des années 1980 soit lorsque les entreprises étrangères avant tout japonaises, implantées des usines dans le pays. Quand l'économie du pays a vraiment décollé, ce fut impressionnant avec des paysans affluant dans les villes pour trouver un bon emploi, les bons résultats que le première vague d'investisseurs étrangers a rencontré. Ce qui a encouragé d'autres investisseurs à venir. La Thailande a connu une croissance de 8% par an minimum. Puis les célèbres temples de Bangkok se retrouvèrent à l'ombre des tours de bureaux et d'habitation. Comme ses voisins, la Thailande devint un espace en développement où des millions de gens ordinaires commencèrent à sortir d'une pauvreté sans issue pour accéder aux prémices d'une vie décent et où certains même étaient en train de devenir très riches. Jusqu'au début des années 1990, la plupart des investissements ayant permis cette croissance provenaient de l'épargne des Thailandais eux mêmes : les capitaux étrangers servirent à construire les grandes usines tournées vers l'exportation, mais les petites entreprises étaient financées par les hommes d'affaires locaux, sur leurs propres fonds. Et les nouveaux quartiers de bureaux et d'habitation furent eux financés par les dépôts bancaires des ménages. En 1991, la dette extérieure de la Thailande était légèrement inférieure à ses exportations annuelles, ce qui sans être insignifiant, restait malgré tout dans les limites de sécurité habituelles. Je rappelle qu'à ce moment là, la dette de l'Amérique latine représentait presque 3 fois les exportations du sous continent.
Cependant, au long des années 1990, l'autosuffisance financière de la Thailande commença à s'éroder. L'initiative de ce processus vint de l'extérieur, essentiellement. Le dénouement de la crise de la dette d'Amérique latine redonna à l'investissement dans le tiers monde toute sa respectabilité. En diminuant la menace perçue d'un renversement du pouvoir, la chute du communisme rendit l'investissement hors du monde occidental moins risqué qu'auparavant. Au début des années 1990, les taux d'intérêt dans les pays développés étaient exceptionnellement bas en raison des efforts consentis par les Banques centrales pour sortir leurs économies d'une légère récession, et de nombreux investisseurs allèrent à l'étranger à la recherche de profits plus élevés. Le plus déterminant vint peut être des fonds d'investissements, qui forgèrent une nouvelle appellation pour ce qu'il était convenu d'appeler, auparavant, pays du tiers monde ou en développement : rebaptisés marchés émergents, ils devinrent le nouveau front pionner des bonnes affaires financières. Les investisseurs répondirent en masse. En 1990, les flux de capitaux privés à destination des pays en développement étaient de 42 milliards de dollars et des institutions officielles comme le FMI ou la Banque mondiale finançaient davantage d'investissements dans le tiers monde que tous les investisseurs privés réunis. Mais en 1997, alors que l'apport d'argent en provenance de ces institutions s'était ralenti, l'afflux de capitaux étrangers dans les pays en développement avait quintuplé pour atteindre 256 milliards de dollars. Dans un premier temps, ces fonds se dirigèrent vers l'Amérique latine, et plus particulièrement vers le Mexique, mais après 1994, ils prirent davantage la direction des économiques apparemment plus sûres de l'Asie du Sud Est.
Comment l'argent allait il concrètement de Tokyo ou de Francfort à Bangkok ou à Jakarta? Que devenait il une fois arrivé? Il faut prendre l'exemple d'une transaction classique : une banque japonaise accorde un prêt à une société financière thaie, une institution dont la principale activité est de servir de courroie de transmission pour les fonds étrangers. La société financière se retrouve alors en possession de yens qu'elle va prêter à un promoteur immobilier local à un taux d'intérêt plus élevé que celui qui lui fut consenti. Or, le promoteur veut emprunter des bahts et non pas des yens, puisqu'il doit acheter un terrain et payer ses employés en monnaie locale. La société financière change donc ses yens en bahts sur le marché des changes. Or, le marché des changes, à l'instar des autres marchés, est régi par la loi de l'offre et de la demande : une augmentation de la demande d'un bien donné en fait habituellement grimper le prix. Ce qui veut dire que la demande de bahts faite par la société financière aura tendance à faire monter le cours du baht par rapport aux autres monnaies. Il se trouve que la Banque centrale s'était engagée à maintenir un taux de change stable entre le baht et le dollar américain durant les années du boom. Pour ce faire, elle avait dû compenser toute augmentation de la demande en bahts par une augmentation de l'offre équivalente, en vendant des bahts et en acheminant des devises étrangères comme le dollar ou le yen. Ainsi, le résultat indirect de ce prêt initial en yens dut être tout à la fois une augmentation des réserves en devises de la Banque de Thailande et de l'offre de bahts.Il y eut sans doute aussi une augmentation du crédit dans l'économie, non seulement le crédit correspondant directement au prêt accordé par la société financière, mais aussi un crédit additionnel consenti par les banques dans lesquelles les bahts nouvellement émis étaient déposés.
Comme la majeure partie de l'argent prêté retourne dans les banques sous forme de nouveaux dépôts, cela sert généralement à financer de nouveaux prêts, et ainsi de suite, selon le principe du multiplicateur monétaire enseigné en premier cycle d'économie.
Au fur et à mesure de l'arrivée en masse de prêts accordés par l'étranger, on assista à une explosion du crédit qui alimenta une vague de nouveaux investissements. Certains se matérialisèrent par de vrais constructions, des immeubles, des bureaux et de logements pour l'essentiel, mais ils alimentèrent aussi de façon conséquente la pure spéculation immobilière et financière. Au début de l'année 1996, les pays d'Asie du Sud Est commençaient à montrer un certain air de famille avec l'économie de bulle du Japon de la fin des années 1980.
Pourquoi les autorités monétaires n'avaient elles pas mis de frein au boom spéculatif? En fait, elles avaient essayé mais elles avaient échoué. Dans toutes les économies d'Asie, les Banques centrales ont tenté de stériliser l'afflux de capitaux : obligée de vendre des bahts sur le marché des changes, la Banque de Thailande cherchait à racheter ces bahts par ailleurs en vendant des bons, ce qui revenait à emprunter l'argent qu'elle venait d'émettre. Mais cet emprunt fit grimper les taux d'intérêt locaux, rendant encore plus attractifs les emprunts à l'étranger et attirant encore davantage de yens et de dollars. L'effort de stérilisation a donc échoué : le crédit avait simplement continué de croître. Le seul moyen qu'aurait pu employer la Banque centrale pour empêcher la masse monétaire et le crédit de gonfler exagérément aurait été d'abandonner le système de taux de change fixe et de laisser simplement le baht monter. Et c'est ce que maintenant les exports du" je vous l'avais bien dit " disent que les Thailandais auraient du faire. Mais à l'époque, cela semblait être une mauvaise idée. Un baht plus fort aurait rendu les exportations thais moins compétitives sur les marchés mondiaux étant donné que les salaires et les coûts en dollars auraient été plus élevés. Et en général, les Thailandais pensaient qu'un taux de change stable favorisait la confiance dans les affaires, qu'ils étaient un trop petit pays pour supporter un taux de change très fluctuant comme celui des Etats Unis pouvaient se permettre. Et le boom a donc pu se poursuivre.
Finalement, comme vous le dirait un manuel d'économie, l'expansion de la monnaie et du crédit est auto limitative. L'essor de l'investissement conjugué avec une vague de dépenses faites par des consommateurs qui venaient de s'enrichir conduisit à une explosion des importations. L'économie en plein essor fit monter les salaires, rendant les exportations thailandaises moins compétitives, d'autant plus que la Chine, un important concurrent de la Thailande, avait dévalué sa monnaie en 1994. Et surtout, l'économie en plein essor rendit la hausse des exportations ralentit. Il s'ensuivit un énorme déficit commercial. Au lieu d'alimenter la monnaie et le crédit intérieurs, ces prêts en devises commencèrent à être utilisés pour payer les importations.
Pourquoi pas? Certains économistes ont affirmé tout comme avant eux les supporters inconditionnels du Mexique au début des années 1990, que les déficits extérieurs de la Thailande, de la Malaisie et de l'Indonésie reflétaient non pas une faiblesse économique mais plutôt la force de marchés fonctionnant tout à fait comme il fallait. Il nous faut répéter l'argument : en comptabilité, un pays attirant des flux nets de capitaux doit réaliser un déficit d'un montant égal sur sa balance courant. Donc, si l'on pense que l'afflux de capitaux en Asie du Sud Est était justifié, les déficits commerciaux l'étaient aussi. Et pourquoi n'était ce pas raisonnable à l'échelle mondiale, d'investir beaucoup de capitaux en Asie du Sud Est, vu le record de croissance enregistré et la stabilité économique dans la région? Après tout, il ne s'agissait pas de gouvernements qui faisaient de folles dépenses. La Malaisie et l'Indonésie avaient nombre de projets publics grandioses, mais ils allaient être financés sur les recettes courantes et les budgets se trouvaient plus ou moins en équilibre. Ces déficits commerciaux résultaient donc de décisions prises dans le secteur privé. Pourquoi ces décisions auraient elles eu d'autres explications?
La Thailande avait participé activement au miracle asiatique. C'est traditionnellement un pays exportateur de produits agricoles en particulier. Elle a commencé à devenir un pôle industriel important à partir des années 1980 soit lorsque les entreprises étrangères avant tout japonaises, implantées des usines dans le pays. Quand l'économie du pays a vraiment décollé, ce fut impressionnant avec des paysans affluant dans les villes pour trouver un bon emploi, les bons résultats que le première vague d'investisseurs étrangers a rencontré. Ce qui a encouragé d'autres investisseurs à venir. La Thailande a connu une croissance de 8% par an minimum. Puis les célèbres temples de Bangkok se retrouvèrent à l'ombre des tours de bureaux et d'habitation. Comme ses voisins, la Thailande devint un espace en développement où des millions de gens ordinaires commencèrent à sortir d'une pauvreté sans issue pour accéder aux prémices d'une vie décent et où certains même étaient en train de devenir très riches. Jusqu'au début des années 1990, la plupart des investissements ayant permis cette croissance provenaient de l'épargne des Thailandais eux mêmes : les capitaux étrangers servirent à construire les grandes usines tournées vers l'exportation, mais les petites entreprises étaient financées par les hommes d'affaires locaux, sur leurs propres fonds. Et les nouveaux quartiers de bureaux et d'habitation furent eux financés par les dépôts bancaires des ménages. En 1991, la dette extérieure de la Thailande était légèrement inférieure à ses exportations annuelles, ce qui sans être insignifiant, restait malgré tout dans les limites de sécurité habituelles. Je rappelle qu'à ce moment là, la dette de l'Amérique latine représentait presque 3 fois les exportations du sous continent.
Cependant, au long des années 1990, l'autosuffisance financière de la Thailande commença à s'éroder. L'initiative de ce processus vint de l'extérieur, essentiellement. Le dénouement de la crise de la dette d'Amérique latine redonna à l'investissement dans le tiers monde toute sa respectabilité. En diminuant la menace perçue d'un renversement du pouvoir, la chute du communisme rendit l'investissement hors du monde occidental moins risqué qu'auparavant. Au début des années 1990, les taux d'intérêt dans les pays développés étaient exceptionnellement bas en raison des efforts consentis par les Banques centrales pour sortir leurs économies d'une légère récession, et de nombreux investisseurs allèrent à l'étranger à la recherche de profits plus élevés. Le plus déterminant vint peut être des fonds d'investissements, qui forgèrent une nouvelle appellation pour ce qu'il était convenu d'appeler, auparavant, pays du tiers monde ou en développement : rebaptisés marchés émergents, ils devinrent le nouveau front pionner des bonnes affaires financières. Les investisseurs répondirent en masse. En 1990, les flux de capitaux privés à destination des pays en développement étaient de 42 milliards de dollars et des institutions officielles comme le FMI ou la Banque mondiale finançaient davantage d'investissements dans le tiers monde que tous les investisseurs privés réunis. Mais en 1997, alors que l'apport d'argent en provenance de ces institutions s'était ralenti, l'afflux de capitaux étrangers dans les pays en développement avait quintuplé pour atteindre 256 milliards de dollars. Dans un premier temps, ces fonds se dirigèrent vers l'Amérique latine, et plus particulièrement vers le Mexique, mais après 1994, ils prirent davantage la direction des économiques apparemment plus sûres de l'Asie du Sud Est.
Comment l'argent allait il concrètement de Tokyo ou de Francfort à Bangkok ou à Jakarta? Que devenait il une fois arrivé? Il faut prendre l'exemple d'une transaction classique : une banque japonaise accorde un prêt à une société financière thaie, une institution dont la principale activité est de servir de courroie de transmission pour les fonds étrangers. La société financière se retrouve alors en possession de yens qu'elle va prêter à un promoteur immobilier local à un taux d'intérêt plus élevé que celui qui lui fut consenti. Or, le promoteur veut emprunter des bahts et non pas des yens, puisqu'il doit acheter un terrain et payer ses employés en monnaie locale. La société financière change donc ses yens en bahts sur le marché des changes. Or, le marché des changes, à l'instar des autres marchés, est régi par la loi de l'offre et de la demande : une augmentation de la demande d'un bien donné en fait habituellement grimper le prix. Ce qui veut dire que la demande de bahts faite par la société financière aura tendance à faire monter le cours du baht par rapport aux autres monnaies. Il se trouve que la Banque centrale s'était engagée à maintenir un taux de change stable entre le baht et le dollar américain durant les années du boom. Pour ce faire, elle avait dû compenser toute augmentation de la demande en bahts par une augmentation de l'offre équivalente, en vendant des bahts et en acheminant des devises étrangères comme le dollar ou le yen. Ainsi, le résultat indirect de ce prêt initial en yens dut être tout à la fois une augmentation des réserves en devises de la Banque de Thailande et de l'offre de bahts.Il y eut sans doute aussi une augmentation du crédit dans l'économie, non seulement le crédit correspondant directement au prêt accordé par la société financière, mais aussi un crédit additionnel consenti par les banques dans lesquelles les bahts nouvellement émis étaient déposés.
Comme la majeure partie de l'argent prêté retourne dans les banques sous forme de nouveaux dépôts, cela sert généralement à financer de nouveaux prêts, et ainsi de suite, selon le principe du multiplicateur monétaire enseigné en premier cycle d'économie.
Au fur et à mesure de l'arrivée en masse de prêts accordés par l'étranger, on assista à une explosion du crédit qui alimenta une vague de nouveaux investissements. Certains se matérialisèrent par de vrais constructions, des immeubles, des bureaux et de logements pour l'essentiel, mais ils alimentèrent aussi de façon conséquente la pure spéculation immobilière et financière. Au début de l'année 1996, les pays d'Asie du Sud Est commençaient à montrer un certain air de famille avec l'économie de bulle du Japon de la fin des années 1980.
Pourquoi les autorités monétaires n'avaient elles pas mis de frein au boom spéculatif? En fait, elles avaient essayé mais elles avaient échoué. Dans toutes les économies d'Asie, les Banques centrales ont tenté de stériliser l'afflux de capitaux : obligée de vendre des bahts sur le marché des changes, la Banque de Thailande cherchait à racheter ces bahts par ailleurs en vendant des bons, ce qui revenait à emprunter l'argent qu'elle venait d'émettre. Mais cet emprunt fit grimper les taux d'intérêt locaux, rendant encore plus attractifs les emprunts à l'étranger et attirant encore davantage de yens et de dollars. L'effort de stérilisation a donc échoué : le crédit avait simplement continué de croître. Le seul moyen qu'aurait pu employer la Banque centrale pour empêcher la masse monétaire et le crédit de gonfler exagérément aurait été d'abandonner le système de taux de change fixe et de laisser simplement le baht monter. Et c'est ce que maintenant les exports du" je vous l'avais bien dit " disent que les Thailandais auraient du faire. Mais à l'époque, cela semblait être une mauvaise idée. Un baht plus fort aurait rendu les exportations thais moins compétitives sur les marchés mondiaux étant donné que les salaires et les coûts en dollars auraient été plus élevés. Et en général, les Thailandais pensaient qu'un taux de change stable favorisait la confiance dans les affaires, qu'ils étaient un trop petit pays pour supporter un taux de change très fluctuant comme celui des Etats Unis pouvaient se permettre. Et le boom a donc pu se poursuivre.
Finalement, comme vous le dirait un manuel d'économie, l'expansion de la monnaie et du crédit est auto limitative. L'essor de l'investissement conjugué avec une vague de dépenses faites par des consommateurs qui venaient de s'enrichir conduisit à une explosion des importations. L'économie en plein essor fit monter les salaires, rendant les exportations thailandaises moins compétitives, d'autant plus que la Chine, un important concurrent de la Thailande, avait dévalué sa monnaie en 1994. Et surtout, l'économie en plein essor rendit la hausse des exportations ralentit. Il s'ensuivit un énorme déficit commercial. Au lieu d'alimenter la monnaie et le crédit intérieurs, ces prêts en devises commencèrent à être utilisés pour payer les importations.
Pourquoi pas? Certains économistes ont affirmé tout comme avant eux les supporters inconditionnels du Mexique au début des années 1990, que les déficits extérieurs de la Thailande, de la Malaisie et de l'Indonésie reflétaient non pas une faiblesse économique mais plutôt la force de marchés fonctionnant tout à fait comme il fallait. Il nous faut répéter l'argument : en comptabilité, un pays attirant des flux nets de capitaux doit réaliser un déficit d'un montant égal sur sa balance courant. Donc, si l'on pense que l'afflux de capitaux en Asie du Sud Est était justifié, les déficits commerciaux l'étaient aussi. Et pourquoi n'était ce pas raisonnable à l'échelle mondiale, d'investir beaucoup de capitaux en Asie du Sud Est, vu le record de croissance enregistré et la stabilité économique dans la région? Après tout, il ne s'agissait pas de gouvernements qui faisaient de folles dépenses. La Malaisie et l'Indonésie avaient nombre de projets publics grandioses, mais ils allaient être financés sur les recettes courantes et les budgets se trouvaient plus ou moins en équilibre. Ces déficits commerciaux résultaient donc de décisions prises dans le secteur privé. Pourquoi ces décisions auraient elles eu d'autres explications?
il y a 3 mois
Des observateurs de plus en plus nombreux commencèrent à éprouver quelque inquiétude lorsqu'ils virent les déficits de la Thailande et de la Malaisie atteindre, 6, 7, 8% du PIB, des chiffres comparables à ceux du Mexique juste avant la crise tequila. L'expérience mexicaine convainquit certains qu'il ne fallait pas se fier aux flux de capitaux internationaux, même s'ils reflétaient les décisions non déformées du secteur privé. L'enthousiasme des investisseurs pour les perspectives de l'Asie présentait une ressemblance avec celui qu'ils avaient eu en Amérique latine quelques années auparavant. Et l'expérience mexicaine laissait aussi penser qu'un retournement dans la perception du marché, quand il se produisait, pouvait être brutal et difficile à maîtriser.
Le 2 juillet 1997.
Durant toute l'année 1996 et les 6 premiers mois de 1997, le mécanisme de crédit qui était à l'origine du boom de la Thailande se mit à fonctionner à l'envers. C'était en partie la conséquence d'événements extérieures : les marchés de certains produits d'exportation thailandais devinrent mois porteurs, une dépréciation du yen japonais rendit l'industrie du Sud Est asiatique moins compétitive. Mais pour l'essentiel, il s'agissait du problème de la banque du casino qui finit toujours, à long terme, par battre les joueurs : un nombre de plus en plus important d'investissements spéculatifs qui avaient été financés, directement ou indirectement, par des prêts bon marchés contractés à l'étranger tournèrent mal. Certains spéculateurs firent faillite et des sociétés financières mirent la clé sous la porte. Et les créanciers étrangers hésitèrent de plus en plus à accorder de nouveaux prêts. Dans une certaine mesure, la perte de confiance était un processus auto entretenu. Tant que les prix immobiliers et les marchés financiers étaient à la hausse, les investissements même discutables paraissent bons. Lorsque la bulle commença à se dégonfler, les pertes s'accumulèrent, la confiance se dégrade encore, entraînant une contraction plus drastique des nouveaux prêts. Dès avant la crise du 2 juillet, les prix fonciers et les titres boursiers avaient fortement baissé par rapport à leur niveau plafond. Le ralentissement des emprunts à l'étranger a posé également des problèmes à la Banque centrale. Avec des rentrées moindres en yens et en dollars, la demande en bahts sur le marché des changes baisse, tandis que la nécessité de changer des bahts en devises pour payer les importations demeurait inchangée.
Pour empêcher la baisse du baht, la Banque de Thailande devait faire le contraire de ce qu'elle avait fait lorsque les capitaux avaient commencé à affluer : elle intervint sur le marché pour échanger des dollars et des yens contre des bahts, soutenant ainsi sa propre monnaie. Mais il y a une grande différence entre essayer de maintenir votre monnaie faible et essayer de la maintenir forte : la Banque de Thailande peut accroître le volume de bahts comme elle l'entend, parce qu'elle n'a qu'à les émettre. En revanche, elle ne peut pas émettre des dollars. Il y avait donc une limite à sa capacité à soutenir la valeur du baht. Tôt ou tard, ses réserves seraient épuisées. La seule manière de soutenir la valeur de la monnaie aurait été de réduire la nombre de bahts en circulation : cela aurait fait monter les taux d'intérêts et rendu cette devise de nouveaux plus attrayante, pour emprunter en dollars et réinvestir en bahts. Mais cela posait des problèmes d'une autre nature. Puisque le boom des investissements retombait, l'économie thai avait ralenti, l'activité dans le secteur du bâtiment avait baissé, ce qui voulait dire moins d'emplois, donc u n revenu plus bas, mais aussi des licenciements dans tout le reste de l'économie. Ce n'était pas une récession à proprement parler, mais l'économie ne fonctionnait déjà plus comme à l'accoutumée. Relever les taux d'intérêt aurait conduit à décourager encore davantage les investissements et peut être à précipiter l'économie dans une véritable récession. L'autre solution consistait à laisser filer la monnaie, arrêter d'acheter des bahts et laisser le taux de change baisser.
Mais c'était aussi une réponse peu séduisante, non seulement parce qu'elle telle dévaluation de la monnaie aurait nui à la réputation du gouvernement, mais parce que trop de banques, de sociétés financières et d'autres entreprises thailandaises étaient déjà endettées en dollars. Si la valeur du dollar devait monter par rapport au baht, nombre d'entre elles se retrouveraient en situation d'insolvabilité. C"'est pourquoi le gouvernement thai hésita. Il ne voulait pas laisser le baht baisser. Et il ne voulait pas non plus pour l'économie nationale, adopter des mesures drastiques qui auraient permis d'enrayer la fonte des réserves. Il choisit donc l'attente, espérant, de toute évidence, qu'il se produise finalement quelque chose. Cela correspondait en tout point au scénario habituel : l'entrée en matière classique d'une crise monétaire, de celles que les économistes aiment modéliser, de celles que les spéculateurs aiment provoquer. Lorsqu'il apparut évident que le gouvernement n'avait aucune envie de briser l'économie nationale, il devint de plus en plus probable que rien ne serait fait pour empêcher le baht de perdre de la valeur. Or, dans la mesure où cela ne s'était pas encore produit, il était toujours temps de tirer davantage de l'événement à venir. Tant que le taux de change baht dollar semblait devoir rester stable, le fait que les taux d'intérêt en Thailande dépassaient de plusieurs points les taux des Etats Unis constituait une incitation à emprunter en dollars et à prêter des bahts. Mais dès qu'une dévaluation du baht s'avéra imminente, l'incitation fonctionna dans l'autre sens. C'est à dire emprunter en bahts, dans l'attente que la valeur en dollars de ces dettes se réduise rapidement, puis acquérir des dollars, es espérant que leur valeur en bahts augmente vite. Les hommes d'affaires locaux empruntaient en bahts et remboursaient leurs emprunts libellés en dollars.
Les Thailandais fortunés vendirent les titres qu'ils détenaient sur la dette publique et achetèrent des bons du Trésor américain. Enfin, et ce n'est pas le moins important, de grands fonds spéculatifs internationaux commencèrent à emprunter des bahts et à les convertir en dollars. Toutes ces transactions impliquaient la vente de bahts et l'achat d'autres monnaies, ce qui signifiait qu'elles exigeaient de la Banque centrale d'acheter davantage de bahts encore pour empêcher la monnaie de chuter, ce qui épuisa ses réserves en devises encore plus vite, confortant la conviction, si besoin était, que le baht allait être dévalué plus tôt que prévu. Une crise monétaire classique battait son plein. N'importe quel spécialiste de l'économie monétaire dira qu'une fois que les choses en sont arrivés là, le gouvernement doit agir sans hésiter, d'une manière ou d'une autre que ce soit en prenant un engagement clair pour défendre la monnaie coûte que coûte, soit en la laissant filer. Mes les gouvernements ont généralement des difficultés à prendre une décision, quelle qu'elle soit. Comme nombre de gouvernements dans le passé et sans doute de nombreux à venir, celui de la Thailande attendit pendant que ses réserves s'épuisaient.
Pour tenter de convaincre les marchés que sa position était plus forte qu'elle ne l'était en réalité, il fit en sorte que les réserves aient l'air plus importantes par des " swaps de devises " soudains ( en empruntant des dollars pour les rembourser plus tard ). Mais si la pression semblait parfois baissait, elle remontait toujours. Au début du mois de juillet, tout était perdu. Le 2 juillet, les Thailandais laissèrent le baht chuter. Jusqu'à ce moment là, rien de ce qui était arrivé n'était de nature à surprendre. L'épuisement des réserves de devises, l'attaque par la spéculation d'une monnaie dont la faiblesse était patente sortaient tout droit des manuels. Mais, en dépit de l'expérience récente de la crise tequila, la plupart des gens pensaient que la dévaluation du baht marquerait la fin d'une période : une humiliation pour le gouvernement, un choc désagréable peut être pour certaines entreprises qui se retrouvaient étranglées, mais rien de catastrophique. Assurément, la Thailande ne ressemblait pas au Mexique. Personne ne pouvait l'accuser d'avoir réalisé la stabilisation, la réforme sans la croissance. Il n'existait pas de Cardenas thai qui aurait attendu en coulisses pour appliquer un programme populiste. Et il n'y aurait donc pas de récession dévastatrices. Mais ce n'était pas le cas.
Le 2 juillet 1997.
Durant toute l'année 1996 et les 6 premiers mois de 1997, le mécanisme de crédit qui était à l'origine du boom de la Thailande se mit à fonctionner à l'envers. C'était en partie la conséquence d'événements extérieures : les marchés de certains produits d'exportation thailandais devinrent mois porteurs, une dépréciation du yen japonais rendit l'industrie du Sud Est asiatique moins compétitive. Mais pour l'essentiel, il s'agissait du problème de la banque du casino qui finit toujours, à long terme, par battre les joueurs : un nombre de plus en plus important d'investissements spéculatifs qui avaient été financés, directement ou indirectement, par des prêts bon marchés contractés à l'étranger tournèrent mal. Certains spéculateurs firent faillite et des sociétés financières mirent la clé sous la porte. Et les créanciers étrangers hésitèrent de plus en plus à accorder de nouveaux prêts. Dans une certaine mesure, la perte de confiance était un processus auto entretenu. Tant que les prix immobiliers et les marchés financiers étaient à la hausse, les investissements même discutables paraissent bons. Lorsque la bulle commença à se dégonfler, les pertes s'accumulèrent, la confiance se dégrade encore, entraînant une contraction plus drastique des nouveaux prêts. Dès avant la crise du 2 juillet, les prix fonciers et les titres boursiers avaient fortement baissé par rapport à leur niveau plafond. Le ralentissement des emprunts à l'étranger a posé également des problèmes à la Banque centrale. Avec des rentrées moindres en yens et en dollars, la demande en bahts sur le marché des changes baisse, tandis que la nécessité de changer des bahts en devises pour payer les importations demeurait inchangée.
Pour empêcher la baisse du baht, la Banque de Thailande devait faire le contraire de ce qu'elle avait fait lorsque les capitaux avaient commencé à affluer : elle intervint sur le marché pour échanger des dollars et des yens contre des bahts, soutenant ainsi sa propre monnaie. Mais il y a une grande différence entre essayer de maintenir votre monnaie faible et essayer de la maintenir forte : la Banque de Thailande peut accroître le volume de bahts comme elle l'entend, parce qu'elle n'a qu'à les émettre. En revanche, elle ne peut pas émettre des dollars. Il y avait donc une limite à sa capacité à soutenir la valeur du baht. Tôt ou tard, ses réserves seraient épuisées. La seule manière de soutenir la valeur de la monnaie aurait été de réduire la nombre de bahts en circulation : cela aurait fait monter les taux d'intérêts et rendu cette devise de nouveaux plus attrayante, pour emprunter en dollars et réinvestir en bahts. Mais cela posait des problèmes d'une autre nature. Puisque le boom des investissements retombait, l'économie thai avait ralenti, l'activité dans le secteur du bâtiment avait baissé, ce qui voulait dire moins d'emplois, donc u n revenu plus bas, mais aussi des licenciements dans tout le reste de l'économie. Ce n'était pas une récession à proprement parler, mais l'économie ne fonctionnait déjà plus comme à l'accoutumée. Relever les taux d'intérêt aurait conduit à décourager encore davantage les investissements et peut être à précipiter l'économie dans une véritable récession. L'autre solution consistait à laisser filer la monnaie, arrêter d'acheter des bahts et laisser le taux de change baisser.
Mais c'était aussi une réponse peu séduisante, non seulement parce qu'elle telle dévaluation de la monnaie aurait nui à la réputation du gouvernement, mais parce que trop de banques, de sociétés financières et d'autres entreprises thailandaises étaient déjà endettées en dollars. Si la valeur du dollar devait monter par rapport au baht, nombre d'entre elles se retrouveraient en situation d'insolvabilité. C"'est pourquoi le gouvernement thai hésita. Il ne voulait pas laisser le baht baisser. Et il ne voulait pas non plus pour l'économie nationale, adopter des mesures drastiques qui auraient permis d'enrayer la fonte des réserves. Il choisit donc l'attente, espérant, de toute évidence, qu'il se produise finalement quelque chose. Cela correspondait en tout point au scénario habituel : l'entrée en matière classique d'une crise monétaire, de celles que les économistes aiment modéliser, de celles que les spéculateurs aiment provoquer. Lorsqu'il apparut évident que le gouvernement n'avait aucune envie de briser l'économie nationale, il devint de plus en plus probable que rien ne serait fait pour empêcher le baht de perdre de la valeur. Or, dans la mesure où cela ne s'était pas encore produit, il était toujours temps de tirer davantage de l'événement à venir. Tant que le taux de change baht dollar semblait devoir rester stable, le fait que les taux d'intérêt en Thailande dépassaient de plusieurs points les taux des Etats Unis constituait une incitation à emprunter en dollars et à prêter des bahts. Mais dès qu'une dévaluation du baht s'avéra imminente, l'incitation fonctionna dans l'autre sens. C'est à dire emprunter en bahts, dans l'attente que la valeur en dollars de ces dettes se réduise rapidement, puis acquérir des dollars, es espérant que leur valeur en bahts augmente vite. Les hommes d'affaires locaux empruntaient en bahts et remboursaient leurs emprunts libellés en dollars.
Les Thailandais fortunés vendirent les titres qu'ils détenaient sur la dette publique et achetèrent des bons du Trésor américain. Enfin, et ce n'est pas le moins important, de grands fonds spéculatifs internationaux commencèrent à emprunter des bahts et à les convertir en dollars. Toutes ces transactions impliquaient la vente de bahts et l'achat d'autres monnaies, ce qui signifiait qu'elles exigeaient de la Banque centrale d'acheter davantage de bahts encore pour empêcher la monnaie de chuter, ce qui épuisa ses réserves en devises encore plus vite, confortant la conviction, si besoin était, que le baht allait être dévalué plus tôt que prévu. Une crise monétaire classique battait son plein. N'importe quel spécialiste de l'économie monétaire dira qu'une fois que les choses en sont arrivés là, le gouvernement doit agir sans hésiter, d'une manière ou d'une autre que ce soit en prenant un engagement clair pour défendre la monnaie coûte que coûte, soit en la laissant filer. Mes les gouvernements ont généralement des difficultés à prendre une décision, quelle qu'elle soit. Comme nombre de gouvernements dans le passé et sans doute de nombreux à venir, celui de la Thailande attendit pendant que ses réserves s'épuisaient.
Pour tenter de convaincre les marchés que sa position était plus forte qu'elle ne l'était en réalité, il fit en sorte que les réserves aient l'air plus importantes par des " swaps de devises " soudains ( en empruntant des dollars pour les rembourser plus tard ). Mais si la pression semblait parfois baissait, elle remontait toujours. Au début du mois de juillet, tout était perdu. Le 2 juillet, les Thailandais laissèrent le baht chuter. Jusqu'à ce moment là, rien de ce qui était arrivé n'était de nature à surprendre. L'épuisement des réserves de devises, l'attaque par la spéculation d'une monnaie dont la faiblesse était patente sortaient tout droit des manuels. Mais, en dépit de l'expérience récente de la crise tequila, la plupart des gens pensaient que la dévaluation du baht marquerait la fin d'une période : une humiliation pour le gouvernement, un choc désagréable peut être pour certaines entreprises qui se retrouvaient étranglées, mais rien de catastrophique. Assurément, la Thailande ne ressemblait pas au Mexique. Personne ne pouvait l'accuser d'avoir réalisé la stabilisation, la réforme sans la croissance. Il n'existait pas de Cardenas thai qui aurait attendu en coulisses pour appliquer un programme populiste. Et il n'y aurait donc pas de récession dévastatrices. Mais ce n'était pas le cas.
il y a 3 mois
L'effondrement.
Il y a deux question quelque peu différents à se poser concernant la récession qui se propagea dans toute l'Asie, après la dévaluation en Thailande. la première est d'ordre mécanique : comment cette récession s'est elle produite? Pourquoi une dévaluation dans un petit pays put elle provoquer un effondrement de l'investissement et de la production dans une région du monde aussi vaste? L'autre question, plus fondamentale en un sens est : pourquoi les gouvernements n'ont ils pas prévenu la catastrophe? Et le pouvaient ils? Et qu'est il arrivé à la politique macroéconomique? Quand tout se passe bien, rien d'irrémédiable ne se produit lorsqu'on laisse une monnaie perdre de sa valeur. Lorsque la Grande Bretagne cessa de défendre la livre en 1992, la monnaie perdit 15% de sa valeur avant de se stabiliser : les investisseurs pensèrent alors que le pire était passé et qu'une monnaie plus faible favoriserait les exportations du pays, lequel devenait plus attractif pour l'investissement qu'il ne l'avait été auparavant. Les calculs habituels ont montré que le baht aurait dû perdre près de 15% de sa valeur pour que l'industrie thaie soit de nouveau compétitive par ses coûts, donc une baisse de cet ordre de grandeur paraissait souhaitable. Mais en fait, la monnaie tombe en chute libre : le prix en bahts d'un dollar fit un bond de 50% par rapport à son niveau des mois précédents, et aurait même continué à monter si la Thailande n'avait pas vigoureusement relevé ses taux d'intérêt. Pourquoi le baht chuta il tant? La réponse tient en la panique. Il faut se demander de quelle nature était cette panique. Quelquefois, une panique n'était qu'une panique : une réaction irrationnelle de la part des investisseurs, sans qu'elle soit justifiée par des informations concrètes.
Un exemple pourrait être la brève chute du dollar en 1981, après qu'un tireur déséquilibré ait blessé Ronald Reagan. Ce fut un événement choquant mais quand bien même Reagan serait mort que la stabilité du gouvernement américain et la continuité de la politique risquaient peu d'en être affectées. Ceux qui gardèrent la tête froid et ne fuirent pas le dollar en furent récompensées. Cependant, les paniques les plus importantes en économie sont celles qui, quel qu'en soit le motif, s'auto justifient, parce que la panique appelle la panique. L'exemple classique en est la ruée vers les banques : lorsque les déposants d'une banque se présentent pour retirer leur argent d'un seul coup, la banque est obligée de vendre ses actifs avec une forte décote, ce qui la conduit à la banqueroute. Les déposants qui n'ont pas cédé à la panique se retrouvent dans une situation pire que ceux qui y ont cédé. Et en fait, il y eut plusieurs paniques bancaires en Thailande et encore davantage en Indonésie. Mais s'attacher seulement aux ruées vers les banques reviendrait à prendre la métaphore au pied de la lettre. Ce qui s'est réellement passé correspondait à un processus circulaire, une boucle de rétroaction, de dégradation financière et d'érosion de la confiance dont les ruées vers les banques n'ont été qu'un aspect. La baisse de la confiance dans la monnaie doit conduire les investisseurs nationaux et étrangers à désirer faire sortir leurs capitaux du pays. Toutes choses égales par ailleurs, ce processus entraîne la chute du baht. Comme la Banque centrale thai n'était plus en mesure de soutenir sa monnaie en l'achetant sur le marché des changes étant donné qu'elle n'avait plus de dollars ou de yens à dépenser, son seul moyen d'enrayer le déclin de sa devise était de relever les taux d'intérêt et de limiter la masse monétaire en circulation.
Malheureusement, la baisse de la valeur de la monnaie et l'augmentation des taux d'intérêt on créé des problèmes financiers pour les entreprises, tant les institutions financières que les autres. D'un côté, beaucoup avaient des dettes en dollars, qui devinrent soudain plus lourdes lorsqu'il fallut de plus en plus de bahts pour un dollar. De l'autre, elles étaient nombreuses également à avoir des dettes en bahts, qui devinrent plus difficiles à rembourser lorsque les taux d'intérêt plus élevés et de bilans en difficulté avec un système bancaire qui se révéla souvent incapable d'accorder des prêts, même les plus sûrs, s'est traduite au niveau des entreprises par des coupes sombres dans leurs dépenses, entraînant une récession, ce qui constituait le pire des présages pour les futurs profits et bilans. Toutes ces mauvaises nouvelles qui venaient de l'économie ont ébranlé encore davantage la confiance et toute l'activité du pays a été touchée par le marasme. Si on laisse de côté tous les détails compliqués, cette histoire semble assez simple, d'autant qu'il était arrivé sensiblement la même chose au Mexique en 1995. Alors, pourquoi les conséquences désastreuses en Thailande ont elles soulevé une si grande surprise? Bien que de nombreux économistes aient été au courant des él"ments de cette histoire, tout le monde comprenait que la boucle de rétroaction qui allait de la confiance aux marchés financiers et à l'économie réelle, puis revenait de ces derniers sur la confiance, existait bel et bien. Personne semblait il, ne réalisait au juste la force qu'aurait en réalité ce processus de rétroaction. Et, finalement, personne ne s'est rendu compte du caractère explosif qu'aurait la logique circulaire de la crise.
Osons un parallèle. Un microphone dans un auditorium engendre toujours un effet de retour, l'effet Larsen : les sons captés par le microphone sont amplifiés par les enceintes. Mais tant que la pièce ne réverbère pas trop les sons et que le volume n'est pas trop fort, on a un processus assourdi qui ne pose pas de problème. Augmentez le volume en tournant le bouton et le processus devient explosif : chaque son est saisi, amplifié, ressaisi de nouveau et soudain, il se produit un grincement strident. En d'autres termes, ce qui importe, ce n'est pas tant le processus qualitatif de la rétroaction que sa force d'un point de vue quantitatif. Ce qui surprit tout le monde, c'était de découvrir que le volume était monté si haut. Même maintenant, nombreux sont ceux qui ont du mal à croire qu'une économie de marché puisse être à ce point instable, que les rétroactions deviennent fortes au point d'engendrer une crise aussi grave. Mais elles le sont, comme le montre la façon dont la crise s'est propagée.
La contagion.
Il y a certainement de bonnes raisons pour que les réunions sur les finances internationales, notamment sur la gestion des crises internationales, se déroulent dans des lieux de villégiatures champêtres, pourquoi le système monétaire de l'après guerre a il été forgé dans le Mount Washington Hitel à Bretton Woods? Pourquoi de nombreux ministres des Finances se réunissent ils chaque été à Jackson Lake Lodge dans Wyoming? Le cadre contribue peut être à ce que ces éminentes personnes échappent aux combats de leurs vies quotidiennes et se penchent, même rapidement sur des questions générales. Toujours est il qu'au début du mois d'octobre 1997, alors que la crise asiatique était déjà entamée sans que sa gravité soit encore manifeste, de nombreux banquiers, responsables politiques et économistes se dirigeants vers Woodstock dans le Vermont pour faire le point. A ce moment là, la Thailden se trouvait réellement en grande difficulté et la monnaie du pays voisin, la Malaisie, avait aussi été touchée. La roupie indonésienne était dépréciée de 30%. Selon le sentiment générale dans la pièce, la Thailande avait fait son propre malheur. Et la Malaisie suscitait peu de sympathie, elle qui, comme la Thailande, avait enregistré un énorme déficit budgétaire au cours des dernières années et donc le Premier ministre avait envenimé considérablement le climat en dénonçant les spéculateurs malveillants. Tout le monde donnait raison à l'Indonésie d'avoir laissé glisser sa monnaie. En vérité, on a dit beaucoup de bonnes choses sur la gestion économique de l'Indonésie, mais on ne comprenait pas la faiblesse de la roupie, qui ne se justifiait pas réellement. Après tout, le déficit budgétaire de l'Indonésie était loin d'être aussi important, en pourcentage du PIB, que ceux de ses voisins, à moins de 4% du PIB, il était plus faible que celui de l'Australie, par exemple. La base d'exportation du pays, les matières premières et les biens à fort contenu de main d'oeuvre semblait solide.
En l'espace de trois mois, l'Indonésie se retrouva dans une situation bien pire que le reste de l'Asie du Sud Est, sur la pente d'une des plus terribles récessions économiques de l'histoire. Et la crise s'est propagée non seulement à travers toute l'Asie du Sud Est, mais aussi jusqu'en Corée du Sud, un pays éloigné dont le PIB était le double de celui de l'Indonésie et trois fois celui de la Thailande. Parfois, il y a de bonnes raisons pour que se développe une contagion économique. Selon une vieille formule, lorsque les Etats Unis éternuent, le Canada s'enrhume. A cela rien d'étonnant quand on sait que la majeure partie de la production du Canada est vendue sur les marchés du géant que sont les Etats Unis. Des relations directes unissaient bien les économies d'Asie qui furent touchées : la Thailande représente un marché pour les produits malaisiens et vice versa. Il y eut peut être un peu plus de tirage en raison de la tendance qu'on les économies asiatiques à vendre les mêmes produits aux pays tiers. Lorsque la Thailande dévalua sa monnaie, les vêtements qu'elle exportait vers l'Occident devinrent moins chers et entamèrent donc les marges bénéficiaires des producteurs indonésiens de produits similaires. Mais toutes ces estimations de l'effet d'entraînement directs du " marché des biens " sur les économies en crise montrent que ce dernier ne peut ^avoir constitué un facteur majeur dans la propagation de la crise.
Il y a deux question quelque peu différents à se poser concernant la récession qui se propagea dans toute l'Asie, après la dévaluation en Thailande. la première est d'ordre mécanique : comment cette récession s'est elle produite? Pourquoi une dévaluation dans un petit pays put elle provoquer un effondrement de l'investissement et de la production dans une région du monde aussi vaste? L'autre question, plus fondamentale en un sens est : pourquoi les gouvernements n'ont ils pas prévenu la catastrophe? Et le pouvaient ils? Et qu'est il arrivé à la politique macroéconomique? Quand tout se passe bien, rien d'irrémédiable ne se produit lorsqu'on laisse une monnaie perdre de sa valeur. Lorsque la Grande Bretagne cessa de défendre la livre en 1992, la monnaie perdit 15% de sa valeur avant de se stabiliser : les investisseurs pensèrent alors que le pire était passé et qu'une monnaie plus faible favoriserait les exportations du pays, lequel devenait plus attractif pour l'investissement qu'il ne l'avait été auparavant. Les calculs habituels ont montré que le baht aurait dû perdre près de 15% de sa valeur pour que l'industrie thaie soit de nouveau compétitive par ses coûts, donc une baisse de cet ordre de grandeur paraissait souhaitable. Mais en fait, la monnaie tombe en chute libre : le prix en bahts d'un dollar fit un bond de 50% par rapport à son niveau des mois précédents, et aurait même continué à monter si la Thailande n'avait pas vigoureusement relevé ses taux d'intérêt. Pourquoi le baht chuta il tant? La réponse tient en la panique. Il faut se demander de quelle nature était cette panique. Quelquefois, une panique n'était qu'une panique : une réaction irrationnelle de la part des investisseurs, sans qu'elle soit justifiée par des informations concrètes.
Un exemple pourrait être la brève chute du dollar en 1981, après qu'un tireur déséquilibré ait blessé Ronald Reagan. Ce fut un événement choquant mais quand bien même Reagan serait mort que la stabilité du gouvernement américain et la continuité de la politique risquaient peu d'en être affectées. Ceux qui gardèrent la tête froid et ne fuirent pas le dollar en furent récompensées. Cependant, les paniques les plus importantes en économie sont celles qui, quel qu'en soit le motif, s'auto justifient, parce que la panique appelle la panique. L'exemple classique en est la ruée vers les banques : lorsque les déposants d'une banque se présentent pour retirer leur argent d'un seul coup, la banque est obligée de vendre ses actifs avec une forte décote, ce qui la conduit à la banqueroute. Les déposants qui n'ont pas cédé à la panique se retrouvent dans une situation pire que ceux qui y ont cédé. Et en fait, il y eut plusieurs paniques bancaires en Thailande et encore davantage en Indonésie. Mais s'attacher seulement aux ruées vers les banques reviendrait à prendre la métaphore au pied de la lettre. Ce qui s'est réellement passé correspondait à un processus circulaire, une boucle de rétroaction, de dégradation financière et d'érosion de la confiance dont les ruées vers les banques n'ont été qu'un aspect. La baisse de la confiance dans la monnaie doit conduire les investisseurs nationaux et étrangers à désirer faire sortir leurs capitaux du pays. Toutes choses égales par ailleurs, ce processus entraîne la chute du baht. Comme la Banque centrale thai n'était plus en mesure de soutenir sa monnaie en l'achetant sur le marché des changes étant donné qu'elle n'avait plus de dollars ou de yens à dépenser, son seul moyen d'enrayer le déclin de sa devise était de relever les taux d'intérêt et de limiter la masse monétaire en circulation.
Malheureusement, la baisse de la valeur de la monnaie et l'augmentation des taux d'intérêt on créé des problèmes financiers pour les entreprises, tant les institutions financières que les autres. D'un côté, beaucoup avaient des dettes en dollars, qui devinrent soudain plus lourdes lorsqu'il fallut de plus en plus de bahts pour un dollar. De l'autre, elles étaient nombreuses également à avoir des dettes en bahts, qui devinrent plus difficiles à rembourser lorsque les taux d'intérêt plus élevés et de bilans en difficulté avec un système bancaire qui se révéla souvent incapable d'accorder des prêts, même les plus sûrs, s'est traduite au niveau des entreprises par des coupes sombres dans leurs dépenses, entraînant une récession, ce qui constituait le pire des présages pour les futurs profits et bilans. Toutes ces mauvaises nouvelles qui venaient de l'économie ont ébranlé encore davantage la confiance et toute l'activité du pays a été touchée par le marasme. Si on laisse de côté tous les détails compliqués, cette histoire semble assez simple, d'autant qu'il était arrivé sensiblement la même chose au Mexique en 1995. Alors, pourquoi les conséquences désastreuses en Thailande ont elles soulevé une si grande surprise? Bien que de nombreux économistes aient été au courant des él"ments de cette histoire, tout le monde comprenait que la boucle de rétroaction qui allait de la confiance aux marchés financiers et à l'économie réelle, puis revenait de ces derniers sur la confiance, existait bel et bien. Personne semblait il, ne réalisait au juste la force qu'aurait en réalité ce processus de rétroaction. Et, finalement, personne ne s'est rendu compte du caractère explosif qu'aurait la logique circulaire de la crise.
Osons un parallèle. Un microphone dans un auditorium engendre toujours un effet de retour, l'effet Larsen : les sons captés par le microphone sont amplifiés par les enceintes. Mais tant que la pièce ne réverbère pas trop les sons et que le volume n'est pas trop fort, on a un processus assourdi qui ne pose pas de problème. Augmentez le volume en tournant le bouton et le processus devient explosif : chaque son est saisi, amplifié, ressaisi de nouveau et soudain, il se produit un grincement strident. En d'autres termes, ce qui importe, ce n'est pas tant le processus qualitatif de la rétroaction que sa force d'un point de vue quantitatif. Ce qui surprit tout le monde, c'était de découvrir que le volume était monté si haut. Même maintenant, nombreux sont ceux qui ont du mal à croire qu'une économie de marché puisse être à ce point instable, que les rétroactions deviennent fortes au point d'engendrer une crise aussi grave. Mais elles le sont, comme le montre la façon dont la crise s'est propagée.
La contagion.
Il y a certainement de bonnes raisons pour que les réunions sur les finances internationales, notamment sur la gestion des crises internationales, se déroulent dans des lieux de villégiatures champêtres, pourquoi le système monétaire de l'après guerre a il été forgé dans le Mount Washington Hitel à Bretton Woods? Pourquoi de nombreux ministres des Finances se réunissent ils chaque été à Jackson Lake Lodge dans Wyoming? Le cadre contribue peut être à ce que ces éminentes personnes échappent aux combats de leurs vies quotidiennes et se penchent, même rapidement sur des questions générales. Toujours est il qu'au début du mois d'octobre 1997, alors que la crise asiatique était déjà entamée sans que sa gravité soit encore manifeste, de nombreux banquiers, responsables politiques et économistes se dirigeants vers Woodstock dans le Vermont pour faire le point. A ce moment là, la Thailden se trouvait réellement en grande difficulté et la monnaie du pays voisin, la Malaisie, avait aussi été touchée. La roupie indonésienne était dépréciée de 30%. Selon le sentiment générale dans la pièce, la Thailande avait fait son propre malheur. Et la Malaisie suscitait peu de sympathie, elle qui, comme la Thailande, avait enregistré un énorme déficit budgétaire au cours des dernières années et donc le Premier ministre avait envenimé considérablement le climat en dénonçant les spéculateurs malveillants. Tout le monde donnait raison à l'Indonésie d'avoir laissé glisser sa monnaie. En vérité, on a dit beaucoup de bonnes choses sur la gestion économique de l'Indonésie, mais on ne comprenait pas la faiblesse de la roupie, qui ne se justifiait pas réellement. Après tout, le déficit budgétaire de l'Indonésie était loin d'être aussi important, en pourcentage du PIB, que ceux de ses voisins, à moins de 4% du PIB, il était plus faible que celui de l'Australie, par exemple. La base d'exportation du pays, les matières premières et les biens à fort contenu de main d'oeuvre semblait solide.
En l'espace de trois mois, l'Indonésie se retrouva dans une situation bien pire que le reste de l'Asie du Sud Est, sur la pente d'une des plus terribles récessions économiques de l'histoire. Et la crise s'est propagée non seulement à travers toute l'Asie du Sud Est, mais aussi jusqu'en Corée du Sud, un pays éloigné dont le PIB était le double de celui de l'Indonésie et trois fois celui de la Thailande. Parfois, il y a de bonnes raisons pour que se développe une contagion économique. Selon une vieille formule, lorsque les Etats Unis éternuent, le Canada s'enrhume. A cela rien d'étonnant quand on sait que la majeure partie de la production du Canada est vendue sur les marchés du géant que sont les Etats Unis. Des relations directes unissaient bien les économies d'Asie qui furent touchées : la Thailande représente un marché pour les produits malaisiens et vice versa. Il y eut peut être un peu plus de tirage en raison de la tendance qu'on les économies asiatiques à vendre les mêmes produits aux pays tiers. Lorsque la Thailande dévalua sa monnaie, les vêtements qu'elle exportait vers l'Occident devinrent moins chers et entamèrent donc les marges bénéficiaires des producteurs indonésiens de produits similaires. Mais toutes ces estimations de l'effet d'entraînement directs du " marché des biens " sur les économies en crise montrent que ce dernier ne peut ^avoir constitué un facteur majeur dans la propagation de la crise.
il y a 3 mois
Le rôle de la Thailande, en particulier que ce soit comme marché ou comme concurrente de la Corée du Sud, représentait à peine plus d'une erreur de décimale pour l'économie coréenne bien plus importante. Les liaisons financières plus ou moins directes peuvent avoir servi de contagion plus puissant. Non que les Thailandais aient été de gros investisseurs en Corée, ou les Coréens en Thailande : mais les flux de capitaux dans la région étaient souvent canalisés par des " fonds de marché émergents " qui réunissaient tous ces pays.
L'Asie du Sud Est compte dominer le monde.
L'ASEAN a été crée durant les années 1960 par des pays partageant des intérêts communs mais aussi aux modes de gouvernance et d'économie différent voire très différence. Elle est devenue en 2015 une véritable communauté économique. Elle rassemble plus de 9% de la population mondiale et constitue le 5ème plus gros bloc économique derrière la Chine, les US, l'UE et le Japon. Selon des analystes,avec une croissance supérieure à la moyenne mondiale, c'est elle qui devrait prendre le relais de la Chine et servir de moteur à l'économie mondiale. Il y a plusieurs catégories de pays. Parmi la catégorie des pays les moins développés, les plus fragiles économiquement, il y a la Birmanie, le Cambodge et le Laos. Les Philippines et le Vietnam se situent un cran au dessus en faisant partie des pays dont le PIB par habitant est compris entre 2 000 et 3 000 dollars par an. Ensuite il y a les pays dit de revenus intermédiaires, à savoir l'Indonésie, la Malaisie et la Thailande. Enfin parmi les pays les plus avancés on retrouve Brunei ainsi que Singapour.
Aujourd'hui, on sait que l'ASEAN a connu 3,1% de croissance en 2021 et 5,3% de croissance en 2022. Selon le FMI le score sera le même à la fin de l'année 2023. Tous les membres de l'ASEAN connaissent une croissance située entre 3% et 8% sauf la Birmanie et le Laos. Le Cambodge, l'Indonésie et le Cambodge font partie des pays les plus dynamiques. Le Vietnam encore plus. Le Vietnam a plus de 98 millions d'habitants pour un PIB par habitant de plus de 3 700 dollars. Le Vietnam profite d'une politique de montée en gamme de son outil de production qui s'oriente progressivement vers d'autres branches comme l'électronique ou le textile. Il est devenu le plus gros fournisseur mondial de crustacés en élevage en seulement quelques années. Mais la corruption et le manque de transparence qui sont présents au sein du parti communiste au pouvoir fait que depuis la fin de la guerre du Vietnam, les investisseurs étrangers ont tendance parfois à se méfier. Le Vietnam est encore grandement dépendant du marché chinois tandis que son système bancaire est sous dimensionné. C'est le cas aussi du Cambodge mais il abrite la ville Battabamg et son train en bambou ce qui attire des touristes.Le monastère de Ta Prohm et les tour d'Angkor font partie de son patrimoine touristique également. Malgré sa dépendance à l'industrie du textile, celle ci s'est modernisée et offre plusieurs niveaux de qualité permettant aux exportateurs cambodgiens d'améliorer sa valeur ajouté. Le FMI s'attend à une poursuite du développement du pays avec une croissance de 5,6% contre 5,1% pour ce qui est de l'Indonésie. En parlant de l'Indonésie il s'agit du pays le plus peuplé de l'AEAN avec 274 millions d'habitants ainsi que l'u des 5 membres fondateurs de l'ASEAN. Mais son désavantage réside dans ses nombreux conflits ethniques. Malgré le développement progressif du tourisme, l'archipel manque d'infrastructures. Et son marché est en grande partie dépendant de celui de la Chine commercialement.
Les Philippines sont également un des membres fondateurs de l'ASEAN. Les prévisions sont positives pour ce pays car le pays dispose de 110 millions d'habitants pour un niveau de pauvreté en baisse ainsi qu'une croissance de 7,1% en 2022. Le seul désavantage pour le moment pour les investisseurs étrangers réside dans son inflation. Elle traîne également une mauvaise réputation par rapport aux blanchissements d'argent douteux. En plus de la mangue, l'autre spécialiste des Philippines réside dans l'externalisation des processus, ou BPO pour les Anglo saxons. Cela peut être la maintenance du parc informatique, la gestion des salariés par exemple. En revanche, un pays reste fragile à l'ouest de l'ASEAN, à savoir le Myanmar, ancienne Birmanie. Leurs 53 millions d'habitants produisent seulement 1217 dollars de PIB chacun et ce par an. De plus, les infrastructures ainsi que le système financier de Birman sont sous développés pour grandement peser dans les affaires asiatiques et mondiales. Le Groupe d'Action Financière a également mis le pays sur liste noire. Le GAF est censé pourchasser ceux qui alimentent les comptes bancaires du terrorisme. Cela ne signifie pas qu'il y a pas de potentiel. On le voit notamment avec l'or, le cuivre, le jade, le gaz et le pétrole. De plus, des terres sont encore cultivables et la population est jeune. Il y a 130 ethnies dans le pays ce qui n'arrange pas grand chose concernant la question des conflits ethniques.
Enfin, Brunei et Singapour sont loin devant la Laos et la Birmanie pour le moment. 73 000 dollars de PIB annuels sont produits en moyenne par chaque habitant du pays malgré le fait qu'il ne représente que 8% de la population totale de l'ASEAN. La bourse de Singapour est en contact direct avec la bourse de Londres ou encore avec les bourses américaines ou australiennes. On en parle comme étant la Silicon Valley du sud est. Grâce à ses fonds souverains, c'est le premier exportateurs de capitaux et son industrie à forte valeur ajoutée lui permet de dominer l'ASEAN. En plus d'être un centre financier d'envergure attirant les investisseurs étrangers c'est également une grande escale pour les transports maritimes. Parmi les points faibles de Singapour à noter figurent tout de même sa dépendance aux importations sur le plan alimentaire comme énergétique. Les productions locales ne suffisent pas. De plus, Singapour est également touché par l'inflation. L'inflation à été de plus de 6% en moyenne en 2022. A l'ouest au nord de la Malaisie on retrouve Brunei. C'est un micro état et une monarchie vivant de ses rentes pétrolières depuis 1929. Sa population est de plus de 430 000 habitants seulement. Parmi les avantages figurent le fait que les soins sont gratuits, pareil pour l'éducation. De plus, les impôts sont inexistants. Cependant, ses comptes publics sont en déficit d'1 millard 100 millions en 2022 soit 7,8% de son PIB. Sa croissance ne devrait pas dépasser les 2,3% en 2023. Autrement dit il y a nécessité de trouver d'autres ressources de revenus pour maintenir leur niveau de vie. l'ASEAN réalise au total 3 378 milliards de dollars de PIB. Soit l'équivalent du Royaume Uni contre seulement 30% à la fin des années 1980.
Les services financiers en représentent la plus grosse partie notamment grâce à Singapour. Ils sont suivis par les secteurs de l'industrie, des communications ainsi que l'immobilier.
L'Asie du Sud Est compte dominer le monde.
L'ASEAN a été crée durant les années 1960 par des pays partageant des intérêts communs mais aussi aux modes de gouvernance et d'économie différent voire très différence. Elle est devenue en 2015 une véritable communauté économique. Elle rassemble plus de 9% de la population mondiale et constitue le 5ème plus gros bloc économique derrière la Chine, les US, l'UE et le Japon. Selon des analystes,avec une croissance supérieure à la moyenne mondiale, c'est elle qui devrait prendre le relais de la Chine et servir de moteur à l'économie mondiale. Il y a plusieurs catégories de pays. Parmi la catégorie des pays les moins développés, les plus fragiles économiquement, il y a la Birmanie, le Cambodge et le Laos. Les Philippines et le Vietnam se situent un cran au dessus en faisant partie des pays dont le PIB par habitant est compris entre 2 000 et 3 000 dollars par an. Ensuite il y a les pays dit de revenus intermédiaires, à savoir l'Indonésie, la Malaisie et la Thailande. Enfin parmi les pays les plus avancés on retrouve Brunei ainsi que Singapour.
Aujourd'hui, on sait que l'ASEAN a connu 3,1% de croissance en 2021 et 5,3% de croissance en 2022. Selon le FMI le score sera le même à la fin de l'année 2023. Tous les membres de l'ASEAN connaissent une croissance située entre 3% et 8% sauf la Birmanie et le Laos. Le Cambodge, l'Indonésie et le Cambodge font partie des pays les plus dynamiques. Le Vietnam encore plus. Le Vietnam a plus de 98 millions d'habitants pour un PIB par habitant de plus de 3 700 dollars. Le Vietnam profite d'une politique de montée en gamme de son outil de production qui s'oriente progressivement vers d'autres branches comme l'électronique ou le textile. Il est devenu le plus gros fournisseur mondial de crustacés en élevage en seulement quelques années. Mais la corruption et le manque de transparence qui sont présents au sein du parti communiste au pouvoir fait que depuis la fin de la guerre du Vietnam, les investisseurs étrangers ont tendance parfois à se méfier. Le Vietnam est encore grandement dépendant du marché chinois tandis que son système bancaire est sous dimensionné. C'est le cas aussi du Cambodge mais il abrite la ville Battabamg et son train en bambou ce qui attire des touristes.Le monastère de Ta Prohm et les tour d'Angkor font partie de son patrimoine touristique également. Malgré sa dépendance à l'industrie du textile, celle ci s'est modernisée et offre plusieurs niveaux de qualité permettant aux exportateurs cambodgiens d'améliorer sa valeur ajouté. Le FMI s'attend à une poursuite du développement du pays avec une croissance de 5,6% contre 5,1% pour ce qui est de l'Indonésie. En parlant de l'Indonésie il s'agit du pays le plus peuplé de l'AEAN avec 274 millions d'habitants ainsi que l'u des 5 membres fondateurs de l'ASEAN. Mais son désavantage réside dans ses nombreux conflits ethniques. Malgré le développement progressif du tourisme, l'archipel manque d'infrastructures. Et son marché est en grande partie dépendant de celui de la Chine commercialement.
Les Philippines sont également un des membres fondateurs de l'ASEAN. Les prévisions sont positives pour ce pays car le pays dispose de 110 millions d'habitants pour un niveau de pauvreté en baisse ainsi qu'une croissance de 7,1% en 2022. Le seul désavantage pour le moment pour les investisseurs étrangers réside dans son inflation. Elle traîne également une mauvaise réputation par rapport aux blanchissements d'argent douteux. En plus de la mangue, l'autre spécialiste des Philippines réside dans l'externalisation des processus, ou BPO pour les Anglo saxons. Cela peut être la maintenance du parc informatique, la gestion des salariés par exemple. En revanche, un pays reste fragile à l'ouest de l'ASEAN, à savoir le Myanmar, ancienne Birmanie. Leurs 53 millions d'habitants produisent seulement 1217 dollars de PIB chacun et ce par an. De plus, les infrastructures ainsi que le système financier de Birman sont sous développés pour grandement peser dans les affaires asiatiques et mondiales. Le Groupe d'Action Financière a également mis le pays sur liste noire. Le GAF est censé pourchasser ceux qui alimentent les comptes bancaires du terrorisme. Cela ne signifie pas qu'il y a pas de potentiel. On le voit notamment avec l'or, le cuivre, le jade, le gaz et le pétrole. De plus, des terres sont encore cultivables et la population est jeune. Il y a 130 ethnies dans le pays ce qui n'arrange pas grand chose concernant la question des conflits ethniques.
Enfin, Brunei et Singapour sont loin devant la Laos et la Birmanie pour le moment. 73 000 dollars de PIB annuels sont produits en moyenne par chaque habitant du pays malgré le fait qu'il ne représente que 8% de la population totale de l'ASEAN. La bourse de Singapour est en contact direct avec la bourse de Londres ou encore avec les bourses américaines ou australiennes. On en parle comme étant la Silicon Valley du sud est. Grâce à ses fonds souverains, c'est le premier exportateurs de capitaux et son industrie à forte valeur ajoutée lui permet de dominer l'ASEAN. En plus d'être un centre financier d'envergure attirant les investisseurs étrangers c'est également une grande escale pour les transports maritimes. Parmi les points faibles de Singapour à noter figurent tout de même sa dépendance aux importations sur le plan alimentaire comme énergétique. Les productions locales ne suffisent pas. De plus, Singapour est également touché par l'inflation. L'inflation à été de plus de 6% en moyenne en 2022. A l'ouest au nord de la Malaisie on retrouve Brunei. C'est un micro état et une monarchie vivant de ses rentes pétrolières depuis 1929. Sa population est de plus de 430 000 habitants seulement. Parmi les avantages figurent le fait que les soins sont gratuits, pareil pour l'éducation. De plus, les impôts sont inexistants. Cependant, ses comptes publics sont en déficit d'1 millard 100 millions en 2022 soit 7,8% de son PIB. Sa croissance ne devrait pas dépasser les 2,3% en 2023. Autrement dit il y a nécessité de trouver d'autres ressources de revenus pour maintenir leur niveau de vie. l'ASEAN réalise au total 3 378 milliards de dollars de PIB. Soit l'équivalent du Royaume Uni contre seulement 30% à la fin des années 1980.
Les services financiers en représentent la plus grosse partie notamment grâce à Singapour. Ils sont suivis par les secteurs de l'industrie, des communications ainsi que l'immobilier.
il y a 3 mois





















