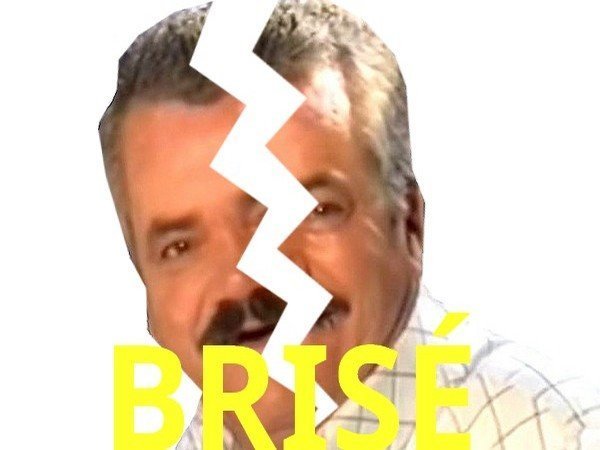Ce sujet a été résolu
un article écrit par le boomer Olivier Babeau :  https://www.lefigaro.fr/l[...]ve-des-paresseux-20250111
https://www.lefigaro.fr/l[...]ve-des-paresseux-20250111
«On craignait d’avoir élevé des révolutionnaires, c’est pire que ça : on a élevé des paresseux»
Prise de distance par rapport au travail, paresse généralisée, déclassement… dans l’Ère de la flemme , dont Le Figaro Magazine publie des extraits, Olivier Babeau dénonce une crise de l’effort qui pourrait pénaliser durablement notre pays.
Professeur d’université, Olivier Babeau est président-fondateur de l’Institut Sapiens, un laboratoire d’idées dédié à la place de l’être humain dans le monde technologique.
En matière de travail , nous sommes passés d’une logique du « toujours mieux » à celle du « juste assez ». L’éthique de l’amélioration permanente a fait place à l’éthique du minimum possible. La cause ? L’industrialisation d’abord […] La logique industrielle du produit a effacé la logique artisanale de l’œuvre. Le tour de main perd son importance.
La tertiarisation de l’économie et l’élargissement des lignes hiérarchiques ont multiplié les emplois aux contours peu définis et à l’utilité douteuse : les fameux bullshit jobs du sociologue David Graeber […] Seconde cause de la fin du travail bien fait : son statut a changé. On ne croit plus en rien, et surtout pas en lui. On n’espère plus rien, même pas une vie meilleure par le travail […] Farniente, c’est-à-dire en italien ne rien faire, est devenu un programme à part entière.
En 2024, l’une des tendances qui fait fureur sur les réseaux sociaux est celle du bed rotting (littéralement : « pourrir au lit »). Le principe ? Rester au lit aussi longtemps que possible. Toute la journée idéalement. Pour y faire quoi ? Rien. En pratique : faire défiler à l’infini les contenus des réseaux sociaux, somnoler, regarder ses séries préférées. Joie ! On atteint les limites extrêmes de l’injonction à la paresse.
Le Covid, un moment charnière
Il s’agit de se transformer en sorte de mort-vivant. De limace géante. Les risques associés à cet étrange mode de vie sont ceux de la sédentarité et de l’addiction aux écrans : réclusion sociale, diabète, maladie de cœur, dépression, etc. Difficile de ne pas décrire ce genre de loisir comme dysfonctionnel dès lors qu’il devient une habitude. Déjà en 2003, l’accorte chanteuse Alizée chantait : « J’ai pas de problèmes, je fainéante […] Bien à mon aise, dans l’air du temps » […]
Le Covid a constitué un moment charnière dans ce grand découragement. La rupture complète de rythme pendant deux mois, la découverte de la vie oisive, la réflexion sur le sens de sa vie : tout a pu concourir à ce que le Covid brise durablement notre rapport à l’effort en général et au travail en particulier. Mais le Covid n’explique pas tout. Les premiers signes étaient apparus avant.
On a fêté en décembre 2023 les vingt-cinq ans des 35 heures et les quarante deux ans de la retraite à 60 ans par répartition. Triste fête, en vérité. Le problème des décisions politiques est de mettre très longtemps à prouver leur bien-fondé ou leurs défauts. En l’occurrence, ces décisions se révèlent des catastrophes absolues. Plus de trois décennies l’ont montré.
Les 35 heures, c’était l’illusion de l’argent gratuit avant la lettre. Elles ont été payées par de moindres hausses de salaire et se sont traduites par une croissance moins forte que notre voisin allemand. Selon Xavier Fontanet, le différentiel de 3 % de croissance par rapport à l’Allemagne sur vingt-cinq ans aurait représenté une perte de richesse de 2 000 milliards d’euros.
La France travaille trop peu […] Trop de gens en âge de travailler sont sortis du marché de l’emploi. La France a une préférence pour le loisir : elle préfère limiter son temps de travail, donc ses revenus, pour augmenter son temps libre. Compense-t-on par une productivité plus grande que les autres pays ? C’était plutôt le cas. Ça ne l’est plus.
L’effort n’intéresse plus
La croissance de la productivité du travail aux États-Unis a été le double de celle des pays de la zone euro depuis vingt ans. La France est l’avant-dernier pays parmi tous les pays développés en termes d’évolution de la richesse créée par heure travaillée entre 2017 et 2022 : alors que presque tous les pays progressent, comme l’Irlande par exemple avec 38 % de progression, nous reculons de 3 %. Nous sommes moins productifs […]
L’effort n’intéresse plus. Il n’est plus donné en exemple, ni inscrit au nombre des valeurs qui comptent. On lui préfère les vertus égalitaristes de l’humilité et de la passivité. On ne salue plus le héros, mais la victime. Le tire-au-flanc, le profiteur des efforts des autres est excusé, presque considéré avec bienveillance. On se méfie de l’excellence, quand on ne nie pas tout simplement son existence. L’élitisme était une qualification louangeuse, c’est devenu un reproche. Il est désormais de mauvais ton de se distinguer. Le médiocre rassure.
Si l’on écoute les grands débats sur les impôts ou la retraite, on a parfois l’impression que le but essentiel de tout citoyen est de parvenir à capter les prébendes généreuses de la redistribution, durant la vie active ou la retraite. Chacun compte sur le travail des autres beaucoup plus que sur son propre travail. La préférence pour la paresse s’est inséminée dans toutes les dimensions de la société. Autrefois on exaltait l’effort, aujourd’hui il dérange. Hier célébré et placé sur un piédestal, l’effort est maintenant sur le banc des accusés. Étrange époque que celle où l’effort a besoin d’un avocat […]
La paresse nous tue. Nous n’avons pas fini de le mesurer. L’effort est le ressort caché des civilisations, le principe qui fait tenir une existence debout. Le perdre, c’est s’effondrer.
Dissipons d’emblée un malentendu. Il ne s’agit pas de réhabiliter la valeur travail. Ou plutôt il s’agit de bien plus que cela. On a trop souvent confondu justement l’effort et le travail, comme si le premier ne s’imposait qu’au sein du second. Si la perte de l’effort est dramatique, c’est précisément parce que son rôle déborde de beaucoup la simple question de l’effort rémunéré. Le travail n’est qu’une petite partie du tableau. Et probablement pas la plus importante contrairement a ce qu’on pense.
La thèse de ce livre est que nous perdons le sens de l’effort. Il se produit une détente inédite dans notre rapport au monde. La corde hier vibrante de l’humanité ne joue presque plus, comme si la cheville avait lâché. En tout cas en France et dans nombre de pays proches. Apparemment pas ailleurs. C’est une rupture civilisationnelle majeure qui se produit. Quelque chose s’est brisé dans notre relation à l’ardeur […] Si cette ère de la flemme suit la logique cyclique des Trente Paresseuses, elle devrait finir avec 2035.
On a flatté les flemmards
Et en effet d’ici une dizaine d’années le processus devrait aboutir à un terme naturel. Parce que ces années mèneront logiquement à une forme de faillite économique et politique qui marquera, d’une façon ou d’une autre, un coup d’arrêt à ce que nous étions. Comme c’est arrivé cent fois dans l’histoire des civilisations, nous ferons probablement l’objet d’une forme de colonisation culturelle, économique et politique. Car l’ère de la flemme ne concerne que les vieux pays d’Occident. Une énergie qui habitait l’humanité depuis toujours est en train de nous quitter. En particulier les plus jeunes. Nous perdons ce souffle vital qui avait permis notre survie et nos plus belles œuvres. Rodrigue avait du cœur. Nous n’en avons plus guère.
On craignait d’avoir élevé des révolutionnaires. C’est pire que ça : on a élevé des paresseux. On a flatté les flemmards et célébré les tire-au-flanc. La crise de l’effort ne concerne d’ailleurs pas que les jeunes. Notre époque est un trou noir à énergie pour quiconque y vit. Tout ou presque y semble irrésistiblement absorbé. On accuse tous les jours les riches de ne pas payer leur part d’impôt, mais au fond on vénère la rente. On l’envie. On la respecte plus que la réussite par le travail, qui est celle des nouveaux riches méprisés. Vivre aux dépens des efforts des autres est notre grande affaire.



«On craignait d’avoir élevé des révolutionnaires, c’est pire que ça : on a élevé des paresseux»

Prise de distance par rapport au travail, paresse généralisée, déclassement… dans l’Ère de la flemme , dont Le Figaro Magazine publie des extraits, Olivier Babeau dénonce une crise de l’effort qui pourrait pénaliser durablement notre pays.
Professeur d’université, Olivier Babeau est président-fondateur de l’Institut Sapiens, un laboratoire d’idées dédié à la place de l’être humain dans le monde technologique.
En matière de travail , nous sommes passés d’une logique du « toujours mieux » à celle du « juste assez ». L’éthique de l’amélioration permanente a fait place à l’éthique du minimum possible. La cause ? L’industrialisation d’abord […] La logique industrielle du produit a effacé la logique artisanale de l’œuvre. Le tour de main perd son importance.
La tertiarisation de l’économie et l’élargissement des lignes hiérarchiques ont multiplié les emplois aux contours peu définis et à l’utilité douteuse : les fameux bullshit jobs du sociologue David Graeber […] Seconde cause de la fin du travail bien fait : son statut a changé. On ne croit plus en rien, et surtout pas en lui. On n’espère plus rien, même pas une vie meilleure par le travail […] Farniente, c’est-à-dire en italien ne rien faire, est devenu un programme à part entière.
En 2024, l’une des tendances qui fait fureur sur les réseaux sociaux est celle du bed rotting (littéralement : « pourrir au lit »). Le principe ? Rester au lit aussi longtemps que possible. Toute la journée idéalement. Pour y faire quoi ? Rien. En pratique : faire défiler à l’infini les contenus des réseaux sociaux, somnoler, regarder ses séries préférées. Joie ! On atteint les limites extrêmes de l’injonction à la paresse.
Le Covid, un moment charnière

Il s’agit de se transformer en sorte de mort-vivant. De limace géante. Les risques associés à cet étrange mode de vie sont ceux de la sédentarité et de l’addiction aux écrans : réclusion sociale, diabète, maladie de cœur, dépression, etc. Difficile de ne pas décrire ce genre de loisir comme dysfonctionnel dès lors qu’il devient une habitude. Déjà en 2003, l’accorte chanteuse Alizée chantait : « J’ai pas de problèmes, je fainéante […] Bien à mon aise, dans l’air du temps » […]
Le Covid a constitué un moment charnière dans ce grand découragement. La rupture complète de rythme pendant deux mois, la découverte de la vie oisive, la réflexion sur le sens de sa vie : tout a pu concourir à ce que le Covid brise durablement notre rapport à l’effort en général et au travail en particulier. Mais le Covid n’explique pas tout. Les premiers signes étaient apparus avant.
On a fêté en décembre 2023 les vingt-cinq ans des 35 heures et les quarante deux ans de la retraite à 60 ans par répartition. Triste fête, en vérité. Le problème des décisions politiques est de mettre très longtemps à prouver leur bien-fondé ou leurs défauts. En l’occurrence, ces décisions se révèlent des catastrophes absolues. Plus de trois décennies l’ont montré.
Les 35 heures, c’était l’illusion de l’argent gratuit avant la lettre. Elles ont été payées par de moindres hausses de salaire et se sont traduites par une croissance moins forte que notre voisin allemand. Selon Xavier Fontanet, le différentiel de 3 % de croissance par rapport à l’Allemagne sur vingt-cinq ans aurait représenté une perte de richesse de 2 000 milliards d’euros.
La France travaille trop peu […] Trop de gens en âge de travailler sont sortis du marché de l’emploi. La France a une préférence pour le loisir : elle préfère limiter son temps de travail, donc ses revenus, pour augmenter son temps libre. Compense-t-on par une productivité plus grande que les autres pays ? C’était plutôt le cas. Ça ne l’est plus.
L’effort n’intéresse plus

La croissance de la productivité du travail aux États-Unis a été le double de celle des pays de la zone euro depuis vingt ans. La France est l’avant-dernier pays parmi tous les pays développés en termes d’évolution de la richesse créée par heure travaillée entre 2017 et 2022 : alors que presque tous les pays progressent, comme l’Irlande par exemple avec 38 % de progression, nous reculons de 3 %. Nous sommes moins productifs […]
L’effort n’intéresse plus. Il n’est plus donné en exemple, ni inscrit au nombre des valeurs qui comptent. On lui préfère les vertus égalitaristes de l’humilité et de la passivité. On ne salue plus le héros, mais la victime. Le tire-au-flanc, le profiteur des efforts des autres est excusé, presque considéré avec bienveillance. On se méfie de l’excellence, quand on ne nie pas tout simplement son existence. L’élitisme était une qualification louangeuse, c’est devenu un reproche. Il est désormais de mauvais ton de se distinguer. Le médiocre rassure.
Si l’on écoute les grands débats sur les impôts ou la retraite, on a parfois l’impression que le but essentiel de tout citoyen est de parvenir à capter les prébendes généreuses de la redistribution, durant la vie active ou la retraite. Chacun compte sur le travail des autres beaucoup plus que sur son propre travail. La préférence pour la paresse s’est inséminée dans toutes les dimensions de la société. Autrefois on exaltait l’effort, aujourd’hui il dérange. Hier célébré et placé sur un piédestal, l’effort est maintenant sur le banc des accusés. Étrange époque que celle où l’effort a besoin d’un avocat […]
La paresse nous tue. Nous n’avons pas fini de le mesurer. L’effort est le ressort caché des civilisations, le principe qui fait tenir une existence debout. Le perdre, c’est s’effondrer.
Dissipons d’emblée un malentendu. Il ne s’agit pas de réhabiliter la valeur travail. Ou plutôt il s’agit de bien plus que cela. On a trop souvent confondu justement l’effort et le travail, comme si le premier ne s’imposait qu’au sein du second. Si la perte de l’effort est dramatique, c’est précisément parce que son rôle déborde de beaucoup la simple question de l’effort rémunéré. Le travail n’est qu’une petite partie du tableau. Et probablement pas la plus importante contrairement a ce qu’on pense.
La thèse de ce livre est que nous perdons le sens de l’effort. Il se produit une détente inédite dans notre rapport au monde. La corde hier vibrante de l’humanité ne joue presque plus, comme si la cheville avait lâché. En tout cas en France et dans nombre de pays proches. Apparemment pas ailleurs. C’est une rupture civilisationnelle majeure qui se produit. Quelque chose s’est brisé dans notre relation à l’ardeur […] Si cette ère de la flemme suit la logique cyclique des Trente Paresseuses, elle devrait finir avec 2035.
On a flatté les flemmards

Et en effet d’ici une dizaine d’années le processus devrait aboutir à un terme naturel. Parce que ces années mèneront logiquement à une forme de faillite économique et politique qui marquera, d’une façon ou d’une autre, un coup d’arrêt à ce que nous étions. Comme c’est arrivé cent fois dans l’histoire des civilisations, nous ferons probablement l’objet d’une forme de colonisation culturelle, économique et politique. Car l’ère de la flemme ne concerne que les vieux pays d’Occident. Une énergie qui habitait l’humanité depuis toujours est en train de nous quitter. En particulier les plus jeunes. Nous perdons ce souffle vital qui avait permis notre survie et nos plus belles œuvres. Rodrigue avait du cœur. Nous n’en avons plus guère.
On craignait d’avoir élevé des révolutionnaires. C’est pire que ça : on a élevé des paresseux. On a flatté les flemmards et célébré les tire-au-flanc. La crise de l’effort ne concerne d’ailleurs pas que les jeunes. Notre époque est un trou noir à énergie pour quiconque y vit. Tout ou presque y semble irrésistiblement absorbé. On accuse tous les jours les riches de ne pas payer leur part d’impôt, mais au fond on vénère la rente. On l’envie. On la respecte plus que la réussite par le travail, qui est celle des nouveaux riches méprisés. Vivre aux dépens des efforts des autres est notre grande affaire.
il y a 7 mois
Et les commentaires ? Pas mal de boomers doivent avoir atteint l'orgasme, non ?

https://cnews.boats Juif qui parle, bouche qui ment.
il y a 7 mois
Olivier Babeau est né le 26 mars 1976 à Neuilly-sur-Seine. Il est le fils de l'économiste André Babeau.
Enseignant à l'université de Paris-Dauphine, puis à l'université Paris VIII Vincennes et à l’université de Bordeaux, il fait en parallèle un bref passage en politique1.
Il a été directeur des études et porte-parole de la Fondation Concorde jusqu’en 2017. Depuis 2017, il dirige l’Institut Sapiens, un think tank, dont il est le cofondateur2,3.
En parallèle, il dirige un cabinet de conseil (Human First). Olivier Babeau intervient régulièrement dans les médias. Il est souvent présenté comme — et se revendique — libéral4.
À partir de 2024, il assure la chronique économique de la matinale d'Europe 15.
« Il s’intéresse en particulier aux mutations des modèles économiques liées à la diffusion du numérique. »6
autant vous dire que cette article a été écrit par un fils à papa qui n'a jamais mis un pied à l'usine



Enseignant à l'université de Paris-Dauphine, puis à l'université Paris VIII Vincennes et à l’université de Bordeaux, il fait en parallèle un bref passage en politique1.
Il a été directeur des études et porte-parole de la Fondation Concorde jusqu’en 2017. Depuis 2017, il dirige l’Institut Sapiens, un think tank, dont il est le cofondateur2,3.
En parallèle, il dirige un cabinet de conseil (Human First). Olivier Babeau intervient régulièrement dans les médias. Il est souvent présenté comme — et se revendique — libéral4.
À partir de 2024, il assure la chronique économique de la matinale d'Europe 15.
« Il s’intéresse en particulier aux mutations des modèles économiques liées à la diffusion du numérique. »6
autant vous dire que cette article a été écrit par un fils à papa qui n'a jamais mis un pied à l'usine

il y a 7 mois
WaifuGhislaine
7 mois
un article écrit par le boomer Olivier Babeau :  https://www.lefigaro.fr/l[...]ve-des-paresseux-20250111
https://www.lefigaro.fr/l[...]ve-des-paresseux-20250111
«On craignait d’avoir élevé des révolutionnaires, c’est pire que ça : on a élevé des paresseux»
Prise de distance par rapport au travail, paresse généralisée, déclassement… dans l’Ère de la flemme , dont Le Figaro Magazine publie des extraits, Olivier Babeau dénonce une crise de l’effort qui pourrait pénaliser durablement notre pays.
Professeur d’université, Olivier Babeau est président-fondateur de l’Institut Sapiens, un laboratoire d’idées dédié à la place de l’être humain dans le monde technologique.
En matière de travail , nous sommes passés d’une logique du « toujours mieux » à celle du « juste assez ». L’éthique de l’amélioration permanente a fait place à l’éthique du minimum possible. La cause ? L’industrialisation d’abord […] La logique industrielle du produit a effacé la logique artisanale de l’œuvre. Le tour de main perd son importance.
La tertiarisation de l’économie et l’élargissement des lignes hiérarchiques ont multiplié les emplois aux contours peu définis et à l’utilité douteuse : les fameux bullshit jobs du sociologue David Graeber […] Seconde cause de la fin du travail bien fait : son statut a changé. On ne croit plus en rien, et surtout pas en lui. On n’espère plus rien, même pas une vie meilleure par le travail […] Farniente, c’est-à-dire en italien ne rien faire, est devenu un programme à part entière.
En 2024, l’une des tendances qui fait fureur sur les réseaux sociaux est celle du bed rotting (littéralement : « pourrir au lit »). Le principe ? Rester au lit aussi longtemps que possible. Toute la journée idéalement. Pour y faire quoi ? Rien. En pratique : faire défiler à l’infini les contenus des réseaux sociaux, somnoler, regarder ses séries préférées. Joie ! On atteint les limites extrêmes de l’injonction à la paresse.
Le Covid, un moment charnière
Il s’agit de se transformer en sorte de mort-vivant. De limace géante. Les risques associés à cet étrange mode de vie sont ceux de la sédentarité et de l’addiction aux écrans : réclusion sociale, diabète, maladie de cœur, dépression, etc. Difficile de ne pas décrire ce genre de loisir comme dysfonctionnel dès lors qu’il devient une habitude. Déjà en 2003, l’accorte chanteuse Alizée chantait : « J’ai pas de problèmes, je fainéante […] Bien à mon aise, dans l’air du temps » […]
Le Covid a constitué un moment charnière dans ce grand découragement. La rupture complète de rythme pendant deux mois, la découverte de la vie oisive, la réflexion sur le sens de sa vie : tout a pu concourir à ce que le Covid brise durablement notre rapport à l’effort en général et au travail en particulier. Mais le Covid n’explique pas tout. Les premiers signes étaient apparus avant.
On a fêté en décembre 2023 les vingt-cinq ans des 35 heures et les quarante deux ans de la retraite à 60 ans par répartition. Triste fête, en vérité. Le problème des décisions politiques est de mettre très longtemps à prouver leur bien-fondé ou leurs défauts. En l’occurrence, ces décisions se révèlent des catastrophes absolues. Plus de trois décennies l’ont montré.
Les 35 heures, c’était l’illusion de l’argent gratuit avant la lettre. Elles ont été payées par de moindres hausses de salaire et se sont traduites par une croissance moins forte que notre voisin allemand. Selon Xavier Fontanet, le différentiel de 3 % de croissance par rapport à l’Allemagne sur vingt-cinq ans aurait représenté une perte de richesse de 2 000 milliards d’euros.
La France travaille trop peu […] Trop de gens en âge de travailler sont sortis du marché de l’emploi. La France a une préférence pour le loisir : elle préfère limiter son temps de travail, donc ses revenus, pour augmenter son temps libre. Compense-t-on par une productivité plus grande que les autres pays ? C’était plutôt le cas. Ça ne l’est plus.
L’effort n’intéresse plus
La croissance de la productivité du travail aux États-Unis a été le double de celle des pays de la zone euro depuis vingt ans. La France est l’avant-dernier pays parmi tous les pays développés en termes d’évolution de la richesse créée par heure travaillée entre 2017 et 2022 : alors que presque tous les pays progressent, comme l’Irlande par exemple avec 38 % de progression, nous reculons de 3 %. Nous sommes moins productifs […]
L’effort n’intéresse plus. Il n’est plus donné en exemple, ni inscrit au nombre des valeurs qui comptent. On lui préfère les vertus égalitaristes de l’humilité et de la passivité. On ne salue plus le héros, mais la victime. Le tire-au-flanc, le profiteur des efforts des autres est excusé, presque considéré avec bienveillance. On se méfie de l’excellence, quand on ne nie pas tout simplement son existence. L’élitisme était une qualification louangeuse, c’est devenu un reproche. Il est désormais de mauvais ton de se distinguer. Le médiocre rassure.
Si l’on écoute les grands débats sur les impôts ou la retraite, on a parfois l’impression que le but essentiel de tout citoyen est de parvenir à capter les prébendes généreuses de la redistribution, durant la vie active ou la retraite. Chacun compte sur le travail des autres beaucoup plus que sur son propre travail. La préférence pour la paresse s’est inséminée dans toutes les dimensions de la société. Autrefois on exaltait l’effort, aujourd’hui il dérange. Hier célébré et placé sur un piédestal, l’effort est maintenant sur le banc des accusés. Étrange époque que celle où l’effort a besoin d’un avocat […]
La paresse nous tue. Nous n’avons pas fini de le mesurer. L’effort est le ressort caché des civilisations, le principe qui fait tenir une existence debout. Le perdre, c’est s’effondrer.
Dissipons d’emblée un malentendu. Il ne s’agit pas de réhabiliter la valeur travail. Ou plutôt il s’agit de bien plus que cela. On a trop souvent confondu justement l’effort et le travail, comme si le premier ne s’imposait qu’au sein du second. Si la perte de l’effort est dramatique, c’est précisément parce que son rôle déborde de beaucoup la simple question de l’effort rémunéré. Le travail n’est qu’une petite partie du tableau. Et probablement pas la plus importante contrairement a ce qu’on pense.
La thèse de ce livre est que nous perdons le sens de l’effort. Il se produit une détente inédite dans notre rapport au monde. La corde hier vibrante de l’humanité ne joue presque plus, comme si la cheville avait lâché. En tout cas en France et dans nombre de pays proches. Apparemment pas ailleurs. C’est une rupture civilisationnelle majeure qui se produit. Quelque chose s’est brisé dans notre relation à l’ardeur […] Si cette ère de la flemme suit la logique cyclique des Trente Paresseuses, elle devrait finir avec 2035.
On a flatté les flemmards
Et en effet d’ici une dizaine d’années le processus devrait aboutir à un terme naturel. Parce que ces années mèneront logiquement à une forme de faillite économique et politique qui marquera, d’une façon ou d’une autre, un coup d’arrêt à ce que nous étions. Comme c’est arrivé cent fois dans l’histoire des civilisations, nous ferons probablement l’objet d’une forme de colonisation culturelle, économique et politique. Car l’ère de la flemme ne concerne que les vieux pays d’Occident. Une énergie qui habitait l’humanité depuis toujours est en train de nous quitter. En particulier les plus jeunes. Nous perdons ce souffle vital qui avait permis notre survie et nos plus belles œuvres. Rodrigue avait du cœur. Nous n’en avons plus guère.
On craignait d’avoir élevé des révolutionnaires. C’est pire que ça : on a élevé des paresseux. On a flatté les flemmards et célébré les tire-au-flanc. La crise de l’effort ne concerne d’ailleurs pas que les jeunes. Notre époque est un trou noir à énergie pour quiconque y vit. Tout ou presque y semble irrésistiblement absorbé. On accuse tous les jours les riches de ne pas payer leur part d’impôt, mais au fond on vénère la rente. On l’envie. On la respecte plus que la réussite par le travail, qui est celle des nouveaux riches méprisés. Vivre aux dépens des efforts des autres est notre grande affaire.
«On craignait d’avoir élevé des révolutionnaires, c’est pire que ça : on a élevé des paresseux»

Prise de distance par rapport au travail, paresse généralisée, déclassement… dans l’Ère de la flemme , dont Le Figaro Magazine publie des extraits, Olivier Babeau dénonce une crise de l’effort qui pourrait pénaliser durablement notre pays.
Professeur d’université, Olivier Babeau est président-fondateur de l’Institut Sapiens, un laboratoire d’idées dédié à la place de l’être humain dans le monde technologique.
En matière de travail , nous sommes passés d’une logique du « toujours mieux » à celle du « juste assez ». L’éthique de l’amélioration permanente a fait place à l’éthique du minimum possible. La cause ? L’industrialisation d’abord […] La logique industrielle du produit a effacé la logique artisanale de l’œuvre. Le tour de main perd son importance.
La tertiarisation de l’économie et l’élargissement des lignes hiérarchiques ont multiplié les emplois aux contours peu définis et à l’utilité douteuse : les fameux bullshit jobs du sociologue David Graeber […] Seconde cause de la fin du travail bien fait : son statut a changé. On ne croit plus en rien, et surtout pas en lui. On n’espère plus rien, même pas une vie meilleure par le travail […] Farniente, c’est-à-dire en italien ne rien faire, est devenu un programme à part entière.
En 2024, l’une des tendances qui fait fureur sur les réseaux sociaux est celle du bed rotting (littéralement : « pourrir au lit »). Le principe ? Rester au lit aussi longtemps que possible. Toute la journée idéalement. Pour y faire quoi ? Rien. En pratique : faire défiler à l’infini les contenus des réseaux sociaux, somnoler, regarder ses séries préférées. Joie ! On atteint les limites extrêmes de l’injonction à la paresse.
Le Covid, un moment charnière

Il s’agit de se transformer en sorte de mort-vivant. De limace géante. Les risques associés à cet étrange mode de vie sont ceux de la sédentarité et de l’addiction aux écrans : réclusion sociale, diabète, maladie de cœur, dépression, etc. Difficile de ne pas décrire ce genre de loisir comme dysfonctionnel dès lors qu’il devient une habitude. Déjà en 2003, l’accorte chanteuse Alizée chantait : « J’ai pas de problèmes, je fainéante […] Bien à mon aise, dans l’air du temps » […]
Le Covid a constitué un moment charnière dans ce grand découragement. La rupture complète de rythme pendant deux mois, la découverte de la vie oisive, la réflexion sur le sens de sa vie : tout a pu concourir à ce que le Covid brise durablement notre rapport à l’effort en général et au travail en particulier. Mais le Covid n’explique pas tout. Les premiers signes étaient apparus avant.
On a fêté en décembre 2023 les vingt-cinq ans des 35 heures et les quarante deux ans de la retraite à 60 ans par répartition. Triste fête, en vérité. Le problème des décisions politiques est de mettre très longtemps à prouver leur bien-fondé ou leurs défauts. En l’occurrence, ces décisions se révèlent des catastrophes absolues. Plus de trois décennies l’ont montré.
Les 35 heures, c’était l’illusion de l’argent gratuit avant la lettre. Elles ont été payées par de moindres hausses de salaire et se sont traduites par une croissance moins forte que notre voisin allemand. Selon Xavier Fontanet, le différentiel de 3 % de croissance par rapport à l’Allemagne sur vingt-cinq ans aurait représenté une perte de richesse de 2 000 milliards d’euros.
La France travaille trop peu […] Trop de gens en âge de travailler sont sortis du marché de l’emploi. La France a une préférence pour le loisir : elle préfère limiter son temps de travail, donc ses revenus, pour augmenter son temps libre. Compense-t-on par une productivité plus grande que les autres pays ? C’était plutôt le cas. Ça ne l’est plus.
L’effort n’intéresse plus

La croissance de la productivité du travail aux États-Unis a été le double de celle des pays de la zone euro depuis vingt ans. La France est l’avant-dernier pays parmi tous les pays développés en termes d’évolution de la richesse créée par heure travaillée entre 2017 et 2022 : alors que presque tous les pays progressent, comme l’Irlande par exemple avec 38 % de progression, nous reculons de 3 %. Nous sommes moins productifs […]
L’effort n’intéresse plus. Il n’est plus donné en exemple, ni inscrit au nombre des valeurs qui comptent. On lui préfère les vertus égalitaristes de l’humilité et de la passivité. On ne salue plus le héros, mais la victime. Le tire-au-flanc, le profiteur des efforts des autres est excusé, presque considéré avec bienveillance. On se méfie de l’excellence, quand on ne nie pas tout simplement son existence. L’élitisme était une qualification louangeuse, c’est devenu un reproche. Il est désormais de mauvais ton de se distinguer. Le médiocre rassure.
Si l’on écoute les grands débats sur les impôts ou la retraite, on a parfois l’impression que le but essentiel de tout citoyen est de parvenir à capter les prébendes généreuses de la redistribution, durant la vie active ou la retraite. Chacun compte sur le travail des autres beaucoup plus que sur son propre travail. La préférence pour la paresse s’est inséminée dans toutes les dimensions de la société. Autrefois on exaltait l’effort, aujourd’hui il dérange. Hier célébré et placé sur un piédestal, l’effort est maintenant sur le banc des accusés. Étrange époque que celle où l’effort a besoin d’un avocat […]
La paresse nous tue. Nous n’avons pas fini de le mesurer. L’effort est le ressort caché des civilisations, le principe qui fait tenir une existence debout. Le perdre, c’est s’effondrer.
Dissipons d’emblée un malentendu. Il ne s’agit pas de réhabiliter la valeur travail. Ou plutôt il s’agit de bien plus que cela. On a trop souvent confondu justement l’effort et le travail, comme si le premier ne s’imposait qu’au sein du second. Si la perte de l’effort est dramatique, c’est précisément parce que son rôle déborde de beaucoup la simple question de l’effort rémunéré. Le travail n’est qu’une petite partie du tableau. Et probablement pas la plus importante contrairement a ce qu’on pense.
La thèse de ce livre est que nous perdons le sens de l’effort. Il se produit une détente inédite dans notre rapport au monde. La corde hier vibrante de l’humanité ne joue presque plus, comme si la cheville avait lâché. En tout cas en France et dans nombre de pays proches. Apparemment pas ailleurs. C’est une rupture civilisationnelle majeure qui se produit. Quelque chose s’est brisé dans notre relation à l’ardeur […] Si cette ère de la flemme suit la logique cyclique des Trente Paresseuses, elle devrait finir avec 2035.
On a flatté les flemmards

Et en effet d’ici une dizaine d’années le processus devrait aboutir à un terme naturel. Parce que ces années mèneront logiquement à une forme de faillite économique et politique qui marquera, d’une façon ou d’une autre, un coup d’arrêt à ce que nous étions. Comme c’est arrivé cent fois dans l’histoire des civilisations, nous ferons probablement l’objet d’une forme de colonisation culturelle, économique et politique. Car l’ère de la flemme ne concerne que les vieux pays d’Occident. Une énergie qui habitait l’humanité depuis toujours est en train de nous quitter. En particulier les plus jeunes. Nous perdons ce souffle vital qui avait permis notre survie et nos plus belles œuvres. Rodrigue avait du cœur. Nous n’en avons plus guère.
On craignait d’avoir élevé des révolutionnaires. C’est pire que ça : on a élevé des paresseux. On a flatté les flemmards et célébré les tire-au-flanc. La crise de l’effort ne concerne d’ailleurs pas que les jeunes. Notre époque est un trou noir à énergie pour quiconque y vit. Tout ou presque y semble irrésistiblement absorbé. On accuse tous les jours les riches de ne pas payer leur part d’impôt, mais au fond on vénère la rente. On l’envie. On la respecte plus que la réussite par le travail, qui est celle des nouveaux riches méprisés. Vivre aux dépens des efforts des autres est notre grande affaire.
Ok on réduit les retraites de moitié pour alléger les impôts des actifs et on supprime toutes les aides et je considérerai peut-être de travailler en France

never dies.
il y a 7 mois
Ok on réduit les retraites de moitié pour alléger les impôts des actifs et on supprime toutes les aides et je considérerai peut-être de travailler en France

il y a 7 mois
Espérer la "logique du toujours mieux" quand ce pays de merde fait toujours pire à tous les niveaux en nous chiant dessus sans aucune vergogne, et que ces vieux fils de putains de boomers ne récompensent même pas l'effort en traitant leurs emplo esclaves comme de la merde. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette non motivation générale à se suer à la tâche, je comprends pas non plus

Qu'ils aillent se faire foutre.

Qu'ils aillent se faire foutre.
𓃫 𓃩 𓁣
il y a 7 mois
Je propose de diviser par deux toute portion d'une pension de retraite supérieure au SMIC pour redonner aux jeunes le fruit de leur travail et le goût de l'effort.

il y a 7 mois
etudianthumide
7 mois
sacrifier son temps pour des miettes

il y a 7 mois
WaifuGhislaine
7 mois
Olivier Babeau est né le 26 mars 1976 à Neuilly-sur-Seine. Il est le fils de l'économiste André Babeau.
Enseignant à l'université de Paris-Dauphine, puis à l'université Paris VIII Vincennes et à l’université de Bordeaux, il fait en parallèle un bref passage en politique1.
Il a été directeur des études et porte-parole de la Fondation Concorde jusqu’en 2017. Depuis 2017, il dirige l’Institut Sapiens, un think tank, dont il est le cofondateur2,3.
En parallèle, il dirige un cabinet de conseil (Human First). Olivier Babeau intervient régulièrement dans les médias. Il est souvent présenté comme — et se revendique — libéral4.
À partir de 2024, il assure la chronique économique de la matinale d'Europe 15.
« Il s’intéresse en particulier aux mutations des modèles économiques liées à la diffusion du numérique. »6
autant vous dire que cette article a été écrit par un fils à papa qui n'a jamais mis un pied à l'usine
Enseignant à l'université de Paris-Dauphine, puis à l'université Paris VIII Vincennes et à l’université de Bordeaux, il fait en parallèle un bref passage en politique1.
Il a été directeur des études et porte-parole de la Fondation Concorde jusqu’en 2017. Depuis 2017, il dirige l’Institut Sapiens, un think tank, dont il est le cofondateur2,3.
En parallèle, il dirige un cabinet de conseil (Human First). Olivier Babeau intervient régulièrement dans les médias. Il est souvent présenté comme — et se revendique — libéral4.
À partir de 2024, il assure la chronique économique de la matinale d'Europe 15.
« Il s’intéresse en particulier aux mutations des modèles économiques liées à la diffusion du numérique. »6
autant vous dire que cette article a été écrit par un fils à papa qui n'a jamais mis un pied à l'usine

Bordel les types qui parlent d'effort alors qu'ils ont jamais rien fait de productif dans leur vie

il y a 7 mois