Ce sujet a été résolu
Sondage – 17 votes
Le Mia Califat
Califat Omeyyade
Califat abbasside
Empire ottoman
Califat fatimide
Califat Rashidun
il y a un an
La Califat Mia, la seule bonne chose que puisse faire ce peuple
Suomen voimat näytetään, Keinot karskit käytetään !

il y a un an

GrandeBrisure
1 an
La Califat Mia, la seule bonne chose que puisse faire ce peuple
qu'Allah l'agrée

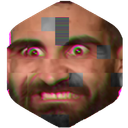


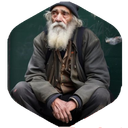




il y a un an
L'OP c'est dommage que tu n'aie pas mis le califat de Cordoue.
Art et culture dans le monde musulman. Les traits les plus caractéristiques de cet art et culture prirent place dans le monde irakien au IXème siècle; l'éclatement de l'empire abbâsside provoqua rtoutefois de bonne heure le développement de variantes régionales. A l'époque préislamique, les Arabes étaient assez totalement étrangers aux arts figurés; en revanche ils possédaient en matière littéraire toute une tradition de poésie orale qui ordonnée en qasîde, chantait la vie au désert; ils possédaient aussi en langue poétique commune, en laquelle fut exprimé le Coran. La mise par écrit de ce monument littéraire marque le début d'une culture écrite. La fondation de l'empire arabe prolongea durablement les conquérants dans des milieux culturels divers dont le contact permit l'éclosion d'une première littérature musulmane et d'un art qui n'était ni tout à fait arabe ni purement byzantin ou iranien, un art de l'Islam. Les besoins religieux déterminèrent tout d'abord les premières réalisations artistiques et l'élaboration d'une langue de culture. Les musulmans édifièrent des lieux de culte : parfois ils se bornèrent à réaménager des édifices existants dans les villes neuves. Dès l'époque umayyade apparut aussi une architecture religieuse, celle des mosquées qui surent utiliserles traditions décoratives des mosaistes chrétiens. Le plan de la mosquée à transept avec rangées de colonnes perpendiculaires au mur qibla est alors le plus répandu. Les mosquées édifiées à cette époque parfois connues par les seules témoignages littéraires, sont celles de Basra, Kufa, Médine, Alep, Fustât et la mosquée d'al Aqsâ à Jérusalem.
Le souci de fixer la langue du Coran pour préserver son caractère sacré détermina une vaste enquête qui se poursuivit le long du VIIIème siècle et aboutit à un corpus de la langue arabe : l'examen des hadith du Prophète et de la vieille poésie bédouine rapportés par la tradition orale et mis par écrit, l'étue du vocubulaire employé par les diverses tribus arabes permirent aux grammairiens et lexicographes, à Basra et à Kura, de tirer des lois et d'établir une grammaire. Sibawayh, grammmairien de Basra mort en 793, illustre bien cette activité. Ainsi se forgea la langue écrite, instrument de l'expression littéraire. Les premiers développements artistiques et littéraires ne se limitent pas à répondre à des nécessités religieuses : la formation d'une administraion, la constitution d'un milieu de cour, l'adoption de la langue arabe comme langue administrative suscitèrent d'autres réalisations. Une achitecture civile apparut avec les palais syriens ou l'ornementation fait large place à l'élément figuré. Quant aux poètes ils conservèrent leur place mais tout en prolongeant les grandes traditions de la poésie préislamique, ils laissent percevoir la marque de la nouvelle société, urbaine et islamisée. La prose littéraire fit également son apparition. Abd al Hamid ibn Yahya, membre de l'administration ymayyade, est considéré comme le premier styliste authentique créateur de l'épître. Son oeuvre exprime l'avènement de la classe des kuttâb et de leur goût pour la culture. Son discipleIbn al Muqaffa doit sa célébrité à la traduction en arabe à partir d'une version pehlvie, des fables indiennes de Kalîla et Dimma. Mais le vrai créateur de la prose arabe fût al Djâhiz, ce grand écrivain de Basra. Défenseur d'une culture arabe, il a laissé une abaondanet oeuvre sur les sujets les plus variés, entre autres de petits traités décrivant avec verve et humour de son temps; le " Livre des Avares ", le traité sur les Turcs, celui sur les marchands, etc...
A partir du IXème siècle un prodigieux effort intellectuel particulièrement affirmé entre 850 et 950 se déploya. On voit alors apparaître en matière architacturale et décorative un art dont les éléments furent indéfiniment utilisés et diversement combinés par les siècles ultérieurs. Une culture nouvelle nettement arabo islamique se forme, dans laquelle les diverses branches du savoir commencèrent à se diversifier. Dans l'un et l'autre domaine, l'influence des civilisations antiques, grecque, perse, indienne, fut certaine, si grande même qu'à certains moments elle alimenta dans les milieux intellectuels un débat entre tenants des traditions arabes et adeptes de ces civilisations, srtout l'iranienne. Tel est le mouvement connu sous le nom de shu"ûbiyya. L'art nouveau nous est révélé par la ville de Sâmarrâ. L'ancienne cité de Bagdad aujourd'hui détruite n'est accessible que via tradition littéraire alors que la ville de Sâmarrâ, créée pour le khailfe al Mu'stasim qui s'y installa en 838 fut totalement délaissée dès la fin du IXème siècle et devint un site inhabité que l'archéologie nous restitue peu à peu. Par les formes d'architecture et de décoration déployées, l'art de Sâmarrâ nous révèle ce que fut le premier art abbâsside. La grande mosquée avec son minaret à spirales, un mausolée et divers palais manifestent des formes architecturales nouvelles. Les palais associent aux traditionnelles salles du trône à coupole des iwân, d'inspiration sassanide. De nouveaux types d'arc apparaissent comme l'arc outrepassé.
La sculpture ornementale en haut relief n'existe pas, mais le décor ornemental laisse apparaître de plus en plus souvent les niches polylobées superposées ou en files, ainsi qu'un procédé nouveau de remplissage des surfaces : les stalactites. Dans le décor stuqué, fréquemment employé, on utilise ainsi qu'un procédé de la taille oblique soulignant les reliefs de façon plus nuancée. Le penchant pour ls tylisation et l'ornementation géométrique apparaît dans le décor à palmettes diversement combinées et dans les formes primitives de l'arabesque. Le mihrab srutout est l'objet d'une décoration soignée et abandonne la forme ronde pour adopter un cadre rectangulaire. Les nombreuses céramiques trouvées à Sâmarrâ révèlent l'introduction dans le monde musulman de la vaissellle de faiance et de porcelaine de Chine, mais aussi l'apparition d'une cérémique totalement originale, la caramique lustrée susceptible d'une étonnante diversité. Là aussi aussi se retrouve le décor à palmettes tandis qu'apparaît un type de décoration épigraphique utilisant une écriture arabe angulaire, le coufique. Le travail du bois, de l'voire, atteste un haut niveau. Ainsi se constituait peu à peu un fonds en matière artistique auquel allaient puiser les autres de l'Emppire. A la fin du IXème siucle l'influence de l'art de Sâmarrâ est très sensible en Egypte, à la mosquée d'Ibn Tûun construite entre 876 et 879, et remarquablement conservée avec ses piliers de brique dont le noyau octogonal est cantonné de 4 minces colonnes de marbre, ses niches polylobées qui articulent la façade; l'ornementation répond au style de Sâmarrâ.
La culture s'élaborant à partir du IXème siècle s'exprime en arabe : par l'étendue de son vocabulaire et sa grammaire la langue a atteint une sorte de perfection. Déjà cependant cette langue écrite s'éloigne des dialectes et des parlers citadins. Mais elle est utilisée par les milieux dirigeants, employée dans l'administration. Difficile à écrire, elle impose un apprentissage et la fréquentation des grammairiens. Certes l'arabe n'a pas faît disparaître les autres langues. Cependant les Iraniens eux mêmes écrivent en arabe et on voit même une littérature chrétienne se constituer en arabe. C'est une culture de citadins et de cités : les villes d'Irak comme Basra, Kûfa, Bagdad puis des centres régionaux, offrent les instruments de travail ( bibiothèques dont la construction se développe ), les mécènes et la clientèle : cours, fonctionnaires, savants, etc... Mais quelle que soit la primauté de l'arabe, ou l'attachement aux traditions arabes, la culture au IXème siècle est marquée par la reconnaissance des civilisations antiques. Si le khalife al Mansûr passe pour avoir demandé à Constantinople des ouvrages de mathématiques, c'est avec al Ma'mûn que se manifeste le mieux le souci d'incorporer à la culture arabi musulmane les connaissances antiques. Ainsi mena t il une véritable politique de traductions, cherchant textes et traducteurs. Il n' a pas à proprement parler fondé la " Maison de la Sagesse " ou Bayt al hikma, il a du moins donné une forte impulsion à l'activité de cette vaste bibiothèque où travaillaient et se réunissaient astronomes, mathématiciens, penseurs, lettrés, traducteurs et dont les fonds furent mis à disposition des musulmans, surotut des oeuvres philosophiques et scientifiques. La traduction s'accompagnant de réflexions et commentaires, cette politique devait peu à peu provoquer l'apparition d'une forme nouvelle de littérature.
Art et culture dans le monde musulman. Les traits les plus caractéristiques de cet art et culture prirent place dans le monde irakien au IXème siècle; l'éclatement de l'empire abbâsside provoqua rtoutefois de bonne heure le développement de variantes régionales. A l'époque préislamique, les Arabes étaient assez totalement étrangers aux arts figurés; en revanche ils possédaient en matière littéraire toute une tradition de poésie orale qui ordonnée en qasîde, chantait la vie au désert; ils possédaient aussi en langue poétique commune, en laquelle fut exprimé le Coran. La mise par écrit de ce monument littéraire marque le début d'une culture écrite. La fondation de l'empire arabe prolongea durablement les conquérants dans des milieux culturels divers dont le contact permit l'éclosion d'une première littérature musulmane et d'un art qui n'était ni tout à fait arabe ni purement byzantin ou iranien, un art de l'Islam. Les besoins religieux déterminèrent tout d'abord les premières réalisations artistiques et l'élaboration d'une langue de culture. Les musulmans édifièrent des lieux de culte : parfois ils se bornèrent à réaménager des édifices existants dans les villes neuves. Dès l'époque umayyade apparut aussi une architecture religieuse, celle des mosquées qui surent utiliserles traditions décoratives des mosaistes chrétiens. Le plan de la mosquée à transept avec rangées de colonnes perpendiculaires au mur qibla est alors le plus répandu. Les mosquées édifiées à cette époque parfois connues par les seules témoignages littéraires, sont celles de Basra, Kufa, Médine, Alep, Fustât et la mosquée d'al Aqsâ à Jérusalem.
Le souci de fixer la langue du Coran pour préserver son caractère sacré détermina une vaste enquête qui se poursuivit le long du VIIIème siècle et aboutit à un corpus de la langue arabe : l'examen des hadith du Prophète et de la vieille poésie bédouine rapportés par la tradition orale et mis par écrit, l'étue du vocubulaire employé par les diverses tribus arabes permirent aux grammairiens et lexicographes, à Basra et à Kura, de tirer des lois et d'établir une grammaire. Sibawayh, grammmairien de Basra mort en 793, illustre bien cette activité. Ainsi se forgea la langue écrite, instrument de l'expression littéraire. Les premiers développements artistiques et littéraires ne se limitent pas à répondre à des nécessités religieuses : la formation d'une administraion, la constitution d'un milieu de cour, l'adoption de la langue arabe comme langue administrative suscitèrent d'autres réalisations. Une achitecture civile apparut avec les palais syriens ou l'ornementation fait large place à l'élément figuré. Quant aux poètes ils conservèrent leur place mais tout en prolongeant les grandes traditions de la poésie préislamique, ils laissent percevoir la marque de la nouvelle société, urbaine et islamisée. La prose littéraire fit également son apparition. Abd al Hamid ibn Yahya, membre de l'administration ymayyade, est considéré comme le premier styliste authentique créateur de l'épître. Son oeuvre exprime l'avènement de la classe des kuttâb et de leur goût pour la culture. Son discipleIbn al Muqaffa doit sa célébrité à la traduction en arabe à partir d'une version pehlvie, des fables indiennes de Kalîla et Dimma. Mais le vrai créateur de la prose arabe fût al Djâhiz, ce grand écrivain de Basra. Défenseur d'une culture arabe, il a laissé une abaondanet oeuvre sur les sujets les plus variés, entre autres de petits traités décrivant avec verve et humour de son temps; le " Livre des Avares ", le traité sur les Turcs, celui sur les marchands, etc...
A partir du IXème siècle un prodigieux effort intellectuel particulièrement affirmé entre 850 et 950 se déploya. On voit alors apparaître en matière architacturale et décorative un art dont les éléments furent indéfiniment utilisés et diversement combinés par les siècles ultérieurs. Une culture nouvelle nettement arabo islamique se forme, dans laquelle les diverses branches du savoir commencèrent à se diversifier. Dans l'un et l'autre domaine, l'influence des civilisations antiques, grecque, perse, indienne, fut certaine, si grande même qu'à certains moments elle alimenta dans les milieux intellectuels un débat entre tenants des traditions arabes et adeptes de ces civilisations, srtout l'iranienne. Tel est le mouvement connu sous le nom de shu"ûbiyya. L'art nouveau nous est révélé par la ville de Sâmarrâ. L'ancienne cité de Bagdad aujourd'hui détruite n'est accessible que via tradition littéraire alors que la ville de Sâmarrâ, créée pour le khailfe al Mu'stasim qui s'y installa en 838 fut totalement délaissée dès la fin du IXème siècle et devint un site inhabité que l'archéologie nous restitue peu à peu. Par les formes d'architecture et de décoration déployées, l'art de Sâmarrâ nous révèle ce que fut le premier art abbâsside. La grande mosquée avec son minaret à spirales, un mausolée et divers palais manifestent des formes architecturales nouvelles. Les palais associent aux traditionnelles salles du trône à coupole des iwân, d'inspiration sassanide. De nouveaux types d'arc apparaissent comme l'arc outrepassé.
La sculpture ornementale en haut relief n'existe pas, mais le décor ornemental laisse apparaître de plus en plus souvent les niches polylobées superposées ou en files, ainsi qu'un procédé nouveau de remplissage des surfaces : les stalactites. Dans le décor stuqué, fréquemment employé, on utilise ainsi qu'un procédé de la taille oblique soulignant les reliefs de façon plus nuancée. Le penchant pour ls tylisation et l'ornementation géométrique apparaît dans le décor à palmettes diversement combinées et dans les formes primitives de l'arabesque. Le mihrab srutout est l'objet d'une décoration soignée et abandonne la forme ronde pour adopter un cadre rectangulaire. Les nombreuses céramiques trouvées à Sâmarrâ révèlent l'introduction dans le monde musulman de la vaissellle de faiance et de porcelaine de Chine, mais aussi l'apparition d'une cérémique totalement originale, la caramique lustrée susceptible d'une étonnante diversité. Là aussi aussi se retrouve le décor à palmettes tandis qu'apparaît un type de décoration épigraphique utilisant une écriture arabe angulaire, le coufique. Le travail du bois, de l'voire, atteste un haut niveau. Ainsi se constituait peu à peu un fonds en matière artistique auquel allaient puiser les autres de l'Emppire. A la fin du IXème siucle l'influence de l'art de Sâmarrâ est très sensible en Egypte, à la mosquée d'Ibn Tûun construite entre 876 et 879, et remarquablement conservée avec ses piliers de brique dont le noyau octogonal est cantonné de 4 minces colonnes de marbre, ses niches polylobées qui articulent la façade; l'ornementation répond au style de Sâmarrâ.
La culture s'élaborant à partir du IXème siècle s'exprime en arabe : par l'étendue de son vocabulaire et sa grammaire la langue a atteint une sorte de perfection. Déjà cependant cette langue écrite s'éloigne des dialectes et des parlers citadins. Mais elle est utilisée par les milieux dirigeants, employée dans l'administration. Difficile à écrire, elle impose un apprentissage et la fréquentation des grammairiens. Certes l'arabe n'a pas faît disparaître les autres langues. Cependant les Iraniens eux mêmes écrivent en arabe et on voit même une littérature chrétienne se constituer en arabe. C'est une culture de citadins et de cités : les villes d'Irak comme Basra, Kûfa, Bagdad puis des centres régionaux, offrent les instruments de travail ( bibiothèques dont la construction se développe ), les mécènes et la clientèle : cours, fonctionnaires, savants, etc... Mais quelle que soit la primauté de l'arabe, ou l'attachement aux traditions arabes, la culture au IXème siècle est marquée par la reconnaissance des civilisations antiques. Si le khalife al Mansûr passe pour avoir demandé à Constantinople des ouvrages de mathématiques, c'est avec al Ma'mûn que se manifeste le mieux le souci d'incorporer à la culture arabi musulmane les connaissances antiques. Ainsi mena t il une véritable politique de traductions, cherchant textes et traducteurs. Il n' a pas à proprement parler fondé la " Maison de la Sagesse " ou Bayt al hikma, il a du moins donné une forte impulsion à l'activité de cette vaste bibiothèque où travaillaient et se réunissaient astronomes, mathématiciens, penseurs, lettrés, traducteurs et dont les fonds furent mis à disposition des musulmans, surotut des oeuvres philosophiques et scientifiques. La traduction s'accompagnant de réflexions et commentaires, cette politique devait peu à peu provoquer l'apparition d'une forme nouvelle de littérature.
il y a un an
Un Califat qui accueillait des Espagnols , Arabes , Hébreux , Chrétiens..
 https://www.noelshack.com[...]ifato-de-cordoba-1000.png (Califat de Cordoue vers l'an 1000 en sachant que a cette époque il a perdu quelques territoires), population vers l'an 1000 , 700 000 habitants.
https://www.noelshack.com[...]ifato-de-cordoba-1000.png (Califat de Cordoue vers l'an 1000 en sachant que a cette époque il a perdu quelques territoires), population vers l'an 1000 , 700 000 habitants.
Quelques infrastructures du Califat de Cordoue :
 https://www.noelshack.com[...]158-moors-caliphate-2.jpg
https://www.noelshack.com[...]158-moors-caliphate-2.jpg
 https://www.noelshack.com[...]ordoba-284929-500x335.jpg
https://www.noelshack.com[...]ordoba-284929-500x335.jpg
 https://www.noelshack.com[...]1551119223-al-andalus.jpg
https://www.noelshack.com[...]1551119223-al-andalus.jpg
Ce mouvement se prolongea tout au long au IXème siècle marqué al Mutawwakil par la personnalité d'un chrétien nestorien, Hynayn ibn Ishâq qui traduisit entre autres la majeure partie de l'oevure de Galien. Ainsi fondée par les traditions arabes et la réflexion à partir du Coran mais progressivement enrichie de tout un héritage antique se développa une culture arabo musulmane qui s'apanouit dans les domaines les plus divers. Les penseurs musulmans du Moyen Age distinguent volontiers les scientes proprement dites " ildm, au pluriel ulûm en arabe " du reste de la prodction littéraire. Par sciences ils entendent diverses branches du savoir et opposaient les sciences religieuses ou traditionnelles aux sciences anciennes ou rationnelles. Les premières ont pour source le Coran et la Tradition ainsi que l'exégèse, la science des hadîth, la morale, la théologie dogmatique, le fiqh ou droit. Ces disciplines ont connu une phase d'intension élaboration aux premiers siècles abbâssides suivie d'un arrêt de la réflexion. Les sciences dites rationnelles sont celles que l'homme acquiert par le seul exercice de la réflexion; elles correspondent aux champs couverts aujourd'hui par la philosophie, les sciences exactes et les sciences de la nature. A côté de ces savoirs spécialisés religieux et scientifiques la production littéraire s'est déployée dans les domaines de la posédie, de la prose divertissante, de l'histoire, de la géographie et plus encore de l'enclclopédisme. Cette séparation nette entre réflexion religieuse, la pensée philosophique et scientifique, la création littéraire, ne correspond pourtant pas aux clivages entre disciplines forgés dans l'Europe moderne. C'est ainsi qu'existent des relations étrroites entre exégèse coranique et histoire chez un penseur tel Tabarî ou entre philosophie et médecine chez un savant Ibn Sînâ ( ou Avicenne ).
L'étude de cette culture impose donc un sérieux effort pour en comprendre les orientations profondes, et dans la présentation qui suit seuls ont été retenus quelques aspects parmi les plus notables, de l'immense production littéraire, scientifique et philosophique. Personne ne pouvait prétendre maîtriser l'ensemble de ces connaissances et tôt au IXème siècle apparut une conception de la culture qui péserait très fort sur son évolution; elle s'exprime en un mot dont la tradution est pratiquement impossible tant les notions qu'il véhicule sont complexes et évoluèrent : l'adab. Cela désigne : " la somme des connaissances rendant l'homme courotis et urbain, la culture profane ( par opposition à la science religieuse ) " en quelque sorte la culture générale nécessaire à l'homme cultivé pour remplir certaines fonctions ( secrétaire, vizi, qâdî ). 4adab se propose d'instruire en amusant. Djâhiz ( 776 - 868 ), plus grand prosateur du IXème siècle, sut choisir et doser dans le legs de la tradition arabe et des civilisations antiques; Ibn Qutayba ( 828 - 889 ), plus dogmatique, fixa dans une série de petits manuels les éléments d'une culture arabe qui par la primauté qu'il accordait aux questions religieuses islamiques, lui valut l'adhésion des milieux orthodoxes. Tous 2, Djâhiz comme Ibn Qutayba, avaient opté ainsi pour un savoir non spécialisé, ouvert au plus large public possible; le second surtout devait contribuer nettement à un vieillissement de la culture.
.
. Avec ses différentes écoles, le droit se formait, et la quête des hadith et le souci de la Sunna provoquèrent les débuts d'une genre qu'on peut qualifier d'historique. De recueils de hadiths furent constitués, classés de plus en plus souvent par matières et utilisant largement le principe des garants. Les plus grands noms en ce domaine sont ceux d'al Bukhârî, Musllim et celui du fondateur d'une école juridique, Ibn Hanbal. Les premières bibiographies du prophète apparurent aussi, et si on ne possède plus les oeuvres de Muhammad Ibn Ishâq, l'essentiel en fut utilisé par Ibn Hishâm qui composa une bibiographie de Mahomet, base de toutes les études ultérieures. Mais il s'agissait plus de traditionnalistes que d'historiens. D'autres s'intéressèrent aux faits plus proprement militaires de la conquête, mettant en évidence le rôle des clans et s'attachant aux généalogies. Ainsi Ibn Abd al Hakam qui décrit la conquête du Maghreb et de l'Espagne, Wâqidî qui s'est intéressé aux campagnes de Mahomet, et surtout al Balâdhurî, auteur d'une remarquable " Histoire des conquêtes musulmanes ". Ibn Sa"d mit en oeuvre les bibliographies des " compagnons " et " successeurs ' de Mahomet, c'est à dire de tous ceux par qui des hadits avaient été transmis; il inaugurait ainsi un autre genre historique particulièrement florissant en islam : celui des tabaqât ou dictionnaires bio bibiographiques traitant des personnages célèbres. Le genre historique est ainsi à ses débuts étroitement lié au fait musulman. Au cours du Xème siècle il devait achever son évolution : Tabarî est le créateur de l'histoire universelle qu'il fait commencer à la Création.
Ensuite aux Xème et XIème siècles, l'histoire se diversifia, devient celle des villes, de dynasties, revêtit la forme d'annales et de chroniques. La géographie s'élaborer lentement, infleuncée par la traduction d'oeuvres grecques et persanes. Les Arabes s'inspirant des théories iraniennes, distribuèrent les ensembles humains autour d'un centre : l'Irak parfois remplacé par la Mecque et Médine. Les premières oeuvres répondirent toute fois à des besoins administratifs avec Ibn Khurdâdhbâh et Qudâma ou résultèrent de voyages, ainsi l'anonyme " Relation de la Chine et de l'Inde " composée en 851. Ce dernier aspect devait se prolonger, illustré par la célèbre Relation du voyage d'Ibn Fadlpan chez les Bulgares de la Voga en 921. Dès le Xème siècle apparurent des descriptions du monde avec Ya'Qûbî, Ibn Rustah; chez Mas'ûdi, la géographie s'inséra dans des oeuvres à caractère encyclopédique. Mais surtout on vit apparaître un autre type de géographie, qui s'en tient à la description du seul monde musulman, connu par expérience personnelle, et qui s'attacha à présenter les activités humaines : elle commença véritablement avec Istakhrô et s'épanouit avec Ibn Hawqal et al Muqaddasî. En sciences et philosophie les Arabes se sont affirmés comme continuateurs d'un vaste héritage antique et comme des créateurs capables d'allier refléxion et observaation. Par la biais des tradutions, ils ont recueilli les savoirs indo persans et surtout grecs; bientôt parurent aussi les premiers ouvrages arabes : en mathématiques ( al Khwârizmî ), en astronomie, en physique; la médecine se développa considérablement avec al Râzî ( Rhazès ) et Ibn Sîna ( Avicenne ). Fort souvent d'ailleurs actte activité scientifique va de pair avec la spéculation philosophique se développant sous l'impulsion des tradutions grecques, surtout des oeuvres de Platon et d'Aristote.
Sans doute pour les docteurs de l'Islam la pensée antique ne devait tenir aucune place dans l'approfondissement du Coran mais dès le IXème siècle le concept de falsafa fit son apparition pour désigner une activité qui méthodologiquement, se présente comme une recherche indépendante au problème de la Création du monde et des rapports de la craéture et du créateur, les philosophes devaient faire preuve d'une audace intellectuelle qui les rapprocha des milieux peu orthodoxes, et notamment des ismâ îliens. Les grands représentants de cette activité furent l'arabe al Kindi, le Turc al Farâbi et surtout Ibn Sînâ, connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Ce mouvement philosophique devait susciter l'opposition des penseurs sunnites rigoristes. Nombre de ces ouvrages scientifiques et philosophiques gagnèrent l'Occident chrétien, grâce aux traductions effectuées entre le XIème et le XIIIème siècle en Italie su sud, en Sicile, en Espagne, et favorisèrent l'essor intellectuel du monde latin. C'est donc bien une culture arabo islamique qui s'était constituée, une culture qu'on peut définir comme l'ensemble des sciences, des connaissances, des idées et des traditions créées ou transmises en langue arabe par des lettrés et savants de diverses origines. Cependant, après le rejet du mu'tazilisme, l'alliance étroite des docteurs sunnistes et du khalifat, leur inquiétude devant le développement des doctrines shî'ites, de la philosophie, provoquèrent une vive réaction : en tous domaines se fermèrent " les portes de l'effort personnel ". Le repli sur l'orthodixie étroitement définie fut ainsi un facteur considérable, sinon de déclin du moins d'appauvrissement.
.
Quelques infrastructures du Califat de Cordoue :
Ce mouvement se prolongea tout au long au IXème siècle marqué al Mutawwakil par la personnalité d'un chrétien nestorien, Hynayn ibn Ishâq qui traduisit entre autres la majeure partie de l'oevure de Galien. Ainsi fondée par les traditions arabes et la réflexion à partir du Coran mais progressivement enrichie de tout un héritage antique se développa une culture arabo musulmane qui s'apanouit dans les domaines les plus divers. Les penseurs musulmans du Moyen Age distinguent volontiers les scientes proprement dites " ildm, au pluriel ulûm en arabe " du reste de la prodction littéraire. Par sciences ils entendent diverses branches du savoir et opposaient les sciences religieuses ou traditionnelles aux sciences anciennes ou rationnelles. Les premières ont pour source le Coran et la Tradition ainsi que l'exégèse, la science des hadîth, la morale, la théologie dogmatique, le fiqh ou droit. Ces disciplines ont connu une phase d'intension élaboration aux premiers siècles abbâssides suivie d'un arrêt de la réflexion. Les sciences dites rationnelles sont celles que l'homme acquiert par le seul exercice de la réflexion; elles correspondent aux champs couverts aujourd'hui par la philosophie, les sciences exactes et les sciences de la nature. A côté de ces savoirs spécialisés religieux et scientifiques la production littéraire s'est déployée dans les domaines de la posédie, de la prose divertissante, de l'histoire, de la géographie et plus encore de l'enclclopédisme. Cette séparation nette entre réflexion religieuse, la pensée philosophique et scientifique, la création littéraire, ne correspond pourtant pas aux clivages entre disciplines forgés dans l'Europe moderne. C'est ainsi qu'existent des relations étrroites entre exégèse coranique et histoire chez un penseur tel Tabarî ou entre philosophie et médecine chez un savant Ibn Sînâ ( ou Avicenne ).
L'étude de cette culture impose donc un sérieux effort pour en comprendre les orientations profondes, et dans la présentation qui suit seuls ont été retenus quelques aspects parmi les plus notables, de l'immense production littéraire, scientifique et philosophique. Personne ne pouvait prétendre maîtriser l'ensemble de ces connaissances et tôt au IXème siècle apparut une conception de la culture qui péserait très fort sur son évolution; elle s'exprime en un mot dont la tradution est pratiquement impossible tant les notions qu'il véhicule sont complexes et évoluèrent : l'adab. Cela désigne : " la somme des connaissances rendant l'homme courotis et urbain, la culture profane ( par opposition à la science religieuse ) " en quelque sorte la culture générale nécessaire à l'homme cultivé pour remplir certaines fonctions ( secrétaire, vizi, qâdî ). 4adab se propose d'instruire en amusant. Djâhiz ( 776 - 868 ), plus grand prosateur du IXème siècle, sut choisir et doser dans le legs de la tradition arabe et des civilisations antiques; Ibn Qutayba ( 828 - 889 ), plus dogmatique, fixa dans une série de petits manuels les éléments d'une culture arabe qui par la primauté qu'il accordait aux questions religieuses islamiques, lui valut l'adhésion des milieux orthodoxes. Tous 2, Djâhiz comme Ibn Qutayba, avaient opté ainsi pour un savoir non spécialisé, ouvert au plus large public possible; le second surtout devait contribuer nettement à un vieillissement de la culture.
.
. Avec ses différentes écoles, le droit se formait, et la quête des hadith et le souci de la Sunna provoquèrent les débuts d'une genre qu'on peut qualifier d'historique. De recueils de hadiths furent constitués, classés de plus en plus souvent par matières et utilisant largement le principe des garants. Les plus grands noms en ce domaine sont ceux d'al Bukhârî, Musllim et celui du fondateur d'une école juridique, Ibn Hanbal. Les premières bibiographies du prophète apparurent aussi, et si on ne possède plus les oeuvres de Muhammad Ibn Ishâq, l'essentiel en fut utilisé par Ibn Hishâm qui composa une bibiographie de Mahomet, base de toutes les études ultérieures. Mais il s'agissait plus de traditionnalistes que d'historiens. D'autres s'intéressèrent aux faits plus proprement militaires de la conquête, mettant en évidence le rôle des clans et s'attachant aux généalogies. Ainsi Ibn Abd al Hakam qui décrit la conquête du Maghreb et de l'Espagne, Wâqidî qui s'est intéressé aux campagnes de Mahomet, et surtout al Balâdhurî, auteur d'une remarquable " Histoire des conquêtes musulmanes ". Ibn Sa"d mit en oeuvre les bibliographies des " compagnons " et " successeurs ' de Mahomet, c'est à dire de tous ceux par qui des hadits avaient été transmis; il inaugurait ainsi un autre genre historique particulièrement florissant en islam : celui des tabaqât ou dictionnaires bio bibiographiques traitant des personnages célèbres. Le genre historique est ainsi à ses débuts étroitement lié au fait musulman. Au cours du Xème siècle il devait achever son évolution : Tabarî est le créateur de l'histoire universelle qu'il fait commencer à la Création.
Ensuite aux Xème et XIème siècles, l'histoire se diversifia, devient celle des villes, de dynasties, revêtit la forme d'annales et de chroniques. La géographie s'élaborer lentement, infleuncée par la traduction d'oeuvres grecques et persanes. Les Arabes s'inspirant des théories iraniennes, distribuèrent les ensembles humains autour d'un centre : l'Irak parfois remplacé par la Mecque et Médine. Les premières oeuvres répondirent toute fois à des besoins administratifs avec Ibn Khurdâdhbâh et Qudâma ou résultèrent de voyages, ainsi l'anonyme " Relation de la Chine et de l'Inde " composée en 851. Ce dernier aspect devait se prolonger, illustré par la célèbre Relation du voyage d'Ibn Fadlpan chez les Bulgares de la Voga en 921. Dès le Xème siècle apparurent des descriptions du monde avec Ya'Qûbî, Ibn Rustah; chez Mas'ûdi, la géographie s'inséra dans des oeuvres à caractère encyclopédique. Mais surtout on vit apparaître un autre type de géographie, qui s'en tient à la description du seul monde musulman, connu par expérience personnelle, et qui s'attacha à présenter les activités humaines : elle commença véritablement avec Istakhrô et s'épanouit avec Ibn Hawqal et al Muqaddasî. En sciences et philosophie les Arabes se sont affirmés comme continuateurs d'un vaste héritage antique et comme des créateurs capables d'allier refléxion et observaation. Par la biais des tradutions, ils ont recueilli les savoirs indo persans et surtout grecs; bientôt parurent aussi les premiers ouvrages arabes : en mathématiques ( al Khwârizmî ), en astronomie, en physique; la médecine se développa considérablement avec al Râzî ( Rhazès ) et Ibn Sîna ( Avicenne ). Fort souvent d'ailleurs actte activité scientifique va de pair avec la spéculation philosophique se développant sous l'impulsion des tradutions grecques, surtout des oeuvres de Platon et d'Aristote.
Sans doute pour les docteurs de l'Islam la pensée antique ne devait tenir aucune place dans l'approfondissement du Coran mais dès le IXème siècle le concept de falsafa fit son apparition pour désigner une activité qui méthodologiquement, se présente comme une recherche indépendante au problème de la Création du monde et des rapports de la craéture et du créateur, les philosophes devaient faire preuve d'une audace intellectuelle qui les rapprocha des milieux peu orthodoxes, et notamment des ismâ îliens. Les grands représentants de cette activité furent l'arabe al Kindi, le Turc al Farâbi et surtout Ibn Sînâ, connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Ce mouvement philosophique devait susciter l'opposition des penseurs sunnites rigoristes. Nombre de ces ouvrages scientifiques et philosophiques gagnèrent l'Occident chrétien, grâce aux traductions effectuées entre le XIème et le XIIIème siècle en Italie su sud, en Sicile, en Espagne, et favorisèrent l'essor intellectuel du monde latin. C'est donc bien une culture arabo islamique qui s'était constituée, une culture qu'on peut définir comme l'ensemble des sciences, des connaissances, des idées et des traditions créées ou transmises en langue arabe par des lettrés et savants de diverses origines. Cependant, après le rejet du mu'tazilisme, l'alliance étroite des docteurs sunnistes et du khalifat, leur inquiétude devant le développement des doctrines shî'ites, de la philosophie, provoquèrent une vive réaction : en tous domaines se fermèrent " les portes de l'effort personnel ". Le repli sur l'orthodixie étroitement définie fut ainsi un facteur considérable, sinon de déclin du moins d'appauvrissement.
.
il y a un an
L'essor de la culture persane. Une culture islamique persane fit surtout son apparition, d'abord chez les Sâmanides, ensuite chez les Ghaznévides qui, ignorant l'arabe, sans aucune culture turque, encouragèren l'iranisation. Le chef d'oeuvre de cette littérature est le " Livre des Rois " de Firdawsî. L'arabe resta la langue de la religion, le persan devint la langue littéraire. Des oeuvres en prose apparurent également, adaptations de l'arabe, puis oeuvres originales en histoire comme en géographie. Ainsi un tournant s'amorçait dans le développement littéraire du monde musulman. Les IX - Xème siècles avaient été des siècles de création. Au XIème siècle apparaissent les symptômes d'une ankylose.
Le monde musulman : une dispersion toujours accrue.
L'industrie de ces régions au XIIème siècle laisse une impression de stagnation voire de régression. En Syrie musulmane sauf peut être aux cotonnades d'Alep et les soieries de Damas, très prisées des Francs, rien ne témoigne alors d'un essor particulier. En Egypte l'industrie textile, victime des guerres contre les Latins et les Syriens, périclite à la fin du XIIème siècle, tant le delta que le Feyyûm. Quant à l'Anatolie, en dépression bien avant l'invasion turque, on peut penser qu'elle a conservé ses fabriques de céramique et que l'industrie du tapis, surtout SSivas, s'y est développée dès avant le XIIIème siècle, mais ce n'est qu'une hypothèse. En fait, la seule région qui reste prospère est la côte levantine, dominée par les Francs. Les croisés n'ont certes rien créé mais ils ont développé les vieilles industries textiles d'Antioche, Tripole et Tyr, ainsi que la poterie fine, la verrerie et l'orfèvrerie, tous produits que les marchands latins pouvaient maintenant venir changer librement dans les portes syriens. En Anatolie où on commence à construire des caravansérails dès la fin du XIIème siècle, le trafic terrestre semble avoir repris dès lors mais les textes insistent sur les obstacles, naturels et humains, qu'il rencontre. La Syrie musulmane garde ses relations caravanières avec l'Irak et l'Iran, mais on doit de plus en plus s'approvisionner en Egypte, en traversant le royaume de Jérusalem dont les douanes enchérissent ces denrées. Jusqu'à Nûr al Din, le commerce syrien est en stagnation et sa floraison correspond à la fin du siècle, à la décadence des Etats croisés et à la réunification des syro égyptiennes par Salâh al Dîn : ce n'est pas un hasard si les relations de Venise avec Alep se régularisent au début de XIIIème siècle.
Au contraire, l'Egypteest alors le confluent du grand commerce oriental : " marché public des 2 mondes ", comme le nomme Guillaume de Tyr, Alexandrie reçoit par le mer Rouge, en provenance des Indes, d'Arabie, de Perse, les aromates, les pierreries, et surtout les épices que Benjamin de Tudèle et l'Allemand Brukhard voient descendre le Nil en d'énormes quantités. Grâce à ce trafic le douane d'Alexandrie, selon Arnold de Lubeck, rapportait plus de 8 000 marcs d'argent fin en 1175. Et pourtant malgré less bénéfices perçus par les Egyptiens, les produits d'Orient étaient encore nettement moins chers qu'à Alexandrie ou à Damiette que dans n'importe quelle ville de Syrie. En outre, l'Egypte qui manque de bois et de fer, est un bon marché d'exportation pour les Occidentaux : comment s'étonner dès lors que ceux ci aient de loin préféré l'Egypte musulmane aux ports syriens soumis à leurs frères? On ne peut nier l'activité commerciale du Levant chrétien : la présence des colonies génoises, pisanes et vénitiennes dans le royaume de Jérusalem et dans les principautés d'Antioché et de Tripoli prouve que leur marché n'était pas sans intérêt. Pourtant il me semble que l'essentiel du trafic y ait été alimenté par les produits locaux agricoles et industriels, et encore les quantités n'étaient elles pas toujours suffisantes, puisque nous voyons des navires aller compléter leur cargaison en Egypte avant de regagner l'Occident. Au Levant on jouisssait pourtant en principe de facilités bien plus grandes qu'en Egypte où on était souvent l'objet d'attitudes hostiles. En outre, les autorités chrétiennes n'acceotaient toujours pas le principe du libre commerce avec les musulmans : les papes et les conciles, généraux et régionaux, renouvellent sans cesse l'interdiction de vendre aux infidèles des produits stratégiques comme le bois, le fer ou la poix.
Mais l'Egypte était un marché trop intéressant : seul Innocent III essaye en 1198 d'interdire tout trafic vers les Arrasins mais il doit aussitôt renoncer sous la pression de Venise. Outre ce qu'on y exportait il y avait trop de produits à acheter en Egypte pour qu'on se laîssat impressionner par un quelconque scrupule religieux, fût ce une menace d'excommunication. Ainsi, à en croire Maqqarî, 3 000 marchands latins auraient touché Alexandrie dans la seule année 1215 - 1216. Avant la conquêt ayyûbide, ce sont les Pisans qui sont le mieux implantés en Egypte : dès 1154 ils obtiennent un véritable traité de commerce du khalife al Zafîr : celui ci leur assure la jouissance d'un fondaco à Alexandrie et d'un autre au Caire, la liberté de vendre dans tout le pays après acquittement des taxes et la suppression du système ancien de la responsabilité collectivé qui permettait au pouvoir de sévir contre les compatriotes de tout étranger fautif. Dès lors, Pise devait rester fidèle aux Fatimides : en 1167, c'est elle qui s'entremet pour faire restituer Alexandrie, prise par Shirkûh, et elle obtient en récompense un abaissement des taxes payables au Caire; naturellement elle se monter hostile à Salâh al Dîn dans les années suivantes. Pour Gênes aussi, Alexandrie est un pôle d'attraction : au milieu du XIIème siècle, elle semble même avoir été le but principal de son trafic oriental, et ce trafic était si naturel que les archevêques de Gênes percevaient une dîme sur les vaisseaux venant d'Alexandrie. La Sicile garda au XIIème siècle, malgré des phases de rupture, ses relations traditionnelles avec l'Egypte. Dès 1137, Roger II promettait aux Salernitains d'obtenir une diminution des droits qu'ils payaient à Alexandrie au taux exigé des Siciliens; quelques années après, il aurait en outre conclu un traité " profitable aux deux parties ", avec le khalife d'Egypte. Venise enfin entretenait au moins depuis 1158 une ligne régulière de galées vers Alexandrie.
A la fin du siècle, elle possédait un fondaco dans ce port, puis un second en 1208. Sous doute Pise perdit elle du terrain au moment de la conquête ayyûbide : le Minhâdj d'al Makhzûmi écrit aux environs de 1172, ne parle pas des Pisans. Mais elle se rattrape vite, dès 1173, obtenant de nouvelles concessions, le droit d'utiliser ses propres poids et mesures et la suppression certains abus vexatoires ( ventes forcées, exactions de douaniers ) : ses importations de fer, bois, d'or et d'argent valeitn bien cela, de l'aveau de Salâh al Dîn lui même. Gênes de son côté a tant d'intérêts en Egypte ayyûbide qu'en 1192 Eichard Coeur de Lion ne peut obtenir son concours lorsqu'il songe à l'attaquer. Quant à Venise, elle aurait sous le dogat de Sabastiano Ziani ( 1172 - 1178 ),s igné une " pax firmissa " avec l'Egypte : les actes privés prouvent en tout casque ses navires touchaient assidûment Alexandrie à la fin du siècle. Au début du XIIIème siècle, le sultant al Malik al âdil, frère de Salâh al Dîn souligne son intention d'avnatager Venise de préférence à toutes les autres nations. D'où le peu d'enthousiasme des cités marchandes pour la quatrième croisade, à l'origine dirigée contre l'Egypte : on sait qu'au XIIIème siècle, une tradition accuse Venise de l'avoir détournée pour ménager le sultan. L'Egypte était donc pour les Latins un marché rentable : ils y vendaient cher leurs produits stratégiques, ils y achetaient meilleur marché qu'ailleurs les épices et surtout l'alun, indispensable à leur jeune industrie textile et qui ne viendra d'Asie Mineure qu'au siècle suivant.
N'oublions pourtant pas qu'ils avaient à y subir de fortes contraintes; la période fâtimide ayyûbide semble même se caractériser par un renforcement du contrôle d'Etat sur le commerce : un document de 118 nous apprend qu'à l'arrivée d'un navire latin, les autorités faisaient saisir ses vergues et son gouvernail afin de l'empêcher de repartir sans payer les taxes. Cette impression de contrôle renforcé ressort aussi du Minhâdj d'al Makhzûmî. Jusqu'au XIIIème siècle, les marchands latins sont sous le régime de grâces toujours révocables ou modifiables. Pourtant, malgré cette insécurité, il n'y eut dans l'Egypte du XIIème siècle, rien de semblable aux coups de forces byzantins de 1171 et de 1182. Dans ces conditions, on comprend l'attachement des italiens à un trafic qui, grâce aux exportations de matières stratégiques, étant sans doute mieux équilibré que leur commerce avec Constantinople. Plus insidieusement, l'économie des pays islamiques, surtout celle de l'Egypte, dépend de l'étranger presque autant que celle de Byzance.
il y a un an
Sinon parmi les autres autres choix restants, honnêtement c'est dur de choisir. Surtout entre les califats Omayyade, Abbasside et Ottoman. Les 3 ont une histoire plutôt cool.
L'empire perse sassanide.
Le roi Artaban V est abattu au début du IIIème siècle par Ardashir qui se fait couronner roi à Ctésiphon en 226. Il fondait l'empire perse sassanide qui voulait renouer avec les traditions achéménides. Par une série de guerres contre les Romains surtout, la frontière fut établir sur l'Euphrate et au sud de la Caspienne; 2 zones restèrent plus incertaines : à l'est l'empire des Kouchans, sous la pression des peuples turco mongols tendait à repousser sa propre frontière toujours plus à l'ouest, tandis qu'au nord ouest, l'Arménie refusait d'admettre la révolution sassanide. 2 nouveaux porblèmes apparurent au IVème siècle : l'établisssement de Constantinople comme capitale de l'EMpire romain rapproche Ctésiphon l'adversaire occidental; d'autre part l'Empire romaine adopta comme relgion officielle le christianiame qui possédait déjà de nombreux adeptes en Mésopotamie perse, et qui fut aussi adopté en Arménie. La consolidation de l'empire entre le IVème et Vème siècles. Une série de guerres avec les Romains aboutissent en 395 ou 399 à un traité de paix. La clause principale en fut le partage de l'Arménie dont la portion orientale devint partie intégrante de l'empire sassanide. En dépit de périodes de tensions provoquées par des problèmes religieux, la paix avec l'Ouest devait pratiquement durer tout el Vème siècle. La pression et l'infiltration de tribus turques contraignirent les rois perses à mener de nombreuses expéditions contre les Kouchans mais le problème devient aigu quand vers 440, ces derniers furent remplacés par les Huns Hephtalites. la bataille livrée en 484 par Firuz contre les Huns fut une catastrophe : l'armée perse décimée, les Huns s'avancèrent jusqu'à Marw et Herat imposèrent un tribut annuel à la Perse qui entra ainsi dans une onéreuse dépendance.
Les Sassanides établirent le mazdéisme ou zoroastrime issu d'une réforme de l'ancien polythéisme indo euroépen par Zoroastre comme religion officielle. Les textes sacrés ( Avesta ), conservés en de rares examplaires furent recueillis par les Sassanides qui en firent établir une copie officielle avec des additions scientifiques. Le culte comprenait surtout la vénération du Feu, dans des pyrées; ces temples, par maison, village, canton, province, s'élevaient dans tout le royaume; 3 3 d'entre eux étaient rattachés aux 3 corps sociaux institués par la dynastie : le Feu des prêtres, le Feu des guerriers ou Feu royal et le Feu des agriculteurs. Le clergé, à l'origine recruté dans une tribu mède, assurait le culte, la direction morale et l'enseignement du peuple. Hiérarchisé, il comprenait à la base des prêtres ou mages. Certains, les mobadhan, adminsitraient les districts ecclésiastiques. Au sommet, le mobadhan mobed avait la direction suprême des affaires religieuses. Le clergé interveanit dans tous les actes de la vie de l'individu : ainsi le Grand Mobedh devint progressivement un des premiers personnages de l'Empire. Le mazdéisme ne faisait pas de propagande extérieure, mais prétendait à une domination absolue à l'intérieur des frontières. Au IIIème siècle, les mages avaient réussi à écarter la menace manichéenne. Mais les chrétiens, de Mésopotamie ou d'Arménie, leur posaient d'autres problèmes car outre leurs différences religieuses, ils étaient toujours suspects de sympathie envers Constantinople. Leur situation fut ainsi fonction des relations entre Perses et Romains. A la faveur de la paix de 399, l'Eglise de Perse put s'organiser; elle adopta le nestorianisme en 486, ce qui écarte tout problème politique.
L'Arménie fut l'objet de diverses tentatives peu fructueuses pour y implanter le culte du feu; les problèmes furent atténués par l'adoption du monophysisme par les Arméniens. Ardashir I avait rompu d'emblée avec la tradition parthe en introduisant une ferme centralisation et en tenant en main les gouverneurs de province. Mais les grands vaspuhrs n'avaient pas renoncé à leur prérogaties et le clergé voulut contrôler une monarchie qui dès le début prétendit tenir son pouvoir d'une investiture divine. La faiblesse des successeurs de Shapûr II et l'absence d'une tradition définie en matière de succession permirent aux nobles et au clergé de contrôler le pouvoir royal. Le royaume devint une sorte de monarchie élecive dans la famille des Sassanides. L'élection appartenait aux plus hauts dignitaires de l'Etat et en dernier ressort, dépendant du Grand Mobedh. Leur politique antichrétienne occasionna des difficultés avec Constantinople et surtout une grande révolte de l'Arménie en 450. L'Empire souffrait de longs efforts financiers imposés par les guerres orientales, de sécheresses et de famine. C'est alors qu'intervient la grande défaite de 484 devant les Huns. Un lourd tribut annuel aggrava les difficultés du pays et l'armée n'existait pratiquement plus quand en 488, arrive au pouvoir le fils de Firuz, Kawadh : ses bonnes relations avec les Hephtalites, chez qui il avait été élevé, laissent bien augurer de l'avenir.
Organisation de l'Empire.
Les premiers Sassanides avaient dû ménager la très haute noblesse des vaspuhrs. Leur politique consista à s'appuyer sur la classe des propriétaires fonciers moyens pour constituer une bureaucratie stable liant la province à la capital. Le Grand Mobedh probablememnt nommé par le roi, le conseillait dans tous les cas où il s'agissait de religion et pouvait inspirer largement sa politique. Le Grand Vizir dirigeait l'administration centrale, l'étendue de son pouvoir est mal connue. 3 autres grands dignitaires avaient d'importantes fonctions : le chef des Guerriers, le chef de la Bureaucratie et le chef des Agriculteurs et des Artisans, responsable de la levée de l'impôt foncier et de la capitation,. L'impôt foncier, payé par les paysans, était réparti en fonction de la fertibilité de la terre, son montant allait du sixième au tiers de la récolte, et le revneu global variait donc beaucoup d'une année sur l'autre. La capitation était acquittée par tous sauf les nobles, les prêtres, les soldats et les fonctionnaires. Les revenus de l'Empire comprenaient en outre, des contributions extraordinaires pour la guerre, des dons coutumiers, les revenus des domaines royaux et de la régale, les droits de douane. Les Sassanides veillèrent à lier soigneusement la province à la capitale. Matiriellement un bon service de postes assurait les communications. Quelques princes vassaux qui avaient le titre de rois, les shaks, furent maintenus aux frontières, ainsi les prinves arabes lakhmides de Hira, les rois d'Arméni ( jusqu'en 430 ). Mais d'une façon générale, l'Empire fut divisé en provinces dirigées par des marzbans, choisis par la haute noblesse. Les provinces étaient divisées en nomes et cantons qui avaient pour centre une ville. Le canton était administré par un fonctionnaire choisi parmi les chefs du village, ou dehkans. Elles avaient un caractère plutôt militaire et les marzbans dépendaient totalement du souverain.
La véritable administration civile était au niveau des cantons : sur eux reposait la stabilité réelle du pays. De cet empire, Ctésiphon était la capitale. C'est là qu'en dehors du territoire iranien résidait le Roi des rois. L'agriculture constituait la base économique de l'Empire. De Grands domaines dont on connaît mal le mode d'exploitation, appartenaient à la noblesse, aux grands temples et à l'Etat. Il semble que les esclaves étaient en voie d'affranchissement mais les paysans étaient attachés à la glèbe et la loi leur accordait peu de protection. Astreints au paiement de l'impôt foncier et de la capitation., il devaient servir dans l'armée comme fantassins. L'irrigation était soigneusement réglementée et l'essor urbain, qui caractérise l'époque sassanide, est lié, dans ses causes et ses effets, à l'activité agricole. De villes nouvelles furent fondées et surtout peuplées d'artisans pris au cours des guerres. Ne payant que la capitation et dispensés su service militaire, les artisans connaissaient un sort meilleur que celui des paysans, mais supportaient en temps de guerre le poids de lourdes contribuations. Parmi eux se trouvaient les groupes chrétiens les plus nombreux. L'acitivé la plus connue était le tissage de la soie. L'empire sassanide tira en effet largement partie de sa situation entre le monde méditerranéen et le monde chinois. Depuis Ctésiphon les routes vers l'est gagnaient Hamadhann, la Susianne, la Perside et le golfe Persique. Une autre route reliait Hamadhân à Rayy puis se divisait, permettant de joindre soit les rives de la Caspienne, soit Kaboul et l'Inde, soit la Chine. Ce dernier itinéraire impliquait de bonnes relations avec les puissances d'Asie centrale : Kouchans, Huns Hephtalites ou Turcs. Les Perses déloppèrent aussi une puissance marine qui, par le golfe Persique, captait au détriment du monde arabe, une grande partie du trafic de l'océan Indien.
L'empire perse sassanide.
Le roi Artaban V est abattu au début du IIIème siècle par Ardashir qui se fait couronner roi à Ctésiphon en 226. Il fondait l'empire perse sassanide qui voulait renouer avec les traditions achéménides. Par une série de guerres contre les Romains surtout, la frontière fut établir sur l'Euphrate et au sud de la Caspienne; 2 zones restèrent plus incertaines : à l'est l'empire des Kouchans, sous la pression des peuples turco mongols tendait à repousser sa propre frontière toujours plus à l'ouest, tandis qu'au nord ouest, l'Arménie refusait d'admettre la révolution sassanide. 2 nouveaux porblèmes apparurent au IVème siècle : l'établisssement de Constantinople comme capitale de l'EMpire romain rapproche Ctésiphon l'adversaire occidental; d'autre part l'Empire romaine adopta comme relgion officielle le christianiame qui possédait déjà de nombreux adeptes en Mésopotamie perse, et qui fut aussi adopté en Arménie. La consolidation de l'empire entre le IVème et Vème siècles. Une série de guerres avec les Romains aboutissent en 395 ou 399 à un traité de paix. La clause principale en fut le partage de l'Arménie dont la portion orientale devint partie intégrante de l'empire sassanide. En dépit de périodes de tensions provoquées par des problèmes religieux, la paix avec l'Ouest devait pratiquement durer tout el Vème siècle. La pression et l'infiltration de tribus turques contraignirent les rois perses à mener de nombreuses expéditions contre les Kouchans mais le problème devient aigu quand vers 440, ces derniers furent remplacés par les Huns Hephtalites. la bataille livrée en 484 par Firuz contre les Huns fut une catastrophe : l'armée perse décimée, les Huns s'avancèrent jusqu'à Marw et Herat imposèrent un tribut annuel à la Perse qui entra ainsi dans une onéreuse dépendance.
Les Sassanides établirent le mazdéisme ou zoroastrime issu d'une réforme de l'ancien polythéisme indo euroépen par Zoroastre comme religion officielle. Les textes sacrés ( Avesta ), conservés en de rares examplaires furent recueillis par les Sassanides qui en firent établir une copie officielle avec des additions scientifiques. Le culte comprenait surtout la vénération du Feu, dans des pyrées; ces temples, par maison, village, canton, province, s'élevaient dans tout le royaume; 3 3 d'entre eux étaient rattachés aux 3 corps sociaux institués par la dynastie : le Feu des prêtres, le Feu des guerriers ou Feu royal et le Feu des agriculteurs. Le clergé, à l'origine recruté dans une tribu mède, assurait le culte, la direction morale et l'enseignement du peuple. Hiérarchisé, il comprenait à la base des prêtres ou mages. Certains, les mobadhan, adminsitraient les districts ecclésiastiques. Au sommet, le mobadhan mobed avait la direction suprême des affaires religieuses. Le clergé interveanit dans tous les actes de la vie de l'individu : ainsi le Grand Mobedh devint progressivement un des premiers personnages de l'Empire. Le mazdéisme ne faisait pas de propagande extérieure, mais prétendait à une domination absolue à l'intérieur des frontières. Au IIIème siècle, les mages avaient réussi à écarter la menace manichéenne. Mais les chrétiens, de Mésopotamie ou d'Arménie, leur posaient d'autres problèmes car outre leurs différences religieuses, ils étaient toujours suspects de sympathie envers Constantinople. Leur situation fut ainsi fonction des relations entre Perses et Romains. A la faveur de la paix de 399, l'Eglise de Perse put s'organiser; elle adopta le nestorianisme en 486, ce qui écarte tout problème politique.
L'Arménie fut l'objet de diverses tentatives peu fructueuses pour y implanter le culte du feu; les problèmes furent atténués par l'adoption du monophysisme par les Arméniens. Ardashir I avait rompu d'emblée avec la tradition parthe en introduisant une ferme centralisation et en tenant en main les gouverneurs de province. Mais les grands vaspuhrs n'avaient pas renoncé à leur prérogaties et le clergé voulut contrôler une monarchie qui dès le début prétendit tenir son pouvoir d'une investiture divine. La faiblesse des successeurs de Shapûr II et l'absence d'une tradition définie en matière de succession permirent aux nobles et au clergé de contrôler le pouvoir royal. Le royaume devint une sorte de monarchie élecive dans la famille des Sassanides. L'élection appartenait aux plus hauts dignitaires de l'Etat et en dernier ressort, dépendant du Grand Mobedh. Leur politique antichrétienne occasionna des difficultés avec Constantinople et surtout une grande révolte de l'Arménie en 450. L'Empire souffrait de longs efforts financiers imposés par les guerres orientales, de sécheresses et de famine. C'est alors qu'intervient la grande défaite de 484 devant les Huns. Un lourd tribut annuel aggrava les difficultés du pays et l'armée n'existait pratiquement plus quand en 488, arrive au pouvoir le fils de Firuz, Kawadh : ses bonnes relations avec les Hephtalites, chez qui il avait été élevé, laissent bien augurer de l'avenir.
Organisation de l'Empire.
Les premiers Sassanides avaient dû ménager la très haute noblesse des vaspuhrs. Leur politique consista à s'appuyer sur la classe des propriétaires fonciers moyens pour constituer une bureaucratie stable liant la province à la capital. Le Grand Mobedh probablememnt nommé par le roi, le conseillait dans tous les cas où il s'agissait de religion et pouvait inspirer largement sa politique. Le Grand Vizir dirigeait l'administration centrale, l'étendue de son pouvoir est mal connue. 3 autres grands dignitaires avaient d'importantes fonctions : le chef des Guerriers, le chef de la Bureaucratie et le chef des Agriculteurs et des Artisans, responsable de la levée de l'impôt foncier et de la capitation,. L'impôt foncier, payé par les paysans, était réparti en fonction de la fertibilité de la terre, son montant allait du sixième au tiers de la récolte, et le revneu global variait donc beaucoup d'une année sur l'autre. La capitation était acquittée par tous sauf les nobles, les prêtres, les soldats et les fonctionnaires. Les revenus de l'Empire comprenaient en outre, des contributions extraordinaires pour la guerre, des dons coutumiers, les revenus des domaines royaux et de la régale, les droits de douane. Les Sassanides veillèrent à lier soigneusement la province à la capitale. Matiriellement un bon service de postes assurait les communications. Quelques princes vassaux qui avaient le titre de rois, les shaks, furent maintenus aux frontières, ainsi les prinves arabes lakhmides de Hira, les rois d'Arméni ( jusqu'en 430 ). Mais d'une façon générale, l'Empire fut divisé en provinces dirigées par des marzbans, choisis par la haute noblesse. Les provinces étaient divisées en nomes et cantons qui avaient pour centre une ville. Le canton était administré par un fonctionnaire choisi parmi les chefs du village, ou dehkans. Elles avaient un caractère plutôt militaire et les marzbans dépendaient totalement du souverain.
La véritable administration civile était au niveau des cantons : sur eux reposait la stabilité réelle du pays. De cet empire, Ctésiphon était la capitale. C'est là qu'en dehors du territoire iranien résidait le Roi des rois. L'agriculture constituait la base économique de l'Empire. De Grands domaines dont on connaît mal le mode d'exploitation, appartenaient à la noblesse, aux grands temples et à l'Etat. Il semble que les esclaves étaient en voie d'affranchissement mais les paysans étaient attachés à la glèbe et la loi leur accordait peu de protection. Astreints au paiement de l'impôt foncier et de la capitation., il devaient servir dans l'armée comme fantassins. L'irrigation était soigneusement réglementée et l'essor urbain, qui caractérise l'époque sassanide, est lié, dans ses causes et ses effets, à l'activité agricole. De villes nouvelles furent fondées et surtout peuplées d'artisans pris au cours des guerres. Ne payant que la capitation et dispensés su service militaire, les artisans connaissaient un sort meilleur que celui des paysans, mais supportaient en temps de guerre le poids de lourdes contribuations. Parmi eux se trouvaient les groupes chrétiens les plus nombreux. L'acitivé la plus connue était le tissage de la soie. L'empire sassanide tira en effet largement partie de sa situation entre le monde méditerranéen et le monde chinois. Depuis Ctésiphon les routes vers l'est gagnaient Hamadhann, la Susianne, la Perside et le golfe Persique. Une autre route reliait Hamadhân à Rayy puis se divisait, permettant de joindre soit les rives de la Caspienne, soit Kaboul et l'Inde, soit la Chine. Ce dernier itinéraire impliquait de bonnes relations avec les puissances d'Asie centrale : Kouchans, Huns Hephtalites ou Turcs. Les Perses déloppèrent aussi une puissance marine qui, par le golfe Persique, captait au détriment du monde arabe, une grande partie du trafic de l'océan Indien.
il y a un an
Cependant, il me semble que c'est vers le milieu du 8e siècle, avec l’accession de la famille abbasside au califat, que l’islam commence à vraiment se penser comme une religion universelle.
Un important courant d'échanges existait vers les steppes du nord. Cependant le commerce avec le monde romain qui s'effectuait en Haute Mésopotamie ( par Nisibe et Dara à et en Arménie ( par Artaxata ) constituait pour la perse, le complément indispensable à ses activités avec le monde asiatique. Une monnaie d'argent, le direm, soutenait ce commerce : d'un poids à peu près constant, entre 3,65 et 3,94 g, elle portait à l'avers le buste du roi, avec des inscriptions en pehlvi, et au revers le temps du feu : le firem sassanide rivalisait sur les marchés orientaux avec le nomisma d'or byzantin. Toutefois les principaux bénéficiaires de cette activité étaient les nobles et le clergé. La société iranienne essentiellement aristocratique était figée en classes bien définies et la loi, fondée sur l'Avesta, s'efforçait de garantir la conversation de la famille et de la propriété et de maintenir les distinctions sociales. On conçoit qu'aux termes du Vème siècle, les milieux populaires aient particulièrement souffert de la situation générale. Le poids des impôts et des contributions de guerre conduisit beaucoup d'Iraniens à écouter les théories répandues alors par les Mazdakites dont ils retenaient surtout les aspects sociaux.
L'affirmation du pouvoir royal.
Un moment tenté par les idées mazdakites, Kawadh se consacra à partir de 499 à affermir le pouvoir royal en réformant certaines fonctions palatines. Les pillages et jacqueries suscités par les mazdakites le conduisirent à une sévère répression qui lui valut l'appui du clergé et la désignation de son fils Khusraw comme euccesseur. Khusraw, surnommé Anushirvan, " à l'âme immortelle ", inaugura la période la plus brillante de l'Empire. Après avoir rétablir l'ordre social, il réforma, en l'allégeant, le système des impôt et opéra une réforme militaire : une cavalerie iranienne permanente fut établie, renforcée de corps auxiliaires, et la fonction d'Eren Spahbadh partagée entre 4 généraux, chacun responsable d'un quart de l'Empire et assisté d'un marzban. Réformes fiscales et militaires devaient lui permettre de mener une politique extérieure expansionniste face à Byzance, aux Hephtalites et aux Abyssins, tandis qu'à l'intérieur il contrôlait sévèrement l'administration qui travaillait par l'intermédiaire de bureaux, ou dîwâns, assurait le bon fonctionnement de l'Empire. Unecour nombreuse entourait le souverain : les titres, les dons de robes d'honneur, les charges de cour et l'Etat servaient de récompense et de moyens de gouvernement.
L'art traduit le mieux l'éclat de cette période. Plus que les grands reliefs rupestres, caractérisques des premiers siècles plus que les grands palais où se combinent la voûte, la coupole, l'iwân, ce sont les arts somptuaires, qui s'épanouissement : l'orfèvrerie, sassanide figure, à côté de scènes de chasse ou de banquets, le roi trônant ou combattant; des soieries somptueses inscrivent dans des roues des motifs animaliers, affrontés ou adossés, des personnages à la chasse. Objets d'exportation, les grands plats d'argent, les coupes et les soieries de luxe faisaient connaître hors de l'Empire la grandeur du souverain que les monnaies représentent coiffé du korymbos, la solidité de l'Etat, le goût de la société pour le magnificience et le luxe. Une grande liberté de pensée régnait à la cour. Khusrax, ouvert et tolérant, y employait des chrétiens, accuillait les philosophes grecs, encourageait l'enseignement de la médecine. L'influence indienne se faisait sentir, notamment dans la littérature avec la traduction en pehlvi des fables de Kalila et Dimna.
Des écrits sapeitnaixu se développaient. Cet éclat ne sortait guère cependant des milieux aristocratiques. La haute noblesse décimée et réorganisée était provisoirement tranquille, la petite noblesse des dehkans vivait à l'aise, mais la prospérité ne s'était pas réellement diffusée et le climat dz libre pensée favorisait les critiques contre le dogmatisme zoroastrien. Le pouvoir royal devait encore briller d'un vif éclat sous Khusraw II mais déjà s'était manifesté ce qui devait dominer le début du VIIème siècle : les tentatives d'usurpation du pouvoir par les généraux dont la réforme militaire de Khursaw avait renforcé la puissance. Il reste malheureusement peu de choses des constructions de cette époque, mais les auteurs arabes et hindous nous font connaître avec les détails les merveilles du palais de Dastgard, près de Ctéphison. Le luxe, l'or et la richesse s'expliquaient par les profits de la guerre, et aussi par une dure politique intérieure. Les mécontentements se développaient, devant l'oppression fiscale et l'arbitraire envers les grands; les mages, afafiblis et critiqués, mais qui gardaient toute leur puissance économique, s'irritaient des faveurs faites aux chrétiens. La reconquête d'Héraclius marqua le début des revers illustrés par la destruction du temple du feu de Gandzak en 624 et la prise du palais royal de Dastgard en 628. La mort de Khusraw II qui intervint peu après fut suivie de règnes éphémères de princes qui n'étaient même pas toujours reconnus dans tous l'Empire. Tandis que seule restait solide, à la base, l'administration des dehkans, les symptômes de désorganisation se manifestaient au sommet : régionalement les spahbads tentaient de s'imposer et lorsqu'en 636, les armées arabes arrivèrent à Ctésiphon, il n'existait plus d'autorité centrale, le dernier fils de Khusraw, Yazdgard, n'avait de roi que le titre.
.
Un important courant d'échanges existait vers les steppes du nord. Cependant le commerce avec le monde romain qui s'effectuait en Haute Mésopotamie ( par Nisibe et Dara à et en Arménie ( par Artaxata ) constituait pour la perse, le complément indispensable à ses activités avec le monde asiatique. Une monnaie d'argent, le direm, soutenait ce commerce : d'un poids à peu près constant, entre 3,65 et 3,94 g, elle portait à l'avers le buste du roi, avec des inscriptions en pehlvi, et au revers le temps du feu : le firem sassanide rivalisait sur les marchés orientaux avec le nomisma d'or byzantin. Toutefois les principaux bénéficiaires de cette activité étaient les nobles et le clergé. La société iranienne essentiellement aristocratique était figée en classes bien définies et la loi, fondée sur l'Avesta, s'efforçait de garantir la conversation de la famille et de la propriété et de maintenir les distinctions sociales. On conçoit qu'aux termes du Vème siècle, les milieux populaires aient particulièrement souffert de la situation générale. Le poids des impôts et des contributions de guerre conduisit beaucoup d'Iraniens à écouter les théories répandues alors par les Mazdakites dont ils retenaient surtout les aspects sociaux.
L'affirmation du pouvoir royal.
Un moment tenté par les idées mazdakites, Kawadh se consacra à partir de 499 à affermir le pouvoir royal en réformant certaines fonctions palatines. Les pillages et jacqueries suscités par les mazdakites le conduisirent à une sévère répression qui lui valut l'appui du clergé et la désignation de son fils Khusraw comme euccesseur. Khusraw, surnommé Anushirvan, " à l'âme immortelle ", inaugura la période la plus brillante de l'Empire. Après avoir rétablir l'ordre social, il réforma, en l'allégeant, le système des impôt et opéra une réforme militaire : une cavalerie iranienne permanente fut établie, renforcée de corps auxiliaires, et la fonction d'Eren Spahbadh partagée entre 4 généraux, chacun responsable d'un quart de l'Empire et assisté d'un marzban. Réformes fiscales et militaires devaient lui permettre de mener une politique extérieure expansionniste face à Byzance, aux Hephtalites et aux Abyssins, tandis qu'à l'intérieur il contrôlait sévèrement l'administration qui travaillait par l'intermédiaire de bureaux, ou dîwâns, assurait le bon fonctionnement de l'Empire. Unecour nombreuse entourait le souverain : les titres, les dons de robes d'honneur, les charges de cour et l'Etat servaient de récompense et de moyens de gouvernement.
L'art traduit le mieux l'éclat de cette période. Plus que les grands reliefs rupestres, caractérisques des premiers siècles plus que les grands palais où se combinent la voûte, la coupole, l'iwân, ce sont les arts somptuaires, qui s'épanouissement : l'orfèvrerie, sassanide figure, à côté de scènes de chasse ou de banquets, le roi trônant ou combattant; des soieries somptueses inscrivent dans des roues des motifs animaliers, affrontés ou adossés, des personnages à la chasse. Objets d'exportation, les grands plats d'argent, les coupes et les soieries de luxe faisaient connaître hors de l'Empire la grandeur du souverain que les monnaies représentent coiffé du korymbos, la solidité de l'Etat, le goût de la société pour le magnificience et le luxe. Une grande liberté de pensée régnait à la cour. Khusrax, ouvert et tolérant, y employait des chrétiens, accuillait les philosophes grecs, encourageait l'enseignement de la médecine. L'influence indienne se faisait sentir, notamment dans la littérature avec la traduction en pehlvi des fables de Kalila et Dimna.
Des écrits sapeitnaixu se développaient. Cet éclat ne sortait guère cependant des milieux aristocratiques. La haute noblesse décimée et réorganisée était provisoirement tranquille, la petite noblesse des dehkans vivait à l'aise, mais la prospérité ne s'était pas réellement diffusée et le climat dz libre pensée favorisait les critiques contre le dogmatisme zoroastrien. Le pouvoir royal devait encore briller d'un vif éclat sous Khusraw II mais déjà s'était manifesté ce qui devait dominer le début du VIIème siècle : les tentatives d'usurpation du pouvoir par les généraux dont la réforme militaire de Khursaw avait renforcé la puissance. Il reste malheureusement peu de choses des constructions de cette époque, mais les auteurs arabes et hindous nous font connaître avec les détails les merveilles du palais de Dastgard, près de Ctéphison. Le luxe, l'or et la richesse s'expliquaient par les profits de la guerre, et aussi par une dure politique intérieure. Les mécontentements se développaient, devant l'oppression fiscale et l'arbitraire envers les grands; les mages, afafiblis et critiqués, mais qui gardaient toute leur puissance économique, s'irritaient des faveurs faites aux chrétiens. La reconquête d'Héraclius marqua le début des revers illustrés par la destruction du temple du feu de Gandzak en 624 et la prise du palais royal de Dastgard en 628. La mort de Khusraw II qui intervint peu après fut suivie de règnes éphémères de princes qui n'étaient même pas toujours reconnus dans tous l'Empire. Tandis que seule restait solide, à la base, l'administration des dehkans, les symptômes de désorganisation se manifestaient au sommet : régionalement les spahbads tentaient de s'imposer et lorsqu'en 636, les armées arabes arrivèrent à Ctésiphon, il n'existait plus d'autorité centrale, le dernier fils de Khusraw, Yazdgard, n'avait de roi que le titre.
.
il y a un an
Donc en terme d'influence, je vais dire abbasside.

Mais j'aurai voulu mettre les Ottomans également.
En 2 siècles et plus, les Ottomans ont soumis la quasi totalité des Etats qui les entouraient, intégrant chrétiens et juifs sous le statut de zimmi et enrôlé un nombre croissant de recrus dans des régiments légers et sur leurs galères. Ils ont couvert les espaces conquis de mosquées et ont diffusé leurs idéaux des " beys des frontières " ( uc beyci à et de la mystique des derviches. Mais ils ont conversé la plupart des traditions des pays dominés, se sont accommodés des pouvoirs locaux placés sous leur tutelle tout en posant les cadres d'un mode de souveraineté inédite en terre d'islam comme en pays chrétien. Au milieu du Vème siècle un nouvel âge de formation du droit et de la souveraineté s'ouvre. Nouvelle capitale repeuplée et embellie, protégée aussi, équilibre des institutions dont le palais Topkapi est le siège et le miroir, suprématie impériale en Europe et en Asie Mineure, jonctions sans entrave entre les 2 continents, extension nouvelle en Asie et en Afrique du Nord, conquête des grandes centres des pays de l'islam. Sous le règne de Muraf III l'esprit des témoins de l'époque s'obscurcit d'inquiétudes. Conquêtes se poursuivent ( Chypre en 1571n Tunis en 1574 ) mais les soldes sont difficilement payées, le système timarial réduit ses capacités et le sultan se replie dans son palais. C'est la fin d'un cycle d'extension continue. L'échec devant Malte en 1565, la défaite de Lépante en 1571, la dévaluation de 1585 - 1586 et le renoncement de l'établissement d'une base ottomane près de Tanger en 1580 révèlent autant les lézardes de l'outil militaire qu'ils signalent les limites de la logistique navale.
Bien des historiens n'ont pas essayé de nuancer la grandeur des souverains et vizirs qui se sont succédé entre 1453 et 1574 car leur temps est celui de l'expansion ibérique et du " beau 16ème siècle " L'époque accueille aussi des transferts culturels, permettant des alliances comme celle entre François Ier et Soliman. Bayezid II ( 1481 - 1512 ) en qui on vit un faible paralysé par la menace de son frère Cem et dont le règne a fini par une grave crise, s'est employé à refermer les fractures produites sous le règne de Mehmed II, a redonné la cohérence à la formation impériale et consolidé l'organisation de l'administration et de la marine. Le père du second, Selim Ier, a régné peu de temps ( 1512 - 1520 ) et exprimé son autorité dans la fureur mais il a pris le contrôle des Lieux Saints. Champion de l'Islam sunnite face à la poussée safavide, il a conquis des pays ayant donné à l'Empire une population majoritairement musulmane. Quand à Selim II ( 1566 - 1574 ) longtemps déconsidéré par les historiens, il apparaît qu'il a poursuivi en grande parti l'oeuvre de son père Soliman. Sans vouloir rabaisser, ce grand siècle turc fut aussi une période de mutations complexes et de progressions ralenties. Mehmed II est un souverain cultivé, intéressé par les questions religieuses et de philosophie antique, connaissait le grec et le latin, plus maîtrisait l'arabe et le persan. Il est seul sultan des siècles ottomans à commander son portrait. Chef de guerre avisé et audacieux. Sa vision de l'Etat il la puise dans sa lecture de classiques. C'est un conquérant, Fatih, surnom que la postérité lui lègue. Il fait tomber Cosntantinople contrairement à Bayezid Ier en 1394, Murad II en 1422. Sans oublier les 5 souverains arabes ayant tenté de prendre la ville entre 655 et 785.
Des propos attribués au prophète ( hadiths ) lient la prise de la ville à la fin des temps. Mehmed II avait fait de la conquête de Constantinople sa priorité. Il veut marquer son retour au trône par un coup d'éclat., son premier règne était relativement infructueux ( 1444 - 1446 ) et ainsi prendre l'ascendant sur son grand vizir, Candarli Halil Pacha, partisan du maintien d'une paix bénéfice au commerce de l'Etat et hostile au principe d'un nouveau siège de la ville. Prendre Constantinople c'est hériter de l'empire du monde, contrôler les routes maritimes de la mère Noire, réaliser l'unité territoriale entre l'Anatolie eet la Roumélie; réduire les appels à la croisade dy Byzantin aux Latins, renflouer le Trésor mis à mal par les campagnes précédentes. Mais cela demandait des préparatifs, assurer la sécurité aux frontières pour ne pas avoir à lever le siège. Un traité avec Venise est signé en 1451, une trêve de 3 ans est conclue avec les Hongrois. Un nouveau fort est construit sur la rive européenne face au château d'Anatolie ( Anadolu Hisan ) élevé par Bayezid Ier. Les tirs croisés des 2 forts permettant de contrôler le Bosphore. La flotte est renforcée et des dizaines de millierss d'hommes, des timariotes et janissaires, sont levés auquels s'ajoutent des mineurs serbes venus des territoires ottomans et quantité de volontaires auxquels l'Etat fait miroiter un butin fructueux et l'espoir d'une dotation foncière. Il faut aussi un prétexte : suite à un accrochage hors les murs, Constantin XI décrète la fermeture des ports de la ville, confinant les musulmans qui s'y trouvent. Surtout, ce qui a fait échoué les autres, les murailles de ma ville. De puissants canons sont fondus à Edirne et transportés jusqu'à Constantinople.
Conçue par un maître hongrois, une pièce de 8 mètres de long fait la joie du souverain. Durablement affaibli, l'Etat byzantin n'abrite dans ses murailles que quelques milliers de soldats à peine augmentés des équipages de navires génois. Mais la ville est réputée imprenable, les Byzantins disposent Corne d'Or : tant que l'approvisionnement est possible, le siège peut être soutenu. Premiers jours d'avirl, Mehmed II s'installca face à la porte de Saint Romain. Les murailles sont ébranéls par l'artillerie mais le premier assaut du 18 avril est repoussé. Des vaisseaux génois arrivent à la ville, soulignant les insuffisances de la marine ottomane. Le sultan réagit et 70 bateaux sont transportés par voie terrestre à partir du Bosphore vers la Corne d'Or. Un pont flottant est étbali; l'artillerie a désormais prise sur les murailles septentrionales. De nouveaux assauts sont repoussés les 7 et 12 mai; la crainte d'une arrivée de renforts occidentaux se fait ressentir. Le parti de la paxi reste influent dans le conseil de guerre mais les Byzantins sont affaiblis par le début d'une disette et d'un manque croissant de poudres. 29 mai, Mehmed lance une attaque sur tous les fronts; Des brèches sont causées par l'artillerie. Le gros des défenseurs génoix fuient et Constantin XI disparaît dans la débâcle. Le pillage et les massacres débutent. Mehmed II, ne souhaitant pas ruiner la ville à jamais mais la repeupler, met fin à cela au bout d'un jour. Mehmed II s'assure un prestige sans pareil aux yeux des peuples d'Islam et de leurs gouvernants. Il s'inscrit dans la lignée d'Alexandre le Grand. En 1458 - 1459 il élit Istanbul pour résidence.Une partie de son entourage voyait en Constantinople une cité maudite et l'encouageait à s'installer à Ederin, " ancien et saint seuil des gazi ".
Dans la décennie suivante, Mehmed II entreprend la construction d'une résidence plus vaste plus aidée à défendre et plus proche de Sainte Sophie,. Située sur l'ancien site de l'acropole byzantine, le " nouveau palais " est connu sous le nom de Topkapi.
En Europe la souveraineté ottomane s'applique à 2 cercles distincts : le premier comprenant les territoires anciennement cinquis ( Bulgarie, Thrace, Thessalie, Macédoine et Dobroudja ) situés à proximité de la capitale Edirne. Le pouvoir central exerce son emprise de façon direct et rigoureux. La plupart de ces pays ont coupé les liens avec le reste de l'Europe et des populations musulmanes sont installées dans les pôles urbains comme Nicopolus, Kyustendil, Trikala, Stokpe, Silistra ) et les campagnes environnantes. Le second cercle est formé de possessions plus récentes, comme l'Albanie et la Serbie, plus instables et éloignées des bases logistiques ottomanes.
La république des turcs.
Le sultan est garant des institutions impériales, garant du bon ordre du monde et incarne la justice. Il est soumis comme tout musulman à la loi Sainte mais à lui seul cette loi confère un pouvoir absolu, légitimé par la volonté divine. Monarque universel, il promulgue des firmans qui commandent " obéissance au monde entier ". Les hauts murs encerclant le palais de Topkapi sont faits pour impressionner et séparer les gens de la ville de leur monarque. Le sultan est celui qui sans être vu, voit tout. Le plan du palais a été conçu sous Mehmed II mais Soliman a fait d'importants aménagements pour y installer sa famille notamment. Aménagements poursuivis par Murad III durant les années 1580. Différente de la structure des châteaux européens construits autour d'un bâtiment central, l'organisation générale du site reproduit en partie le plan des camps militaires ottomans et l'enchaînement de cours successives séparées par d'importantes portes et bordées de pavillons aux formes diverses ne sont pas sans évoquer l'architecture de grands couvents anatoliens ou les agencements de cités intérieurs artistiques. A la pointe du séral sont installées des pièces d'artillerie, d'où le nom Topkapi, " porte des canons " utilisées pour tirer des salves d'honneur car le Bosphore est à l'abri de toute incursion étrangère. L'ensemble est divisé en 2 parties principales : dans les 2 premières cours les services extérieures ( birun t humayun ) accueillent le gouvernement central, la salle du conseil et plusieurs corps professionnels et militaires. Le personnel y est nombreux et soigneusement enregistré. Les écuries abritent des milliers de chevaux et les cuisines impériales nourrissent les résidents du palais, les invités étrangers lors des réceptions d'ambassadeur et le peuple lors des grands festins données par le monarque.
Mais j'aurai voulu mettre les Ottomans également.
En 2 siècles et plus, les Ottomans ont soumis la quasi totalité des Etats qui les entouraient, intégrant chrétiens et juifs sous le statut de zimmi et enrôlé un nombre croissant de recrus dans des régiments légers et sur leurs galères. Ils ont couvert les espaces conquis de mosquées et ont diffusé leurs idéaux des " beys des frontières " ( uc beyci à et de la mystique des derviches. Mais ils ont conversé la plupart des traditions des pays dominés, se sont accommodés des pouvoirs locaux placés sous leur tutelle tout en posant les cadres d'un mode de souveraineté inédite en terre d'islam comme en pays chrétien. Au milieu du Vème siècle un nouvel âge de formation du droit et de la souveraineté s'ouvre. Nouvelle capitale repeuplée et embellie, protégée aussi, équilibre des institutions dont le palais Topkapi est le siège et le miroir, suprématie impériale en Europe et en Asie Mineure, jonctions sans entrave entre les 2 continents, extension nouvelle en Asie et en Afrique du Nord, conquête des grandes centres des pays de l'islam. Sous le règne de Muraf III l'esprit des témoins de l'époque s'obscurcit d'inquiétudes. Conquêtes se poursuivent ( Chypre en 1571n Tunis en 1574 ) mais les soldes sont difficilement payées, le système timarial réduit ses capacités et le sultan se replie dans son palais. C'est la fin d'un cycle d'extension continue. L'échec devant Malte en 1565, la défaite de Lépante en 1571, la dévaluation de 1585 - 1586 et le renoncement de l'établissement d'une base ottomane près de Tanger en 1580 révèlent autant les lézardes de l'outil militaire qu'ils signalent les limites de la logistique navale.
Bien des historiens n'ont pas essayé de nuancer la grandeur des souverains et vizirs qui se sont succédé entre 1453 et 1574 car leur temps est celui de l'expansion ibérique et du " beau 16ème siècle " L'époque accueille aussi des transferts culturels, permettant des alliances comme celle entre François Ier et Soliman. Bayezid II ( 1481 - 1512 ) en qui on vit un faible paralysé par la menace de son frère Cem et dont le règne a fini par une grave crise, s'est employé à refermer les fractures produites sous le règne de Mehmed II, a redonné la cohérence à la formation impériale et consolidé l'organisation de l'administration et de la marine. Le père du second, Selim Ier, a régné peu de temps ( 1512 - 1520 ) et exprimé son autorité dans la fureur mais il a pris le contrôle des Lieux Saints. Champion de l'Islam sunnite face à la poussée safavide, il a conquis des pays ayant donné à l'Empire une population majoritairement musulmane. Quand à Selim II ( 1566 - 1574 ) longtemps déconsidéré par les historiens, il apparaît qu'il a poursuivi en grande parti l'oeuvre de son père Soliman. Sans vouloir rabaisser, ce grand siècle turc fut aussi une période de mutations complexes et de progressions ralenties. Mehmed II est un souverain cultivé, intéressé par les questions religieuses et de philosophie antique, connaissait le grec et le latin, plus maîtrisait l'arabe et le persan. Il est seul sultan des siècles ottomans à commander son portrait. Chef de guerre avisé et audacieux. Sa vision de l'Etat il la puise dans sa lecture de classiques. C'est un conquérant, Fatih, surnom que la postérité lui lègue. Il fait tomber Cosntantinople contrairement à Bayezid Ier en 1394, Murad II en 1422. Sans oublier les 5 souverains arabes ayant tenté de prendre la ville entre 655 et 785.
Des propos attribués au prophète ( hadiths ) lient la prise de la ville à la fin des temps. Mehmed II avait fait de la conquête de Constantinople sa priorité. Il veut marquer son retour au trône par un coup d'éclat., son premier règne était relativement infructueux ( 1444 - 1446 ) et ainsi prendre l'ascendant sur son grand vizir, Candarli Halil Pacha, partisan du maintien d'une paix bénéfice au commerce de l'Etat et hostile au principe d'un nouveau siège de la ville. Prendre Constantinople c'est hériter de l'empire du monde, contrôler les routes maritimes de la mère Noire, réaliser l'unité territoriale entre l'Anatolie eet la Roumélie; réduire les appels à la croisade dy Byzantin aux Latins, renflouer le Trésor mis à mal par les campagnes précédentes. Mais cela demandait des préparatifs, assurer la sécurité aux frontières pour ne pas avoir à lever le siège. Un traité avec Venise est signé en 1451, une trêve de 3 ans est conclue avec les Hongrois. Un nouveau fort est construit sur la rive européenne face au château d'Anatolie ( Anadolu Hisan ) élevé par Bayezid Ier. Les tirs croisés des 2 forts permettant de contrôler le Bosphore. La flotte est renforcée et des dizaines de millierss d'hommes, des timariotes et janissaires, sont levés auquels s'ajoutent des mineurs serbes venus des territoires ottomans et quantité de volontaires auxquels l'Etat fait miroiter un butin fructueux et l'espoir d'une dotation foncière. Il faut aussi un prétexte : suite à un accrochage hors les murs, Constantin XI décrète la fermeture des ports de la ville, confinant les musulmans qui s'y trouvent. Surtout, ce qui a fait échoué les autres, les murailles de ma ville. De puissants canons sont fondus à Edirne et transportés jusqu'à Constantinople.
Conçue par un maître hongrois, une pièce de 8 mètres de long fait la joie du souverain. Durablement affaibli, l'Etat byzantin n'abrite dans ses murailles que quelques milliers de soldats à peine augmentés des équipages de navires génois. Mais la ville est réputée imprenable, les Byzantins disposent Corne d'Or : tant que l'approvisionnement est possible, le siège peut être soutenu. Premiers jours d'avirl, Mehmed II s'installca face à la porte de Saint Romain. Les murailles sont ébranéls par l'artillerie mais le premier assaut du 18 avril est repoussé. Des vaisseaux génois arrivent à la ville, soulignant les insuffisances de la marine ottomane. Le sultan réagit et 70 bateaux sont transportés par voie terrestre à partir du Bosphore vers la Corne d'Or. Un pont flottant est étbali; l'artillerie a désormais prise sur les murailles septentrionales. De nouveaux assauts sont repoussés les 7 et 12 mai; la crainte d'une arrivée de renforts occidentaux se fait ressentir. Le parti de la paxi reste influent dans le conseil de guerre mais les Byzantins sont affaiblis par le début d'une disette et d'un manque croissant de poudres. 29 mai, Mehmed lance une attaque sur tous les fronts; Des brèches sont causées par l'artillerie. Le gros des défenseurs génoix fuient et Constantin XI disparaît dans la débâcle. Le pillage et les massacres débutent. Mehmed II, ne souhaitant pas ruiner la ville à jamais mais la repeupler, met fin à cela au bout d'un jour. Mehmed II s'assure un prestige sans pareil aux yeux des peuples d'Islam et de leurs gouvernants. Il s'inscrit dans la lignée d'Alexandre le Grand. En 1458 - 1459 il élit Istanbul pour résidence.Une partie de son entourage voyait en Constantinople une cité maudite et l'encouageait à s'installer à Ederin, " ancien et saint seuil des gazi ".
Dans la décennie suivante, Mehmed II entreprend la construction d'une résidence plus vaste plus aidée à défendre et plus proche de Sainte Sophie,. Située sur l'ancien site de l'acropole byzantine, le " nouveau palais " est connu sous le nom de Topkapi.
En Europe la souveraineté ottomane s'applique à 2 cercles distincts : le premier comprenant les territoires anciennement cinquis ( Bulgarie, Thrace, Thessalie, Macédoine et Dobroudja ) situés à proximité de la capitale Edirne. Le pouvoir central exerce son emprise de façon direct et rigoureux. La plupart de ces pays ont coupé les liens avec le reste de l'Europe et des populations musulmanes sont installées dans les pôles urbains comme Nicopolus, Kyustendil, Trikala, Stokpe, Silistra ) et les campagnes environnantes. Le second cercle est formé de possessions plus récentes, comme l'Albanie et la Serbie, plus instables et éloignées des bases logistiques ottomanes.
La république des turcs.
Le sultan est garant des institutions impériales, garant du bon ordre du monde et incarne la justice. Il est soumis comme tout musulman à la loi Sainte mais à lui seul cette loi confère un pouvoir absolu, légitimé par la volonté divine. Monarque universel, il promulgue des firmans qui commandent " obéissance au monde entier ". Les hauts murs encerclant le palais de Topkapi sont faits pour impressionner et séparer les gens de la ville de leur monarque. Le sultan est celui qui sans être vu, voit tout. Le plan du palais a été conçu sous Mehmed II mais Soliman a fait d'importants aménagements pour y installer sa famille notamment. Aménagements poursuivis par Murad III durant les années 1580. Différente de la structure des châteaux européens construits autour d'un bâtiment central, l'organisation générale du site reproduit en partie le plan des camps militaires ottomans et l'enchaînement de cours successives séparées par d'importantes portes et bordées de pavillons aux formes diverses ne sont pas sans évoquer l'architecture de grands couvents anatoliens ou les agencements de cités intérieurs artistiques. A la pointe du séral sont installées des pièces d'artillerie, d'où le nom Topkapi, " porte des canons " utilisées pour tirer des salves d'honneur car le Bosphore est à l'abri de toute incursion étrangère. L'ensemble est divisé en 2 parties principales : dans les 2 premières cours les services extérieures ( birun t humayun ) accueillent le gouvernement central, la salle du conseil et plusieurs corps professionnels et militaires. Le personnel y est nombreux et soigneusement enregistré. Les écuries abritent des milliers de chevaux et les cuisines impériales nourrissent les résidents du palais, les invités étrangers lors des réceptions d'ambassadeur et le peuple lors des grands festins données par le monarque.
il y a un an
Mais bon, pas un choix facile dans tous les cas.
Dans la troisième cour se tient la partie intérieure du palais ( endrun i humayun ) accessible aux seuls compagnons du sulta, ses pages, ses eunuques et ses femmes. Les 2 ensembles sont séparés par la porte de la Falicité ( bab us saade ) derrière laquelle le souverain accueille des visiteurs dans un petit pavillon. La partie la plus secrète du palais est le Harem, objet de légendes décrits dans quantité de relations de voyage. Le sultan est le seul homme non castré à pouvoir y entrer. C'est un complexe labyrinthique de pièces et de cours. L'ordre et la discipline sont assurés par un corps d'eunuques, symétrique des eunuques blancs affectés aux services intérieurs. Y vivent les esclaves parmi lesquelles les sultans prennent femme sans généralement contracter d'union légale, le mariage de Soliman à Roxelane, sa seule épouse, faisant office d'exception à la règle. Y vivent aussi les filles du souverain jusqu'à ce qu'elles soient mariées aux plus influences des esclaves de la Porte qui deviennent ainsi les gendres ( damad ) de leur maître. C'est le meilleur moyen de s'assurer la loyauté de ces derniers, maintenir la primauté de la lignée masculine issue des sultans et par là, garantir la continuité de la dynastie sans laquelle dans l'imaginaire des sultans et de ses serviteurs, il n'est pas d'intégrité impériale. Sont aussi logées au Harem des novices issues du butin de guerre, des dons de courtisans ou d'achats au marché d'esclave. On leur inculque les principes de l'Islam ainsi que divers savoirs pratiques. Au fil de sélections successives, certaines d'entre elles s'élèvent dans la hiérarchie du Palais et épousent des pages du sultan qui alimenteux eux mêmes le vivier de recrutement des agents de la Porte.
L'histoire du droit ottoman est fait d'arrières plans idéologiques. Les historiens de l'époque kémaliste ont mésestimé le caractère sécularisé des institutions impériales et ceux du régime de l'AKP n'ont eu de cesse de souligner les dimensions islamiques du pouvoir du sultan. A travers la figure du sultan convergent 3 traditions juridiques. La première turco mondole, place la justice au coeur de l'exercice du pouvoir. En toutes circonstances, le monarque se doit de protéger ses sujets contre les abus des gouvernants. A cette fin il applique la loi suprême ( yasa ) dont il est le garant. La seconde, iranienne, établit la justice comme grâce ou faveur du pouvoir royal. Son exercice procède de l'expression des qualités du souverain. La troisième prolonge la conception islamique d'une communauté politico religieuse ( umma ) : le sultan se doit d'être " juste " ( adil ). Le système politique d'organise autour de la théorie du " cercle de justice " ( daire i adliye ), formalisée par la moraliste de Kinakizade Ali à partir de préceptes élaborés au Xème siècle : " La justice conduit à la justesse du monde. Le monde est un jardin, ses murs sont l'Etat. L'Etat est gouverné par la charia. La charia n'est défendue que par le roi. Le roi ne peut gouverner qu'avec l'aide d'une armée. L'armée n'est rassemblée que par l'argent. L'argent est accumulé par les sujets. C'est la justice qui fait les sujets serviteurs d'un souverain. " Dans les territoires étendus par les conquêtes et partagés au sein du dar al islam, le sultan doit préserver la loi religieuse et assurer son application. Il peut en interpréter les dispositions - cette fonction revient aux muftis.
Mais à partir des années 1520 les muftis d'Istanbul ( seyh ûl islam ) jouent un rôle grandissant dans l'harmonisation du droit et la systématisation des procédures judiciaires et administratives. Un éminent titulaire du poste, Ebussud ( 1574 ) dispose qu'il appartient au sultan d'opter entre diverses opinions émises par les juristes. Cette théorie établit l'importance du kanun dans le droit ottoman. Certes les règlements de la charia en dépend. Mans en pratique leur application prévaut dans bien des domaines. Alors que la charia dconsidère par exemple le mariage comme un contrat privé conclu oralement en présence de témoins, un décret du sulta rend l'enregistrement de l'acte obligatoire. Une autre innovation est instaurée, également considérable : contrairement à ce qui est prévu dans la théologie islamique, une cléricature est intégrée à l'appareil d'Etat. Classement des collèges de formation, hiérarchisation des postes et réglementation des carrières participent d'une fonctionnarisation du clergé. Cependant les oulémas des provinces arabes incorporées dans l'Empire conservent leur école juridique ( hanbalite, chaféite, ou malékite ) et les règles antérieures à la conquête y sont attachées. Au sommet de la ilmiye, le seyh ul islam est assisté de 2 juges suprêmes ( jazasker de Roumélie et d'Anatolie ). A la différence du premier, les seconds siègent au divan, lui conférant la qualité de tribunal. 3 hauts dignitaires ont autorité sur les oulémas et veillent à l'observation de la chariat autant qu'à l'application du droit du sultan. Ce sont les kazasker et non les cadis qui jugent des infractions commises par les askeri.
En 1545 le sultan ottoman apporte une innovation supplémentaire dans la longue histoire de l'Islam : le chef de l'Etat prend contrôle du corps des oulémas. Il donne au mufti d'Istanbul la prééminence sur les autres dignitaires. Placé à la tête de la hiérarchie des clercs,le syh ul islam nomme aux fonctions de la magistrature et présente au sultan des projets de décret. Soliman le consulte sur les grandes questions de droit et de politique : la guerre et la paix; la législation foncière; les règles à appliquer aux legs pieux. La terre est miri, c'est à dire propriété éminente du sultan. Elle constitue 87% des terres arables en 1528. Elle peut faire l'objet d'un titre légal de tenure ( tapu senedi ) conféré à un groupe ou à un particulier. Le droit d'exploiter la terre est transmissible sous certaines conditions. La propriété d'une terre peut être certains conditions. La propriété d'une terre peut être attribuée de manière définitive à des personnes : elle devient alors mûlk. Le détenteur d'un mulk a la possibilité de fonder sa concession en vakk : la propriété est immobilisée et rendue inaliénable dans un but charitable. En général, elle est loué avec des baux de longue durée ( jusqu'à 99 ans ). Toute terre cultivée qui n'est ni mulk ni vakf est miri. Les statuts fonciers sont attachés à des prélèvements fiscaux. L'impôt est régi par la coutume. Les taxes sont couchées par écrit dans des registres et sur les brevets ( berat ) individuels des amil ( fermiers de l'impôt ) et autres personnes chargées d'en assurer la levée. Ces documents ont force de loi : ils ont la forme de décrets et sont émis au nom du sultan. De la fin du XVème siècle à la fin du XVIème siècle, le matériel assemblé constitue la base des règlements appliqués ( kanunname ).
Dès lors que la structure fiscale de l'Empire change après 1600 la compilation des kannuname prend fin sauf ceux établis lors des nouvelles conquêtes ou reconquêtes du XVIIème siècle et du début du XVIIIème siècle. Par contre l'institution du timar se maintient : en 152 - 1528, elle représente 37% des revenus fiscaux et concerne 37 741 timariotes dont 9 653 janissaires ( localisés pour 69% d'entre eux en Roumélie ). Les officiers des échelons supérieurs perçoivent des allocations appelées zeamet ( moins de 100 000 aspres ) ou hass ( au dessus de 100 000 aspres ). En proportion des revenus perçus ils lèvent des hommes pour la guerre qu'ils sont chargés de mener au front et de commander sur le champ de bataille. A ces officiers supérieurs, des sipahi cèdent une partie de leurs revenus en général la taxe de labour. Eux mêmes disposent d'une réserve seigneuriale sur laquelle ils font travailler leur famille, leurs serviteurs, des esclaves ou des reaya assujettis à des corvées. Nul n'est propriétaire de son timar : le titulaire en bénéficie aussi longtemps qu'il accomplit le service militaire qui lui incombe. S'il ne se rend pas en campagne ou n'a pas l'équipement requis à l'inspection, s'il déserte ou commet d'autres sortes d'infraction, son timar lui est retiré et transmis à un autre titulaire. Si à l'inverse il se signale par de brillants états de service ou si pour parler comme Koçi Bey, auteur de mémorandums sous Murad IV, " il rapport les langues et les têtes " de ceux qu'il a tués au combat, son timar est augmenté. Au milieu du XVème siècle, la ilgne de séparation entre askeri et reaya est établie par l'usage systématique de registres fiacaux exhaustifs. Plus institutionnelle que sociologique cependa,t, elle se tranchit dans les décennies qui suivent : des magnats locaux, des knez chrétiens et des groupes de semi nomades parvienennent à quitter leur statut de reaya, assurent des fonctions militaires pour un temps avant de revenir à leur ancienne condition.
Dans la troisième cour se tient la partie intérieure du palais ( endrun i humayun ) accessible aux seuls compagnons du sulta, ses pages, ses eunuques et ses femmes. Les 2 ensembles sont séparés par la porte de la Falicité ( bab us saade ) derrière laquelle le souverain accueille des visiteurs dans un petit pavillon. La partie la plus secrète du palais est le Harem, objet de légendes décrits dans quantité de relations de voyage. Le sultan est le seul homme non castré à pouvoir y entrer. C'est un complexe labyrinthique de pièces et de cours. L'ordre et la discipline sont assurés par un corps d'eunuques, symétrique des eunuques blancs affectés aux services intérieurs. Y vivent les esclaves parmi lesquelles les sultans prennent femme sans généralement contracter d'union légale, le mariage de Soliman à Roxelane, sa seule épouse, faisant office d'exception à la règle. Y vivent aussi les filles du souverain jusqu'à ce qu'elles soient mariées aux plus influences des esclaves de la Porte qui deviennent ainsi les gendres ( damad ) de leur maître. C'est le meilleur moyen de s'assurer la loyauté de ces derniers, maintenir la primauté de la lignée masculine issue des sultans et par là, garantir la continuité de la dynastie sans laquelle dans l'imaginaire des sultans et de ses serviteurs, il n'est pas d'intégrité impériale. Sont aussi logées au Harem des novices issues du butin de guerre, des dons de courtisans ou d'achats au marché d'esclave. On leur inculque les principes de l'Islam ainsi que divers savoirs pratiques. Au fil de sélections successives, certaines d'entre elles s'élèvent dans la hiérarchie du Palais et épousent des pages du sultan qui alimenteux eux mêmes le vivier de recrutement des agents de la Porte.
L'histoire du droit ottoman est fait d'arrières plans idéologiques. Les historiens de l'époque kémaliste ont mésestimé le caractère sécularisé des institutions impériales et ceux du régime de l'AKP n'ont eu de cesse de souligner les dimensions islamiques du pouvoir du sultan. A travers la figure du sultan convergent 3 traditions juridiques. La première turco mondole, place la justice au coeur de l'exercice du pouvoir. En toutes circonstances, le monarque se doit de protéger ses sujets contre les abus des gouvernants. A cette fin il applique la loi suprême ( yasa ) dont il est le garant. La seconde, iranienne, établit la justice comme grâce ou faveur du pouvoir royal. Son exercice procède de l'expression des qualités du souverain. La troisième prolonge la conception islamique d'une communauté politico religieuse ( umma ) : le sultan se doit d'être " juste " ( adil ). Le système politique d'organise autour de la théorie du " cercle de justice " ( daire i adliye ), formalisée par la moraliste de Kinakizade Ali à partir de préceptes élaborés au Xème siècle : " La justice conduit à la justesse du monde. Le monde est un jardin, ses murs sont l'Etat. L'Etat est gouverné par la charia. La charia n'est défendue que par le roi. Le roi ne peut gouverner qu'avec l'aide d'une armée. L'armée n'est rassemblée que par l'argent. L'argent est accumulé par les sujets. C'est la justice qui fait les sujets serviteurs d'un souverain. " Dans les territoires étendus par les conquêtes et partagés au sein du dar al islam, le sultan doit préserver la loi religieuse et assurer son application. Il peut en interpréter les dispositions - cette fonction revient aux muftis.
Mais à partir des années 1520 les muftis d'Istanbul ( seyh ûl islam ) jouent un rôle grandissant dans l'harmonisation du droit et la systématisation des procédures judiciaires et administratives. Un éminent titulaire du poste, Ebussud ( 1574 ) dispose qu'il appartient au sultan d'opter entre diverses opinions émises par les juristes. Cette théorie établit l'importance du kanun dans le droit ottoman. Certes les règlements de la charia en dépend. Mans en pratique leur application prévaut dans bien des domaines. Alors que la charia dconsidère par exemple le mariage comme un contrat privé conclu oralement en présence de témoins, un décret du sulta rend l'enregistrement de l'acte obligatoire. Une autre innovation est instaurée, également considérable : contrairement à ce qui est prévu dans la théologie islamique, une cléricature est intégrée à l'appareil d'Etat. Classement des collèges de formation, hiérarchisation des postes et réglementation des carrières participent d'une fonctionnarisation du clergé. Cependant les oulémas des provinces arabes incorporées dans l'Empire conservent leur école juridique ( hanbalite, chaféite, ou malékite ) et les règles antérieures à la conquête y sont attachées. Au sommet de la ilmiye, le seyh ul islam est assisté de 2 juges suprêmes ( jazasker de Roumélie et d'Anatolie ). A la différence du premier, les seconds siègent au divan, lui conférant la qualité de tribunal. 3 hauts dignitaires ont autorité sur les oulémas et veillent à l'observation de la chariat autant qu'à l'application du droit du sultan. Ce sont les kazasker et non les cadis qui jugent des infractions commises par les askeri.
En 1545 le sultan ottoman apporte une innovation supplémentaire dans la longue histoire de l'Islam : le chef de l'Etat prend contrôle du corps des oulémas. Il donne au mufti d'Istanbul la prééminence sur les autres dignitaires. Placé à la tête de la hiérarchie des clercs,le syh ul islam nomme aux fonctions de la magistrature et présente au sultan des projets de décret. Soliman le consulte sur les grandes questions de droit et de politique : la guerre et la paix; la législation foncière; les règles à appliquer aux legs pieux. La terre est miri, c'est à dire propriété éminente du sultan. Elle constitue 87% des terres arables en 1528. Elle peut faire l'objet d'un titre légal de tenure ( tapu senedi ) conféré à un groupe ou à un particulier. Le droit d'exploiter la terre est transmissible sous certaines conditions. La propriété d'une terre peut être certains conditions. La propriété d'une terre peut être attribuée de manière définitive à des personnes : elle devient alors mûlk. Le détenteur d'un mulk a la possibilité de fonder sa concession en vakk : la propriété est immobilisée et rendue inaliénable dans un but charitable. En général, elle est loué avec des baux de longue durée ( jusqu'à 99 ans ). Toute terre cultivée qui n'est ni mulk ni vakf est miri. Les statuts fonciers sont attachés à des prélèvements fiscaux. L'impôt est régi par la coutume. Les taxes sont couchées par écrit dans des registres et sur les brevets ( berat ) individuels des amil ( fermiers de l'impôt ) et autres personnes chargées d'en assurer la levée. Ces documents ont force de loi : ils ont la forme de décrets et sont émis au nom du sultan. De la fin du XVème siècle à la fin du XVIème siècle, le matériel assemblé constitue la base des règlements appliqués ( kanunname ).
Dès lors que la structure fiscale de l'Empire change après 1600 la compilation des kannuname prend fin sauf ceux établis lors des nouvelles conquêtes ou reconquêtes du XVIIème siècle et du début du XVIIIème siècle. Par contre l'institution du timar se maintient : en 152 - 1528, elle représente 37% des revenus fiscaux et concerne 37 741 timariotes dont 9 653 janissaires ( localisés pour 69% d'entre eux en Roumélie ). Les officiers des échelons supérieurs perçoivent des allocations appelées zeamet ( moins de 100 000 aspres ) ou hass ( au dessus de 100 000 aspres ). En proportion des revenus perçus ils lèvent des hommes pour la guerre qu'ils sont chargés de mener au front et de commander sur le champ de bataille. A ces officiers supérieurs, des sipahi cèdent une partie de leurs revenus en général la taxe de labour. Eux mêmes disposent d'une réserve seigneuriale sur laquelle ils font travailler leur famille, leurs serviteurs, des esclaves ou des reaya assujettis à des corvées. Nul n'est propriétaire de son timar : le titulaire en bénéficie aussi longtemps qu'il accomplit le service militaire qui lui incombe. S'il ne se rend pas en campagne ou n'a pas l'équipement requis à l'inspection, s'il déserte ou commet d'autres sortes d'infraction, son timar lui est retiré et transmis à un autre titulaire. Si à l'inverse il se signale par de brillants états de service ou si pour parler comme Koçi Bey, auteur de mémorandums sous Murad IV, " il rapport les langues et les têtes " de ceux qu'il a tués au combat, son timar est augmenté. Au milieu du XVème siècle, la ilgne de séparation entre askeri et reaya est établie par l'usage systématique de registres fiacaux exhaustifs. Plus institutionnelle que sociologique cependa,t, elle se tranchit dans les décennies qui suivent : des magnats locaux, des knez chrétiens et des groupes de semi nomades parvienennent à quitter leur statut de reaya, assurent des fonctions militaires pour un temps avant de revenir à leur ancienne condition.
il y a un an



























