Ce sujet a été résolu
Ironlake
1 an
Impossible fake
il y a un an
il y a un an
il y a un an
La généralisation progressive de l'euro se déroule sur deux périodes. D'abord entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 durant lequel l'euro scriptural est mis en place. Ensuite il y a la période entre le 1er janvier 2002 et du 30 juin 2002 durant lequel est mis en place l'euro fiduciaire et pièces et en billets donc. Le 1er janvier 1999, l'ECU est donc remplacé par l'euro qui devient la monnaie centrale des pays de la zone euro. Les 11 pays adoptant l'euro étaient l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l'Irlande, les Pays Bas, le Portugal et l'Espagne. Les unités monétaires nationales de ces pays existent toujours comme instruments de paiement intérieures mais elles sont désormais liés entre elles et les monnaies nationales sont remplacés par les euro. L'euro qui a un taux de conversion fixe à 1 euro ) 6,559 57 francs. Les banques mettant en circulation des francs, marks, florins, lires, pesetas, etc.... le font sur la base d'une seule monnaie centrale qui est l'euro. Dès le début de l'union monétaire, l'euro est la monnaie banque centrale qui sert aux règlements entre les banques et aux interventions de la BCE sur le marché monétaire. Durant cette étape, toutes les opérations sur les marchés de capitaux se font en euros. En ce qui concerne les opérations des agents non financiers, la Commission recommande de laisse ces derniers choisir librement leur calendrier de transition entre des règlements en monnaie nationale et des règlements en euro. La période transitoire de trois ans achevée, toutes les opérations monétaires scripturales sont libellées en euro à partir du 1er janvier 2002. Entre le 1er janvier 2002 et le 1er juillet 2002, les anciens billets peuvent encore circuler. Cependant, à partir de cette date, l'euro qu'elle soit monnaie scripturale ou fiduciaire, devient la seule monnaie en circulation.
Le 1er janvier 1999, le Système européen de banques centrales, aka SEBC entre en vigueur avec les banques centrales qui ne sont plus que les relais locaux de la banque centrale européenne qui est la BCE. Le Conseil des gouverneurs des banques centrales définit les grande orientations de la politique monétaire. La politique monétaire au jour le jour est menée par le Directoire de la BCE. Ce dernier est composé de 6 membres nommés pour 8 ans non renouvelables par le Conseil européen. Il prend ses décisions à la majorité simple. Les status de la BCE lui assignent pour objectif prioritaire la stabilité des prix et lui interdisent le financement des déficits publics. La BCE ne peut recevoir ni avis ni conseil de la part des gouvernements. Il n'a de compte à rendre à personne. La BCE st chargé de mettre en oeuvre la politique de change de la monnaie européenne à l'égard des autres monnaies. Certes, les orientations de la politique de change sont définies par le Conseil européen mais il est stipulé que cette politique ne peut contrarier l'objectif prioritaire de stabilité des prix assigné à la BCE. Dans une certaine mesure, la monnaie unique peut apparaître comme étant la conclusion logique du processus de la construction européenne qui a débuté depuis les années 1950. C'est la théorie de l'engrenage selon laquelle l'intégration commerciale provoque nécessairement l'apparition d'un système monétaire européen dont les limites entraînent la mise en place d'une monnaie unique qui est censée provoquer l'union politique. Les pères de l'Europe auraient aussi réinventé une ruse de l'Histoire en enclenchant un processus économique dont l'aboutissement serait la réalisation des Etats Unis d'Europe. En conséquence, les raisons fondamentales de l'intégration monétaire sont à chercher du côté des visions politiques qui sous entendent les choix des décideurs. Ces deux visions semblent à l'oeuvre dans le processus d'union monétaire.
La première qu'on pourrait qualifier de keynésienne, voit dans l'euro une manière de restaurer l'efficacité des politiques macroéconomiques qui étaient freinés par les contraintes de gestion des taux de change intra européens, également un moyen de restaurer des marges de maneuvre politiques face à une économie qui s'internationalise. C'est initiale de la social démocratie européenne. La deuxième est la vision néo libérale qui apprécient le fait que les gouvernements soient privés de deux instruments de politique économique, à savoir le taux d'intérêt et le taux de change, car ils espèrent qu'avec moins de moyens de régulation politique, la régulation par les marchés s'imposera. Une partie de la droite européenne pense ainsi. L'intégration économique européenne s'est faite par les échanges commerciaux et par la production. Le développement du Marché commun a engendré sur la constitution d'un grand marché unique où depuis 1993, peuvent circuler librement les biens, les services et les personnes. Si les agents et notamment les entreprises n'avaient pas pu déplacer librement les capitaux d'un pays à l'autre, ce marché unique n'aurait pas été cohérent du tout. C'est pour cela que la fin des contrôles de change tout comme la libre circulation des capitaux ont été décidées avant la mise en place du Marché unique. Les échanges dans le Marché commun puis le Marché unique ont augmenté ce qui supposait assurer une stabilité des taux de change entre pays membres pour éviter l'incertitude sur la rentabilité des échanges internationaux qu'implique une forte variabilité des changes. Or, les pays liés par un système de change fixe où les mouvements de capitaux sont libres ne peuvent plus pratiquer de politique monétaire autonome. Le SME s'était transformé en une sorte de zone mark où les pays devaient aligner leur politique monétaire sur celle du pays disposant de la monnaie la plus stable sur le plan interne comme externe, à savoir le mark allemand.
Le système actuel allège la contrainte extérieur car les pays ne sont plus contraints d'intervenir sur les marchés de change pour stabiliser les taux de change entre monnaies européennes. Les Etats perdent un instrument de politique économique, à savoir le taux de change. Mais c'est un instrument jugé d'une efficacité bien faible dans la recherche de l'équilibre interne comme externe. L'euro apparait aussi comme un moyen de défendre la contrainte financière extérieure avec l'équilibre de la balance des paiements. La plupart des pays membres de l'UE réalisent une part essentielle de leurs échanges de biens, de services et de capitaux avec d'autres pays membres. Si ces échanges sont réglés en euro, chaque pays peut payer une part importante de ses importations dans sa propre monnaie. Un pays qui doit régler son déficit extérieur en devises étrangères doit tôt ou tard réaliser des excédents dans sa balance des paiements courants pour avoir les devises nécessaires. Cette contrainte financières disparait si le pays règle son déficit avec sa monnaie nationale. Le pays n'a plus la possibilité de créer de la monnaie et donc le déficit sera financé par plus d'endettement. Même si cette dette peut être en partie remboursé en euro qui est la monnaie du pays. Les agents nationaux ne sont donc pas contraints de dégager un excédent des échanges extérieurs pour rembourser cette dette extérieure car ils peuvent accumuler des capacités de financement dans leur propre monnaie en développant leurs débouchés et leurs revenus intérieurs. De plus, la création de l'euro émanant de la première puissance économique en terme de PIB qu'est l'Europe intégrée peut se traduire par un usage international hors Europe plus étendu de cette monnaie européenne qu'est l'euro. La fraction des échanges que les européens pourront payer avec leur propre monnaie peut s'étendre progressivement.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a 10 mois
Ceci dit, je trouve les livres de Jacques Généreux sur la macroéconomie plutôt intéressants.

LE CAPITAL
Piketty
L'inégalité de la propriété du capital.
Il faut noter l'importance des choix démographiques et des règles de transmission.. Car moins les riches ont d'enfants, plus la concentration patrimoniale est forte. La primogéniture est une des caractéristiques de nombre de sociétés aristocratiques. Avec le fils aîné ayant la grande majorité si ce n'est pas quasi totalité de l'héritage, de façon à éviter l'émiétemment du patrimoine parental et préserver si ce n'est augmenter la fortune familiale. Le domaine terrien principal est notamment un privilège accordé au fils aîné. L'héritier ne peut dilapider le bien et doit se contenter de consommer les revenus du capital qui est ensuite trasnmis à l'héritier suivant dans l'ordre de succession. En droit britannique c'est le système des entails. Ou la substitution héréditaire dans l'Ancien Régime en France. Dans " Le Coeur et la raison ", le domaine de Norland passe directement de leur père à leur demi frère John Dashwood qui après avoir réfléchi avec sa femme Fanny décide finalement de ne rien leur laisser. Dans " Persuation ", le patrimoine de Sir Walter passe à son neveu directement au détriment de ses 3 filles. La Révolution française et le Code Civil ont connus l'abolition des substitutions héréditaires et l'abolition de la primogéniture. Avec une affirmation de principes comme la division égale des biens entre frères et soeurs. C'est le cas depui 1804 en France avec lq quotité disponible, soit la part du patrimoine dont les parents peuvent disposer librement par testament qui ne représente plus qu'un quart des biens pour les parents de 3 enfants ou plus. Seuls des circonstances particulières peuvent permettre de déroger à cette règle comme par exemple si les enfants ont assassiné votre nouveau conjoint. Au delà du principe d'égalité, il y a un principe d'efficacité économique.
La libre circulation des biens et la possibilité de réallouer en permanence vers le meilleur usage possible en fonction de la génération suivante sont ce que voulaient notamment Voltaire, Monstesquieu et Rouseau. La Révolution américaine a abouti à des résultats à peu près similaires.
.
A Paris le code civil de Napoléon s'applique depuis 1904 le centile supérieur de la hiérarchie des fortunes détient plus de 70% du patrimoine total en 1913 soit plus qu'au Royaume Uni. Certains dessins animés dont les aristochats sont même allés jusqu'à peindre cette réalité.
Le taux de croissance est passé d'à peine 0,2% par an au XVIIème siècle à 0,5% au XVIIIème siècle puis 1% au XIXème siècle. Par comparaison à un taux de rendement de l'ordre de 5%, cela ne change pas grand chose. Plus, la révolution industrielle a accrut légèrement le rendement de capital car les estimations du rendement pur du capital doivent être considérées comme des bornes minimales.
LA CROISSANCE : ILLUSIONS ET REALITES ( suite )
Il faut aussi parler d'inflation. Car ce n'est pas qu'un phénomène purement monétaire. Les taux de croissance évoqués jusque là étaient des taux de croissance réelles. Soit peu après avoir déduit de la croissance nominale le taux d'inflation, c'est à dire la hausse de l'indice moyen des prix à la consommation. Si la hausse des prix est de 2%, pour une croissance nominale de 3% par an, la croissance réelle sera en réalité de 1%. Dans la théorie de Ricardo et son principe de raret, si certains prix comme celui de l'immobilier, pétrole ou de la terre, prennent des valeurs extrêmes durant des périodes prolongées, cela peut avoir un gros impact sur la répartition des richesses. Cela bénéficierait aux détenteurs initiaux de ces ressources rares. L'inflation à proprement parler, au delà des prix relatifs, peut jouer un rôle important dans la répartition de la richesse. C'est aussi ce qui a permis aux pays développés de se débarrasser de leur dette publique après la Seconde Guerre mondiale. Il y a également un effet redistributif, qui peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais car étant peu maîtrisé. Car l'inflation s'est avant tout fait ressentir au XXème siècle. Jusqu'à la WW1, soit l'inflation n'existait pas soit elle était faible avec des prix montant ou baisser fortement ou non quelques années durant mais avec des mouvements qui se compensaient mutuellement sur le long terme. Ce n'est pas pour rien qu'entre 1700 et 1913, l'inflation dans des pays comme la France, Royaume Uni, Etats Unis et Allemagne, atteignait maximum entre 0,2 et 0,3% par an. Voire des niveaux négatifs avec une moyenne de - 0,2% entre 1820 et 1913 pour ce qui est du Royaume Uni et de l'Allemagne. Globalement cette période fut plus stable monétairement que le XXème siècle. A part peu être la Révolution française avec les gouvernements révolutionnaires émettant à la fin de 1789 les assignants qui deviennent une véritable monnaie d'échange et de circulation.
Cela sera le cas dès 1790 et cela va générer une inflation conséquente. Il faut savoir que c'était une des premières monnaies de papier de l'histoire. Le franc germinal fut crée par la suite à la même parité que la monnaie de l'Ancien Régime. La loi du 18 germinal an III du 7 avril 1795 débaptise la veille livre tournois rappelant trop la royauté et l'a remplacé par le franc, qui devient la nouvelle unité officielle du pays et gardant la même teneur en métal. Soit 4,5 grammes d'argent tout comme le livre tournois depuis 1726. Le bimétallisme argent or est confirmé par la loi de 1796 puis par la loi de 1803. Le pouvoir d'achat de la monnaie n'a pas été modifié par la Révolution. Ce n'est que la loi monétaire du 28 juin 1928 qui modifie la valeur en or du franc fixée en 1803. En fait depuis août 1914, la Banque de France était dispensée déjà de rembourser ses billets en espèces d'or ou d'argent et le franc or était déjà devenu dans les faits un franc papier entre 1914 et 1928. La même parité métallique s'est appliquée de 1726 à 1914. La même stabilité monétaire au Royaume Uni se constate avec un conversion entre les monnaies des deux pays stable deux siècles durant. Car la livre sterling vaut entre 20 et 25 livres tournois ou francs germinals que ce soit au XVIIIème siècle ou au XIXème siècle jusqu'en 1914.
LE CAPITAL
Piketty
L'inégalité de la propriété du capital.
Il faut noter l'importance des choix démographiques et des règles de transmission.. Car moins les riches ont d'enfants, plus la concentration patrimoniale est forte. La primogéniture est une des caractéristiques de nombre de sociétés aristocratiques. Avec le fils aîné ayant la grande majorité si ce n'est pas quasi totalité de l'héritage, de façon à éviter l'émiétemment du patrimoine parental et préserver si ce n'est augmenter la fortune familiale. Le domaine terrien principal est notamment un privilège accordé au fils aîné. L'héritier ne peut dilapider le bien et doit se contenter de consommer les revenus du capital qui est ensuite trasnmis à l'héritier suivant dans l'ordre de succession. En droit britannique c'est le système des entails. Ou la substitution héréditaire dans l'Ancien Régime en France. Dans " Le Coeur et la raison ", le domaine de Norland passe directement de leur père à leur demi frère John Dashwood qui après avoir réfléchi avec sa femme Fanny décide finalement de ne rien leur laisser. Dans " Persuation ", le patrimoine de Sir Walter passe à son neveu directement au détriment de ses 3 filles. La Révolution française et le Code Civil ont connus l'abolition des substitutions héréditaires et l'abolition de la primogéniture. Avec une affirmation de principes comme la division égale des biens entre frères et soeurs. C'est le cas depui 1804 en France avec lq quotité disponible, soit la part du patrimoine dont les parents peuvent disposer librement par testament qui ne représente plus qu'un quart des biens pour les parents de 3 enfants ou plus. Seuls des circonstances particulières peuvent permettre de déroger à cette règle comme par exemple si les enfants ont assassiné votre nouveau conjoint. Au delà du principe d'égalité, il y a un principe d'efficacité économique.
La libre circulation des biens et la possibilité de réallouer en permanence vers le meilleur usage possible en fonction de la génération suivante sont ce que voulaient notamment Voltaire, Monstesquieu et Rouseau. La Révolution américaine a abouti à des résultats à peu près similaires.
.
A Paris le code civil de Napoléon s'applique depuis 1904 le centile supérieur de la hiérarchie des fortunes détient plus de 70% du patrimoine total en 1913 soit plus qu'au Royaume Uni. Certains dessins animés dont les aristochats sont même allés jusqu'à peindre cette réalité.
Le taux de croissance est passé d'à peine 0,2% par an au XVIIème siècle à 0,5% au XVIIIème siècle puis 1% au XIXème siècle. Par comparaison à un taux de rendement de l'ordre de 5%, cela ne change pas grand chose. Plus, la révolution industrielle a accrut légèrement le rendement de capital car les estimations du rendement pur du capital doivent être considérées comme des bornes minimales.
LA CROISSANCE : ILLUSIONS ET REALITES ( suite )
Il faut aussi parler d'inflation. Car ce n'est pas qu'un phénomène purement monétaire. Les taux de croissance évoqués jusque là étaient des taux de croissance réelles. Soit peu après avoir déduit de la croissance nominale le taux d'inflation, c'est à dire la hausse de l'indice moyen des prix à la consommation. Si la hausse des prix est de 2%, pour une croissance nominale de 3% par an, la croissance réelle sera en réalité de 1%. Dans la théorie de Ricardo et son principe de raret, si certains prix comme celui de l'immobilier, pétrole ou de la terre, prennent des valeurs extrêmes durant des périodes prolongées, cela peut avoir un gros impact sur la répartition des richesses. Cela bénéficierait aux détenteurs initiaux de ces ressources rares. L'inflation à proprement parler, au delà des prix relatifs, peut jouer un rôle important dans la répartition de la richesse. C'est aussi ce qui a permis aux pays développés de se débarrasser de leur dette publique après la Seconde Guerre mondiale. Il y a également un effet redistributif, qui peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais car étant peu maîtrisé. Car l'inflation s'est avant tout fait ressentir au XXème siècle. Jusqu'à la WW1, soit l'inflation n'existait pas soit elle était faible avec des prix montant ou baisser fortement ou non quelques années durant mais avec des mouvements qui se compensaient mutuellement sur le long terme. Ce n'est pas pour rien qu'entre 1700 et 1913, l'inflation dans des pays comme la France, Royaume Uni, Etats Unis et Allemagne, atteignait maximum entre 0,2 et 0,3% par an. Voire des niveaux négatifs avec une moyenne de - 0,2% entre 1820 et 1913 pour ce qui est du Royaume Uni et de l'Allemagne. Globalement cette période fut plus stable monétairement que le XXème siècle. A part peu être la Révolution française avec les gouvernements révolutionnaires émettant à la fin de 1789 les assignants qui deviennent une véritable monnaie d'échange et de circulation.
Cela sera le cas dès 1790 et cela va générer une inflation conséquente. Il faut savoir que c'était une des premières monnaies de papier de l'histoire. Le franc germinal fut crée par la suite à la même parité que la monnaie de l'Ancien Régime. La loi du 18 germinal an III du 7 avril 1795 débaptise la veille livre tournois rappelant trop la royauté et l'a remplacé par le franc, qui devient la nouvelle unité officielle du pays et gardant la même teneur en métal. Soit 4,5 grammes d'argent tout comme le livre tournois depuis 1726. Le bimétallisme argent or est confirmé par la loi de 1796 puis par la loi de 1803. Le pouvoir d'achat de la monnaie n'a pas été modifié par la Révolution. Ce n'est que la loi monétaire du 28 juin 1928 qui modifie la valeur en or du franc fixée en 1803. En fait depuis août 1914, la Banque de France était dispensée déjà de rembourser ses billets en espèces d'or ou d'argent et le franc or était déjà devenu dans les faits un franc papier entre 1914 et 1928. La même parité métallique s'est appliquée de 1726 à 1914. La même stabilité monétaire au Royaume Uni se constate avec un conversion entre les monnaies des deux pays stable deux siècles durant. Car la livre sterling vaut entre 20 et 25 livres tournois ou francs germinals que ce soit au XVIIIème siècle ou au XIXème siècle jusqu'en 1914.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a 10 mois
Honnêtement, à part Piketty et Généreux les autres sont quasi tous des noname.

L'inégalité du capital en Amérique.
A partir des années 1910-1920, il existe des statistiques successorales utilisées par les chercheurs notamment Kopczuk, Lampman et Saez. Mais le faible pourcentage de la population concerné par l'impôt fédéral fait que ces statistiques ont leur limite. Ces estimations peuvent être complétées par des enquêtes détailllées sur les patrimoines réalisées par la FED américaine depuis les années 1960 exploitées par Wolff et Kennickell. Et par des estimations plus limitées portant sur la période allant de 1810 à 1870 se fondant sur des inventaires au décès et un recensement des patrimoines exploités respectivement par Jones et Soltow. Entre l'Europe et l'Amérique on voit que l'inégalité des patrimoines aux USA au début du XIXème siècle n'était pas beaucoup plus élevé qu'en Suède durant les années 1970 et 1980. S'agissant d'un pays neuf composé d'une population de migrants arrivés au Nouveau Monde sans patrimoine ou du moins pour certains avec un capital limité, ce n'est pas étonnant. Car le processus d'accumulation et de concentration des fortunes ne peut pas vraiment se mettre en place en si peu de temps. Les données sont imparfaites et varient selon qu'on enquête sur les états du nord ou les états du sud. Au nord des estimations indiquent que les inégalités sont inférieurs à la Suède des années 1970 et 1980. Au sud, les inégalités sont plus proches des pays européens durant la même période. En effet certaines estimations font apparaître des parts du centile supérieure inférieures à 15% du patrimoine total pour l'ensemble des USA autour de 1800. Cela est du au fait de se concentrer sur les personnes libres, choix discutable. De plus il y a bien eu croissance de la concentration des patrimoines américaines durant le XIXème siècle. Même si les inégalités de patrimoine restent en 1910 plus faibles qu'en Europe avec 80% du patrimoine totale pour le décile supérieur soit les 10% les plus riches. Le tout pour environ 45% du patrimoine total pour les 1% les plus riches.
Il y a eu un processsus de rattrapage américain des inégalités par rapport à l'Europe ce qui avait déjà à l'époque inquiété certains économistes du pays. Wilford King a fait la première étude sur la répartition des richesses aux Etats Unis en 1915. Du moins la première étude d'ensemble sur la question. Son ouvrage s'intitule :" The Wealth and income of the People of the United States ". King était professeur de statistiques et d'économie à l'université du Wisconsin. Il a rassemblé des données et les a comparé aux estimations européennes issues notamment des statistiques fiscales prussiennes de l'époque. Il y trouve des écarts plus réduits à ce qu'il imaginait. Tout cela peut surprendre étant donné qu'on a l'habitude à ce que les Etats Unis soient un pays globalement plus inégalitaire que les pays européens. Au XIXème siècle, le Nouveau Monde était par nature moins inégalitaire que le vieille Europe. Et il s'agissait d'une fierté américaine pour les américains eux mêmes. Mais à la fin du XIXème siècle lors de lé période du Gilded Age, des fortunes monstrueuses s'accumulent et allant dans les poches d'industriels et de financiers comme Carnegie, J P Morgan ou Rockefeller. Il y avait cette peur de la part de certains en Amérique que le pays ne suive la trajectoire de l'Europe. Ce qui peut expliquer en partie l'invention d'une fiscalité lourdement progressive sur les grosses successions et sur les revenus jugés excessifs. L'inégalité américaine des patrimoines diminue durant les années 1910 jusqu'aux années 1950 tout comme l'inégalité des revenus quoique bien moins fortement qu'en Europe. Même si elle part de moins haut et que les chocs causés par les guerres ont été moins violents pour les américains que pour les européens.
Au début des années 2010, la part du décile supérieur dépasse les 70% du patrimoine total et celle du centile supérieure est proche des 35%. Ces niveaux, issus des enquêtes officielles de la FED, peuvent être sous estimés cela dit compte tenu des difficultés d'estimations des plus grandes fortunes du pays. La part du centile avait probablement atteint les 40%. Pour ce qui est de l'Europe, les inégalités étaient tout aussi fortes la veille de la Première Guerre mondiale que sous l'Ancien Régime, si ce n'est plus. Puis la tendance s'est inversé après la guerre avec la moitié de la population ayant pu accéder à un minimum de patrimoine et accéder à une part du capital national non négligeable. C'est bien plus le cas après la Seconde Guerre mondiale avec l'élan des Trente Glorieuses. Même si après l'optimisme ayant marqué cette période, la marche en avant vers le progrès social se soit vu enrayé durant les années. Pour revenir aux Etats Unis, il y avait une classe moyenne patrimoniale au début du XIXème siècle. Mais le Gilded Age l'a mise à mal avant de s'en remettre au début du XXème siècle et avant de connaître à nouveau des difficultés durant les années 1970 et 1980. Il n'y a pas eu aux Etats Unis de grand bond en avant au niveau de la justice sociale au cours du XXème siècle.
.
On peut également en parlant de ce sujet évoquer Corrado Gini, un italien qui a mit au point un indicateur visant à résumer les inégalités d'un pays. On peut ausi parler de Vilfredo Pareto sont les travaux principaux ont été publiés entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle. Notamment la loi de Pareto. A noter que durant l'entre deux guerres, les fascistes italiens avaient fait de PAreto et sa théorie des élites un de leurs économistes officiels, avec une certaine volonté de récupération certes. Pareto qui avait salué l'arrivée de Mussolini au pouvoir peu avant sa mort en 1923. Il faut dire que les thèses de Pareto, sur l'implacable stabilité des inégalités, qu'il serait illusoire de vouloir réduire, avait de quoi séduire. A noter également qu'il n'avait aucune donnée susceptible de conclure à cette stabilité.Vers 1900 Pareto a utilisé des tabulations fiscales disponibles à son époque issues des impôts sur le revenus appliqués en Saxe et en Prusse et dans quelques villes italiennes et suisses des années 1880 et 1890. Ce sont des données éparses portant sur une dizaine d'année maximum. Elles indiquent globalement une légère hausse des inégalités ce que Pareto tente de dissimuler. Impossible avec si peu de données de conclure par rapport aux tendances de long terme ou encore sur la stabilité des inégalités dans l'histoire globale. Pareto se méfiait des socialistes et de ce qu'il voyait comme étant des illusions étatiques et redistributrices. A l'image de Lory Beaulieu, qu'il appréciait. En voulant étudier à quelle vitesse le nombre de contribuables dimie quand on s'élève dans la hiérarchie des revenus, Pareto constate que ce rythme de décroissance peut être approximé par une loi mathématique qu'il appelera par la suite loi de Pareto.
C'est une fonction de puissance : power law. Mais utiliser ce genre de courbes mathématiques n'est utile que pour étudier le sommet de ces répartitions. En plus de cela, c'est juste une relation approximative, valable localement.
A noter que entre le début de la WW1 et la fin de la WW2, il y a eu plusieurs redistributions ayant touché plus fortement les hauts patrimoines notamment les actionnaires des grandes sociétés industrielles. Plus que les patrimoines moyens et modestes. On peut évoquer les cas des nationalisations de la régie Renaut en France après la libération notamment. Ou à l'impôt de solidarité nationale instituée en 1945. Cet impôt exceptionnel et progressif prélevé à la fois sur le capital et sur les enrichissements survenus lors de l'Occupation ne fut prélevé qu'une fois mais ses taux très élevés ont constitué un choc supplémentaire lourd pour les personnes concernées. L'impôt de solidarité nationale mis en place le 15 août 1945 comprenait un prélèvement exceptionnel sur la valeur de tous patrimoines estimée au 4 juin 1945, à des taux allant jusqu'aà 20% pour les patrimoines les plus élevés et un prélèvement exceptionnel pesant sur tous les enrichissements nominaux de patrimoine survenus entre 1940 et 1945, à des taux allant jusqu'à 100% pour les enrichissements les plus importants. En pratique compte tenu de la très forte inflation avec le triplement des prix voire plus entre 1940 et 1945, ce prélèvement revient en fait à taxer à 100% tous ceux ne s'étant pas suffisamment appauvris, ce que reconnaîtra d'ailleurs André Philip, membre SFIO du gouvernement provisoire du général De Gaulle, qui explique qu'il étant inévitable que le prélèvement pèse également sur ceux qui ne se sont pas enrichis et peut être même sur ceux qui, monétairement, se sont appauvris en ce sens que leur fortune ne s'est pas accrue dans la même proportion que la hausse général des prix, mais qui ont pu conserver leur fortune globale, alors qu'il y a tant de français qui ont tout perdu. Source : " L'année politique 1945 ". Page 159.
L'inégalité du capital en Amérique.
A partir des années 1910-1920, il existe des statistiques successorales utilisées par les chercheurs notamment Kopczuk, Lampman et Saez. Mais le faible pourcentage de la population concerné par l'impôt fédéral fait que ces statistiques ont leur limite. Ces estimations peuvent être complétées par des enquêtes détailllées sur les patrimoines réalisées par la FED américaine depuis les années 1960 exploitées par Wolff et Kennickell. Et par des estimations plus limitées portant sur la période allant de 1810 à 1870 se fondant sur des inventaires au décès et un recensement des patrimoines exploités respectivement par Jones et Soltow. Entre l'Europe et l'Amérique on voit que l'inégalité des patrimoines aux USA au début du XIXème siècle n'était pas beaucoup plus élevé qu'en Suède durant les années 1970 et 1980. S'agissant d'un pays neuf composé d'une population de migrants arrivés au Nouveau Monde sans patrimoine ou du moins pour certains avec un capital limité, ce n'est pas étonnant. Car le processus d'accumulation et de concentration des fortunes ne peut pas vraiment se mettre en place en si peu de temps. Les données sont imparfaites et varient selon qu'on enquête sur les états du nord ou les états du sud. Au nord des estimations indiquent que les inégalités sont inférieurs à la Suède des années 1970 et 1980. Au sud, les inégalités sont plus proches des pays européens durant la même période. En effet certaines estimations font apparaître des parts du centile supérieure inférieures à 15% du patrimoine total pour l'ensemble des USA autour de 1800. Cela est du au fait de se concentrer sur les personnes libres, choix discutable. De plus il y a bien eu croissance de la concentration des patrimoines américaines durant le XIXème siècle. Même si les inégalités de patrimoine restent en 1910 plus faibles qu'en Europe avec 80% du patrimoine totale pour le décile supérieur soit les 10% les plus riches. Le tout pour environ 45% du patrimoine total pour les 1% les plus riches.
Il y a eu un processsus de rattrapage américain des inégalités par rapport à l'Europe ce qui avait déjà à l'époque inquiété certains économistes du pays. Wilford King a fait la première étude sur la répartition des richesses aux Etats Unis en 1915. Du moins la première étude d'ensemble sur la question. Son ouvrage s'intitule :" The Wealth and income of the People of the United States ". King était professeur de statistiques et d'économie à l'université du Wisconsin. Il a rassemblé des données et les a comparé aux estimations européennes issues notamment des statistiques fiscales prussiennes de l'époque. Il y trouve des écarts plus réduits à ce qu'il imaginait. Tout cela peut surprendre étant donné qu'on a l'habitude à ce que les Etats Unis soient un pays globalement plus inégalitaire que les pays européens. Au XIXème siècle, le Nouveau Monde était par nature moins inégalitaire que le vieille Europe. Et il s'agissait d'une fierté américaine pour les américains eux mêmes. Mais à la fin du XIXème siècle lors de lé période du Gilded Age, des fortunes monstrueuses s'accumulent et allant dans les poches d'industriels et de financiers comme Carnegie, J P Morgan ou Rockefeller. Il y avait cette peur de la part de certains en Amérique que le pays ne suive la trajectoire de l'Europe. Ce qui peut expliquer en partie l'invention d'une fiscalité lourdement progressive sur les grosses successions et sur les revenus jugés excessifs. L'inégalité américaine des patrimoines diminue durant les années 1910 jusqu'aux années 1950 tout comme l'inégalité des revenus quoique bien moins fortement qu'en Europe. Même si elle part de moins haut et que les chocs causés par les guerres ont été moins violents pour les américains que pour les européens.
Au début des années 2010, la part du décile supérieur dépasse les 70% du patrimoine total et celle du centile supérieure est proche des 35%. Ces niveaux, issus des enquêtes officielles de la FED, peuvent être sous estimés cela dit compte tenu des difficultés d'estimations des plus grandes fortunes du pays. La part du centile avait probablement atteint les 40%. Pour ce qui est de l'Europe, les inégalités étaient tout aussi fortes la veille de la Première Guerre mondiale que sous l'Ancien Régime, si ce n'est plus. Puis la tendance s'est inversé après la guerre avec la moitié de la population ayant pu accéder à un minimum de patrimoine et accéder à une part du capital national non négligeable. C'est bien plus le cas après la Seconde Guerre mondiale avec l'élan des Trente Glorieuses. Même si après l'optimisme ayant marqué cette période, la marche en avant vers le progrès social se soit vu enrayé durant les années. Pour revenir aux Etats Unis, il y avait une classe moyenne patrimoniale au début du XIXème siècle. Mais le Gilded Age l'a mise à mal avant de s'en remettre au début du XXème siècle et avant de connaître à nouveau des difficultés durant les années 1970 et 1980. Il n'y a pas eu aux Etats Unis de grand bond en avant au niveau de la justice sociale au cours du XXème siècle.
.
On peut également en parlant de ce sujet évoquer Corrado Gini, un italien qui a mit au point un indicateur visant à résumer les inégalités d'un pays. On peut ausi parler de Vilfredo Pareto sont les travaux principaux ont été publiés entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle. Notamment la loi de Pareto. A noter que durant l'entre deux guerres, les fascistes italiens avaient fait de PAreto et sa théorie des élites un de leurs économistes officiels, avec une certaine volonté de récupération certes. Pareto qui avait salué l'arrivée de Mussolini au pouvoir peu avant sa mort en 1923. Il faut dire que les thèses de Pareto, sur l'implacable stabilité des inégalités, qu'il serait illusoire de vouloir réduire, avait de quoi séduire. A noter également qu'il n'avait aucune donnée susceptible de conclure à cette stabilité.Vers 1900 Pareto a utilisé des tabulations fiscales disponibles à son époque issues des impôts sur le revenus appliqués en Saxe et en Prusse et dans quelques villes italiennes et suisses des années 1880 et 1890. Ce sont des données éparses portant sur une dizaine d'année maximum. Elles indiquent globalement une légère hausse des inégalités ce que Pareto tente de dissimuler. Impossible avec si peu de données de conclure par rapport aux tendances de long terme ou encore sur la stabilité des inégalités dans l'histoire globale. Pareto se méfiait des socialistes et de ce qu'il voyait comme étant des illusions étatiques et redistributrices. A l'image de Lory Beaulieu, qu'il appréciait. En voulant étudier à quelle vitesse le nombre de contribuables dimie quand on s'élève dans la hiérarchie des revenus, Pareto constate que ce rythme de décroissance peut être approximé par une loi mathématique qu'il appelera par la suite loi de Pareto.
C'est une fonction de puissance : power law. Mais utiliser ce genre de courbes mathématiques n'est utile que pour étudier le sommet de ces répartitions. En plus de cela, c'est juste une relation approximative, valable localement.
A noter que entre le début de la WW1 et la fin de la WW2, il y a eu plusieurs redistributions ayant touché plus fortement les hauts patrimoines notamment les actionnaires des grandes sociétés industrielles. Plus que les patrimoines moyens et modestes. On peut évoquer les cas des nationalisations de la régie Renaut en France après la libération notamment. Ou à l'impôt de solidarité nationale instituée en 1945. Cet impôt exceptionnel et progressif prélevé à la fois sur le capital et sur les enrichissements survenus lors de l'Occupation ne fut prélevé qu'une fois mais ses taux très élevés ont constitué un choc supplémentaire lourd pour les personnes concernées. L'impôt de solidarité nationale mis en place le 15 août 1945 comprenait un prélèvement exceptionnel sur la valeur de tous patrimoines estimée au 4 juin 1945, à des taux allant jusqu'aà 20% pour les patrimoines les plus élevés et un prélèvement exceptionnel pesant sur tous les enrichissements nominaux de patrimoine survenus entre 1940 et 1945, à des taux allant jusqu'à 100% pour les enrichissements les plus importants. En pratique compte tenu de la très forte inflation avec le triplement des prix voire plus entre 1940 et 1945, ce prélèvement revient en fait à taxer à 100% tous ceux ne s'étant pas suffisamment appauvris, ce que reconnaîtra d'ailleurs André Philip, membre SFIO du gouvernement provisoire du général De Gaulle, qui explique qu'il étant inévitable que le prélèvement pèse également sur ceux qui ne se sont pas enrichis et peut être même sur ceux qui, monétairement, se sont appauvris en ce sens que leur fortune ne s'est pas accrue dans la même proportion que la hausse général des prix, mais qui ont pu conserver leur fortune globale, alors qu'il y a tant de français qui ont tout perdu. Source : " L'année politique 1945 ". Page 159.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a 10 mois
Les autres, ( hormis 2 ou 3 ), osef : que des noname.

La forte réduction des inégalités patrimoniales suite au début de la WW1 s'explique par les chocs dus aux guerres et aux politiques résultant de la guerre, conduisant à un effondrement du rapport capital/revenu. Mais cette réduction n'a pas frappé de manière égale tous les patrimoines de manière proportionnel. Car les patrimoines n'ont pas tous les mêmes origines et le même fonctions. En haut de la hiérarchie, le patrimoine est souvent le fruit d'une accumulation venant de plusieurs générations. Et reconstituer des fortunes aussi importantes prend du temps, plus de temps que d'accumuler un patrimoine modeste et moyen. De plus, les hauts patrimoines servent à financer un niveau de vie. Or les archives successorales montrent que durant l'entre deux guerres, nombre de rentiers n'ont pas réduit leur train de vie très vite après les chocs subis par leurs patrimoines et leurs revenus suite à la WW1 et aux crises des années 1920 et 1930. Du coup ils ont du progressivement amputer leur capital pour financer leurs dépenses courantes et par conséquent à transmettre un patrimoine sensiblement plus faible que celui qu'ils avaient reçu, et ne permettant en aucun cas de prologner l'équilibre social d'avant. Les données de Paris démontrent que les 1% des héritiers parisiens les plus riches avant un patrimoine leur permettant de financer un niveau de vie de l'ordre de 80 voire 100 fois plus élevés que le salaire mmoyen de l'époque tout en réinvestissant une petit partir du rendement du capital. Cela correspond au niveau de vie d'entre 2 et 2,5 millions d'euros annuels dans un monde où le salaire moyen est de l'ordre de 24 000 euros par an soit 2 000 euros par mois.
Ce système parait équilivré entre 1872 et 1912 avec un acroissement tendanciel de la concentration des fortunes. Mais durant entredeux guerres, les 1% des héritiers parisiens les plus riches continuent de vivre approximativement comme par le passé, mais ce qu'ils laissent à la génération suivante permet de financer un niveau de vie d'à peine 30 à 40 fois le salaire moyen de l'époque, voire 20 fois à la fin des années 1930. Pour les rentiers c'est le début de la fin. C'est sans doute le mécanisme le plus important expliquant la déconcentration des pétrimoines observées dans tous les pays européen voire aux Etats Unis dans une moindre mesure suite aux chocs ayant survenu entre 1914 et 1945. La composition des plus hauts patrimoines les exposait plus massivement en moyenne aux pertes en capital entraînées par les 2 guerres mondiales. Notamment les données sur la composition des portefeuillles disponibles dans les archives successorales montrent que les actifs étrangers représentaient jusqu'à un quart des patrimoines les plus importants à la veille de la Première Guerre mondiale, dont près de la moitié pour les obligations publiques émises par les états étrangers notamment par la Russie, qui s'apprêtait à faire défaut. Même si on n'a pas de données similaires du Royaume Uni, il est quasiment sûr que les actifs étrangers ont joué un rôle au moins aussi important pour les hauts patrimoines britanniques. Or que ce soit au Royaume Uni ou en France, les actifs étrangers ont quasiment disparu après les 2 guerres mondiales. Mais ce facteur ne doit pas être surestimé car les détenteurs ds patrimoines les plus élevés sont parfois les plus à même de procéder aux réallocations de portefeuille les plus profitables au bon moment.
De plus, les niveaux de patrimoine et pas seulement les plus élevés, comprenaient à la veille de la WW1, des quantités non négligeable d'actifs étrangers. Généralement quand on voit la structure des patrimoines parisiens à la fin du XIXème siècle et lors de la Belle Epoque, on voit que ces portefeuilles sont diversifiés. Les biens immobiliers avant WW1 représentent à peine plus du tiers des actifs dont environ les deux tiers pour des biens immobiliers parisiens et à peine un tiers pour les biens provinciaux dont une petit quantité de terres agricoles.
Mérite et héritage sur le long terme. Les trois forces : l'illusion de la fin de l'héritage.
Inégalité des revenus du travail.
On sait l'éducation et la technologie jouent un rôle crucial à long terme. Mais la technologie ne sait parfois pas utiliser les qualifications et investir dans la formation ne suffit pas toujours. La santé a pour objectif de fourni aux autres secteurs des travailleurs en bonne santé. Le secteur de l'éducation doit préparer à un métier dans les autres secteurs. Le principal problème de la théorie de la productivité marginale est qu'elle ne permet pas de rendre compte de la diversité des évolutions historiques et des expériences internationales. Pour comprendre la dynamique des inégalités salariales, il faut introduire un rôle pour les différentes institutions et règles qui dans toutes les sociétés caractérisent le fonctionnement du marché du travail n'est pas une abstraction mathématique dont le fonctionnement est déterminé entièrement par des mécanisme naturels et immuables. Et par d'implacables forces technologiques. C'est une construction sociale faite de règles et de compromis spécifiques.
Aux Etats Unis, le salaire minimum fédéral a été introduit en 1933 soit près de 20 ans avant la France. Tout comme en France les mouvements du salaire minimum ont joué un rôle important dans l'évolution des inégalités américaines au niveua salarial. En terme de pouvoir d'achat, le niveau maximum du salaire minimum a été atteint il y a près d'un demi siècle en 1969, avec 1,60 dollar par heure soit 10,10 dollars en 2013 avec l'inflation entre 1968 et 2013. A une époque où le taux de chômage était inférieur à 4%. De 1980 à 1990, sous Reagan et Bush père, le salaire minimum fédéral est resté bloqué à 3,35 dollars d'où une baisse significative de pouvoir d'achat compte tenu de l'inflation. Puis il passe à 5,25 sou Clinton durant les années 1990 avant d'être gelé sous Bush fils et d'être relevé par Obama à partir de 2008. Au début de l'année 2013, il est de 7,25 dollars l'heure soit 6 euros à peine soit un tiers plus bas que le salaire minimum en France. Or c'était le contraire jusqu'au années 1980. L'écart entre les 10% des salaires les plus faibles et le salaire moyen a augmenté fortement durant les années 1990 avant de se réduire un peu durant les années 1990 puis d'augmenter encore à partir des années 2000. La part des 10% des salaires les plus élevés n'ont pas cessé d'augmenter durant toute la période. Le salaire minimum a un effet sur le bas de la distribution mais bien moins dans le haut. Les régulations du marché du travail dans chaque pays dépendent des perceptions, mentalités et normes de justice sociale dans la société.
Durant les années 1950 et 1960, le salaire minimum est utilisé par les Etats Unis pour augmenter les salaires modestes. A partir des années 1970 jusqu'au années 1980, cet outil est délaissé. En France c'était l'inverse avec le salaire minimum gelé durant les années 1950 et 1960 puis utilisé depuis les années 1970. Pour ce qui est du Royaume Uni, le salaire minimum nationale a été introduit en 1999. En 2013 il était de 6,19 livre par heure. La Suède et l'Allemagne ont choisi de ne pas avoir de salaires minimums au niveau naitonal et de laisser aux syndicats la tâche de négocier avec les employeurs des salaires minima et le plus souvent des grilles salariales complètes au niveau de chaque branche d'activité. En pratique les minima dans ces 2 pays sont en 2013 supérieures à 10 euros par heure dans de nombreuses branches donc plus élevés que dans les pays ayant un salaire minimum national. Mais ils peuvent être inférieurs dans certains secteurs peu syndiqués ou régulés. Pour avoir un plancher minimum, l'Allemagne a introduit un salaire minimum national en 2015. Il faut voir suivant quels principes généraux on peut analyser ces institutions régulant dans tous les pays la formation des salaires. Difficile de savoir la productivité marginale d'un salarié donné. C'est évident dans le secteur public mais aussi dans le secteur privé car ce n'est pas facile de savoir au sein d'une organisation comportant plusieurs dizaines de salariés et parfois plusieurs dizaines de milliers de salariés, et parfois plusieurs dizaines de milliers de salariés, quelle est la contribution exacte d'un salarié individuel à la production d'ensemble. On peut avoir une estimation approximative pour les tâches duplicables donc pouvant être occupées par plusieurs salariés de manière identique ou presque.
La forte réduction des inégalités patrimoniales suite au début de la WW1 s'explique par les chocs dus aux guerres et aux politiques résultant de la guerre, conduisant à un effondrement du rapport capital/revenu. Mais cette réduction n'a pas frappé de manière égale tous les patrimoines de manière proportionnel. Car les patrimoines n'ont pas tous les mêmes origines et le même fonctions. En haut de la hiérarchie, le patrimoine est souvent le fruit d'une accumulation venant de plusieurs générations. Et reconstituer des fortunes aussi importantes prend du temps, plus de temps que d'accumuler un patrimoine modeste et moyen. De plus, les hauts patrimoines servent à financer un niveau de vie. Or les archives successorales montrent que durant l'entre deux guerres, nombre de rentiers n'ont pas réduit leur train de vie très vite après les chocs subis par leurs patrimoines et leurs revenus suite à la WW1 et aux crises des années 1920 et 1930. Du coup ils ont du progressivement amputer leur capital pour financer leurs dépenses courantes et par conséquent à transmettre un patrimoine sensiblement plus faible que celui qu'ils avaient reçu, et ne permettant en aucun cas de prologner l'équilibre social d'avant. Les données de Paris démontrent que les 1% des héritiers parisiens les plus riches avant un patrimoine leur permettant de financer un niveau de vie de l'ordre de 80 voire 100 fois plus élevés que le salaire mmoyen de l'époque tout en réinvestissant une petit partir du rendement du capital. Cela correspond au niveau de vie d'entre 2 et 2,5 millions d'euros annuels dans un monde où le salaire moyen est de l'ordre de 24 000 euros par an soit 2 000 euros par mois.
Ce système parait équilivré entre 1872 et 1912 avec un acroissement tendanciel de la concentration des fortunes. Mais durant entredeux guerres, les 1% des héritiers parisiens les plus riches continuent de vivre approximativement comme par le passé, mais ce qu'ils laissent à la génération suivante permet de financer un niveau de vie d'à peine 30 à 40 fois le salaire moyen de l'époque, voire 20 fois à la fin des années 1930. Pour les rentiers c'est le début de la fin. C'est sans doute le mécanisme le plus important expliquant la déconcentration des pétrimoines observées dans tous les pays européen voire aux Etats Unis dans une moindre mesure suite aux chocs ayant survenu entre 1914 et 1945. La composition des plus hauts patrimoines les exposait plus massivement en moyenne aux pertes en capital entraînées par les 2 guerres mondiales. Notamment les données sur la composition des portefeuillles disponibles dans les archives successorales montrent que les actifs étrangers représentaient jusqu'à un quart des patrimoines les plus importants à la veille de la Première Guerre mondiale, dont près de la moitié pour les obligations publiques émises par les états étrangers notamment par la Russie, qui s'apprêtait à faire défaut. Même si on n'a pas de données similaires du Royaume Uni, il est quasiment sûr que les actifs étrangers ont joué un rôle au moins aussi important pour les hauts patrimoines britanniques. Or que ce soit au Royaume Uni ou en France, les actifs étrangers ont quasiment disparu après les 2 guerres mondiales. Mais ce facteur ne doit pas être surestimé car les détenteurs ds patrimoines les plus élevés sont parfois les plus à même de procéder aux réallocations de portefeuille les plus profitables au bon moment.
De plus, les niveaux de patrimoine et pas seulement les plus élevés, comprenaient à la veille de la WW1, des quantités non négligeable d'actifs étrangers. Généralement quand on voit la structure des patrimoines parisiens à la fin du XIXème siècle et lors de la Belle Epoque, on voit que ces portefeuilles sont diversifiés. Les biens immobiliers avant WW1 représentent à peine plus du tiers des actifs dont environ les deux tiers pour des biens immobiliers parisiens et à peine un tiers pour les biens provinciaux dont une petit quantité de terres agricoles.
Mérite et héritage sur le long terme. Les trois forces : l'illusion de la fin de l'héritage.
Inégalité des revenus du travail.
On sait l'éducation et la technologie jouent un rôle crucial à long terme. Mais la technologie ne sait parfois pas utiliser les qualifications et investir dans la formation ne suffit pas toujours. La santé a pour objectif de fourni aux autres secteurs des travailleurs en bonne santé. Le secteur de l'éducation doit préparer à un métier dans les autres secteurs. Le principal problème de la théorie de la productivité marginale est qu'elle ne permet pas de rendre compte de la diversité des évolutions historiques et des expériences internationales. Pour comprendre la dynamique des inégalités salariales, il faut introduire un rôle pour les différentes institutions et règles qui dans toutes les sociétés caractérisent le fonctionnement du marché du travail n'est pas une abstraction mathématique dont le fonctionnement est déterminé entièrement par des mécanisme naturels et immuables. Et par d'implacables forces technologiques. C'est une construction sociale faite de règles et de compromis spécifiques.
Aux Etats Unis, le salaire minimum fédéral a été introduit en 1933 soit près de 20 ans avant la France. Tout comme en France les mouvements du salaire minimum ont joué un rôle important dans l'évolution des inégalités américaines au niveua salarial. En terme de pouvoir d'achat, le niveau maximum du salaire minimum a été atteint il y a près d'un demi siècle en 1969, avec 1,60 dollar par heure soit 10,10 dollars en 2013 avec l'inflation entre 1968 et 2013. A une époque où le taux de chômage était inférieur à 4%. De 1980 à 1990, sous Reagan et Bush père, le salaire minimum fédéral est resté bloqué à 3,35 dollars d'où une baisse significative de pouvoir d'achat compte tenu de l'inflation. Puis il passe à 5,25 sou Clinton durant les années 1990 avant d'être gelé sous Bush fils et d'être relevé par Obama à partir de 2008. Au début de l'année 2013, il est de 7,25 dollars l'heure soit 6 euros à peine soit un tiers plus bas que le salaire minimum en France. Or c'était le contraire jusqu'au années 1980. L'écart entre les 10% des salaires les plus faibles et le salaire moyen a augmenté fortement durant les années 1990 avant de se réduire un peu durant les années 1990 puis d'augmenter encore à partir des années 2000. La part des 10% des salaires les plus élevés n'ont pas cessé d'augmenter durant toute la période. Le salaire minimum a un effet sur le bas de la distribution mais bien moins dans le haut. Les régulations du marché du travail dans chaque pays dépendent des perceptions, mentalités et normes de justice sociale dans la société.
Durant les années 1950 et 1960, le salaire minimum est utilisé par les Etats Unis pour augmenter les salaires modestes. A partir des années 1970 jusqu'au années 1980, cet outil est délaissé. En France c'était l'inverse avec le salaire minimum gelé durant les années 1950 et 1960 puis utilisé depuis les années 1970. Pour ce qui est du Royaume Uni, le salaire minimum nationale a été introduit en 1999. En 2013 il était de 6,19 livre par heure. La Suède et l'Allemagne ont choisi de ne pas avoir de salaires minimums au niveau naitonal et de laisser aux syndicats la tâche de négocier avec les employeurs des salaires minima et le plus souvent des grilles salariales complètes au niveau de chaque branche d'activité. En pratique les minima dans ces 2 pays sont en 2013 supérieures à 10 euros par heure dans de nombreuses branches donc plus élevés que dans les pays ayant un salaire minimum national. Mais ils peuvent être inférieurs dans certains secteurs peu syndiqués ou régulés. Pour avoir un plancher minimum, l'Allemagne a introduit un salaire minimum national en 2015. Il faut voir suivant quels principes généraux on peut analyser ces institutions régulant dans tous les pays la formation des salaires. Difficile de savoir la productivité marginale d'un salarié donné. C'est évident dans le secteur public mais aussi dans le secteur privé car ce n'est pas facile de savoir au sein d'une organisation comportant plusieurs dizaines de salariés et parfois plusieurs dizaines de milliers de salariés, et parfois plusieurs dizaines de milliers de salariés, quelle est la contribution exacte d'un salarié individuel à la production d'ensemble. On peut avoir une estimation approximative pour les tâches duplicables donc pouvant être occupées par plusieurs salariés de manière identique ou presque.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a 10 mois
0nlyfans
1 an
si ils le soutiennent c'est que ca doit etre vrai ? hein

L'économie est une science qui a du mal à décrire, et une impossibilité à prédire.
Par exemple, dans son programme, Melenchon partait du constat suivant :
1 - Les femmes sont moins bien payées de 20%
2 - nous forceront les patrons à les payer 25% plus pour se mettre à niveau avec les hommes
3 - les taxes et cotisations issues de cette hausse de salaire reportera du budget pour l'état
4 - la consommation va augmenter grâce à cet enrichissement qui va retourner dans l'économie.
Sur le papier, ça peut effectivement fonctionner, un économiste aura aucun mal à dire "oui, transferer de l'argent des entreprises vers les ménages augmentera effectivement la consommation", ça veut pas dire que : 1 est vrai, 2 est possible, 3 est sans risque, 4 est automatique.
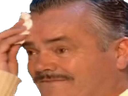
Par exemple, dans son programme, Melenchon partait du constat suivant :
1 - Les femmes sont moins bien payées de 20%
2 - nous forceront les patrons à les payer 25% plus pour se mettre à niveau avec les hommes
3 - les taxes et cotisations issues de cette hausse de salaire reportera du budget pour l'état
4 - la consommation va augmenter grâce à cet enrichissement qui va retourner dans l'économie.
Sur le papier, ça peut effectivement fonctionner, un économiste aura aucun mal à dire "oui, transferer de l'argent des entreprises vers les ménages augmentera effectivement la consommation", ça veut pas dire que : 1 est vrai, 2 est possible, 3 est sans risque, 4 est automatique.
il y a 10 mois
Par contre si NUPES arrive au pouvoir et qu'on se vautre, certains de ces économistes auront des comptes à rendre.

On peut prendre l'exemple d'un ouvrier sur une chaîne de montage ou d'un serveur d'un restaurant McDonald's avec l'entreprise qui peut calculer combien en terme de chiffres d'affaires supplémentaires, le fait d'avoir un ouvrier ou un serveur en plus lui rapporterait . Mais ce serait une estimation approximative, d'un intervalle de productivité et pas une certitude absolue. Certains argumentent que laisser au chef d'entreprise le pouvoir absolu de fixer chaque mois ou jour le salaire de chaque employé peut signifier des décisions arbitraires et injustes mais aussi inefficaces pour l'entreprise globalement. Faire que les salaires soient relativement stables dans le temps peut être efficace collectivement. Et qu'ils ne varient pas sans cesse selon les aléas des ventes de l'entreprise. Les dirigeants d'entreprise et propriétaires ont des patrimoines et revenus plus élevés de beaucoup que leurs salariés. Ils peuvent donc amortir les chocs de revenus de court terme plus facilement. Il peut être dans l'intérêt général que le contrat sociale a une dimension assurantielle avec un salaire garanti dans le temps et soit quasiment le même chaque mois. Ce qui n'exclut ni les bonus ni les primes. C'est la mensualisation des salaires qui a finit par se normaliser durant le XXème siècle dans les pays développés que ce soit dans les loi ou dans les négociations entre employeurs et employés. Le salaire journalier était la norme durant le XIXème siècle. Mais fixer les salaires à l'avance a des limites car si les ventes s'effondrent d'un seul coup, maintenir salaires et emplois au même niveau qu'avant peut mener à la faillite dans certains cas.Le fait que les salaires bas et moyens soient globalement bien plus stables que les profits et les salaires très élevés absorbent le gros de la volatilité de court terme, est une bonne chose mais la rigidité salariale absolue est à éviter.
Un autre argument favorable aux salaires minimum et des grilles salariales concerne les investissements spécifiques. Les tâches particulières devant être remplies dans une entreprise donnée exigent souvent de la part des salariés des investissements spécifiques à l'entreprise. Si les chefs d'entreprises fixent les salaires, ou si le salaire est fixé unilatéralement en général, modifiable à tout moment sans que les salariés ne sachent rien concernent leur rénmunération, ils peuvent ne pas s'investir autant qu'ils le devraient. Si un petit groupe d'employeurs est en situation de monopsone sur un marché du travail local, c'est à dire qu'ils sont les seuls ou presque à pouvoir offrir du travail du fait de la mobilité réduite de la main d'oeuvre, ils essayeront probablement d'exploiter cet avantage au maximum pour baisser les salaires autant qu'ils le peuvent en dessous de la production marginale des salariés. Avoir un salaire minimum est non seulement juste mais efficace puiqu'une augmentation du minimum légal peut arapprocher l'économie de l'équilibre concurrentiel et augmenter le niveau d'emploi. Ce modèle théorique à base de concurrence imparfaite constitue la justification la plus évidente pour l'existence d'un salaire minimum : il s'agit de faire en sorte qu'aucun employeur ne puise exploiter trop cet avantage concurrentiel. Mais la limite d'un salaire minimum ne peut pas être fixé dans l'absolue indépendemment de l'état général des qualifications et de la producitvité d'une société. Card et Krueger ont mené des études aux Etats Unis entre les années 1980 et 2000. Ils montrent que le salaire minimum américain est tombé à un niveau tellement bas que son relèvement permet d'augmenter les bas salaires sans perdre d'emplois ou même e augmentant le niveau d'emploi suivant le plus pur modèle du monopsone. Source : " Myth and Measurement : The New Economics of the Minimum Xage. "
Mais quand on continue d'augmenter le salaire minimum, au bout d'un moment, les effets négatifs sur le niveau d'emploi finissent par se voir et par l'emporter sur le positif. Difficile d'avoir un relèvement fort du salaire minimum dans un pays comme le France par exemple contrairement aux Etats Unis. Autant utiliser d'autres outils pour augmenter le pouvoir d'achat en France, notamment l'amélioration des qualifications ou la réforme fiscale, les deux étant complémentaires. Cela ne signifie pas que le salaire minimum doit être ggelé de façon excessive. Car s'il est difficile de faire augmenter les salaires aussi vite que la production, augmenter les salaires ou une partie importante d'entre eux, moins vite que la production est tout aussi malsain. Au delà du salaire minimum, l'éducation et la technologie jouent un rôle plus important concernant les salaires.
La montée des super cadres : un phénomène anglo saxon.
Une autre difficulté de la théorie de la productivité marginale est que ce décrochage des très hauts salaires a lieu dans certains pays développés mais pas dans d'autres. On peut donc penser que les différences institutionnelles des pays sont la cause de cela. Durant les années 1970 et 1980, il y a eu augmentation de la part du centile supérieur dans le revenu national aux USA comme au Canada, Australie et Royaume Uni. les données concernant les revenus par niveau de reveni total, montrent que l'ensemble de ces pays voient un envol des hauts salaires explique pour les 2 tiers généralement, de la hausse de la part du centile supérieur de la hiérarchie des revenus avec le reste s'expliquant par la bonne santé des revenus du capital. Les inégalités s'expliquent dans les pays anglo saxons en grande partie par la montée des super cadres. Durant les années 1970, la part du centile supérieur dans le revenu nationale était proche dans les différents pays. Entre 6 et 8% dans les 4 pays anglo daxons. 30 ans après au début des années 2010, la part du centile supérieur atteint 20% du revenu nationale aux Etats Unis pour seulement entre 14 et 15% du revenu national au Royaume Uni et au Canada. Pour à peine 10% du revenu national en Australie. La progression de la part du centile supérieur aux Etats Unis était 2 fois plus forte qu'au Royaume Uni et Canada voire 3 fois plus forte qu'en Australie et Nouvelle Zélande. Difficile de voir par conséquent cette montée des super cadres comme un phénomène purement technologique. La part du centile supérieur dans le revenu nationale a augmenté en Europe continentale de façon plus faible que dans les pays anglo saxons depuis les années 1970 et 1980.
Le Japon suit environ la trajectoire de l'Europe continentale là dessus. En fait ll'évolution a été quasiment la même au Japon qu'en France avec une part du centile supérieur à peine à 7% du revenu nationale au début des années 1980 pour finalement monter à plus de 9% au début des années 2010. En Suède on est passé durant la même période de 4%, soit le plus bas niveau enregistré dans la World Top Incomes Databse, à 7%. En Allemagne, on est passé de 9% à 11% entre le début des années 1980 et le début des années 2010. Au Danemark on est passé de 5% à 7% durant la même période. En Espagne et en Italie, les évolutions étaient à peu près similaires à ceux de la France, soit de 7% à 9% durant la même période. Le Royaume Uni est plus proche de la trajectoire américaine que de la trajectoire de l'Europe continentale de ce point de vue là. Ces hausse de 2 à 3% correspondent à des augmentations des inégalités de revenus non négligeables. Ces hausses impliquent une hausse plus élevée chez les 1% de revenus les plus élevées par rapport au revenu moyen qui a progressé bien plus lentement. A noter que plus on monte haut dans la hiérarchie des revenus, plus les hausses sont spectaculaires. Les 0,1 % les plus riches ont vu leur part passer de 2% à 10% du revenu national aux Etats Unis ou 8% si on oublie les plus values. Sachant qu'en comptant toutes les plus values on est dans du 12%.
En France et au Japon, la part du millime supérieur passe de 1,5% du revenu national au début des années 1980 à 2,5% au début des années 2010 soit presque un doublement. En Suède on passe au cours de la même période de 1% à 2% du revenu national. Ce qui revient à ce que ce groupe a en moyenne un revenu 20 fois plus élevé que la moyenne du pays. Si c'est 10%, les 0,1% ont un revenu 100 fois plus élevé que la moyenne. Alors que le pouvoir d'achat moyen stagnait en Occident entre les années 1990 et 2010 voire 2020, celui des 1% et plus encore, 0,1% les plus riches, a augmenté énormément. Au Etats Unis, durant les années 2000 et 2010, on était sur des inégalités de revenus comparables à ceux des années 1910 et 1920 bien que sous une autre forme avec un rôle plus important auparavant joué par les hauts revenus du travail et moins important pour les hauts revenus du capital. En Europe continentale et au Japon, l'inégalité des revenus est globalement plus faible par rapport aux années 1920 et 1930. Cependant, au Japon, on semble se diriger vers la trajectoire américaine avec 1 ou 2 décennies de retard. Pourtant le changement technologique a eu lieu partout. Et la croissance de la production par habitant, soit la productivité, a été la même dans toutes les parties du monde riche, avec des écarts portant souvent sur quelques dixièmes de points de pourcentage.
On peut prendre l'exemple d'un ouvrier sur une chaîne de montage ou d'un serveur d'un restaurant McDonald's avec l'entreprise qui peut calculer combien en terme de chiffres d'affaires supplémentaires, le fait d'avoir un ouvrier ou un serveur en plus lui rapporterait . Mais ce serait une estimation approximative, d'un intervalle de productivité et pas une certitude absolue. Certains argumentent que laisser au chef d'entreprise le pouvoir absolu de fixer chaque mois ou jour le salaire de chaque employé peut signifier des décisions arbitraires et injustes mais aussi inefficaces pour l'entreprise globalement. Faire que les salaires soient relativement stables dans le temps peut être efficace collectivement. Et qu'ils ne varient pas sans cesse selon les aléas des ventes de l'entreprise. Les dirigeants d'entreprise et propriétaires ont des patrimoines et revenus plus élevés de beaucoup que leurs salariés. Ils peuvent donc amortir les chocs de revenus de court terme plus facilement. Il peut être dans l'intérêt général que le contrat sociale a une dimension assurantielle avec un salaire garanti dans le temps et soit quasiment le même chaque mois. Ce qui n'exclut ni les bonus ni les primes. C'est la mensualisation des salaires qui a finit par se normaliser durant le XXème siècle dans les pays développés que ce soit dans les loi ou dans les négociations entre employeurs et employés. Le salaire journalier était la norme durant le XIXème siècle. Mais fixer les salaires à l'avance a des limites car si les ventes s'effondrent d'un seul coup, maintenir salaires et emplois au même niveau qu'avant peut mener à la faillite dans certains cas.Le fait que les salaires bas et moyens soient globalement bien plus stables que les profits et les salaires très élevés absorbent le gros de la volatilité de court terme, est une bonne chose mais la rigidité salariale absolue est à éviter.
Un autre argument favorable aux salaires minimum et des grilles salariales concerne les investissements spécifiques. Les tâches particulières devant être remplies dans une entreprise donnée exigent souvent de la part des salariés des investissements spécifiques à l'entreprise. Si les chefs d'entreprises fixent les salaires, ou si le salaire est fixé unilatéralement en général, modifiable à tout moment sans que les salariés ne sachent rien concernent leur rénmunération, ils peuvent ne pas s'investir autant qu'ils le devraient. Si un petit groupe d'employeurs est en situation de monopsone sur un marché du travail local, c'est à dire qu'ils sont les seuls ou presque à pouvoir offrir du travail du fait de la mobilité réduite de la main d'oeuvre, ils essayeront probablement d'exploiter cet avantage au maximum pour baisser les salaires autant qu'ils le peuvent en dessous de la production marginale des salariés. Avoir un salaire minimum est non seulement juste mais efficace puiqu'une augmentation du minimum légal peut arapprocher l'économie de l'équilibre concurrentiel et augmenter le niveau d'emploi. Ce modèle théorique à base de concurrence imparfaite constitue la justification la plus évidente pour l'existence d'un salaire minimum : il s'agit de faire en sorte qu'aucun employeur ne puise exploiter trop cet avantage concurrentiel. Mais la limite d'un salaire minimum ne peut pas être fixé dans l'absolue indépendemment de l'état général des qualifications et de la producitvité d'une société. Card et Krueger ont mené des études aux Etats Unis entre les années 1980 et 2000. Ils montrent que le salaire minimum américain est tombé à un niveau tellement bas que son relèvement permet d'augmenter les bas salaires sans perdre d'emplois ou même e augmentant le niveau d'emploi suivant le plus pur modèle du monopsone. Source : " Myth and Measurement : The New Economics of the Minimum Xage. "
Mais quand on continue d'augmenter le salaire minimum, au bout d'un moment, les effets négatifs sur le niveau d'emploi finissent par se voir et par l'emporter sur le positif. Difficile d'avoir un relèvement fort du salaire minimum dans un pays comme le France par exemple contrairement aux Etats Unis. Autant utiliser d'autres outils pour augmenter le pouvoir d'achat en France, notamment l'amélioration des qualifications ou la réforme fiscale, les deux étant complémentaires. Cela ne signifie pas que le salaire minimum doit être ggelé de façon excessive. Car s'il est difficile de faire augmenter les salaires aussi vite que la production, augmenter les salaires ou une partie importante d'entre eux, moins vite que la production est tout aussi malsain. Au delà du salaire minimum, l'éducation et la technologie jouent un rôle plus important concernant les salaires.
La montée des super cadres : un phénomène anglo saxon.
Une autre difficulté de la théorie de la productivité marginale est que ce décrochage des très hauts salaires a lieu dans certains pays développés mais pas dans d'autres. On peut donc penser que les différences institutionnelles des pays sont la cause de cela. Durant les années 1970 et 1980, il y a eu augmentation de la part du centile supérieur dans le revenu national aux USA comme au Canada, Australie et Royaume Uni. les données concernant les revenus par niveau de reveni total, montrent que l'ensemble de ces pays voient un envol des hauts salaires explique pour les 2 tiers généralement, de la hausse de la part du centile supérieur de la hiérarchie des revenus avec le reste s'expliquant par la bonne santé des revenus du capital. Les inégalités s'expliquent dans les pays anglo saxons en grande partie par la montée des super cadres. Durant les années 1970, la part du centile supérieur dans le revenu nationale était proche dans les différents pays. Entre 6 et 8% dans les 4 pays anglo daxons. 30 ans après au début des années 2010, la part du centile supérieur atteint 20% du revenu nationale aux Etats Unis pour seulement entre 14 et 15% du revenu national au Royaume Uni et au Canada. Pour à peine 10% du revenu national en Australie. La progression de la part du centile supérieur aux Etats Unis était 2 fois plus forte qu'au Royaume Uni et Canada voire 3 fois plus forte qu'en Australie et Nouvelle Zélande. Difficile de voir par conséquent cette montée des super cadres comme un phénomène purement technologique. La part du centile supérieur dans le revenu nationale a augmenté en Europe continentale de façon plus faible que dans les pays anglo saxons depuis les années 1970 et 1980.
Le Japon suit environ la trajectoire de l'Europe continentale là dessus. En fait ll'évolution a été quasiment la même au Japon qu'en France avec une part du centile supérieur à peine à 7% du revenu nationale au début des années 1980 pour finalement monter à plus de 9% au début des années 2010. En Suède on est passé durant la même période de 4%, soit le plus bas niveau enregistré dans la World Top Incomes Databse, à 7%. En Allemagne, on est passé de 9% à 11% entre le début des années 1980 et le début des années 2010. Au Danemark on est passé de 5% à 7% durant la même période. En Espagne et en Italie, les évolutions étaient à peu près similaires à ceux de la France, soit de 7% à 9% durant la même période. Le Royaume Uni est plus proche de la trajectoire américaine que de la trajectoire de l'Europe continentale de ce point de vue là. Ces hausse de 2 à 3% correspondent à des augmentations des inégalités de revenus non négligeables. Ces hausses impliquent une hausse plus élevée chez les 1% de revenus les plus élevées par rapport au revenu moyen qui a progressé bien plus lentement. A noter que plus on monte haut dans la hiérarchie des revenus, plus les hausses sont spectaculaires. Les 0,1 % les plus riches ont vu leur part passer de 2% à 10% du revenu national aux Etats Unis ou 8% si on oublie les plus values. Sachant qu'en comptant toutes les plus values on est dans du 12%.
En France et au Japon, la part du millime supérieur passe de 1,5% du revenu national au début des années 1980 à 2,5% au début des années 2010 soit presque un doublement. En Suède on passe au cours de la même période de 1% à 2% du revenu national. Ce qui revient à ce que ce groupe a en moyenne un revenu 20 fois plus élevé que la moyenne du pays. Si c'est 10%, les 0,1% ont un revenu 100 fois plus élevé que la moyenne. Alors que le pouvoir d'achat moyen stagnait en Occident entre les années 1990 et 2010 voire 2020, celui des 1% et plus encore, 0,1% les plus riches, a augmenté énormément. Au Etats Unis, durant les années 2000 et 2010, on était sur des inégalités de revenus comparables à ceux des années 1910 et 1920 bien que sous une autre forme avec un rôle plus important auparavant joué par les hauts revenus du travail et moins important pour les hauts revenus du capital. En Europe continentale et au Japon, l'inégalité des revenus est globalement plus faible par rapport aux années 1920 et 1930. Cependant, au Japon, on semble se diriger vers la trajectoire américaine avec 1 ou 2 décennies de retard. Pourtant le changement technologique a eu lieu partout. Et la croissance de la production par habitant, soit la productivité, a été la même dans toutes les parties du monde riche, avec des écarts portant souvent sur quelques dixièmes de points de pourcentage.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a 10 mois
Aussi étrange que cela puisse paraître, les inégalités sont plus faibles dans les pays dits émergents qu'aux Etats Unis. On le sait en dépit des sources relativement plus réduites quand on sort des pays riches. On a notamment des données venant des pays anciennement colonisé par la Grande Bretagne et les Pays Bas, lesquels avaient introduit un impôt sur le revenu et l'ayant imposé aux pays colonisés. De plus durant l'entre deux guerres, l'Argentine introduit précisément en 1932 l'impôt sur le revenu. Durant les années 1020, les données fiscales commencent à être disponibles pour des pays comme l'Indonésie et l'Inde. Pour le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas depuis 1913. Certes les données sont moins nombreuses voire moins précises par moment, mais elles existent. De plus l'impôt sur le revenu dans les pays moins développés a tendance à ne concerner qu'une petite minorité de la population. Ce qui fait qu'on peut estimer la part du centile supérieur dans le revenu total mais pas la part du décile supérieur par exemple. En Afrique du Sud, les plus hauts niveau de la part du décile supérieur étaient par moment de plus de 50% du revenu national, soit plus élevé que les Etats Unis à partir des années 2000. A partir des années 1990 et 2000 il y a une certaine détérioration des données discales dues aux fichiers numériques, ce qui fait que les administrations interrompent les publications statistiques détaillées existant dans les époques plus anciennes où elles en avaient elles mêmes besoin, ce qui peut paradoxalement mener à une détérioration des sources d'information à l'âge du numérique. Cela semble surtout correspondre à une certaine désaffection pour l'impôt sur le revenu en général au sein des organisations internationales mais aussi chez certains gouvernements.
A partir du début des années 2000, l'Inde a arrêté de publier les dépouillements détaillés issus des déclarations de revenus, existant pourtant sans discontinuer depuis 1922. A noter que la très forte croissance qu'ont connus l'Inde et la Chine vient avant tout des statistiques de production. Quand on essaye de mesurer la pgoression des revenus en utilisant des enquêtes sur les budgets des ménages, difficile de retrouver les taux de croissance macroéconomiques annoncés car les revenus indiens et chinois progressent à des rythmes élevés mais moins que ceux prévus par les statistiques de croissance officielle. C'est le paradoxe du trou noir de la croissance. Cela peut venir du fait que la croissance de la production est surestimé avec de multiples incitations administratives à manipuler les flux de production, ou bien que la croissance du revenu est sous estimée étant donné que les enquêtes auprès des ménages ont parfois des imperfections. Ou alors les 2 à la fois. Cela peut s'expliquer également par le fait que les plus hauts revenus notamment mal enregistrés dans les enquêtes déclaratives, ont capté une part disproportionnée de la croissance de la production. En Inde, sur la base des revenus déclarés, on peut estimer que la progression de la part du centile supérieur dans le revenu national constatée grâce aux données fiscales permet d'expliquer à elle seule entre un quart et un tiers du trou noir de croissance entre 1990 et 2000. Source : Banerjee et Piketty " Top Indian incomes, 1922 - 2000 ". Mais avec la détérioration des statistiques fiscales au cours des années 2000, impossible de prolonger l'enquête. Les statistiques établies par l'administration fiscale en Chine sont plus rudimentaires que pour l'Inde.
Un état social pour le XXIème siècle.
La crise financière globale en 2007 2008 est vue comme la plus grave depuis 1929. A noter quand même des différences majeures entre les 2 crises. D'abord la crise de 2007 2008 n'a pas débouché sur une dépression aussi dévastatrice que la précédente. Entre 1929 et 1935, le niveau de production des pays développés a chuté d'un quart et le chômage a explosé. Ce n'est que la Seconde Guerre mondiale qui a totalement sorti la planète de cette dépression. La crise de 2008 n'a pas été aussi grave. C'est pourquoi on la réfère en parlant de grande récession. En 2013 2014, les grandes économies ont à peine retrouvées leur niveau de production de 2007 avec des finances publiques en mauvais état. Mais Mais la chute de la production au plus fort de la crise n'a pas dépassé les 5% dans la plupart des pays dits riches. De plus les pays émergents ont vu leur croissance rapidement reprendre le rythme d'avant crise, ce qui a tiré la croissance mondiale durant les années 2010. De plus les gouvernements et banques centrales n'ont pas laissé le système financier s'effondrer. Les banques centrales ne sont pas là que pour maintenir un taux d'inflation faible après tout. Lors des paniques financières, elles doivent jouer leur rôle de prêteur en dernier ressort. Elle doivent éviter l'effondrement total de l'économie et de la société. Le problème est que la politique ayant suivi la crise n'a pas apporté de réponse satisfaisante aux problèmes structurels ayant rendue la crise possible en premier lieu. Notamment au niveau du manque de transparence financière et au niveau de la montée des inégalités.
Après la crise de 1929, Roosevelt avait en quelques années fait augmenté le taux supérieur de l'impôt fédéral sur le revenu à plus de 80% alors que sous Hoover ce taux n'était que de 25%. Il faut à la fois inventer de nouveaux outils permettant de reprendre le contrôle du capitalisme financier, rénover et moderniser en permanence et en profondeur les systèmes de prélèvements et de dépenses qui sont devenus sans doute trop complexes en plus de menacer leur efficacité sur le plan économique comme sur le plan social. A noter qu'avant la WW1, les impôts représentaient moins de 10% du revenu national dans tous les pays au XIXème siècle notamment. L'Etat se contentait de remplir les fonctions régaliennes comme la justice, l'armée, la police, les affaires étrangères, l'administration générale. Mais pas beaucoup plus. Il y a aussi tout au plus des infrastructures minimales et certaines écoles et universités voire dispensaires. Mais à partir des années 1920 jusqu'aux années 1980, la part du revenu nationale augmente que les pays consacrent aux impôts et aux dépenses publiques. Notamment pour les dépenses sociales. La part des impôts dans le revenu national a été multiplié par 3 ou 4 au moins dans tous les pays développés. Voire par 5 dans les pays nordiques. Puis une stabilisation de la part des impôts dans le revenu nationale depuis les années 1980 jusqu'aux années 2010. A peine 30% pour les USA et entre 45 et 55% du revenu national en Europe continentale dont 45% en Allemagne, près de 55% en Suède et 50% en France durant les années 2010.
LA QUESTION DE LE DETTE PUBLIQUE
Pour réduire de façon importante la dette publique, il y a 3 solutions principales, à savoir l'austérité, l'inflation et l'impôt sur le capital. Parmi les 3, l'austérité est la pire solution que ce soit en terme d'efficacité économique ou en terme de justice sociale. Surtout si la cure d'austérité est prolongé. Il vaut mieux donc se tourner vers l'inflation ou l'impôt sur le capital. L'impôt exceptionnel sur le capital privé est sans doute la solution la plus juste et efficace. L'inflation est un moindre mal comparé à l'austérité. La plupart des grosses dettes publiques historiquement ont été résorbées par cette voie. Il faut savoir que le patrimoine national avoisine les 6 années de revenus dans la plupart des pays européens. Il est détenu dans sa quasi totalité par les agents privés donc les ménages. La valeur totale des actifs publics et du même ordre que les dettes publiques soit environ une année de revenu national. Donc le patrimoine public net est quasi nul. Les patrimoines privés se divisent entre d'un côté les actifs financiers nets de dettes privés et d'un autre les actifs immobiliers, qui occupent à peu près une même part de ces patrimoines privés. Les dettes publiques des pays européens sont en moyenne détenues par les ménages européens Ce que le reste du monde détient est compensé par ce que les européens détiennent dans le reste du monde. A noter la complexité du système d'intermédiation financière et l'ampleur des participations croisées entre pays. Il n'en reste pas moins que les ménages européens, ceux qui détiennent quelque chose du moins, possèdent l'équivalent de tout ce qu'il y a à posséder en Europe y compris les dettes publiques. Une première solution serait de privatiser tous les actifs publics pour réduire la dette publique à quasi 0.
Selon les comptes nationaux établis dans divers pays européens, le produit des ventes de tous les bâtiments publics, écoles, universités, hôpitaux, infrastructures de tous genre, gendarmeries, etc... permettrait de rembourse le gros de la dette publique. Les ménages européens les plus dotés en patrimoines deviendraient directement propriétaires de ce qui a été privatisé au lieu de détenir la dette publique à travers leurs placements financiers. Il faudrait par la suite leur verser un loyer pour pouvoir utiliser ces actifs et continuer de produire les services publics correspondants. Cette solution est évoquée parfois mais est clairement une mauvaise idée. Car sinon impossible que l'état social puise remplir sa mission notamment au niveau de l'éducation, de la sécurité et de la santé. L'état doit détenir les actifs publics correspondants à ces domaines. Chaque année l'état verse de gros intérêts de la dette publique. Et cela pèse sur le budget public national. On peut du coup penser à prélever un impôt exceptionnel sur le capital privé. Un impôt exceptionnel de 15% sur tous les patrimoines privés rapporterait près d'une année de revenu national et permettrait donc de rembourser immédiatement toutes les dettes publiques. Et l'Etat détiendrait toujours des actifs publics. Mais la valeur de ses dettes serait réduite à 0. Il n'aurait plus d'intérêt, par conséquent, à payer.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a 10 mois
Chacun contribuera à l'effort. Et il n'y aura pas de faillites bancaires car ce sont les détenteurs finaux des patrimoines à savoir les personnes physiques qui sont mis à contribution et non pas les établissements financiers. Il faut pour cela que les autorités publiques aient les transactions automatiques d'informations bancaires à disposition sur l'ensemble des actifs financiers détenus par les uns et les autres. Cette solution fiscale a aussi l'avantage de permettre de moduler l'effort en fonction du patrimoine de chacun. Ainsi au lieu d'appliquer un impôt proportionnel de 15% pour tous les patrimoines de tel ou tel pays, autant appliquer un barème progressif pour épargner les patrimoines les plus modestes et demander davantage aux patrimoines les plus élevés. C'est d'une certaine façon ce que font déjà certaines lois bancaires en Europe. Elle garantissent les dépôts inférieurs à 100 000 euros en cas de faillite. Et cela peut s'appliquer à l'ensemble des actifs, pas seulement aux dépôts bancaires. C'est important surtout si on veut mettre à contribution les patrimoines les plus importants dont les économies sont rarement placées sur un compte chèque.
Même si l'impôt sur le capital est la façon la plus transparente voire efficace et juste si bien appliquée, de réduire considérablement la dette publique, on peut très bien utiliser le levier de l'inflation. Car la dette publique est un actif nominal dont le prix donc est fixé à l'avance et ne dépend pas de l'inflation. Ce n'est pas un actif réel, soit un actif dont le prix évoluerait selon la situation économique, généralement aussi vite que l'inflation au moins si ce n'est plus, à l'image des prix des actifs boursiers ou immobiliers. Donc un peu d'inflation réduirait la valeur réelle de la dette publique. Avec une inflation de 5% par an, en 5 ans la valeur réelle de la dette, exprimée en pourcentage du PIB, serait réduite de 15%. C'est ça ce qui a d'ailleurs permet de réduire les dettes publiques importantes en Europe durant le XXème siècle. Entre 1913 et 1950, la France et l'Allemagne ont connu une moyenne de respectivement 13% et 17% d'inflation par an. Cela a largement contribué les 2 pays de se lancer dans des politiques de reconstruction importantes quasiment sans dette ou presque. Certaines grandes banques avaient tenté de relever leur cible d'inflation. Sans prélèvement exceptionnel sur le capital et sans inflation, il faudrait plusieurs décennies pour sortir de l'endettement public, à supposer qu'on ne change pas de système bancaire ou monétaire. Pour parler d'austérité, prenons l'exemple du Royaume Uni au XIXème siècle qui a connu une cure prolongée d'austérité. Il a fallu un siècle d'excédents primaires soit entre 2 et 3 points de PIB par an en moyenne pour effacer leur énorme dette publique causée en grande partie par les guerres napoléoniennes.
Durant cette période, les contribuables britanniques ont versé plus de ressources en intérêts de la dette qu'ils en ont versé pour leurs dépenses totales d'éducation. Un choix allant sans doute dans l'intérêt de détenteurs des titres de dettes. Mais qui n'allait sans doute pas dans l'intérêt général du pays. Car le Royaume Uni a connu un retard éducatif qui a pu contribué au déclin du Royaume Uni durant les décennies suivantes. Leur dette était de plus de 200% du PIB avec quasiment pas d'inflation. Concernant les effets secondaires de l'inflation, on peut noter le risque d'emballement car on n'est pas sûr qu'on puisse s'arrêter disons à 5% par an. Difficile de stopper la spirale inflationniste avec chacun voulant voir les prix et salaires les concernant évoluer de manière qui les arrange. Ainsi malgré le prélèvement exceptionnel sur les patrimoines en France appliqué en 1945, c'est l'inflation dépassant les 50% entre 1945 et 1948 qui a le plus contribué à massivement réduire la dette publique française. Mais l'inflation a ruiné des millions de petits épargnants, aggravant la pauvreté du troisième âge durant les années 1950. Car l'épargne financière des années 1920 1930 était détruite par l'effondrement des marchés boursiers certes. Mais l'inflation entre 1945 et 1948 a entraîné un choc supplémentaire. Le minimum vieillesse crée en 1956 fut une des réponses, ainsi que le développement des systèmes de retraite par répartition en 1945. Entre le début et la fin de 1923, les prix en Allemagne sont multipliés par 100 millions. Et quand l'inflation devient non seulement permanente et anticipée, elle en perd une partie des effets souhaités à l'origine, notamment du côté de ceux qui prêtent à l'Etat et qui exigent un taux d'intérêt plus élevé.
Mais un avantage de l'inflation est que contrairement à l'impôt sur le capital qui soustrait des ressources à des personnes qui les auraient dépensé ou épargné, l'inflation idéalement ponctionne principalement ceux qui ne savent pas trop quoi faire de leur argent, soit ceux ayant conservé trop de liquidités sur leurs comptes en banques et sur des comptes et livrets peu dynamiques. Ceux qui ont quasiment tout dépensé sont épargné de même que ceux ayant tout investi dans des actifs économiques réels dont profesionnels ou immobiliers. Ou encore ceux qui sont endettés dont la dette nominale est par ailleurs réduite par l'inflation ce qui leur permet d'investir plus rapidement. Soit une sorte de taxe sur le capital inutile et oisif. Mais l'inflation n'empêche pas les patrimoines bien diversifiés et importants d'avoir un très bon rendement, indépendamment de toute implication personnelle, simplement du fait de leur taille. Donc l'inflation reste imprécis comme outil. Car les redistributions de richesses peuvent aller dans le bon sens tout comme dans le mauvais. Un peu plus d'inflation reste certes préférable à plus d'austérité globalement et généralement. Et une vague inflationniste d'ampleur en Europe épargnerait les détenteurs de patrimoines immobiliers et boursiers importants contrairement aux personnes modestes.
A noter que les banques centrales ne créent pas la richesse mais la redistribuent. Quand la BCE créer 1 milliard d'euros par exemple, le capital national européen n'augmente pas d'1 milliard. Car le capital national ne change pas d'un pouce. Les opérations effectuées par les banques centrales sont toujours des opérations de prêts. Cela conduit à la création d'actifs et de passifs financiers se compensant au moment exactement où ceux ci sont introduits. Aussi si le prêt fait par la banque centrale permet à la société en question de sortir d'une mauvaise passe et d'éviter la faillite définitive, faillite qui aurait pu conduire à une baisse du patrimoine nationale, alors une fois la situation stable et que le prêt est remboursé, on peut dire que le prêt a permis d'accroître le patrimoine national. Au contraire si le prêt n'a fait que retardé la faillite de la société et si cela a même empêché l'émergence d'un concurrent viable, on doit considérer que cette politique a eu pour effet la diminution du patrimoine national. Quand les banques centrales augmentent la masse monétaire en faisant un prêt à une société financière ou non financière, ou alors à un gouvernement, dans l'immédiat il n'y a aucun effet sur le capital national ou le capital public ou privé. Hors crise, les banques centrales sont censées faire en sorte que la masse monétaire croit au même rythme que l'activité économique du pays considéré. Elles introduisent la monnaie nouvelle en prêtant de l'argent aux banques sur des durées courtes, souvent de quelques jours à peine.
Ces prêts permettent de garantir la solvabilité de l'ensemble du système financier. Les énormes flux de dépôts et de retraits faits de façon quotidien par les entreprises et ménages ne s'équilibrent jamais parfaitement au jour près pour chaque banque particulière. La nouveauté la plus importante depuis 2008 se trouve dans la durée des prêts consentis aux banques privées car au lieu de prêt pour quelques jours, FED et BCE se sont mis à prêté à échéance de 3 mois voire 6. Cela a entraîné une forte augmentation des volumes correspondants au cours de la fin de l'année 2008 et du début de l'année 2009. Avec les mêmes échéances elles se sont mises à prêté à des sociétés non financières aux Etats Unis particulièrement avec des prêts au secteur bancaire allant jusqu'à 9 ou 12 mois et des achats directs d'obligations très longues. A partir de 2011 2012, la BCA par exemple a commencé à pratiquer les achats des bons du Trésor et diverses obligations publiques lorsque la crise se propageait dans les pays du sud de l'Europe.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a 10 mois
L'économie est une science qui a du mal à décrire, et une impossibilité à prédire.
Par exemple, dans son programme, Melenchon partait du constat suivant :
1 - Les femmes sont moins bien payées de 20%
2 - nous forceront les patrons à les payer 25% plus pour se mettre à niveau avec les hommes
3 - les taxes et cotisations issues de cette hausse de salaire reportera du budget pour l'état
4 - la consommation va augmenter grâce à cet enrichissement qui va retourner dans l'économie.
Sur le papier, ça peut effectivement fonctionner, un économiste aura aucun mal à dire "oui, transferer de l'argent des entreprises vers les ménages augmentera effectivement la consommation", ça veut pas dire que : 1 est vrai, 2 est possible, 3 est sans risque, 4 est automatique.
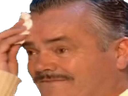
Par exemple, dans son programme, Melenchon partait du constat suivant :
1 - Les femmes sont moins bien payées de 20%
2 - nous forceront les patrons à les payer 25% plus pour se mettre à niveau avec les hommes
3 - les taxes et cotisations issues de cette hausse de salaire reportera du budget pour l'état
4 - la consommation va augmenter grâce à cet enrichissement qui va retourner dans l'économie.
Sur le papier, ça peut effectivement fonctionner, un économiste aura aucun mal à dire "oui, transferer de l'argent des entreprises vers les ménages augmentera effectivement la consommation", ça veut pas dire que : 1 est vrai, 2 est possible, 3 est sans risque, 4 est automatique.
à 2 doigts de se rendre compte que dans un jeu où les joueurs sont ceux qui écrivent et réecrivent les règles en permanence, aucune loi n'est nécessairement stable

Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres

il y a 10 mois
Espérons que ces mêmes économistes n'aient pas demandé à voter Hollande.

LA CROISSANCE : ILLUSIONS ET REALISTES
Il y eu un processus de convergence et de rattrapage par les pays émergents qui continue encore aujourd'hui malgré des inégalités qui persistent. Mais au XXIème siècle, il est possible qu'on ait sur le long terme une période de croissance faible. En fait la croissance a toujours été historiquement faible en dehors de périodes exceptionnelles ou de rattrapages. Il faut penser à diviser la croissance entre croissance de la population et croissance de la production par habitant. Soit une composant démographique et économique. C'est souvent oublié dans le débat public aujourd'hui où on fait comme si la population stagnait indéfiniment. On peut voir que depuis le XVIIIème siècle il y a eu une envolée de la croissance dont les composantes démographiques et économiques ont eu à peu près la même ampleur. Le taux de croissance du PIB mondial a été en moyenne de 1,6% par an entre 1700 et 2012 dont 0,8% par an au titre de croissance de la population, et 0,8% par an au titre de croissance de la production par habitants, ce qui peut sembler faible à priori. On s'imagine souvent qu'un taux de croissance digne de ce nom est de 3% ou 4% par an voire plus comme c'était le cas à l'époque des Trente Glorieuses voire en Chine au début du XXIème siècle. Mais sur longue période, un rythme de croissance de 1% par an que ce soit pour la population ou la production par habitant est rapide, bien plus que celles observées durant les siècles précédant la révolution industrielle. Maddison estime dans ses calculs que les taux de croissance démographiques et économiques étaient en moyenne de 0,1% par an entre l'an 0 et 1700 et précisément de 0,06% par an pour la population et 0,02% par an pour la production par habitant. Entre l'Antiquité et la révolution industrielle ls taux étaient très faibles. Pas plus de 0,2% par an en moyenne.
Il faut savoir ce qu'est la loi de la croissance cumulée soit le fait qu'une croissance annuelle faible cumulée sur très longue période conduit à une progression considérable. La population mondiale a progressé d'en moyenne 0,8% par an entre 1700 et 2012. Sur 3 siècles cela a permis de multiplier la population mondiale par plus de 10. Donc sur Terre il y avait 600 millions d'habitants autour de 1700 et plus de 7 milliards en 2012. Si ce rythme se poursuivait plus tard, on aurait eu 70 milliards vers 2300 ce qui n'arrivera jamais. Pour comprendre la loi du taux de croissance cumulée, un exemple : Si un taux de croissance de 1% par an correspond à une progression de 35% au bout de 30 ans, une multiplication par près de 2 au bout de 100 ans, par 20 au bout de 300 ans, 20 000 au bout de 1 000 ans. Cela veut dire que des taux de croissance supérieures à 1% - 1,5% par an ne peuvent pas être soutenables éternellement à part si on envisage des progressions vertigineuses. On a des perceptions différentes de la croissance selon les périodes dans lesquelles on vit et selon qu'on se place sur le long terme ou non. Car 1% de taux de croissance sur 1 an, c'est faible à priori mais sur le long terme non. Sur une génération soit 30 ans environ, cette même croissance correspond à une progression de plus d'un tiers, ce qui représente quelque chose de non négligeable. A plus de 2% par an, cela donne un doublement à chaque génération même si insuffisant pour renouveler profondément et régulièrement une société et pour la transformer radicalement à long terme.
La loi de la croissance cumulée est similaire à la loi dite des rendements cumulées dans son principe, selon laquelle le taux de rendement annuel de quelques pourcents, cumulé sur plusieurs décennies, conduit mécaniquement à une progression forte du capital initial si le rendement est correctement investi et constamment ou qu'au moins la part consommée par le détenteur de capital ne soit pas trop forte par comparaison au taux de croissance de la société considérée. Un écart apparemment limité entre taux de croissance et taux de rendement du capital produit à long terme des effets puissants sur la structure et la dynamique des inégalités dans une société donnée. Cela découle d'une certaine manière de la loi de la croissance et du rendement cumulés. Si le rythme de croissance démographique entre 1700 et 2012, donc 0,8% par an, avait eu lieu depuis l'Antiquité, la population mondiale aurait été multiplié par près de 100 000 entre l'an 0 et 1700. Cela veut dire une population très faible à l'époque de l'an 0 soit même pas 10 000 sur la Terre. Même un taux de 0,2% impliquerait une population mondiale de 20 millions d'habitants au début de notre ère alors que les estimations les plus fiables disent bien qu'on était sur une population de l'ordre de 200 millions et quelques dont près de 50 millions rien que pour l'Empire romain. Donc la croissance démographique moyenne entre l'an 0 et 1700 était largement inférieure à 0,2% par an et inférieur probablement à 0,1%. Or cela ne correspondait pas à une stagnation démographique car le rythme de progression était lent et la croissance cumulée sur des générations se retrouvait annulée en quelques années souvent à cause d'une crise alimentaire ou sanitaire notamment lors de la Grande Peste Noire de 1347 ayant tué près d'un tiers des européens.
Globalement la population a augmenté d'un quart entre 0 et 1000 et de la moitié entre 1000 et 1500. De moitié également entre 1500 et 1700 avec une croissance démographique de 0,2% environ. L'accélération de la croissance démographique est un processus graduel à mesure que progressent les connaissance médicales, etc.... soit lentement. A partir de 1700 la croissance démographique connait une accélaration avec des taux de croissance de l'ordre de 0,4% par an en moyenne au XVIIIème siècle puis de 0,6% au XIXème siècle. L'Europe et l'Amérique connaissent la plus forte progression démographique entre 1700 et 1913. Ca s'inverse au XXème siècle avec un taux de croissance de la population divisée par 2 en Europe avec 0,4% par an entre 1913 et 2012 contre 0,8% entre 1820 et 1913. C'est la transition démographique avec l'allongement de l'espérance de vie ne suffisant plus à compenser la chute de la natalité. En Asie et Afrique, la natalité est restée plus élevée et plus longtemps. Avec une croissance démographique de l'ordre d'entre 1,5% et 2% parfois au XXème siècle. L'Egypte par exemple n'avait que 10 millions d'habitants au début du XXème siècle. Elle est passée à 80 millions d'habitants durant les années 2010. Aujourd'hui, le Pakistan et le Nigéria se rapprochent des 200 millions durant la décennie 2020 alors qu'ils avaient à peine 20 millions d'habitants chacun au début du XXème siècle. Or les taux de croissance démographiques asiatiques et africains du XXème siècle sont relativement similaires aux taux de croissance atteints par les européens et américains au cours du XIXème siècle. Les Etats Unis n'avaient que 3 millions d'habitants durant les années 1790 et ils sont passés à 100 millions durant les années 1900 et plus de 300 millions durant les années 2010. Soit une multiplication par 100 en à peine 2 siècles et quelques.
La différence étant que les migrations venues des autres continents notamment l'Europe est un des grands facteurs explicatifs de la croissance américaine. L'Asie et l'Afrique du XXème siècle cependant ont une telle croissance à cause de l'accroissement naturel seulement ou presque. Du coup le taux de croissance sur la population au niveau mondial est de 1,4% par an au XXème siècle contre entre 0,4% et 0,6% durant les XVIIIème et XIXème siècles. Entre 1970 et 1990, la population mondiale progresse de plus de 1,8% par an soit presque autant que le record historique absolu observé entre 1950 et 1970 qui était de 1,9%. Entre 1990 et 2012, le rythme est de 1,3% par an ce qui était toujours très rapide. D'ici 2030-2040, on devrait probablement passer au dessous de 0,4% et s'établir aux environs de 0,1% à partir de 2070-2080. Si ces prévisions des Nations Unies établies durant les années 2010 ont lieu, on verrait un retour à la faible croissance démographique d'avant 1700. Le taux de croissance démographique de la Terre aurait alors une grande courbe en cloche entre 1700 et 2100 avec un sommet situé entre 1950 et 1990. Il est à noter que la faible croissance prévue pour après 2050 jusqu'à 2100 est du seulement à l'Afrique qui connait une croissance de 1% par an. Sur les 3 autres continents, la population devrait stagner avec 0% en Amérique voire diminuer avec - 0,1 % en Europe et - 0,2% en Asie. Une situation de croissance négative qui serait unique si prolongée, dans l'histoire de l'humanité. Et encore cela dépend de la progression de l'espérance de vie, et des choix des futures générations. Des variations peuvent arriver. L'histoire démontre que la démographie peut être imprévisible au niveau de son évolution. Cela dépend de facteurs économiques, psychologiques, culturelles et intimes. Ils peuvent dépendre des conditions matérielles que les différents pays.
LA CROISSANCE : ILLUSIONS ET REALISTES
Il y eu un processus de convergence et de rattrapage par les pays émergents qui continue encore aujourd'hui malgré des inégalités qui persistent. Mais au XXIème siècle, il est possible qu'on ait sur le long terme une période de croissance faible. En fait la croissance a toujours été historiquement faible en dehors de périodes exceptionnelles ou de rattrapages. Il faut penser à diviser la croissance entre croissance de la population et croissance de la production par habitant. Soit une composant démographique et économique. C'est souvent oublié dans le débat public aujourd'hui où on fait comme si la population stagnait indéfiniment. On peut voir que depuis le XVIIIème siècle il y a eu une envolée de la croissance dont les composantes démographiques et économiques ont eu à peu près la même ampleur. Le taux de croissance du PIB mondial a été en moyenne de 1,6% par an entre 1700 et 2012 dont 0,8% par an au titre de croissance de la population, et 0,8% par an au titre de croissance de la production par habitants, ce qui peut sembler faible à priori. On s'imagine souvent qu'un taux de croissance digne de ce nom est de 3% ou 4% par an voire plus comme c'était le cas à l'époque des Trente Glorieuses voire en Chine au début du XXIème siècle. Mais sur longue période, un rythme de croissance de 1% par an que ce soit pour la population ou la production par habitant est rapide, bien plus que celles observées durant les siècles précédant la révolution industrielle. Maddison estime dans ses calculs que les taux de croissance démographiques et économiques étaient en moyenne de 0,1% par an entre l'an 0 et 1700 et précisément de 0,06% par an pour la population et 0,02% par an pour la production par habitant. Entre l'Antiquité et la révolution industrielle ls taux étaient très faibles. Pas plus de 0,2% par an en moyenne.
Il faut savoir ce qu'est la loi de la croissance cumulée soit le fait qu'une croissance annuelle faible cumulée sur très longue période conduit à une progression considérable. La population mondiale a progressé d'en moyenne 0,8% par an entre 1700 et 2012. Sur 3 siècles cela a permis de multiplier la population mondiale par plus de 10. Donc sur Terre il y avait 600 millions d'habitants autour de 1700 et plus de 7 milliards en 2012. Si ce rythme se poursuivait plus tard, on aurait eu 70 milliards vers 2300 ce qui n'arrivera jamais. Pour comprendre la loi du taux de croissance cumulée, un exemple : Si un taux de croissance de 1% par an correspond à une progression de 35% au bout de 30 ans, une multiplication par près de 2 au bout de 100 ans, par 20 au bout de 300 ans, 20 000 au bout de 1 000 ans. Cela veut dire que des taux de croissance supérieures à 1% - 1,5% par an ne peuvent pas être soutenables éternellement à part si on envisage des progressions vertigineuses. On a des perceptions différentes de la croissance selon les périodes dans lesquelles on vit et selon qu'on se place sur le long terme ou non. Car 1% de taux de croissance sur 1 an, c'est faible à priori mais sur le long terme non. Sur une génération soit 30 ans environ, cette même croissance correspond à une progression de plus d'un tiers, ce qui représente quelque chose de non négligeable. A plus de 2% par an, cela donne un doublement à chaque génération même si insuffisant pour renouveler profondément et régulièrement une société et pour la transformer radicalement à long terme.
La loi de la croissance cumulée est similaire à la loi dite des rendements cumulées dans son principe, selon laquelle le taux de rendement annuel de quelques pourcents, cumulé sur plusieurs décennies, conduit mécaniquement à une progression forte du capital initial si le rendement est correctement investi et constamment ou qu'au moins la part consommée par le détenteur de capital ne soit pas trop forte par comparaison au taux de croissance de la société considérée. Un écart apparemment limité entre taux de croissance et taux de rendement du capital produit à long terme des effets puissants sur la structure et la dynamique des inégalités dans une société donnée. Cela découle d'une certaine manière de la loi de la croissance et du rendement cumulés. Si le rythme de croissance démographique entre 1700 et 2012, donc 0,8% par an, avait eu lieu depuis l'Antiquité, la population mondiale aurait été multiplié par près de 100 000 entre l'an 0 et 1700. Cela veut dire une population très faible à l'époque de l'an 0 soit même pas 10 000 sur la Terre. Même un taux de 0,2% impliquerait une population mondiale de 20 millions d'habitants au début de notre ère alors que les estimations les plus fiables disent bien qu'on était sur une population de l'ordre de 200 millions et quelques dont près de 50 millions rien que pour l'Empire romain. Donc la croissance démographique moyenne entre l'an 0 et 1700 était largement inférieure à 0,2% par an et inférieur probablement à 0,1%. Or cela ne correspondait pas à une stagnation démographique car le rythme de progression était lent et la croissance cumulée sur des générations se retrouvait annulée en quelques années souvent à cause d'une crise alimentaire ou sanitaire notamment lors de la Grande Peste Noire de 1347 ayant tué près d'un tiers des européens.
Globalement la population a augmenté d'un quart entre 0 et 1000 et de la moitié entre 1000 et 1500. De moitié également entre 1500 et 1700 avec une croissance démographique de 0,2% environ. L'accélération de la croissance démographique est un processus graduel à mesure que progressent les connaissance médicales, etc.... soit lentement. A partir de 1700 la croissance démographique connait une accélaration avec des taux de croissance de l'ordre de 0,4% par an en moyenne au XVIIIème siècle puis de 0,6% au XIXème siècle. L'Europe et l'Amérique connaissent la plus forte progression démographique entre 1700 et 1913. Ca s'inverse au XXème siècle avec un taux de croissance de la population divisée par 2 en Europe avec 0,4% par an entre 1913 et 2012 contre 0,8% entre 1820 et 1913. C'est la transition démographique avec l'allongement de l'espérance de vie ne suffisant plus à compenser la chute de la natalité. En Asie et Afrique, la natalité est restée plus élevée et plus longtemps. Avec une croissance démographique de l'ordre d'entre 1,5% et 2% parfois au XXème siècle. L'Egypte par exemple n'avait que 10 millions d'habitants au début du XXème siècle. Elle est passée à 80 millions d'habitants durant les années 2010. Aujourd'hui, le Pakistan et le Nigéria se rapprochent des 200 millions durant la décennie 2020 alors qu'ils avaient à peine 20 millions d'habitants chacun au début du XXème siècle. Or les taux de croissance démographiques asiatiques et africains du XXème siècle sont relativement similaires aux taux de croissance atteints par les européens et américains au cours du XIXème siècle. Les Etats Unis n'avaient que 3 millions d'habitants durant les années 1790 et ils sont passés à 100 millions durant les années 1900 et plus de 300 millions durant les années 2010. Soit une multiplication par 100 en à peine 2 siècles et quelques.
La différence étant que les migrations venues des autres continents notamment l'Europe est un des grands facteurs explicatifs de la croissance américaine. L'Asie et l'Afrique du XXème siècle cependant ont une telle croissance à cause de l'accroissement naturel seulement ou presque. Du coup le taux de croissance sur la population au niveau mondial est de 1,4% par an au XXème siècle contre entre 0,4% et 0,6% durant les XVIIIème et XIXème siècles. Entre 1970 et 1990, la population mondiale progresse de plus de 1,8% par an soit presque autant que le record historique absolu observé entre 1950 et 1970 qui était de 1,9%. Entre 1990 et 2012, le rythme est de 1,3% par an ce qui était toujours très rapide. D'ici 2030-2040, on devrait probablement passer au dessous de 0,4% et s'établir aux environs de 0,1% à partir de 2070-2080. Si ces prévisions des Nations Unies établies durant les années 2010 ont lieu, on verrait un retour à la faible croissance démographique d'avant 1700. Le taux de croissance démographique de la Terre aurait alors une grande courbe en cloche entre 1700 et 2100 avec un sommet situé entre 1950 et 1990. Il est à noter que la faible croissance prévue pour après 2050 jusqu'à 2100 est du seulement à l'Afrique qui connait une croissance de 1% par an. Sur les 3 autres continents, la population devrait stagner avec 0% en Amérique voire diminuer avec - 0,1 % en Europe et - 0,2% en Asie. Une situation de croissance négative qui serait unique si prolongée, dans l'histoire de l'humanité. Et encore cela dépend de la progression de l'espérance de vie, et des choix des futures générations. Des variations peuvent arriver. L'histoire démontre que la démographie peut être imprévisible au niveau de son évolution. Cela dépend de facteurs économiques, psychologiques, culturelles et intimes. Ils peuvent dépendre des conditions matérielles que les différents pays.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a 10 mois
N'est ce pas?

Si on veut comparer des continents entre eux, le plus gros retournement s'est fait entre l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Europe occidentale avait 100 millions d'habitants durant les années 1780 contre 3 millions à peine en Amérique du Nord. Au début des années 2010, l'Amérique du Nord en a 350 millions contre 410 millions pour l'Europe occidentale Et en 2050, l'Amérique du Nord aurait rattrapé l'Europe avec 450 millions d'habitants contre 430 millions à l'Europe. Ce retournement s'explique d'une part par les flux migratoires et d'autre part, par une fécondité plus élevée dans l'Amérique du Nord par rapport à l'Europe. Et ce n'est pas comme si cela s'expliquait par des politiques familiales, quasiment inexistantes en Amérique du Nord. Peut être l'optimisme concernant l'avenir est plus fort en Amérique du Nord qu'en Europe. Après tout est possible. Même au sein des continents il y a eu des retournements comme en Europe. La France était le pays le plus peuplé d'Europe au XVIIIème siècle au point que Young et Malthus y voient l'origine de la misère de certaines compagnes françaises si ce n'est de la Révolution française. Par la suite la transition démographique est précoce avec une chute des naissance et quasi stagnation de la population dès le XIXème siècle ce qui est parfois attribué à la déchristianisation due à la révolution. Ensuite un rebond de la natalité au XXème siècle sans doute aidé par les politiques familiales mis en place après 1945. D'ailleurs selon les prévisions, la population française devrait dépasser la population allemande au cours des années 2050. Concernant la Chine, une des conséquences de la politique de l'enfant unique mis en place durant les années 1970 est que la population de la Chine est dépassée par celle de l'Inde en 2023. Avant que cette politique de l'enfant unique n'ait été mise en place, la population chinoise était plus nombreuse de 50% par rapport à la population de l'Inde.
Concernant l'Europe, avec la chute de la fécondité dans différents pays, pas étonnant que la plupart des prévisions disent qu'on va avoir des taux légèrement négatifs à partir des années 2030. Pareil au Japon ou en Chine dont les générations qui naissent sont un tiers moins nombreux que celles des années 1990 environ. Sur le très long terme, c'est encore plus difficile de prédire quoique ce soit. La prévision centrale est celle d'une croissance démographique positive mais faible de l'ordre du 0,1 et 0,2% par an lors des prochaines siècles. Une croissance démographique forte peut avoir un rôle égalisateur au niveau de la répartition des richesses, en diminuant l'importance des patrimoines issus du passé donc de l'héritage. Plus une génération est nombreuse, moins l'héritage sera important car ce dernier sera divisé entre un grand nombre d'héritiers. Autant davantage se reposer sur le travail que sur l'épargne et l'héritage. L'accroissement démographique via migration peut entraîner des inégalités, pas seulement forcément entre migrants et autochtones mais également entre les migrants eux mêmes. A noter que la stagnation de la population et encore plus sa diminution, augmente le poids du capital accumulé par les générations précédentes. Tout comme la stagnation économique car avec une croissance faible, le taux de rendement du capital peut dépasser largement le taux de croissance. La structure des inégalités ainsi que l'accumulation du capital seront fortement impactés par le retour des sociétés à faible croissance. Quand la croissance et soit faible soit nulle, les fonctions sociales et économiques et différentes activités professionnelles se reproduisent presque à l'identique d'une génération à une autre.
Or une croissance de 1% par an signifie que d'autre fonctions vont se créer et que de nouvelles compétences seront nécessaires pour chaque génération. La croissance peut donc faciliter l'ascension sociale de personnes dont les parents ne se trouvaient pas forcément en haut de l'échelle. La mobilité sociale peut donc être augmenter par la croissance. Mais cela ne veut pas forcément dire diminutions des inégalités de revenus. Cependant, la croissance moderne est trop souvent utilisé comme argument comme quoi cela révélerait les talents d'aujourd'hui et cela sert souvent de justifications des inégalités actuelles quelles que soient leurs raisons et origines. Concernant la croissance de la production par habitant, on était sur du 0,8% par an entre 1700 et 2012. Soit multiplication par 10 en 3 siècles. Le revenu moyen au niveau mondial était de 760 euros par mois et par habitant en 2012 contre moins de 70 euros par mois en 1700 soit le même niveau que les pays les plus pauvres de l'Afrique subsaharienne de 2012 qui était en 2012 de 2 000 euros par habitant soit 150 euros par moi. Ceci dit, il est plus difficile de comparer les biens et les services que les populations. Quand on parle d'histoire économique, il faut avant tout parler des types de biens et services produits et consommés. Et des modes de vie. En Europe occidentale, Japon et Amérique du sud, le revenu moyen est passé de 100 euros par mois à peine et par habitant en 1700 à plus de 2500 euros par mois en 2012. Donc une multiplication de plus de 20.
En fait la progression de la productivité soit progression par heure travaillée était plus élevée encore étant donné que la durée moyenne du travail par habitant a beaucoup diminué. Toutes les sociétés développées ont fait le choix au fur et à mesure de leur enrichissement de travailler moins longtemps pour avoir plus de temps libre. On doit cette progression en grande partie au XXème siècle. Car la progression de la production par habitants n'était que de 0,1% au XVIIIème siècle contre 0,9% au XIXème siècle et 1,6% au XXème siècle. En Europe c'est 1% entre 1700 et 2012 dont 0,2% au XVIIIème siècle, 1,1% au XIXème siècle et 1n9% au XXème siècle. Le pouvoir d'achat moyen en Europe a à peine progressé entre 1700 et 1820 pour finalement être multiplié par plus de 2 entre 1820 et 1913. Puis par plus de 6 entre 1913 et 2012. Ceci étant dit une part considérable de la population n'a pas profité de la croissance du XIXème siècle. C'est moins le cas au XXème siècle après 1945 notamment. Le revenu moyen des européens à la Belle Epoque est d'à peine 400 euros contre 2 500 euros par mois au début des années 2010. En Europe la croissance du niveau de vie et du pouvoir d'achat repose en premier lieu sur la transformation des structures de consommation. On est pass" d'une consommation avec majoritairement des produits alimentaires à une consommation plus diversifée notamment en produits industriels et services. Le pouvoir d'achat n'a pas été multiplié par 6 entre 1913 et 2012 pour tous les biens et services.
Il faut distinguer biens industriels pour lesquels la croissance de la productivité a été bien plus rapide que la moyenne de l'économique aux biens alimentaires pour lesquels la progression de la productivité a été continue et déterminante sur longue période en permettant de nourrir une population en forte hausse, tout en libérant pour d'autres tâches une part croissance de la main d'oeuvre agricole. Ensuite on a les services pour lesquels la croissance de la productivité a été relativement faible voire pour certains cas, nulle. Là les prix ont augmenté plus vite que la moyenne des prix. Aussi pour ce qui est de la croissance de la production par habitant, elle a mis plus de temps à décoller que la croissance démographique, en restant quasi nulle au XVIIIème siècle et s'est vraiment fait voir à partir du XIXème siècle et plus encore au XXème siècle. La croissance de la production mondiale par habitant a dépassé les 2% par an entre 1950 et 1990 grâce au rattrapage de l'Europe en particulier. Et encore entre 1990 et 2012 grâce au rattrapage de l'Asie cette fois ci, de la Chine en particulier, dont la croissance a dépassé les 9% par an en moyenne entre 1990 et 2010/2012. Dans les pays de l'Europe Occidentale, en Amérique du Nord et au Japon, on sera entre les années 2020 et 2010 à une croissance de probablement 1% voire 1,2%. Pour les pays pauvres et émergents, on sera sur une croissance de l'ordre de 4% par an entre 2030 et 2050. Le sommet de la croissance mondiale par habitant sera donc plus tard que la première soit au milieu du XXIème siècle, un siècle plus tard et de décroître vers une croissance un peu supérieure à 1% par an.
Si on veut comparer des continents entre eux, le plus gros retournement s'est fait entre l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Europe occidentale avait 100 millions d'habitants durant les années 1780 contre 3 millions à peine en Amérique du Nord. Au début des années 2010, l'Amérique du Nord en a 350 millions contre 410 millions pour l'Europe occidentale Et en 2050, l'Amérique du Nord aurait rattrapé l'Europe avec 450 millions d'habitants contre 430 millions à l'Europe. Ce retournement s'explique d'une part par les flux migratoires et d'autre part, par une fécondité plus élevée dans l'Amérique du Nord par rapport à l'Europe. Et ce n'est pas comme si cela s'expliquait par des politiques familiales, quasiment inexistantes en Amérique du Nord. Peut être l'optimisme concernant l'avenir est plus fort en Amérique du Nord qu'en Europe. Après tout est possible. Même au sein des continents il y a eu des retournements comme en Europe. La France était le pays le plus peuplé d'Europe au XVIIIème siècle au point que Young et Malthus y voient l'origine de la misère de certaines compagnes françaises si ce n'est de la Révolution française. Par la suite la transition démographique est précoce avec une chute des naissance et quasi stagnation de la population dès le XIXème siècle ce qui est parfois attribué à la déchristianisation due à la révolution. Ensuite un rebond de la natalité au XXème siècle sans doute aidé par les politiques familiales mis en place après 1945. D'ailleurs selon les prévisions, la population française devrait dépasser la population allemande au cours des années 2050. Concernant la Chine, une des conséquences de la politique de l'enfant unique mis en place durant les années 1970 est que la population de la Chine est dépassée par celle de l'Inde en 2023. Avant que cette politique de l'enfant unique n'ait été mise en place, la population chinoise était plus nombreuse de 50% par rapport à la population de l'Inde.
Concernant l'Europe, avec la chute de la fécondité dans différents pays, pas étonnant que la plupart des prévisions disent qu'on va avoir des taux légèrement négatifs à partir des années 2030. Pareil au Japon ou en Chine dont les générations qui naissent sont un tiers moins nombreux que celles des années 1990 environ. Sur le très long terme, c'est encore plus difficile de prédire quoique ce soit. La prévision centrale est celle d'une croissance démographique positive mais faible de l'ordre du 0,1 et 0,2% par an lors des prochaines siècles. Une croissance démographique forte peut avoir un rôle égalisateur au niveau de la répartition des richesses, en diminuant l'importance des patrimoines issus du passé donc de l'héritage. Plus une génération est nombreuse, moins l'héritage sera important car ce dernier sera divisé entre un grand nombre d'héritiers. Autant davantage se reposer sur le travail que sur l'épargne et l'héritage. L'accroissement démographique via migration peut entraîner des inégalités, pas seulement forcément entre migrants et autochtones mais également entre les migrants eux mêmes. A noter que la stagnation de la population et encore plus sa diminution, augmente le poids du capital accumulé par les générations précédentes. Tout comme la stagnation économique car avec une croissance faible, le taux de rendement du capital peut dépasser largement le taux de croissance. La structure des inégalités ainsi que l'accumulation du capital seront fortement impactés par le retour des sociétés à faible croissance. Quand la croissance et soit faible soit nulle, les fonctions sociales et économiques et différentes activités professionnelles se reproduisent presque à l'identique d'une génération à une autre.
Or une croissance de 1% par an signifie que d'autre fonctions vont se créer et que de nouvelles compétences seront nécessaires pour chaque génération. La croissance peut donc faciliter l'ascension sociale de personnes dont les parents ne se trouvaient pas forcément en haut de l'échelle. La mobilité sociale peut donc être augmenter par la croissance. Mais cela ne veut pas forcément dire diminutions des inégalités de revenus. Cependant, la croissance moderne est trop souvent utilisé comme argument comme quoi cela révélerait les talents d'aujourd'hui et cela sert souvent de justifications des inégalités actuelles quelles que soient leurs raisons et origines. Concernant la croissance de la production par habitant, on était sur du 0,8% par an entre 1700 et 2012. Soit multiplication par 10 en 3 siècles. Le revenu moyen au niveau mondial était de 760 euros par mois et par habitant en 2012 contre moins de 70 euros par mois en 1700 soit le même niveau que les pays les plus pauvres de l'Afrique subsaharienne de 2012 qui était en 2012 de 2 000 euros par habitant soit 150 euros par moi. Ceci dit, il est plus difficile de comparer les biens et les services que les populations. Quand on parle d'histoire économique, il faut avant tout parler des types de biens et services produits et consommés. Et des modes de vie. En Europe occidentale, Japon et Amérique du sud, le revenu moyen est passé de 100 euros par mois à peine et par habitant en 1700 à plus de 2500 euros par mois en 2012. Donc une multiplication de plus de 20.
En fait la progression de la productivité soit progression par heure travaillée était plus élevée encore étant donné que la durée moyenne du travail par habitant a beaucoup diminué. Toutes les sociétés développées ont fait le choix au fur et à mesure de leur enrichissement de travailler moins longtemps pour avoir plus de temps libre. On doit cette progression en grande partie au XXème siècle. Car la progression de la production par habitants n'était que de 0,1% au XVIIIème siècle contre 0,9% au XIXème siècle et 1,6% au XXème siècle. En Europe c'est 1% entre 1700 et 2012 dont 0,2% au XVIIIème siècle, 1,1% au XIXème siècle et 1n9% au XXème siècle. Le pouvoir d'achat moyen en Europe a à peine progressé entre 1700 et 1820 pour finalement être multiplié par plus de 2 entre 1820 et 1913. Puis par plus de 6 entre 1913 et 2012. Ceci étant dit une part considérable de la population n'a pas profité de la croissance du XIXème siècle. C'est moins le cas au XXème siècle après 1945 notamment. Le revenu moyen des européens à la Belle Epoque est d'à peine 400 euros contre 2 500 euros par mois au début des années 2010. En Europe la croissance du niveau de vie et du pouvoir d'achat repose en premier lieu sur la transformation des structures de consommation. On est pass" d'une consommation avec majoritairement des produits alimentaires à une consommation plus diversifée notamment en produits industriels et services. Le pouvoir d'achat n'a pas été multiplié par 6 entre 1913 et 2012 pour tous les biens et services.
Il faut distinguer biens industriels pour lesquels la croissance de la productivité a été bien plus rapide que la moyenne de l'économique aux biens alimentaires pour lesquels la progression de la productivité a été continue et déterminante sur longue période en permettant de nourrir une population en forte hausse, tout en libérant pour d'autres tâches une part croissance de la main d'oeuvre agricole. Ensuite on a les services pour lesquels la croissance de la productivité a été relativement faible voire pour certains cas, nulle. Là les prix ont augmenté plus vite que la moyenne des prix. Aussi pour ce qui est de la croissance de la production par habitant, elle a mis plus de temps à décoller que la croissance démographique, en restant quasi nulle au XVIIIème siècle et s'est vraiment fait voir à partir du XIXème siècle et plus encore au XXème siècle. La croissance de la production mondiale par habitant a dépassé les 2% par an entre 1950 et 1990 grâce au rattrapage de l'Europe en particulier. Et encore entre 1990 et 2012 grâce au rattrapage de l'Asie cette fois ci, de la Chine en particulier, dont la croissance a dépassé les 9% par an en moyenne entre 1990 et 2010/2012. Dans les pays de l'Europe Occidentale, en Amérique du Nord et au Japon, on sera entre les années 2020 et 2010 à une croissance de probablement 1% voire 1,2%. Pour les pays pauvres et émergents, on sera sur une croissance de l'ordre de 4% par an entre 2030 et 2050. Le sommet de la croissance mondiale par habitant sera donc plus tard que la première soit au milieu du XXIème siècle, un siècle plus tard et de décroître vers une croissance un peu supérieure à 1% par an.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a 10 mois
























