Ce sujet a été résolu
De la merde quoi.
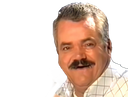
Pas étonnant que les tafioles grecques se soit faites baisées par les cafards turco-mongols.

Même les bédouins d'arabie leur ont chié dessus.

Des 100 de Q.I+ qui se font pissés dessus par des éleveurs de chèvres et de moutons à 82 de Q.I.

Cette idée m'est insupportable. Comment ils ont fait pour disparaitre bordel..

Pas étonnant que les tafioles grecques se soit faites baisées par les cafards turco-mongols.
Même les bédouins d'arabie leur ont chié dessus.
Des 100 de Q.I+ qui se font pissés dessus par des éleveurs de chèvres et de moutons à 82 de Q.I.
Cette idée m'est insupportable. Comment ils ont fait pour disparaitre bordel..
il y a 2 ans

TransForLife
2 ans
De la merde quoi.
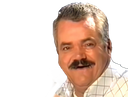
Pas étonnant que les tafioles grecques se soit faites baisées par les cafards turco-mongols.

Même les bédouins d'arabie leur ont chié dessus.

Des 100 de Q.I+ qui se font pissés dessus par des éleveurs de chèvres et de moutons à 82 de Q.I.

Cette idée m'est insupportable. Comment ils ont fait pour disparaitre bordel..

Pas étonnant que les tafioles grecques se soit faites baisées par les cafards turco-mongols.
Même les bédouins d'arabie leur ont chié dessus.
Des 100 de Q.I+ qui se font pissés dessus par des éleveurs de chèvres et de moutons à 82 de Q.I.
Cette idée m'est insupportable. Comment ils ont fait pour disparaitre bordel..
pas de chance
Cette description n'est plus disponible sur onche.org suite à une modération du contenu ou autre action du staff
il y a 2 ans

TransForLife
2 ans
De la merde quoi.
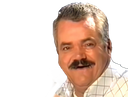
Pas étonnant que les tafioles grecques se soit faites baisées par les cafards turco-mongols.

Même les bédouins d'arabie leur ont chié dessus.

Des 100 de Q.I+ qui se font pissés dessus par des éleveurs de chèvres et de moutons à 82 de Q.I.

Cette idée m'est insupportable. Comment ils ont fait pour disparaitre bordel..

Pas étonnant que les tafioles grecques se soit faites baisées par les cafards turco-mongols.
Même les bédouins d'arabie leur ont chié dessus.
Des 100 de Q.I+ qui se font pissés dessus par des éleveurs de chèvres et de moutons à 82 de Q.I.
Cette idée m'est insupportable. Comment ils ont fait pour disparaitre bordel..
Ils ont juste pris le style musical du territoire le low iq + les grecs étaient très puissants
Nous luttons pour l'Europe et la liberté
 Notre honneur s'appelle fidélité
Notre honneur s'appelle fidélité
il y a 2 ans
J'en ai d'autres dans le genre
L'empire arabe des Umayyades ( 661 - 750 )
Les bases matérielles de la puissance de Mu'awiya se trouvaient en Syrie où sa famille s'était implantée dès la conquête. C'est là,, à Damas, que Mu awiya établit sa capitale : loin de Médine et des milieux piétistes médinois, il tente un compromis entre nécessités imposées par la contruction d'un Etat et aspirations des tribus qui contestaient l'hégémonie des Qurayshites et le développement d'un pouvoir central. La Syrie représentait une base d'autant plus sûre que les musulmans y avaient réalisé assez facilement un équilibre avec les dhimmi et que les arabes établis antérieurement à l'Islam y étaient déjà habitués à une forme centralisée de gouvernement. Le ralliement du fils aîne de Ali, Hasan, empêche pour un temps le regroupement des opposants autour de la descendance de Ali. La réunion par Mu'âwiya, de conseils de shaykh à Damas et en province, favorisa le ralliement des tribus. Cela permit notamment au khalife d'organiser sans heurts sa succession et de remplacer le système électif par un système dynastique : Mu'âwiya désigna en effet lui même son fils Yazîd pour lui succéder et fit ratifier son choix par le conseil des shaykh. Ainsi commençait une lignée de khalifes, descendant par Mu'âwiya de Umayya : les Umayyades. Des gouverneurs, tel Ziyad en Irakn s'efforcèrent avec succès de réaffirmer l'autorité des arabes dans les provinces. Ainsi furent implantées anx environs de Marw 50 000 familles : leur départ d'irak allège la tension y régnant depuis e khalifat de Ali, et la domination des arabes en Iran fut renforcée. Les efforts militaires se maintiennent mais l'expansion réelle resta faible les premières décennies de la dynaste umayyade; au delà de l'Oxus, il s'agissait surtout de manifester la puissance arabe face aux tribus turques.
Quant au Maghreb, les arabes n'y pénétrèrent qu'avec hésitation et la fondation de Kairouan en 670 répondit plus à des nécessités stratégies qu'à un désir de conquêtes. C'est surtout à des nécessités stratégiques qu'à un désir de conquête. C'est surtout sur le plan maritime que l'activité est grande car Mu âwiya tente à 2 reprises, entre 668 et 669, et entre 674 et 680 de prendre Constantinople. Et il menaça Rhodes, Chypre et la Crète. Pas de vraie rupture donc avec la période des khalifes de Médine mais amorce de nouvelles tendances. Le choix de la province syrienne comme centre de pouvoir et non de villes saintes d'Arabie, marquait la volonté d'enraciner le régime arabe terrotorialement et s'associer traditions des grandes empires sédentaires et traditions bédouines. Après la mort de Mu'âwiya et la disparition rapide de ses fils, Yazid Ier et Mu âwiya II, la désignation comme khalife d'un cousin de Mu âwiya, Marwâan, attisa les dissensions entre Qaysites et Kalbites : ces derniers vainqueurs de la bataille de Marj Rahit en 684, permirent à Marwan de prendre le pouvoir. En faveur de ces difficultés, l'hostilité contre les politiques de Umayyades éclate en milieu arabe, gagnant des milieux indigènes et se confonda parfois avec des aspirations régionales. Les révoltes coulèrent dans le cadre shi ite. A Kûfa, les shi ites se révoltent en faisant appel au deuxième fils de Ali, Husayn. En 680 dans la cité irakienne de Kerbela, l'armée umayyade dirigée par Yazid met en pièce les révoltes. Massacre signifiant ici rupture définitive entre shi ites et umayyades. Le tragique du destin de Husayn après celui de Ali insuffle une nouvelle ferveur religieuse au shi isme.
A Kufa encore éclate une révolute shî ite menée par Mukhtar au nom de Muhammad ibn al Hanafiyaa, fils de Alî mais non de Fâtima. Un peu partout en Irak, Djézira, en Arabie centrale et orientale, éclatèrent aussi des mouvements kharidjites. Surtout, au Maghreb, le kharaidjisme se développe, permettant l'expansion de l'Islam parmi les barbères. En plus de devoir maitriser ces mouvements il fallait résoudre les malaises qu'ils exprimaient. A partir de Abd al Malik , la politique umayyade se caractérise par un effort pour mieux organiser l'Empire et en arabiser l'administration. Les décors khalifes apparaissent dans les palais qu'ils firent construire en Syrie à la limite du désert, que ce soient des pavillons des somptueuses résidesnces. Ils expirment la volonté de puissance d'un souverain arabe représenté tantôt à la manière romano byzantine, tantôt selon les modèles sassanides. Au même moment les mosaiques de la grande mosquée de Damas reconstruite sous Walid Ier à l'emplacement de la cathédrale suggèrent par un panorama de villes soigneusement élaboré, le domaine de l'Islam et ses prétentions sur Constantinople. La reprise d'expansion apparaut comme un dérivatif à l'ardeur des tribus arabes et un moyen pour l'Etat de trouver de nouveaux revenus. La deuxième phase d'expansion diffère de la première car elle vise différentes régions. L'agrandissement du domaine islamique ne se fait plus au détriment des Byzantins quoique la paix ne régnait pas avec Constantinople. Les chaînes tauriques gênaient, du coup les arabes avaient renoncé à toute tentative d'implantation permanente en Asie Mineure. Juste quelques provocations notamment celui que provoquait le petite peuple des Mardaites dans l'Amanus. La prise de Constantinople restait un but. Entre 680 et 716, des opérations maritimes préparèrent le grand siège de 716 - 717. Les principaux mouvements d'expansion se firent à partir de l'Egpte et du Khurasan.
La Transoxiane est conquise entre 705 et 714 par les armées du gouverneur Qutayba. Depuis l'Egypte les arabes se réinstallent en Ifriqiya en 698 et de là le nouveau gouverneur Mûsâ ibn Nusayr mène une compagne jusqu'à l'Atlantique à travers le monde berbère; un de ses lieutenants Tarîk passe en Espagne en 711, bat le roi wisigoth et parvient à Tolède : ce fut le début de la conquête de ce qui allait devenir sous le nom d'al Andalus, une nouvelle province de l'Empire. Les armées de Qutayba comme celles de Tarik comprenaient de forts contingents de volontaires arabes, mais elles incorporent également, fait nouveau, des éléments indigènes iraniens ou berbères, convertis à l'islam; Tarik lui même était berbère. Les arabes en effet se montraient de plus en plus réticents à partir pour des campagnes lointaines, l'élan guerrier se ralentissait avec leur sédentarisation progressive et la découverte de sources de revenus pour eux même quand bien même le goût du djihâd se maintenant aux frontières. Le volontariat diminuait dans le reste de l'Empire et les gouverneurs firent de plus en plus appel à des indigènes convertis. Sans politique délibérée des arabes, les convertions se multiplient. Cela créé des groupes de néo musulmans dans la société : affiliés par un lien de clientèle à une tribu ou un notable arabe, ils en devenaient les clients, les mawali, dont le statut a soulevé des conflits avec les Umayyades n'ont pas pu régler.Un ample mouvement de convertion aurait pu faire perdre à l'Etat le bénéfice du djizyâ accru de la différence en tre taux de kharâdj et taux de zakât. Mais attendre les mawâli à payer les impôts qu'il acquittaient auparavant comme dhimmî conduisait à les définir négativement comme des musulmans non arabes, ce qui correspondairtr à une injustice fiscale, à une inégalité au sein de l'islam et à un clivage ethnique.
Aussi les mawâli très minoritaires et affiliés à des familles arabes, restaient dans la dépendant de l'aristocratie conquérante et régnante. Les conquis deviennent musulmans, les Arabes se sédentarisent mais le statut des arabes restent supérieur comme le sort de mawâli le montre. L'arabe devient progressivement à partir de Abd al Malik, la langue administrative. Les monnaies byzantines et sassanides sont remplacées par des monnaies arabo musulmanes. Le dinar d'or et le dirham d'argent sont gravés d'inscriptions en langue arabe sans représentation figurée. Les fabrications d'Etat comme papyrus, tissus de luxe, portent aussi des inscriptions en arabe. Les gouverneurs des diverses procinces furent choisis par les khalifes parmi les arabes même si dans les divers bureaux, les indigènes surtout des Syriens continuent de tenir une grande place en raison de leur expériences administratives.
Cependant, pas d'accord unanime des arabes sur le régime Umayyades même en dehors de l'opposition shi ites et kharidjites. Une propagande hiostile présente les khalifes comme de purs souverains temporels, accusés d'impiété. En fait ils étaient juste plus préoccupés par l'extension de l'Empire et la consolidation de leur povuoir que prêts à assurer les conséquences de l'islamisation. Les difficultés des qasi montrent la difficulté à mettre en place des institutions musulmanes en l'absence de tout droit constitué pour les musulmans. L'opinion générale était que la Sunna du prophète constituait la norme de la vie. On condamnait comme innovation tout ce qui n'avais pas d'exemple correspondant à l'époque de Mahomet. L'hostilité des piétistes aux Umayyades n'excluait pas le ralliement politique de certains. Le mouvement des murdjistes apparu fin VIIème siècle refusait de juger les Umayyades soit comme usurpateurs soit comme auteurs de mesures non conformes aux prescriptions coraniques, soit pour avoir fait du khalifat un bien de famille. Car c'étaient les accusations lancées contre les Umayyades. L'échec de Mukhtar et la mort de Muhammed ibn al Hanafiyya en 701 marquèrent provisoirement l'arrête de l'agitation des Alides, privés successivement d'Hasan, mort en 669, d'Husayn, puis de Muhammad. Résultat d'un côté l'idée qu'à une période do'cculation des imams légitimes succéderait le triomphe annoncé par le retour du Mahdi s'impose petit à petit. S'affirmait dans le shi isme le thème de l'attente du Mahdi dont le règne signifierait le triomphe de la paix, justice et vérité.
L'empire arabe des Umayyades ( 661 - 750 )
Les bases matérielles de la puissance de Mu'awiya se trouvaient en Syrie où sa famille s'était implantée dès la conquête. C'est là,, à Damas, que Mu awiya établit sa capitale : loin de Médine et des milieux piétistes médinois, il tente un compromis entre nécessités imposées par la contruction d'un Etat et aspirations des tribus qui contestaient l'hégémonie des Qurayshites et le développement d'un pouvoir central. La Syrie représentait une base d'autant plus sûre que les musulmans y avaient réalisé assez facilement un équilibre avec les dhimmi et que les arabes établis antérieurement à l'Islam y étaient déjà habitués à une forme centralisée de gouvernement. Le ralliement du fils aîne de Ali, Hasan, empêche pour un temps le regroupement des opposants autour de la descendance de Ali. La réunion par Mu'âwiya, de conseils de shaykh à Damas et en province, favorisa le ralliement des tribus. Cela permit notamment au khalife d'organiser sans heurts sa succession et de remplacer le système électif par un système dynastique : Mu'âwiya désigna en effet lui même son fils Yazîd pour lui succéder et fit ratifier son choix par le conseil des shaykh. Ainsi commençait une lignée de khalifes, descendant par Mu'âwiya de Umayya : les Umayyades. Des gouverneurs, tel Ziyad en Irakn s'efforcèrent avec succès de réaffirmer l'autorité des arabes dans les provinces. Ainsi furent implantées anx environs de Marw 50 000 familles : leur départ d'irak allège la tension y régnant depuis e khalifat de Ali, et la domination des arabes en Iran fut renforcée. Les efforts militaires se maintiennent mais l'expansion réelle resta faible les premières décennies de la dynaste umayyade; au delà de l'Oxus, il s'agissait surtout de manifester la puissance arabe face aux tribus turques.
Quant au Maghreb, les arabes n'y pénétrèrent qu'avec hésitation et la fondation de Kairouan en 670 répondit plus à des nécessités stratégies qu'à un désir de conquêtes. C'est surtout à des nécessités stratégiques qu'à un désir de conquête. C'est surtout sur le plan maritime que l'activité est grande car Mu âwiya tente à 2 reprises, entre 668 et 669, et entre 674 et 680 de prendre Constantinople. Et il menaça Rhodes, Chypre et la Crète. Pas de vraie rupture donc avec la période des khalifes de Médine mais amorce de nouvelles tendances. Le choix de la province syrienne comme centre de pouvoir et non de villes saintes d'Arabie, marquait la volonté d'enraciner le régime arabe terrotorialement et s'associer traditions des grandes empires sédentaires et traditions bédouines. Après la mort de Mu'âwiya et la disparition rapide de ses fils, Yazid Ier et Mu âwiya II, la désignation comme khalife d'un cousin de Mu âwiya, Marwâan, attisa les dissensions entre Qaysites et Kalbites : ces derniers vainqueurs de la bataille de Marj Rahit en 684, permirent à Marwan de prendre le pouvoir. En faveur de ces difficultés, l'hostilité contre les politiques de Umayyades éclate en milieu arabe, gagnant des milieux indigènes et se confonda parfois avec des aspirations régionales. Les révoltes coulèrent dans le cadre shi ite. A Kûfa, les shi ites se révoltent en faisant appel au deuxième fils de Ali, Husayn. En 680 dans la cité irakienne de Kerbela, l'armée umayyade dirigée par Yazid met en pièce les révoltes. Massacre signifiant ici rupture définitive entre shi ites et umayyades. Le tragique du destin de Husayn après celui de Ali insuffle une nouvelle ferveur religieuse au shi isme.
A Kufa encore éclate une révolute shî ite menée par Mukhtar au nom de Muhammad ibn al Hanafiyaa, fils de Alî mais non de Fâtima. Un peu partout en Irak, Djézira, en Arabie centrale et orientale, éclatèrent aussi des mouvements kharidjites. Surtout, au Maghreb, le kharaidjisme se développe, permettant l'expansion de l'Islam parmi les barbères. En plus de devoir maitriser ces mouvements il fallait résoudre les malaises qu'ils exprimaient. A partir de Abd al Malik , la politique umayyade se caractérise par un effort pour mieux organiser l'Empire et en arabiser l'administration. Les décors khalifes apparaissent dans les palais qu'ils firent construire en Syrie à la limite du désert, que ce soient des pavillons des somptueuses résidesnces. Ils expirment la volonté de puissance d'un souverain arabe représenté tantôt à la manière romano byzantine, tantôt selon les modèles sassanides. Au même moment les mosaiques de la grande mosquée de Damas reconstruite sous Walid Ier à l'emplacement de la cathédrale suggèrent par un panorama de villes soigneusement élaboré, le domaine de l'Islam et ses prétentions sur Constantinople. La reprise d'expansion apparaut comme un dérivatif à l'ardeur des tribus arabes et un moyen pour l'Etat de trouver de nouveaux revenus. La deuxième phase d'expansion diffère de la première car elle vise différentes régions. L'agrandissement du domaine islamique ne se fait plus au détriment des Byzantins quoique la paix ne régnait pas avec Constantinople. Les chaînes tauriques gênaient, du coup les arabes avaient renoncé à toute tentative d'implantation permanente en Asie Mineure. Juste quelques provocations notamment celui que provoquait le petite peuple des Mardaites dans l'Amanus. La prise de Constantinople restait un but. Entre 680 et 716, des opérations maritimes préparèrent le grand siège de 716 - 717. Les principaux mouvements d'expansion se firent à partir de l'Egpte et du Khurasan.
La Transoxiane est conquise entre 705 et 714 par les armées du gouverneur Qutayba. Depuis l'Egypte les arabes se réinstallent en Ifriqiya en 698 et de là le nouveau gouverneur Mûsâ ibn Nusayr mène une compagne jusqu'à l'Atlantique à travers le monde berbère; un de ses lieutenants Tarîk passe en Espagne en 711, bat le roi wisigoth et parvient à Tolède : ce fut le début de la conquête de ce qui allait devenir sous le nom d'al Andalus, une nouvelle province de l'Empire. Les armées de Qutayba comme celles de Tarik comprenaient de forts contingents de volontaires arabes, mais elles incorporent également, fait nouveau, des éléments indigènes iraniens ou berbères, convertis à l'islam; Tarik lui même était berbère. Les arabes en effet se montraient de plus en plus réticents à partir pour des campagnes lointaines, l'élan guerrier se ralentissait avec leur sédentarisation progressive et la découverte de sources de revenus pour eux même quand bien même le goût du djihâd se maintenant aux frontières. Le volontariat diminuait dans le reste de l'Empire et les gouverneurs firent de plus en plus appel à des indigènes convertis. Sans politique délibérée des arabes, les convertions se multiplient. Cela créé des groupes de néo musulmans dans la société : affiliés par un lien de clientèle à une tribu ou un notable arabe, ils en devenaient les clients, les mawali, dont le statut a soulevé des conflits avec les Umayyades n'ont pas pu régler.Un ample mouvement de convertion aurait pu faire perdre à l'Etat le bénéfice du djizyâ accru de la différence en tre taux de kharâdj et taux de zakât. Mais attendre les mawâli à payer les impôts qu'il acquittaient auparavant comme dhimmî conduisait à les définir négativement comme des musulmans non arabes, ce qui correspondairtr à une injustice fiscale, à une inégalité au sein de l'islam et à un clivage ethnique.
Aussi les mawâli très minoritaires et affiliés à des familles arabes, restaient dans la dépendant de l'aristocratie conquérante et régnante. Les conquis deviennent musulmans, les Arabes se sédentarisent mais le statut des arabes restent supérieur comme le sort de mawâli le montre. L'arabe devient progressivement à partir de Abd al Malik, la langue administrative. Les monnaies byzantines et sassanides sont remplacées par des monnaies arabo musulmanes. Le dinar d'or et le dirham d'argent sont gravés d'inscriptions en langue arabe sans représentation figurée. Les fabrications d'Etat comme papyrus, tissus de luxe, portent aussi des inscriptions en arabe. Les gouverneurs des diverses procinces furent choisis par les khalifes parmi les arabes même si dans les divers bureaux, les indigènes surtout des Syriens continuent de tenir une grande place en raison de leur expériences administratives.
Cependant, pas d'accord unanime des arabes sur le régime Umayyades même en dehors de l'opposition shi ites et kharidjites. Une propagande hiostile présente les khalifes comme de purs souverains temporels, accusés d'impiété. En fait ils étaient juste plus préoccupés par l'extension de l'Empire et la consolidation de leur povuoir que prêts à assurer les conséquences de l'islamisation. Les difficultés des qasi montrent la difficulté à mettre en place des institutions musulmanes en l'absence de tout droit constitué pour les musulmans. L'opinion générale était que la Sunna du prophète constituait la norme de la vie. On condamnait comme innovation tout ce qui n'avais pas d'exemple correspondant à l'époque de Mahomet. L'hostilité des piétistes aux Umayyades n'excluait pas le ralliement politique de certains. Le mouvement des murdjistes apparu fin VIIème siècle refusait de juger les Umayyades soit comme usurpateurs soit comme auteurs de mesures non conformes aux prescriptions coraniques, soit pour avoir fait du khalifat un bien de famille. Car c'étaient les accusations lancées contre les Umayyades. L'échec de Mukhtar et la mort de Muhammed ibn al Hanafiyya en 701 marquèrent provisoirement l'arrête de l'agitation des Alides, privés successivement d'Hasan, mort en 669, d'Husayn, puis de Muhammad. Résultat d'un côté l'idée qu'à une période do'cculation des imams légitimes succéderait le triomphe annoncé par le retour du Mahdi s'impose petit à petit. S'affirmait dans le shi isme le thème de l'attente du Mahdi dont le règne signifierait le triomphe de la paix, justice et vérité.
il y a un an
De l'autre les mécontentements s'appuisent sur les revendications d'un khalife appartenant à la famiille, celle du prophète. Dans une société où les liens familiaux s'entendaient à l'intérieur d'un ensemble large, où l'oncle maternel jouait un rôle de premier plan , la Famille ne comprenait pas seulement les descendantrs d'Ali, issus de Fatime par Hasanet Husayn mais d'une autre femme, ce qui est le cas des descendants de Muhammad ibn al Hanafiyya dont Abu Hashim, le dernier représentant devait mourir en 716, mais la Famille comprenait aussi la branche issue du frère de Ali, Dja'far : Alides et Dja farides se rattachaient à l'onche de Mahomet, Abu Talib. La descendant du deuxième oncle de Mahomet, Al Abbas, appartenait aussi à la Famille. En faveur d'un Abbâsside, Muhammad, Abû Hashim en 716 aurait fait un testament pour lui transmetre ses droits et prérogatives, rattachant indirectement les Abbâssides à la lignée alide. Ainsi par le simple jeu des générations, la Famille était devenue de plus en plus nombreuse, ce qui rendait possible l'apparition à des titres divers de chefs qui ne faiasient pas toujours l'unanimité. Mais globalement au début du VIIème siècle au sein de l'ensemble qurayshite, la famille hashimite s'opposait à la famille umayyade. Pour elle, attachement à l'Islam et à la Famille ne faisait qu'un, seul un membre de la Famille pouvait guider la communauté dans la voie de l'Islam. Chez les Aides commençait une réflexion doctrinale les conduisant à penser que la mission prophétique de Mahomet se prolongeait dans l'imâmat. L'Imâm, impeccable et infaillible, est dépositaire de la loi et seul capable de l'interpréter car lui a été transmis le don de la connaissance parfaite.
L'élargissement de l'opposition, les problèmes dus au développement des mawali, expliquement sans doute le changement de politique sous les khalifats de Salayman et surtout d'Umar II. Mais les mouvements d'opposition avaient déjà trop d'ampleur. L'échec de l'expédition contre Constantinople en 716 - 717 marque la fin des tentatives contre l'EMpire byzantin. Sur les autres fronts aussi l'expansion s'arrête : équilibre des forces ou volonté du khalife. Mais surtout Umar II se signale par une conception plus musulmane du Khalifat. Il encourage les conversions, ses envoyés en province essayent d'apprendre aux populations locales comment se comproter en musulman. Des mesures restrictives furent prises à l'égard des dhimmi, une réforme fiscale amorcée favorable aux mawali. Même si le règne d'Hisham entre 724 et 743 marque une période de stabilisation,, il fallait résoudre bien des problèmes. Au niveau militaire il pratique un âpre politique fiscale franchant de façon définitive le problème fiscal posé par la mawali : comme les autres musulmans, ils furent exemptés de la djizya et astreints au sesul paiement de la zakât, mais pour éviter tout amenuisement ultérieur des revenus de l'Etat il fut décidé que l'impôt foncier serait désormais attaqué à la terre et non plus à son possesseur dont le statut pouvait changer sans entraîner de conséquences fiscales : le possessur devenu musulman, d'une terre des Kharadj continuait à payer le khadaj et un recensement des terres fut entreprise. Pourtant le mécontentement grandissait. De nouvelles résistances imposait des replis et marqua un freinage des conquêtes : infrigues chinoises en Transxiane, action des Khazars, nouveaux alliés des Byzantins dans le Caucase, résistance de noyaux chrétiens au nord de l'Espagne. Les Umayyades éprouvaient de plus en plus de difficulés pour contrôler l'Empire et ne pouvaient même plus compter sur les Syriens.
Des révoltes kharidjites éclatent au Maghred manifestant la volonté des Barbères de rejeter la suprématie des arabes, mais non de l'Islam. Marwan II se heurta à l'opposition croissante de la famille hashimite qui prit des formes nouvelles et emporta le régime. Les actions de la famille Hashimite se renforcent après la mort d'Hisham à la fin de la décennie 730. Des mouvements sont organisés en faveur des Alides, souvent à Kûfa mais ce furent des échecs. Zayd, fils d'Husayn, échoue en 740. Zayd laisse tout de même son nom au mouvement du zaydisme. Pourtant la branche abbasside prenait de l'ampleur au sein de la famille hashimite. Fondanrt sa mission sur le testament d'Abu Hashim, elle sut s'organiser contrairement aux Alides. Kûfa reste au centre du mouvement mais on lui préfère le Khurasan comme base essentielle d'action car Kûfa était trop proche de Damas. Les Abbassides gardèrent silence sur l'imam qui devait diriger la communauté. Cela habituait les fidèles à penser non à une personne précise mais collectivement avec la Famille avec un grand F. Abu Muslim, mawla iranien, constitua une armée ouverte aux non arabes, avec 2 mots d'ordre : lutte contre l'oppression umayyade et combat pour un imam de la Famille. En 746, il prêche la révole au Khurâsan où l'avait envoyé le prétendant abbasside dont l'identité restait cachée à la majorité. Il déborde les chefs umayyades et son armée pénétre à Kûfa en 749, puis proclama khalife Abu'l Abbas, l'arrière arrière petit fils d'al Abbas, oncle de mahomet. En 750 Marwan II fut battu à la bataille du Grand Zâb ' aflluent du Tigre ). Peu après sa mort fut suivit du massacre général de la famille Umayyade. Il n'y eut qu'un seul survivant. Au milieu du VIIIème siècle, la domaine de l'Islam atteignait des limites naturelles comme le Tian Cha, Taurus, Caucase, désert saharien, Pyrénées. Dans certaines provinces, arabisation et islamisation ne se recouvraient pas avec des langues indigènes loin d'avoir disparues.
Les Bédouins d'Araie utilisaient divers dialectes notamment le dialecte du Hidjaz depuis le début du VIème siècle en particulier. En parallèle se diffusait une langue commune poétique, véhicule d'une littérature essentiellement orale : la Coran avait été récité dans cette langue. La mise par écrit de la Révélation fixe cette langue dont les grammairiens et philologues commencèrent à expliciter les règles au VIIIème siècle fondant ainsi un arabe litéraire classique qui devint la langue de l'administration. Cette langue écrit n'était pas la langue parlée usuelle : les divers dialectes des tribus se mêlèrent d'emprunts, se transformèrent, constituant peu à peu une sorte d'arabe moyen, parlé ou arabe courtant différent de la langue écrite. Cela devait favorisé les échanges entre les provinces linguistiques initialement très variées et où se maintenaient également les langues indigènes, notamment le persan et le berbère. La mosquée était le signe matériel extérieru de la présente de l'Islam. Elle garde d'abord des éléments essentiels de la maison de Mahomet à Médine, maison à cour intérieure et portique latéral. A l'époque umayyade ce schéma se complique car la cour est associée à un oratoire dont le mur de fond, le mur qibla, donnnait la direction de la Mecque et elle s'enrichit d'éléments novueaux comme le mihrab, minbar, minaret, maqsura. Ce n'était pas une construction isolée mais elle s'insérait dans un ensemble de constructions auquel participait le palais du khalife ou de l'amîr. Mosquée irakiennes et syrienne combient différemment les éléments architecturaux. Les plus belles réalisations étaient dans le province syrienne avec notamment la Grande Mosquée de Dams et la Coupole du Rocher. Une nouvelle architecture sacrait se constituait, exprimant la puissance des Arabes et de leur nouvelle relition.
L'implantation des premières mosquées en dehors de l'espace politique arabe traduit bien le développement de l'importance de l'Islam : une mosquée fut élevée à Constantinople au VIIème siècle; L'arabe devint instrument de culture et d'unité. Mais au sein de l'empire, arabisation et islamisation ne recouvraient pas complètement les traditions et cultures antérieures. L'Arabie avait été le point de départ de lexpansion. La Ka'ba à la Mecque, tombeau de Mahomet à Médine attiraient les pélerines, mais le grand rôle commercial de la péninsule avait disparu, ainsi que son rôle politique. Irak et Syrie furent les provinces les plus profondément arabisées et islamisées. Dans ces provinces sémitiques, l'arabisation avait commencé avant la conquête avec la pénétration des tribus bédouines; elle continua ensuite plus homogène en Surie et diverse en Irak : là les villes neuves de Kûfa et Basra acquirent peu à peu une importance sociale, politique puis culturelle considérable et la langue arabe s'imposa largement. Les traditions préislamiques constituèrent autant de résistance à l'assimilation notamment en iran qui était passé sous la domination des Arabes mais la petite noblesses des dekhans gardait son importance sociale et économique; tandis que l'islam se substituait progressivement au zoroastrisme tout en subissant l'influnce des traditions mystiques et dualistes, la langue et culture iraniennes résistèrent et commencèrent même à influencer les conquérants; elles devaient favoriser aux IVème et Xème siècles une brillante renaissance culturelle et politiquze qui constitua après la période de suprématie arabe et avant l'arrivée des Turcs, " l'intermède iranien ". En Egypte des arabes se sédentarisant s'implantent. L'arabe s'impose même dans la population chrétienne, peu à peu, pour qui le copte devint essentiellement la langue du culte.
il y a un an
Mais l'arabisation ethnique et culturelle ne fit pas disparâitre la force d'un particularisme, évident à l'époque byzantine, et qui devait sous les Abbassides se manifester nettement. Le cas des Berbères au Maghred est spécifique car les Arabes avaient hésité à s'éventurer dans cette région qu'ils placèrent à partir de 680 sous leur domination au moins nominale,;e n fait ils tenaient bien la plaine centrale de l'Ifriqiya, très mal les massifs montagneux, les confins sahariens, la plaine atlantique. Les Berbères acceptèrent mal la domination d'étrangers l quand ils se convertirent à l'Islam, ce qut avec une ette attirance pour les thèses kharidjites égalitaires. Les divisions internes aux tribus permirent aux arabes de garde l'Ifriqiya mais ailleurs, le pays leur échappait et de puissants royaumes kharidjites se développèrent. Le mieux connu d'entre eux et l'inâmat de Tâhert fondé en 761 qui devait jouer un rôle décisif par ses relations avec l'Afrique au sud du Sahara. Mais dans ce pays au relief morcélé, où la confédérations des Berbères Zanâtas s'opposait à celle des Sanhâdjas, le khâridjisme lui même se morcela en dverses tendances. Les révoltes berbères ds années 740 qui gagnèrent l'Espagne freinèrent puis arrêtèrent la progression des arabes au delà des Pyrénées. En deça, la résistance des Basques et de chrétiens d'Asturie limitait la domination musulmane sur une Espagne encore très divisée.
La vie intellectuelle et artistique du Proche Orient. La culture byzantine sort de la culture gréco latine telle qu'elle existait dans l'Empire romain du début du IIIème siècle. Dès le passage de l'Empire au christianisme celui ci assume l'héritage paien. Les Pères grecs du IVème siècle sont pétris de rhétorique grecque et constituent la base de la culture ultérieure. L'élite culturelle byzantine est à la fois chrétienne et immergée de culture grecque classique. L'enseignement s'ouvre par la propaideia. On y apprend à lire et écrire souvent dans des textes sacrés ( pseutiers, hymnes ); les enfants commencent entre 6 et 10 ans et reçoivent un embryon d'enseignement religieux. Vers 11 ans jusqu'à 17 / 18 ans, c'est la paideia, enseignement secondaire à base de connaissances profanes. L'organisation et les cadres de cet enseignement profane ont subsisté tels qu'ils étaient dans l'Antiquité : les programmes sont inchangés; l'Eglise leur reste étrangère : elle n'a pas d'écoles. Le seul enseignement vraiment religieux est destiné à apprendre aux futurs scribes et aux futurs chantres d'église à bien s'acquitter de leur mission. Quant au programme il est classique : trivium ( grammaire, géométrie, musique, astronomie ).
Le trivium est d'ailleurs essentiel : on cherche la perfection formelle du langage en apprenant par coeur des auteurs anciens et en essayant de s'exprimer comme eux, d'où un archaisme souvent obscur, un conformisme sans relief mais aussi une imprégnation profonde de la culture hellénique. On apprend la rhétorique dans le degré de complexité où l'avaient conduite les auteurs hellénistiques du IIème siècle. Maîtres et élèves rivalisent d'éloquence dans des concours de rhétorique au point de créer un genre particulier caractéristique de cette déviation formaliste : les schédè, constitués en une science, la schédographie. Il s'agit de faire entrer dans un discours d'une longueur donnée le maximum de figures de styles. Les écoles secondaires sont indépendantes et privées, avec un maître, le maistôr parfois aidé d'un second, le proximos. Au milieu du Xème siècle, le futur Athasane l'Athonite, qui fut un élève d'exception, exerce sa fonction avant d'être nommé à la tête d'une école propre. Le maistôr dispense son enseignement aux élèves les plus avancés, les ekkritoi; ceux ci à leur tour enseignent aux plus jeunes, que le maître contrôle 1 ou 2 fois par semaine. L'enseignement est libre et concurrentiel; les élèves paient le maître souvent avec retard et les écoles se font concurrence; ainsi Athanase renonce au monde et se fait moine devant la jalousie que provoque son succès :
il attire la clientèle des autres bien qu'il ait été muté dans un quarter éloigné de la capitale. Au Xème siècle l'Empereur exerce un certain contrôle à travers un président des écoles. Au XIème siècle l'Eglise intervient plus largement et le patriarche joue un rôle dans la nomination des maistores et peut être dans leur salaire. La fermeture par Justinien de l'université d'Athènes, la conquête par les Arabes d'Alexandrie et de Beyrouth, entraînent la concentration de l'enseignement supérieure sur Constantinople. Mais l'université de Constantinople a disparu au VIIème siècle atteste du niveau élevé maintenu dans les études juridiques. Le César Bardas ouvre à nouveau à la Magnaure en 863 un enseignement supérieur public, avec 4 chaires : grammaire, géométrie, astronomie et celle de philosophie qui est confiée à Léon le Mathématicien, directeur. Léon VI développe l'enseignement du droit sur le moèdle de celui de Justinien; des professeurs spécialisés enseignent le droit codifié une nouvelle fois sous Basile Ier et Léon VI, les Basiliques. Cet école continue sous Constantin Porphyrogénète, qui contrôle la nomination des professeurs et se réjouit d'y recruter les fonctionnaires. Mais à la fin du Xème siècle cette université avait disparu et les grands esprits du XIème siècle, Psellos, Xiphillin, Likoudès, NIcétas le Grammairien, ont tous reçu l'enseignement de haut niveau dispensé dans une école privée fondée vers 1028 par Jean Mavropous qui y enseignait Platon. C'est Mavropous qui est à l'origine de la renaissance universitaire : des personnes intéressées par la cultre, un empereur, Constantin Monomaque, financièrement compréhensif et qui cherche à recruter dans une université juridique de bons fonctionnaires, permettent de créer une université de Droit. L'école est dotée d'une bibiothèque, de bâtiments et de professeurs salariés; les études y sont gratuites et permettent d'obtenir un diplôme.
Le plus grand esprit de l'époque, Psellos qui reçut le titre pompeux de " consul des philosophes ", a longtemps réussi à faire croire que l'université comprenait aussi un enseignement littéraire dont il aurait été le grand maître. En fait c'est l'élévation du niveau des études à l'école de Saint Pierre, que dirigeaient Psellos et Nicétas le Grammairien, dont le corps professoral restait constitué de maistores semblables aux autres : on est loin de l'université de la Magnaure. La diffusion de la culture est surtout lié aux possibilités de copie d'ouvrages. Cette époque est marquée par 2 évolutions décisives. Le IXème si_ècle voit le passage de l'écriture onciale à ma minuscule déjà bien élaborée alors et dont l'invention remonte sûrement au VIIIème siècle. Le papier, d'origine arabe, remplace le parchemin au milieu du XIème siècle. Quant aux scriptoria, ils nous sont mal connus; le plus célèbre était celui du monastère du Stoudios à Constantinople, dont 8 articles du règlement sont consacrés au scriptorium. La diffusion des livres, religieux mais aussi laics, était assez considérable; certains testaments, même de personnes modestes habitant dans une province reculée, mentionnent un nombre d'ouvrages élevé, le plus souvent religieux. On peut parler d'individualités plus que de courants ou d'écoles.
Il y a 3 patriarches se distinguant dont 2 anciens fonctionnaires, Taraise et surtout Nicéphore qui utilisa la philosophie d'Aristote pour justifier les images et qui écrivit outre de nombreux écrits polémiques, une " histoire succinte ". Jean Grammatikos, iconoclaste, était professeur avant; féru de science grecque, il tenta des expériences et fut accusé de magie. L'esprit le plus élevé de l'époque fut sans doute Léon le Mathématicien qui faute de maître à son niveau, a dû parfaire son éducation dans les bibiothèques des monastères. Sa renommée avait franchi les frontières et le khalife tenta de l'attirer à la cour; il dirigea finalement l'université de la Magnaure. Il fut premier Byzantin platonicien; il avait fait recopier la moitié de l'oeuvre de Platon et connaissait bien Porphyre. C'était surtout un scientifique mais la conscience culturelle avait év olué et il ne fut pas accusé de magie. De 840 à 843 il fut archevêque de Thassalonique; déposé lors de la restauration des images, il put sans doute alors reprendre un enseignement privé avant d'être nommé à la tête de l'université en 863. De cette époque aussi date la plus célèbre chronique byzantine, la Chronographie de Théophane, écrite au début du IXème siècle. Il s'agit d'un genre bien byzantin qui consiste à écrire l'histoire par année en commençant à la création du monde; Théophane reprend une chronographie arrêtée en 284; avec Nicéphore il est la seule source, pour une période qui va de 602 au IXème siècle; il utilise des sources inconnues de nous. L'auteur est un moine iconodoule de capacités limitées; aussi il nous livre des documents presque à l'état brut. De plus sa chronologie est exacte et le récit souvent fort détaillé. La fin du IXème siècle est marquée par Phôtios.De bonne famille il fait une grande carrière administrative, devient prôtoasékrétis et possède un petit cercle de disciples à qui il faisait des discours transcrits dans les Amphilochia. En 858 il devient patriarche et c'est là que son oeuvre est la plus remarquable car ses ouvrages théologiques sont nombreux, d'un rare talent et d'une culture sans défaut. Mais l'aspect le plus important de son oeuvre tieint dans ses ouvrages d'érudition. D'baord un Lexique de 8 000 rubriques. Mais surtout sa Bibiothèque, c'est à dire l'inventaire et l'analyse des livres qu'il a le plus appréciés, soit 279 ouvrages. 158 ouvrages sont religieux et 121 profanes;
il y a un an
certains ne nous sont connus à des fins chrétiennes, pour les commentaires qu'il fait sur les ouvrages religieux, il se montre d'une orthofoxie intransigeante, il marque le point de départ du classicisme byzantin. Cette tendance à avoir tout lu et à vouloir tout résumer et classer connaît son apogée au Xème siècle sous la direction de l'Empereur lui même, Constantin VII Porphyrogénète ( 913 - 959 ). Il est précédé par l'archevêque de Césarée, Aréthas, auteur médiocre mais éditeur infatigable à qui remonte la moitié de la tradition manuscrite de Platon et qui fit aussi copier Aristote. Il annote les textes de scholies où apparaît sa culture. Avec Constantin Porphyrogénète on aborde la composition des encyclopédies. L'empereur rédigea lui même celles ayant un sujet politique : outre la vie de Basile Ier il y a de lui 3 ouvrages importants; " Le " Livre des cérémonies ", décrivant le cérémonial de la Cour, la liturgie impériale; le " Livre des thèmes ", décrit les thèmes existant alors avec leur histoire; le " Livre de l'administration de l'Empire " est un ouvrage adressé à son fils pour lui apprendre les relations avec l'étranger.
Pour faire ces ouvrages l'empereur a utilisé les archives du palais surtout des rapports de fonctionnaires; le " Livre des cérémonies " est cependant écrit dans une langue plus courante. L'encyclopédie touche tous les domaines. On trouve aussi une encyclopédie rurale, les Géoponiques; une encyclopédie militaire, regroupant les tacticiens de l'Antiquité et de l'époque byzantine et à part, les traités tactiques de ce soldat en chambre qu'était Léon VI. Le plus beau fleuron de cet encyclopédisme était aux yeux des Byzantins, l'encyclopédie lexicographique, la Souda; elle utilise moins les auteurs eux mêmes que les compilations précédentes. Elle comporte plusieurs milliers articles, allant du simple synonyme à une pleine page d'explications; elle contient aussi bien l'explication des mots rares que des renseignements grammaticaux et des notices sur des personnes, lieux, institutions ou notons. Historique et littéraire, la Souda est aussi un recueil de proverbes, un dictionnaires de citations; elle est le dictionnaire de citations à l'usage des gens cultivés. Du XIème siècle date le renouveau dans l'effort de réflexion à tous les niveaux et dans la création philosophique et littéraire; ce renouveau produira tous ses fruits également au XIIème siècle, mais nombre d'oeuvre remarquables apparaissent dès le XIème siècle, dont l'homme le plus en vue fut incontestablement Michel Psellos. Il donna une impulsion décisive à la philosophie, rendant leur place aux értudes platoniciennes, tout en évitant les pièges de l'hétérodoxie, contrairement à son successeur Jean Italos. Il fut aussi le principal historien par sa " Chronographie " mais pas le seul: un autre fonctionnaire, Michel Attaliate, s'llustra dans ce genre. Psellos brilla d'un vif éclat dans l'art du discours comme son maître Jean Mavropous, passant sans transition et avec un égal bonheur de l'acte d'accusation à l'éloge funèbre du même personnage.
Il se livre aussi à la posédie de cours aux côtés de Jean Mavropous, Théophylacte d'Ochrida et surtout Christophe de Mytilène.
.
L'évolution artistique. L'architecture religieuse est la plus étudiée car mieux conservée et aussi la plus évolutive; elle influence la construction des palais laics nous étant parvenus. L'évolution décisive est le passage de la basilique à coupole dont l'exemple le plus parfait est Sainte Sophie, au plan cruciforme. La basilique à coupole est en effet un type mélange et illogique : la coupole exerce ses poussées de tous côtés et peut être plus aisément soutenue par un carré que par un rectagle, car le passage du rond au rectangle entraîne un nombre élevé de relais pour transmettre la poussée. D'où l'apparition du plan en croix grecque, c'est à dire une croix à branches égales et orthogonales, dont voûtes et arcs reçoivent parfaitement à la poussée de la coupole centrale. Le meilleur example en est la Néa construite par Basile Ier. Ce passage à la croix grecque s'accompagne de 2 évolutions importantes. D'abord dans la distribution de l'espace intérieure. Le diakonidon, chappelle où se tenait le clergé avant le début de l'office et le prothésis où le clergé venait chercher le Sacrement, se rapprochent de l'abside centrale et communiquent avec elle; l'autel qui avait été projeté assez loin dans la nef à l'époque protobyzantine, se retire dans l'abside. Le tout est bientôt prcédé d'un voile puis d'une cloisin mobile, l'inocostase, séparant le clergé célébrant des fidèles : la masse est célérée derrière la cloison en dehors des regards de la masse des fidèles. Elle devient affaire de spécialistes se distinguant de plus en plus du peuple chrétien. Les églises marquent ainsi la distance se creusant entre clergé et laics. La seconde évolution est la diminution considérable de la taille des églises, rendant plus aisées les solutions architecturales.
La plupart des cathédrales ont été construites aux IV ème - VIème siècles, et fonctionnent toujours toujours; les nouvelles églises construites après le VIIIème siècle sont des fondations privées, et non plus des édifices publics bâtis par les cités; elles sont à l'échelle des fortunes privées qui les financent et qui sont plus soucieuses de la richesse de la décoration que des dimensions d'une église dont les fidèles sont pureent et simplement exclus, suivant la messe du marthew, voire du dehors. Les évolutions sont plus sensibles et rapides en ce domaine, l'iconoclasme ayant par définition une grande influence car il vise les représentations. Cette influence est plus nette dans les milieux officiels que dans les provinces et que chez les moines restés iconodoules. Le VIIIème siècle et la première moitié du IXème siècle voient se marquer une coupure entre l'art officiel et l'art populaire bien que l'influence orientale soit sensible sur les 2. L'art officiel ( palais, églises iconoclastes ) s'inspire des décors existant dans les pays anicôniques, essentiellement les arabes. Les murs des palais se couvrent d'animaux, d'armes et d'arbres. Dans les églises de Cappadoce par exemple les motifs sont surtout géométriques, utilisant la croix et y intégrant des animaux. Ce style s'exprime aussi dans la décoration des livres. Quant à l'art resté iconodoule, il retourne à une expression d'influence syrienne assez primitive, aux figures très anguleuses, allongées, mal dessinées, aux couleur spâles; là après 843, l'art iconodoule officiel renaissant puise son inspiration
. A partir du Xème siècle, le plan en croix grecque qui l'emporte dans les églises impose un schéma très rigide de décoration où la Vierge, grande triomphatrice, occupe une place privilégiée; l'image sort de la querelle avec une véritable valeur dogmatique, ce qui impose que les mêmes scènes soient traitées partout et de la même façon jusque dans le détail. La coupole est occupée par le Christ Pantocratôt, image de l'Apocalypse. L'abside est réservée à la Vierge portant l'Enfant sur ses genoux. La voûte séparant l'abside de la coupole porte le trône vide qu'occupera le Christ au jugement dernier, avec seulement les instruments de la Passion. Le reste du sanctuaire est consacré à l'Eucharistie notamment la messe célébréer par le Christ en habit d'officiant. Dans la nef, on a généralement 12 scènes correspondant aux grandes fêtes liturgiques et dans le narthex le cycle de la Vierge. Au dessus de la porte de l'église, dans le narthex, la deisis ( prière ) de la Vierge et de saint Jean Baptiste, à droite et à gauche du Christ vers la figure de qui s'incline leur tête priante. Dans l'exécution de ce décor le style peut différer notablement; les figures des grandes églises de la capitale ont perdu beaucoup de leur rudesse de leur imprécision; mais la décoration de Saint Lux de Phocide reste très influencée par les modèles syriaques. La sculpture a pratiquement disparu sauf pour les bas reliefs et sa place occupée par des ivoires. Le travail du métal, tant l'orfèvrerie et les émaux que des travaux plus importants comme les portes des églises et bâtiments, prend alors une grande place.
Les mutations économiques et sociales du XIIème siècle.
La terre : puissants et faibles. Au XIIème siècle le paysan byzantin reste libre en droit : circulant à son gré, vendant sa terre à sa guise, jouissant des mêmes garanties juridiques que n'importe quel autre sujet des basileis. Il garde même en principe un statut privilégie, car la législation mécédonienne qui le protégeait des entreprises des riches, n'a jamais été abolie par les Comnènes. Pourtant ce paysan se fait rare : épidémies, guerres, troubles intérieures, pression des grandes propriétaires entraînent à la fois exode rural et baisse démographique qui ne compensent pas les replis d'Asie Mineure occupée. L'effort des dunatoi pour attirer les paysans sur leurs domaines se fait donc plus âtre : installé sur la terre du riche, le paysan qui reste libre de droit devient le plus souvent un parèque sur lequel s'exerce en fait tout le poids social et économique des puissants. Le pouvoir réagit chaque fois qu'il peut car en vertu des exemptions fiscales dont jouissent nombre de puissants, chaque paysan tombant sous leur coupe est aussi un contribuable de moins. Les premiers Comnènes entendent donc limiter le mouvement d'installation de parèques sur les grandes domaines : Manuel par exemple refuse aux moines de Patmos le droit d'établir sur leurs terres un nombre illimité de paysans; en 1175 il fait restituer par d'autres moines les paysans excédentaires qu'ils avaient attirés, geste que renouvelle en 1186, Issac II Ange. Installer des paysans sur son domaine n'est donc pas un droit : c'est une faveur que les souverains accodent chichement, seulement s'il s'agit d'hommes " libres et sans obligations ", c'est à dire dépourvus de terre frappeé d'impôt, en sorte que le Trésor ne puisse en pâtir.
Pour faire ces ouvrages l'empereur a utilisé les archives du palais surtout des rapports de fonctionnaires; le " Livre des cérémonies " est cependant écrit dans une langue plus courante. L'encyclopédie touche tous les domaines. On trouve aussi une encyclopédie rurale, les Géoponiques; une encyclopédie militaire, regroupant les tacticiens de l'Antiquité et de l'époque byzantine et à part, les traités tactiques de ce soldat en chambre qu'était Léon VI. Le plus beau fleuron de cet encyclopédisme était aux yeux des Byzantins, l'encyclopédie lexicographique, la Souda; elle utilise moins les auteurs eux mêmes que les compilations précédentes. Elle comporte plusieurs milliers articles, allant du simple synonyme à une pleine page d'explications; elle contient aussi bien l'explication des mots rares que des renseignements grammaticaux et des notices sur des personnes, lieux, institutions ou notons. Historique et littéraire, la Souda est aussi un recueil de proverbes, un dictionnaires de citations; elle est le dictionnaire de citations à l'usage des gens cultivés. Du XIème siècle date le renouveau dans l'effort de réflexion à tous les niveaux et dans la création philosophique et littéraire; ce renouveau produira tous ses fruits également au XIIème siècle, mais nombre d'oeuvre remarquables apparaissent dès le XIème siècle, dont l'homme le plus en vue fut incontestablement Michel Psellos. Il donna une impulsion décisive à la philosophie, rendant leur place aux értudes platoniciennes, tout en évitant les pièges de l'hétérodoxie, contrairement à son successeur Jean Italos. Il fut aussi le principal historien par sa " Chronographie " mais pas le seul: un autre fonctionnaire, Michel Attaliate, s'llustra dans ce genre. Psellos brilla d'un vif éclat dans l'art du discours comme son maître Jean Mavropous, passant sans transition et avec un égal bonheur de l'acte d'accusation à l'éloge funèbre du même personnage.
Il se livre aussi à la posédie de cours aux côtés de Jean Mavropous, Théophylacte d'Ochrida et surtout Christophe de Mytilène.
.
L'évolution artistique. L'architecture religieuse est la plus étudiée car mieux conservée et aussi la plus évolutive; elle influence la construction des palais laics nous étant parvenus. L'évolution décisive est le passage de la basilique à coupole dont l'exemple le plus parfait est Sainte Sophie, au plan cruciforme. La basilique à coupole est en effet un type mélange et illogique : la coupole exerce ses poussées de tous côtés et peut être plus aisément soutenue par un carré que par un rectagle, car le passage du rond au rectangle entraîne un nombre élevé de relais pour transmettre la poussée. D'où l'apparition du plan en croix grecque, c'est à dire une croix à branches égales et orthogonales, dont voûtes et arcs reçoivent parfaitement à la poussée de la coupole centrale. Le meilleur example en est la Néa construite par Basile Ier. Ce passage à la croix grecque s'accompagne de 2 évolutions importantes. D'abord dans la distribution de l'espace intérieure. Le diakonidon, chappelle où se tenait le clergé avant le début de l'office et le prothésis où le clergé venait chercher le Sacrement, se rapprochent de l'abside centrale et communiquent avec elle; l'autel qui avait été projeté assez loin dans la nef à l'époque protobyzantine, se retire dans l'abside. Le tout est bientôt prcédé d'un voile puis d'une cloisin mobile, l'inocostase, séparant le clergé célébrant des fidèles : la masse est célérée derrière la cloison en dehors des regards de la masse des fidèles. Elle devient affaire de spécialistes se distinguant de plus en plus du peuple chrétien. Les églises marquent ainsi la distance se creusant entre clergé et laics. La seconde évolution est la diminution considérable de la taille des églises, rendant plus aisées les solutions architecturales.
La plupart des cathédrales ont été construites aux IV ème - VIème siècles, et fonctionnent toujours toujours; les nouvelles églises construites après le VIIIème siècle sont des fondations privées, et non plus des édifices publics bâtis par les cités; elles sont à l'échelle des fortunes privées qui les financent et qui sont plus soucieuses de la richesse de la décoration que des dimensions d'une église dont les fidèles sont pureent et simplement exclus, suivant la messe du marthew, voire du dehors. Les évolutions sont plus sensibles et rapides en ce domaine, l'iconoclasme ayant par définition une grande influence car il vise les représentations. Cette influence est plus nette dans les milieux officiels que dans les provinces et que chez les moines restés iconodoules. Le VIIIème siècle et la première moitié du IXème siècle voient se marquer une coupure entre l'art officiel et l'art populaire bien que l'influence orientale soit sensible sur les 2. L'art officiel ( palais, églises iconoclastes ) s'inspire des décors existant dans les pays anicôniques, essentiellement les arabes. Les murs des palais se couvrent d'animaux, d'armes et d'arbres. Dans les églises de Cappadoce par exemple les motifs sont surtout géométriques, utilisant la croix et y intégrant des animaux. Ce style s'exprime aussi dans la décoration des livres. Quant à l'art resté iconodoule, il retourne à une expression d'influence syrienne assez primitive, aux figures très anguleuses, allongées, mal dessinées, aux couleur spâles; là après 843, l'art iconodoule officiel renaissant puise son inspiration
. A partir du Xème siècle, le plan en croix grecque qui l'emporte dans les églises impose un schéma très rigide de décoration où la Vierge, grande triomphatrice, occupe une place privilégiée; l'image sort de la querelle avec une véritable valeur dogmatique, ce qui impose que les mêmes scènes soient traitées partout et de la même façon jusque dans le détail. La coupole est occupée par le Christ Pantocratôt, image de l'Apocalypse. L'abside est réservée à la Vierge portant l'Enfant sur ses genoux. La voûte séparant l'abside de la coupole porte le trône vide qu'occupera le Christ au jugement dernier, avec seulement les instruments de la Passion. Le reste du sanctuaire est consacré à l'Eucharistie notamment la messe célébréer par le Christ en habit d'officiant. Dans la nef, on a généralement 12 scènes correspondant aux grandes fêtes liturgiques et dans le narthex le cycle de la Vierge. Au dessus de la porte de l'église, dans le narthex, la deisis ( prière ) de la Vierge et de saint Jean Baptiste, à droite et à gauche du Christ vers la figure de qui s'incline leur tête priante. Dans l'exécution de ce décor le style peut différer notablement; les figures des grandes églises de la capitale ont perdu beaucoup de leur rudesse de leur imprécision; mais la décoration de Saint Lux de Phocide reste très influencée par les modèles syriaques. La sculpture a pratiquement disparu sauf pour les bas reliefs et sa place occupée par des ivoires. Le travail du métal, tant l'orfèvrerie et les émaux que des travaux plus importants comme les portes des églises et bâtiments, prend alors une grande place.
Les mutations économiques et sociales du XIIème siècle.
La terre : puissants et faibles. Au XIIème siècle le paysan byzantin reste libre en droit : circulant à son gré, vendant sa terre à sa guise, jouissant des mêmes garanties juridiques que n'importe quel autre sujet des basileis. Il garde même en principe un statut privilégie, car la législation mécédonienne qui le protégeait des entreprises des riches, n'a jamais été abolie par les Comnènes. Pourtant ce paysan se fait rare : épidémies, guerres, troubles intérieures, pression des grandes propriétaires entraînent à la fois exode rural et baisse démographique qui ne compensent pas les replis d'Asie Mineure occupée. L'effort des dunatoi pour attirer les paysans sur leurs domaines se fait donc plus âtre : installé sur la terre du riche, le paysan qui reste libre de droit devient le plus souvent un parèque sur lequel s'exerce en fait tout le poids social et économique des puissants. Le pouvoir réagit chaque fois qu'il peut car en vertu des exemptions fiscales dont jouissent nombre de puissants, chaque paysan tombant sous leur coupe est aussi un contribuable de moins. Les premiers Comnènes entendent donc limiter le mouvement d'installation de parèques sur les grandes domaines : Manuel par exemple refuse aux moines de Patmos le droit d'établir sur leurs terres un nombre illimité de paysans; en 1175 il fait restituer par d'autres moines les paysans excédentaires qu'ils avaient attirés, geste que renouvelle en 1186, Issac II Ange. Installer des paysans sur son domaine n'est donc pas un droit : c'est une faveur que les souverains accodent chichement, seulement s'il s'agit d'hommes " libres et sans obligations ", c'est à dire dépourvus de terre frappeé d'impôt, en sorte que le Trésor ne puisse en pâtir.
il y a un an
Il est donc juste de dire que loin de favoriser l'asservissement du paysannat, les Comnènes sont restés fidèles à la politique sociale de leurs prédécesseurs.
La lutte contre la grande propriété ecclésiastique : en 1158 Manuel Comnène interdit aux monastères " d'augmenter les propriétés qu'ils détiennent aujourd'hui, en terres ou en paysans attachés " sous peine de confiscation mais le pouvoir n'était pas en principe mieux disposé à l'égard des puissants laics; pourtant l'usurpateur Alexis Comnène ne pouvait affermir son autorité qu'en favorisant le parti aristocratique qui l'avait porté au trône : c'est pourquoi Zonaras l'accuse d'avoir donné à ses partisans des terres " par pleins chariots ". En outre la politique familiale de la dynastie l'amen a à distribuer des domaines aux principes et princesses de la lignée. Mais Zonaras prend soin de noter qu'Alexis ne se montra pas également généraux à l'égard des " autres nobles ". Au reste même quand il s'agissait de leurs partians, les souverains répugnaient à faire des dons de terres en toute propriété, et favorisèrent surtout le développement d'une institution de compromis, la pronoia. La pronoia est la cession entre les mains d'une personne privée, d'une partie du domaine public. A l'origine la pronoia qu'on peut traduire par " tutelle " implique seulement l'obligation poru le titulaire, de maintenir la terre en état de productivité, moyennant jouissance de ses revenus. En outre la pronoia est un simple usufruit car la terre reste propriété de l'Etat et peut être reprise par lui à tout instant. C'est donc un système avantageux pour l'Etat : permettant de satisfaire les assises du régime sans pour autant engager définitivement l'avenir. La pronoia sert aussi à la défense de l'Empire : sous les Comnènes on prend habitude d'exiger du pronoiaire en contrepartie, une contribution en hommes et en équipement militaire.
Enfin il est faux de croire que la pronoia est toujours énorme : elle l'a été, avec celle d'Afiren Comnène, frère d'Alexis, se faisant attribuer en 1081 dans la péninsule de Kassandreia, mais en général il s'agit d'une cession modeste, parfois un village, parfois simplement quelques terres. Le danger n'en est pas moins grand pour l'avenir car quand l'Etat se désorganise, à la fin du XIIème siècle, le risque s'aggrace particulièrement dans les provinces lointaines et mal contrôlées comme la Grèce ou l'Epire, de voir les nobles locaux cumuler entre leurs mains les fonctions officielles, leures terres patrimoniales et confondues avec ces dernières à la faveur du désorbre, d'anciennes pronoiai que le gouvernement n'avait guère moyen de se faire rétrocéder. Les autorités laiques et ecclésiastiques avaient d'ailleurs trouvé un autre moyen économique de manifester leur générosité : depuis le XIème siècle comme en témoigne un opuscule vengeur de Jean d'Antioche, on avait pris l'habitude de remettre entre les mains de laics les biens de certains monastères ruinés ou mal administrés, à charge pour ces laics de les restaurer tout en bénéficiant temporairement de la majeure partir de leurs revenus. L'Eglise par la voix de ses patriarches, ne cessa de protester contre cette innovation nommée charistikè, mais en vain comme le prouvent les nombreux typika au XIIème siècle qui prennent soin de l'interdire par avance. C'était là un moyen supplémentaire de lutte contre la grande propriété religieuse mais c'était aussi risquer de voir les charistikaires mettre définitivement la main sur les biens qui leur étaient confiés, ce qu'ils ne manquèrent pas de faire quand l'Etat s'affaiblit. En terre d'islam, une évolution assez semblable se dessine à la même époque.
En Syrie dès le début du XIème siècle une phase de dépression s'était amorcée avec un net fléchissement démographique pouvant aller jusqu'à l'abandon de certains villes : les prix agricoles très bas, témoignent du reste de la faible demande en denrées alimentaires. Les croisades accentuèrent cette tendance : les ravages provoqués par les armées latines accélèrent encore l'exode rural. En même temps que leurs paysans les titulaires 'iqta abandonnent les campagnes, les premiers ne pouvant trouver protection auprès des seconds qui, n'ayant qu'une jouissance temporaire de leurs domaines, n'ont guère intérêt à les défendre. Ce n'est donc pas un hasard si les grands sultans du XIIème siècle et surtout Nûr al Dîn et Salâh al Dîn adoptèrent résolument le système de l'iqtâ héréditaire : désormais assuré de pouvoir transmettre son domaine à ses enfants, le muqta' se préoccupe sérieusement de sa mise en valeur et protège les paysans qui le travaillent. Parti de la région de Damas, un mouvement de remise en culture des friches s'étend dans la seconde moitié du siècle à l'ensemble de l'émirat zendike, puis ayyûbide. La courbe démographique s'inverse, ce qu'ont bien senti les auteurs du temps. C'est dans la Syrie relativement surpeuplée, oùù le manque de denrées fait monter les prix que naît et se développe le mouvement de contre croisade. Positive à bien des égards, la pratique de l'iqtâ ' héréditaires donne donc naissance, dans la région syro mésopotamienne, à une aristocratie terrienne stable et entraîna par conséquent un assujettissement accru des classes rurales. En raison de sa grande diversité, le monde musulman ne connut pourtant pas uniformément cette évolution car à l'est les dynasties iraniennes et turques comme les Samânides et les Ghaznévides versèrent toujours une solde à leurs armées; le système de l'istâ militaire ne s'y développa point.
Quant à l'Egypte fâtimide, elle eut ses officiers fermiers qui reçurent, sous le nom d'iqtâ, des localités ayant le statut de terres de kharâdj, mais outre que ces concessions restèrent toujours révocables, le contrôle de l'Etat ne cesssa jamais de s'y exercer, surtout en matière fiscale. A cet égard, la conquête ayyûbide de l'Egypte apporta de grandes changements : non seulement le pays se trouva à nouveau surexploité au profit de la Syrie déficitaire, mais Salâh al Dîn y implanta le système de l'iqtâ hérédirai, ce qui réduisit de beaucoup les libertés du paysan égyptien. Alors que l'Egypte avait connu jusque la fin du XIIème siècle une situation démographique stable, la courbe s'infléchit à l'époque ayyubide mais sans abandon des campagnes : comme en Syrie un certain asservissement est compensé par la protection des musta' héréditaires, tandis que l'Etat contrôle sévèrement les impôts et fixe le prix des denrées, en sorte que la sécurité personnelle et économique des paysans s'est sensiblement améliorée. Pourtant la prospérité au XIIème siècle dans les campagnes égyptiennes expliquent en partie le peu d'enthousiasme avec lequel on y accueillit l'idée de contre croisade; elles permettent aussi de mieux comprendre la difficulté avec laquelle le pouvoir ayyûbide s'y installet et s'y maintint. Le sultanat seljukide de Rûm est un cas particulier : nomades, les Turcs ignoraient l'idée de propriété intellectuelle jusque là. Mais en Irak et Djériza l'implantation du système musulman de tenure était si dorte qu'ils ne purent qu'en adopter les principes. En Asie Mineure, au contraire, le système byzantin s'était complètement dilué lors de l'invasion : maîtres d'un pays dont la classe possédante avait généralement fui, les Seljukides comme les Arabes au VIIème siècle, s'y importèrent l'idée que l'ensemble des terres était leur propriété collective.
La disparition des grands propriétaires fut considérée par les paysans comme une délivrance ce que soulignent par exemple les chroniqueurs arméniens; l'invasion turque se traduisit dans les campagnes par un regain de liberté, non seulement les paysans resté sur place adhèrent au nouveau régime dès l'époque de Suleyman ibn Kutlumush mais au cours du XIIème siècle, beaucoup de chrétiens tentés par ces conditions plus libérales, quittèrent l'empire grec pour le sultanat. Cependant la propriété privée reparut vite en Anatolie : la mention de donations en waqf par des personnes privées en début du XIIIème siècle, prouve que l'idée en était dès lors bien implantée. En outre les Seljukides ne pouvaient ignorer longtemps le système de l'iqtâ connu de tous les musulamns voisins. Aussi se répand il assez vite mais sans grand danger pour la classe paysanne : maître de la majorité des terres et conformément à l'usage islamique ancien, le sultan ne disperse sous cette forme que les domaines publics, modérément pour une durée limitée et sans que le titulaire ait droit de modifier le statut personnel et fiscal des paysans. Au total les paysans d'Anatolie, à la fin du XIIème siècle, jouissaient sans doute d'une liberté plus grande que ceux des autres pays musulmans. A la veille de la 4ème croisade, ni les campagnes byzantines ni les campagnes musulmanes ne connaissent la servitude : elles restent peuplées d'hommes juridiquement libres. Mais des menaces de plus en plus précises pèsent sur ces derniers : ici et là, que le pouvoir s'affaiblisse et le grand propriétaire en profite aussitôt.
La chose est d'autant plus grave que l'Orient ne connaît toujours pas le carcan d'un système de type féodal : la disparition de l'autorité centrale fait donc place non pas à cette pyramide sociale qui en Occident, finit par le jeu des droits et des devoirs réciproques, finit toujours par assurer à l'homme quelques garanties élémentaires, mais à un pullulement de petites autorités simplement juxtaposées et donc rien par conséquent ne peut limiter la tyrannie arbitraire sur le pauvre ou le faible.
il y a un an
Anthony_A
1 an
certains ne nous sont connus à des fins chrétiennes, pour les commentaires qu'il fait sur les ouvrages religieux, il se montre d'une orthofoxie intransigeante, il marque le point de départ du classicisme byzantin. Cette tendance à avoir tout lu et à vouloir tout résumer et classer connaît son apogée au Xème siècle sous la direction de l'Empereur lui même, Constantin VII Porphyrogénète ( 913 - 959 ). Il est précédé par l'archevêque de Césarée, Aréthas, auteur médiocre mais éditeur infatigable à qui remonte la moitié de la tradition manuscrite de Platon et qui fit aussi copier Aristote. Il annote les textes de scholies où apparaît sa culture. Avec Constantin Porphyrogénète on aborde la composition des encyclopédies. L'empereur rédigea lui même celles ayant un sujet politique : outre la vie de Basile Ier il y a de lui 3 ouvrages importants; " Le " Livre des cérémonies ", décrivant le cérémonial de la Cour, la liturgie impériale; le " Livre des thèmes ", décrit les thèmes existant alors avec leur histoire; le " Livre de l'administration de l'Empire " est un ouvrage adressé à son fils pour lui apprendre les relations avec l'étranger.
Pour faire ces ouvrages l'empereur a utilisé les archives du palais surtout des rapports de fonctionnaires; le " Livre des cérémonies " est cependant écrit dans une langue plus courante. L'encyclopédie touche tous les domaines. On trouve aussi une encyclopédie rurale, les Géoponiques; une encyclopédie militaire, regroupant les tacticiens de l'Antiquité et de l'époque byzantine et à part, les traités tactiques de ce soldat en chambre qu'était Léon VI. Le plus beau fleuron de cet encyclopédisme était aux yeux des Byzantins, l'encyclopédie lexicographique, la Souda; elle utilise moins les auteurs eux mêmes que les compilations précédentes. Elle comporte plusieurs milliers articles, allant du simple synonyme à une pleine page d'explications; elle contient aussi bien l'explication des mots rares que des renseignements grammaticaux et des notices sur des personnes, lieux, institutions ou notons. Historique et littéraire, la Souda est aussi un recueil de proverbes, un dictionnaires de citations; elle est le dictionnaire de citations à l'usage des gens cultivés. Du XIème siècle date le renouveau dans l'effort de réflexion à tous les niveaux et dans la création philosophique et littéraire; ce renouveau produira tous ses fruits également au XIIème siècle, mais nombre d'oeuvre remarquables apparaissent dès le XIème siècle, dont l'homme le plus en vue fut incontestablement Michel Psellos. Il donna une impulsion décisive à la philosophie, rendant leur place aux értudes platoniciennes, tout en évitant les pièges de l'hétérodoxie, contrairement à son successeur Jean Italos. Il fut aussi le principal historien par sa " Chronographie " mais pas le seul: un autre fonctionnaire, Michel Attaliate, s'llustra dans ce genre. Psellos brilla d'un vif éclat dans l'art du discours comme son maître Jean Mavropous, passant sans transition et avec un égal bonheur de l'acte d'accusation à l'éloge funèbre du même personnage.
Il se livre aussi à la posédie de cours aux côtés de Jean Mavropous, Théophylacte d'Ochrida et surtout Christophe de Mytilène.
.
L'évolution artistique. L'architecture religieuse est la plus étudiée car mieux conservée et aussi la plus évolutive; elle influence la construction des palais laics nous étant parvenus. L'évolution décisive est le passage de la basilique à coupole dont l'exemple le plus parfait est Sainte Sophie, au plan cruciforme. La basilique à coupole est en effet un type mélange et illogique : la coupole exerce ses poussées de tous côtés et peut être plus aisément soutenue par un carré que par un rectagle, car le passage du rond au rectangle entraîne un nombre élevé de relais pour transmettre la poussée. D'où l'apparition du plan en croix grecque, c'est à dire une croix à branches égales et orthogonales, dont voûtes et arcs reçoivent parfaitement à la poussée de la coupole centrale. Le meilleur example en est la Néa construite par Basile Ier. Ce passage à la croix grecque s'accompagne de 2 évolutions importantes. D'abord dans la distribution de l'espace intérieure. Le diakonidon, chappelle où se tenait le clergé avant le début de l'office et le prothésis où le clergé venait chercher le Sacrement, se rapprochent de l'abside centrale et communiquent avec elle; l'autel qui avait été projeté assez loin dans la nef à l'époque protobyzantine, se retire dans l'abside. Le tout est bientôt prcédé d'un voile puis d'une cloisin mobile, l'inocostase, séparant le clergé célébrant des fidèles : la masse est célérée derrière la cloison en dehors des regards de la masse des fidèles. Elle devient affaire de spécialistes se distinguant de plus en plus du peuple chrétien. Les églises marquent ainsi la distance se creusant entre clergé et laics. La seconde évolution est la diminution considérable de la taille des églises, rendant plus aisées les solutions architecturales.
La plupart des cathédrales ont été construites aux IV ème - VIème siècles, et fonctionnent toujours toujours; les nouvelles églises construites après le VIIIème siècle sont des fondations privées, et non plus des édifices publics bâtis par les cités; elles sont à l'échelle des fortunes privées qui les financent et qui sont plus soucieuses de la richesse de la décoration que des dimensions d'une église dont les fidèles sont pureent et simplement exclus, suivant la messe du marthew, voire du dehors. Les évolutions sont plus sensibles et rapides en ce domaine, l'iconoclasme ayant par définition une grande influence car il vise les représentations. Cette influence est plus nette dans les milieux officiels que dans les provinces et que chez les moines restés iconodoules. Le VIIIème siècle et la première moitié du IXème siècle voient se marquer une coupure entre l'art officiel et l'art populaire bien que l'influence orientale soit sensible sur les 2. L'art officiel ( palais, églises iconoclastes ) s'inspire des décors existant dans les pays anicôniques, essentiellement les arabes. Les murs des palais se couvrent d'animaux, d'armes et d'arbres. Dans les églises de Cappadoce par exemple les motifs sont surtout géométriques, utilisant la croix et y intégrant des animaux. Ce style s'exprime aussi dans la décoration des livres. Quant à l'art resté iconodoule, il retourne à une expression d'influence syrienne assez primitive, aux figures très anguleuses, allongées, mal dessinées, aux couleur spâles; là après 843, l'art iconodoule officiel renaissant puise son inspiration
. A partir du Xème siècle, le plan en croix grecque qui l'emporte dans les églises impose un schéma très rigide de décoration où la Vierge, grande triomphatrice, occupe une place privilégiée; l'image sort de la querelle avec une véritable valeur dogmatique, ce qui impose que les mêmes scènes soient traitées partout et de la même façon jusque dans le détail. La coupole est occupée par le Christ Pantocratôt, image de l'Apocalypse. L'abside est réservée à la Vierge portant l'Enfant sur ses genoux. La voûte séparant l'abside de la coupole porte le trône vide qu'occupera le Christ au jugement dernier, avec seulement les instruments de la Passion. Le reste du sanctuaire est consacré à l'Eucharistie notamment la messe célébréer par le Christ en habit d'officiant. Dans la nef, on a généralement 12 scènes correspondant aux grandes fêtes liturgiques et dans le narthex le cycle de la Vierge. Au dessus de la porte de l'église, dans le narthex, la deisis ( prière ) de la Vierge et de saint Jean Baptiste, à droite et à gauche du Christ vers la figure de qui s'incline leur tête priante. Dans l'exécution de ce décor le style peut différer notablement; les figures des grandes églises de la capitale ont perdu beaucoup de leur rudesse de leur imprécision; mais la décoration de Saint Lux de Phocide reste très influencée par les modèles syriaques. La sculpture a pratiquement disparu sauf pour les bas reliefs et sa place occupée par des ivoires. Le travail du métal, tant l'orfèvrerie et les émaux que des travaux plus importants comme les portes des églises et bâtiments, prend alors une grande place.
Les mutations économiques et sociales du XIIème siècle.
La terre : puissants et faibles. Au XIIème siècle le paysan byzantin reste libre en droit : circulant à son gré, vendant sa terre à sa guise, jouissant des mêmes garanties juridiques que n'importe quel autre sujet des basileis. Il garde même en principe un statut privilégie, car la législation mécédonienne qui le protégeait des entreprises des riches, n'a jamais été abolie par les Comnènes. Pourtant ce paysan se fait rare : épidémies, guerres, troubles intérieures, pression des grandes propriétaires entraînent à la fois exode rural et baisse démographique qui ne compensent pas les replis d'Asie Mineure occupée. L'effort des dunatoi pour attirer les paysans sur leurs domaines se fait donc plus âtre : installé sur la terre du riche, le paysan qui reste libre de droit devient le plus souvent un parèque sur lequel s'exerce en fait tout le poids social et économique des puissants. Le pouvoir réagit chaque fois qu'il peut car en vertu des exemptions fiscales dont jouissent nombre de puissants, chaque paysan tombant sous leur coupe est aussi un contribuable de moins. Les premiers Comnènes entendent donc limiter le mouvement d'installation de parèques sur les grandes domaines : Manuel par exemple refuse aux moines de Patmos le droit d'établir sur leurs terres un nombre illimité de paysans; en 1175 il fait restituer par d'autres moines les paysans excédentaires qu'ils avaient attirés, geste que renouvelle en 1186, Issac II Ange. Installer des paysans sur son domaine n'est donc pas un droit : c'est une faveur que les souverains accodent chichement, seulement s'il s'agit d'hommes " libres et sans obligations ", c'est à dire dépourvus de terre frappeé d'impôt, en sorte que le Trésor ne puisse en pâtir.
Pour faire ces ouvrages l'empereur a utilisé les archives du palais surtout des rapports de fonctionnaires; le " Livre des cérémonies " est cependant écrit dans une langue plus courante. L'encyclopédie touche tous les domaines. On trouve aussi une encyclopédie rurale, les Géoponiques; une encyclopédie militaire, regroupant les tacticiens de l'Antiquité et de l'époque byzantine et à part, les traités tactiques de ce soldat en chambre qu'était Léon VI. Le plus beau fleuron de cet encyclopédisme était aux yeux des Byzantins, l'encyclopédie lexicographique, la Souda; elle utilise moins les auteurs eux mêmes que les compilations précédentes. Elle comporte plusieurs milliers articles, allant du simple synonyme à une pleine page d'explications; elle contient aussi bien l'explication des mots rares que des renseignements grammaticaux et des notices sur des personnes, lieux, institutions ou notons. Historique et littéraire, la Souda est aussi un recueil de proverbes, un dictionnaires de citations; elle est le dictionnaire de citations à l'usage des gens cultivés. Du XIème siècle date le renouveau dans l'effort de réflexion à tous les niveaux et dans la création philosophique et littéraire; ce renouveau produira tous ses fruits également au XIIème siècle, mais nombre d'oeuvre remarquables apparaissent dès le XIème siècle, dont l'homme le plus en vue fut incontestablement Michel Psellos. Il donna une impulsion décisive à la philosophie, rendant leur place aux értudes platoniciennes, tout en évitant les pièges de l'hétérodoxie, contrairement à son successeur Jean Italos. Il fut aussi le principal historien par sa " Chronographie " mais pas le seul: un autre fonctionnaire, Michel Attaliate, s'llustra dans ce genre. Psellos brilla d'un vif éclat dans l'art du discours comme son maître Jean Mavropous, passant sans transition et avec un égal bonheur de l'acte d'accusation à l'éloge funèbre du même personnage.
Il se livre aussi à la posédie de cours aux côtés de Jean Mavropous, Théophylacte d'Ochrida et surtout Christophe de Mytilène.
.
L'évolution artistique. L'architecture religieuse est la plus étudiée car mieux conservée et aussi la plus évolutive; elle influence la construction des palais laics nous étant parvenus. L'évolution décisive est le passage de la basilique à coupole dont l'exemple le plus parfait est Sainte Sophie, au plan cruciforme. La basilique à coupole est en effet un type mélange et illogique : la coupole exerce ses poussées de tous côtés et peut être plus aisément soutenue par un carré que par un rectagle, car le passage du rond au rectangle entraîne un nombre élevé de relais pour transmettre la poussée. D'où l'apparition du plan en croix grecque, c'est à dire une croix à branches égales et orthogonales, dont voûtes et arcs reçoivent parfaitement à la poussée de la coupole centrale. Le meilleur example en est la Néa construite par Basile Ier. Ce passage à la croix grecque s'accompagne de 2 évolutions importantes. D'abord dans la distribution de l'espace intérieure. Le diakonidon, chappelle où se tenait le clergé avant le début de l'office et le prothésis où le clergé venait chercher le Sacrement, se rapprochent de l'abside centrale et communiquent avec elle; l'autel qui avait été projeté assez loin dans la nef à l'époque protobyzantine, se retire dans l'abside. Le tout est bientôt prcédé d'un voile puis d'une cloisin mobile, l'inocostase, séparant le clergé célébrant des fidèles : la masse est célérée derrière la cloison en dehors des regards de la masse des fidèles. Elle devient affaire de spécialistes se distinguant de plus en plus du peuple chrétien. Les églises marquent ainsi la distance se creusant entre clergé et laics. La seconde évolution est la diminution considérable de la taille des églises, rendant plus aisées les solutions architecturales.
La plupart des cathédrales ont été construites aux IV ème - VIème siècles, et fonctionnent toujours toujours; les nouvelles églises construites après le VIIIème siècle sont des fondations privées, et non plus des édifices publics bâtis par les cités; elles sont à l'échelle des fortunes privées qui les financent et qui sont plus soucieuses de la richesse de la décoration que des dimensions d'une église dont les fidèles sont pureent et simplement exclus, suivant la messe du marthew, voire du dehors. Les évolutions sont plus sensibles et rapides en ce domaine, l'iconoclasme ayant par définition une grande influence car il vise les représentations. Cette influence est plus nette dans les milieux officiels que dans les provinces et que chez les moines restés iconodoules. Le VIIIème siècle et la première moitié du IXème siècle voient se marquer une coupure entre l'art officiel et l'art populaire bien que l'influence orientale soit sensible sur les 2. L'art officiel ( palais, églises iconoclastes ) s'inspire des décors existant dans les pays anicôniques, essentiellement les arabes. Les murs des palais se couvrent d'animaux, d'armes et d'arbres. Dans les églises de Cappadoce par exemple les motifs sont surtout géométriques, utilisant la croix et y intégrant des animaux. Ce style s'exprime aussi dans la décoration des livres. Quant à l'art resté iconodoule, il retourne à une expression d'influence syrienne assez primitive, aux figures très anguleuses, allongées, mal dessinées, aux couleur spâles; là après 843, l'art iconodoule officiel renaissant puise son inspiration
. A partir du Xème siècle, le plan en croix grecque qui l'emporte dans les églises impose un schéma très rigide de décoration où la Vierge, grande triomphatrice, occupe une place privilégiée; l'image sort de la querelle avec une véritable valeur dogmatique, ce qui impose que les mêmes scènes soient traitées partout et de la même façon jusque dans le détail. La coupole est occupée par le Christ Pantocratôt, image de l'Apocalypse. L'abside est réservée à la Vierge portant l'Enfant sur ses genoux. La voûte séparant l'abside de la coupole porte le trône vide qu'occupera le Christ au jugement dernier, avec seulement les instruments de la Passion. Le reste du sanctuaire est consacré à l'Eucharistie notamment la messe célébréer par le Christ en habit d'officiant. Dans la nef, on a généralement 12 scènes correspondant aux grandes fêtes liturgiques et dans le narthex le cycle de la Vierge. Au dessus de la porte de l'église, dans le narthex, la deisis ( prière ) de la Vierge et de saint Jean Baptiste, à droite et à gauche du Christ vers la figure de qui s'incline leur tête priante. Dans l'exécution de ce décor le style peut différer notablement; les figures des grandes églises de la capitale ont perdu beaucoup de leur rudesse de leur imprécision; mais la décoration de Saint Lux de Phocide reste très influencée par les modèles syriaques. La sculpture a pratiquement disparu sauf pour les bas reliefs et sa place occupée par des ivoires. Le travail du métal, tant l'orfèvrerie et les émaux que des travaux plus importants comme les portes des églises et bâtiments, prend alors une grande place.
Les mutations économiques et sociales du XIIème siècle.
La terre : puissants et faibles. Au XIIème siècle le paysan byzantin reste libre en droit : circulant à son gré, vendant sa terre à sa guise, jouissant des mêmes garanties juridiques que n'importe quel autre sujet des basileis. Il garde même en principe un statut privilégie, car la législation mécédonienne qui le protégeait des entreprises des riches, n'a jamais été abolie par les Comnènes. Pourtant ce paysan se fait rare : épidémies, guerres, troubles intérieures, pression des grandes propriétaires entraînent à la fois exode rural et baisse démographique qui ne compensent pas les replis d'Asie Mineure occupée. L'effort des dunatoi pour attirer les paysans sur leurs domaines se fait donc plus âtre : installé sur la terre du riche, le paysan qui reste libre de droit devient le plus souvent un parèque sur lequel s'exerce en fait tout le poids social et économique des puissants. Le pouvoir réagit chaque fois qu'il peut car en vertu des exemptions fiscales dont jouissent nombre de puissants, chaque paysan tombant sous leur coupe est aussi un contribuable de moins. Les premiers Comnènes entendent donc limiter le mouvement d'installation de parèques sur les grandes domaines : Manuel par exemple refuse aux moines de Patmos le droit d'établir sur leurs terres un nombre illimité de paysans; en 1175 il fait restituer par d'autres moines les paysans excédentaires qu'ils avaient attirés, geste que renouvelle en 1186, Issac II Ange. Installer des paysans sur son domaine n'est donc pas un droit : c'est une faveur que les souverains accodent chichement, seulement s'il s'agit d'hommes " libres et sans obligations ", c'est à dire dépourvus de terre frappeé d'impôt, en sorte que le Trésor ne puisse en pâtir.
Y'a quoi que t'as pas compris dans "déterrage--> ban" Einstein ?
ZE seule chaîne YT 100% burnée !
il y a un an
Y'a quoi que t'as pas compris dans "déterrage--> ban" Einstein ?
C'est pas des déterrages en mono stickers au cas où tu n'aurais pas compris. + je ne ping pas l'auteur.
Donc aucune raison de ban.
Donc aucune raison de ban.
il y a un an
C'est pas des déterrages en mono stickers au cas où tu n'aurais pas compris. + je ne ping pas l'auteur.
Donc aucune raison de ban.
Donc aucune raison de ban.
C'est marrant, en voyant lequel de nous deux s'est fait volatiliser son compte, j'ai soudain comme un doute sur la notion de "pas compris"... après, c'est ton rectum hein, fais-toi plaiz garçon, no judgment.
ZE seule chaîne YT 100% burnée !
il y a un an


















