Ce sujet a été résolu
https://x.com/Arthur_Officiel/status/1981648242791133465
une nouvelle série lancée par Arthur officiel
@TF6 tu vas regarder?
il y a 3 mois
Je suis allé à Manhattan, et là bas je suis allé à la banque, et le mec au guichet avait une kippa nofake

il y a 3 mois
Il pouvait pas le prouver par des chiffres ? A moins que les chiffres soient antisémites

il y a 3 mois
Quel affront de voir ce yid dégoulinant porter le nom d'un roi brittonique comme pseudonyme

il y a 3 mois
ouf me voila rassuré, j espère que cette série faite a 100% par IA vas pas couté trop chère en subvention a nicolas

Monkey see Monkey do
il y a 3 mois
J’y crois un seul instant et ce n’est pas drôle.
Cela ne signifie pa pour autant que cela ne va être rentable.

Cela ne signifie pa pour autant que cela ne va être rentable.
Haec dicit Dominus: Maledictus homo qui confidit in homine, et ponit carnem brachium suum, et a Domino recedit cor ejus.
il y a 3 mois
Non, ils ne contrôlent pas les banques.
C'est juste qu'ils y sont particulièrement surreprésentés.
Tout comme ils sont surreprésentés dans la promotion de l'immigration de massive, du lgbtisme, du féminisme, et autres.

Sûrement le fruit du hasard.

BANQUE CENTRALE D'ARGENTINE
L'évolution de certaines particularités de la Banque centrale de la république d'Argentine depuis sa fondation en 1935 et notamment du point de vue de ses modalités de gouvernance, est dominée par les changements radicaux qui sont intervenus dans la vie politique et économique du pays et par mes modifications institutionnelles qui en ont résulté dans la politique économique. La crise des années 1930 avait en fait pour le cas de l'Argentine, commencé dès 1928. L'abandon de l'étalon or par la Grande Bretagne en 1931 a entraîné l'établissement d'un régime de contrôle des changes. Dont la gestion a été confiée à un organisme spécifique. mais la crise a aussi fait naître le besoin d'instaurer un prêteur en dernier ressort pouvant faire face aux conséquences de la Grande Dépression sur le système bancaire. La Banque centrale d'Argentine est née de cette manière en 1935. Son organisation s'est effectuée sur la base de propositions faites dès 1933, notamment par Otto Niemeyer qui était un haut fonctionnaire de la Banque d'Angleterre auquel le gouvernement argentin avait alors demandé conseil. mais la nouvelle institution avait également bénéficié de l'avis de Raul Prebisch qui était économiste argentin qui deviendrait le premier directeur général de la banque. Il existe une différence entre cette banque centrale et la majorité des banques centrales créées en Amérique du Sud par les missions d'Edwin Kemmerer dans les pays d'Amérique du Sud riverains du Pacifique. Celle du fait que la Banque centrale d'Argentine a d'entrée de jeu été habilitée à surveiller et surtout superviser le système bancaire C'est la mission qu'elle occupe aujourd'hui. Depuis un certain temps, il s'agit aussi de veiller à la stabilité du marché financier.
Car il faut savoir qu'il y avait déjà eu des projets de création d'une banque centrale après la Première Guerre mondiale. Le conflit avait tari d'un coup les importations de capitaux étrangers dont l'économie argentine était dépendante. Le PIB avait reculé de 20% entre 1913 et 1917. La question de la création d'une banque centrale a été posée encore une fois durant les années 1920. Cette fois, ce fut à l'initiative du ministère des finances. Mais la prospérité retrouvé durant la seconde moitié des années 1920 fait que ce débat a tourné court. Ensuite en août 1927, l'Argentine était revenu à l'étalon or sous le contrôle d'une simple caisse d'émission, système qui a fonctionné seulement jusqu'en décembre 1929. C'est la Banco de la Nacion Argentina qui appartenait à l'état argentin qui devait jouer ce rôle de prêteur en dernier ressort à ce moment là. Cette banque avait été créée après la crise Baring de 1890. Depuis l'inauguration de la nouvelle Banque centrale en 1935, cette banque a subi nombre de transformations. Notamment divisables en 5 phases différentes. La première ayant duré jusqu'en 1946 juste après la WW2. A ce moment là, la banque était à la fois publique et privée, et était donc une institution mixte. Ses opérations étaient limitée sur réescompte d'effets commerciaux et à l'octroi d'avances à court terme sur nantissement par l'intermédiaire du système bancaire. Elle faisait aussi office d'argent du Trésor public.
La seconde phase a commencé donc en 1946 avec la nationalisation intégrale de la banque. Elle est devenue chargée d'administrer l'intégralité du système bancaire à travers un mécanisme original consistant à considérer la banque centrale comme bénéficiaire de tous les dépôts bancaires. Le montant total des dépôts ainsi centralisés servait ensuite de base de calcul au montant global des crédits que la Banque d'Argentina allait pouvoir de redistribuer par le biais du réescompte, à travers le système bancaire mais sans nécessairement tenir compte de la part relative revenant individuellement à chaque banque dans l'effort de collecte des dépôts bancaires. De plus, la Banque s'est vu confiée la responsabilité de la gestion du contrôle des changes. La troisième phase a débuté avec le renversement du gouvernement péroniste en 1955. A partir de ce moment là, la banque est revenue à un mécanisme de réserves obligatoires plus classique ne portant plus que sur une fraction de son passif. Le banque centrale, en restant publique, a recouvré un peu plus d'indépendance. Cette évolution qui a été interrompue par un retour momentané au système péroniste de la nationalisation des dépôts au début des années 1970, a perduré avec des modifications mineures dans une perspective argentine jusqu'au début des années 1990. Cependant, le gouvernement militaire au pouvoir entre 1976 et 1983, a procédé à une libéralisation complète du système financier aussi bien à l'intérieur du pays que vis à vis de l'extérieur. Ont été instauré la liberté des taux d'intérêts et la suppression théorique des barrières à l'entrée du système bancaire. Cela a exercé une grande influence sur la banque centrale au delà de quelques changements formels ayant marqué ses status durant cette période.
La quatrième phase a commencé en 1992 lorsque la banque a du adopter son fonctionnement au régime d'une simple caisse d'émission. Cette transformation l'a privée de sa faculté de financier le Trésor public mais aussi d'agir en tant que prêteur en dernier ressort du système bancaire. Cependant, ses nouveaux statuts lui ont garanti une indépendance complète à l'égard du pouvoir politique exécutif. En dehors de surveiller le système bancaire, il y a eu une réduction de sa mission à la simple préservation de la valeur de la monnaie, avec quasiment pas d'instruments nécessaires pour exercer cette responsabilité. Enfin, la cinquième et dernière phase se situe durant la période actuellle au cours de laquelle la Banque a recouvré sa faculté mais dans des limites restreintes, celle de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort à la fois pour le système bancaire mais aussi pour l'Etat et d'intervenir dans la gestion des changes flottants. Que ce soit dans sa manière de faire les choses au niveau de ses missions ou alors au niveau de ses relations avec l'exécutif et le Parlement ou encore de remplir ses obligations à l'égard du système bancaire, la Banque d'Argentine a du évoluer au cours de ses phases. Ainsi, les premiers status de la Banque qui avaient été fixés en 1935, n'envisageaient quasiment aucune mission fondamentale pour la banque centrale au delà de ses fonctions purement techniques qui est celle de l'accumulation de réserves afin de modérer les fluctuations de changes, favoriser la liquidité et le bon fonctionnement du système bancaire, contrôler le volume des moyens de paiement et du crédit mais aussi agir en tant qu'agent et conseiller auprès de l'Etat sur le plan financier. Il faut voir du côté de la loi 12 155 votée au mois de mars 1935 dans son article 3.
On peut déduire une composante implicite de cette mission dans le fait que l'obligation d'accumuler des réserves était destinée, si l'on se réfère à la lettre des status primitifs, à stabiliser les fluctuations de la monnaie, du crédit et des activités commerciales avant qu'à préserver la valeur de la monnaie. Le traduction des status ici comme ailleurs dans ce texte de loi, est de la seule responsabilité de l'auteur. Ensuite, le contrôle quantitatif du crédit et des moyens de paiement avait pour objectif d'ajuster ceux ci au volume réel des affaires. Du coup, la banque s'était vu attribuée une fonction contracyclique en plus de sa fonction consistant à veiller à la valeur de la monnaie et à administrer le contrôle des changes. Car la banque de base avait beaucoup pesé sur la gestion de la dette extérieure de l'Argentine, laquelle n'avait pas connu d'incident de paiement mais avait au contraire été partiellement remboursée au moyen des pléthoriques réserves de devises qu'elle avait accumulées entre 1935 et 1937. Enfin, la banque a depuis le début du faire face à des crises bancaires et par la suite, préserver la stabilité financière y compris sur le marché financier. La nationalisation de la banque centrale qui est intervenue au début de 1946, avait abouti à rendre sa mission plus complexes. Pour cela il faut regarder du côté du décret loi numéro 8503 de mars 1946. L'objectif de la nationalisation était de répondre à la nécessité de faire appliquer simultanément par l'Etat des principes uniformes et identiques dans le domaine de la politique monétaire comme dans celui de la politique économique en général.
C'est juste qu'ils y sont particulièrement surreprésentés.
Tout comme ils sont surreprésentés dans la promotion de l'immigration de massive, du lgbtisme, du féminisme, et autres.
Sûrement le fruit du hasard.
BANQUE CENTRALE D'ARGENTINE
L'évolution de certaines particularités de la Banque centrale de la république d'Argentine depuis sa fondation en 1935 et notamment du point de vue de ses modalités de gouvernance, est dominée par les changements radicaux qui sont intervenus dans la vie politique et économique du pays et par mes modifications institutionnelles qui en ont résulté dans la politique économique. La crise des années 1930 avait en fait pour le cas de l'Argentine, commencé dès 1928. L'abandon de l'étalon or par la Grande Bretagne en 1931 a entraîné l'établissement d'un régime de contrôle des changes. Dont la gestion a été confiée à un organisme spécifique. mais la crise a aussi fait naître le besoin d'instaurer un prêteur en dernier ressort pouvant faire face aux conséquences de la Grande Dépression sur le système bancaire. La Banque centrale d'Argentine est née de cette manière en 1935. Son organisation s'est effectuée sur la base de propositions faites dès 1933, notamment par Otto Niemeyer qui était un haut fonctionnaire de la Banque d'Angleterre auquel le gouvernement argentin avait alors demandé conseil. mais la nouvelle institution avait également bénéficié de l'avis de Raul Prebisch qui était économiste argentin qui deviendrait le premier directeur général de la banque. Il existe une différence entre cette banque centrale et la majorité des banques centrales créées en Amérique du Sud par les missions d'Edwin Kemmerer dans les pays d'Amérique du Sud riverains du Pacifique. Celle du fait que la Banque centrale d'Argentine a d'entrée de jeu été habilitée à surveiller et surtout superviser le système bancaire C'est la mission qu'elle occupe aujourd'hui. Depuis un certain temps, il s'agit aussi de veiller à la stabilité du marché financier.
Car il faut savoir qu'il y avait déjà eu des projets de création d'une banque centrale après la Première Guerre mondiale. Le conflit avait tari d'un coup les importations de capitaux étrangers dont l'économie argentine était dépendante. Le PIB avait reculé de 20% entre 1913 et 1917. La question de la création d'une banque centrale a été posée encore une fois durant les années 1920. Cette fois, ce fut à l'initiative du ministère des finances. Mais la prospérité retrouvé durant la seconde moitié des années 1920 fait que ce débat a tourné court. Ensuite en août 1927, l'Argentine était revenu à l'étalon or sous le contrôle d'une simple caisse d'émission, système qui a fonctionné seulement jusqu'en décembre 1929. C'est la Banco de la Nacion Argentina qui appartenait à l'état argentin qui devait jouer ce rôle de prêteur en dernier ressort à ce moment là. Cette banque avait été créée après la crise Baring de 1890. Depuis l'inauguration de la nouvelle Banque centrale en 1935, cette banque a subi nombre de transformations. Notamment divisables en 5 phases différentes. La première ayant duré jusqu'en 1946 juste après la WW2. A ce moment là, la banque était à la fois publique et privée, et était donc une institution mixte. Ses opérations étaient limitée sur réescompte d'effets commerciaux et à l'octroi d'avances à court terme sur nantissement par l'intermédiaire du système bancaire. Elle faisait aussi office d'argent du Trésor public.
La seconde phase a commencé donc en 1946 avec la nationalisation intégrale de la banque. Elle est devenue chargée d'administrer l'intégralité du système bancaire à travers un mécanisme original consistant à considérer la banque centrale comme bénéficiaire de tous les dépôts bancaires. Le montant total des dépôts ainsi centralisés servait ensuite de base de calcul au montant global des crédits que la Banque d'Argentina allait pouvoir de redistribuer par le biais du réescompte, à travers le système bancaire mais sans nécessairement tenir compte de la part relative revenant individuellement à chaque banque dans l'effort de collecte des dépôts bancaires. De plus, la Banque s'est vu confiée la responsabilité de la gestion du contrôle des changes. La troisième phase a débuté avec le renversement du gouvernement péroniste en 1955. A partir de ce moment là, la banque est revenue à un mécanisme de réserves obligatoires plus classique ne portant plus que sur une fraction de son passif. Le banque centrale, en restant publique, a recouvré un peu plus d'indépendance. Cette évolution qui a été interrompue par un retour momentané au système péroniste de la nationalisation des dépôts au début des années 1970, a perduré avec des modifications mineures dans une perspective argentine jusqu'au début des années 1990. Cependant, le gouvernement militaire au pouvoir entre 1976 et 1983, a procédé à une libéralisation complète du système financier aussi bien à l'intérieur du pays que vis à vis de l'extérieur. Ont été instauré la liberté des taux d'intérêts et la suppression théorique des barrières à l'entrée du système bancaire. Cela a exercé une grande influence sur la banque centrale au delà de quelques changements formels ayant marqué ses status durant cette période.
La quatrième phase a commencé en 1992 lorsque la banque a du adopter son fonctionnement au régime d'une simple caisse d'émission. Cette transformation l'a privée de sa faculté de financier le Trésor public mais aussi d'agir en tant que prêteur en dernier ressort du système bancaire. Cependant, ses nouveaux statuts lui ont garanti une indépendance complète à l'égard du pouvoir politique exécutif. En dehors de surveiller le système bancaire, il y a eu une réduction de sa mission à la simple préservation de la valeur de la monnaie, avec quasiment pas d'instruments nécessaires pour exercer cette responsabilité. Enfin, la cinquième et dernière phase se situe durant la période actuellle au cours de laquelle la Banque a recouvré sa faculté mais dans des limites restreintes, celle de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort à la fois pour le système bancaire mais aussi pour l'Etat et d'intervenir dans la gestion des changes flottants. Que ce soit dans sa manière de faire les choses au niveau de ses missions ou alors au niveau de ses relations avec l'exécutif et le Parlement ou encore de remplir ses obligations à l'égard du système bancaire, la Banque d'Argentine a du évoluer au cours de ses phases. Ainsi, les premiers status de la Banque qui avaient été fixés en 1935, n'envisageaient quasiment aucune mission fondamentale pour la banque centrale au delà de ses fonctions purement techniques qui est celle de l'accumulation de réserves afin de modérer les fluctuations de changes, favoriser la liquidité et le bon fonctionnement du système bancaire, contrôler le volume des moyens de paiement et du crédit mais aussi agir en tant qu'agent et conseiller auprès de l'Etat sur le plan financier. Il faut voir du côté de la loi 12 155 votée au mois de mars 1935 dans son article 3.
On peut déduire une composante implicite de cette mission dans le fait que l'obligation d'accumuler des réserves était destinée, si l'on se réfère à la lettre des status primitifs, à stabiliser les fluctuations de la monnaie, du crédit et des activités commerciales avant qu'à préserver la valeur de la monnaie. Le traduction des status ici comme ailleurs dans ce texte de loi, est de la seule responsabilité de l'auteur. Ensuite, le contrôle quantitatif du crédit et des moyens de paiement avait pour objectif d'ajuster ceux ci au volume réel des affaires. Du coup, la banque s'était vu attribuée une fonction contracyclique en plus de sa fonction consistant à veiller à la valeur de la monnaie et à administrer le contrôle des changes. Car la banque de base avait beaucoup pesé sur la gestion de la dette extérieure de l'Argentine, laquelle n'avait pas connu d'incident de paiement mais avait au contraire été partiellement remboursée au moyen des pléthoriques réserves de devises qu'elle avait accumulées entre 1935 et 1937. Enfin, la banque a depuis le début du faire face à des crises bancaires et par la suite, préserver la stabilité financière y compris sur le marché financier. La nationalisation de la banque centrale qui est intervenue au début de 1946, avait abouti à rendre sa mission plus complexes. Pour cela il faut regarder du côté du décret loi numéro 8503 de mars 1946. L'objectif de la nationalisation était de répondre à la nécessité de faire appliquer simultanément par l'Etat des principes uniformes et identiques dans le domaine de la politique monétaire comme dans celui de la politique économique en général.
il y a 3 mois
Ceinturion
3 mois
Bon dieu qu'est-ce que c'est mauvais
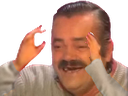
Vivement l'épisode sur Blavatski

Vivement l'épisode sur Blavatski
Tu n apprécies pas les animations humoristiques ? Je suppose que tu trouves que Kev Adams n est pas drôle non plus et qu'il est la uniquement grâce au piston ? On en parlera dans l épisode 2
il y a 3 mois
Prochain épisode pour dénoncer les clichés sur l'empoisonnement des puits?

L'esprit de la loi était dominé par une conception claire et nette. " Les capacités de production devaient être augmentées rationnellement... Il fallait assurer le bien être général... et la richese nationale devait être accrue. " Source : : décret loi numéro 8503 de mars 1946. Les nouveaux statues étaient explicites : " Dans le cadre de ses pouvoirs légaux.... favoriser, orienter et rendre opérationelle... une politique économique compatible avec la préservation d'un niveau d'activité élevé visant à l'emploi optimal des resources humaines et des ressources métarielles disponibles et à l'expansion ordonnée de l'économie en vue d'une croissance de la richesse nationale qui permette d'élever le niveau de vie des habitants du pays. " Source : Article 3 1 ) du décrit numéro 14 957 de mai 1946 adoptée par le gouvernement militaire de 1943 - 1946. Par ailleurs, les autres objectifs de nature anti inflationniste et visant à la stabilité financière ainsi que ceux qui se référaient à la liquidité du système bancaire, implicitement prescrits dans les status de 1935, furent conservés avec de légères modifications dans leur libellé. Source : article 3, b) , c), et d) du décret loi numéro 14 957. Avec les changements institutionnels entraînés par la Revolucion Libertadora qui renversa le président Peron en septembre 1935, la banque centrale s'est vue dotée de novueaux statuts, cohérents avec les évolutions d'un système bancaire qui revenait à des pratiques de crédit fondées sur l'emploi de ses ressources propres et dans le cadre d'un système plus traditionnel de réserves obligatoires.
Les nouveaux statuts qui n'étaient en fait qu'une reformulation de ceux de 1946, ont donné à la banque la responsabilité de " contrôler le volume du crédit bancaire et des moyens de paiements afin de maintenir le pouvoir d'achat de la monnaie, favoriser le développement ordonné de l'épargne et de l'investissement et stimuler la croissance ordonnée et continuelle du revenu national. " Source : Article 1 a) du décret loi numéro 13126 d'octobre 1957. En plus de cet objectif principal, il y avait la mention des objectifs secondaires qui visaient à modérer les fluctuations conjoncturelles liées aux évolutions de la balance des paiements et de la liquidité bancaire; Source :: article 1 b) et c) du décret loi 13126 d'octobre 1957 également. L'autre changement a ensuite eu lieu en 1973 avec le retour d'un gouvernement péroniste. A la mission principale légèrement modifiée de " contrôler le volume du crédit et des moyens de paiement en vue de créer les conditions qui permettent de préserver un développement économique ordonné et croissant ", il a ajouté : " dans une orientation sociale, avec un niveau élevé d'emploi ". L'objectif du maintien du pouvoir d'achat de la monnaie ne venait qu'au second plan. Pour la première fois aussi, était mentionné de manière explicité : " l'application de la politique des changes " qui de toute façon, avait fait partie des attributions de la Banque, le gouvernement militaire a instauré par la suite n'a pas jugé nécessaire d'apporter quelque modification que ce soit aux articles prescrivant ses missions; la clause concernant une " orientation sociale ", notamment, est demeurée inchangée. Source : Les modifications introduites par les lois numéro 21 364 de juillet 1976, numéro 21 947 de mars 1977, numéro 21 571 de mai 1977 et numéro 22 467 de juin 1981.
Le retour à un gouvernement démocratique en 1983, n'entraîna aucune modification fondamentale de la loi bancaire ou des status de la banque centrale, en dépit des critiques voilées à l'encontre des faveurs évidentes dont aurait bénéficié le secteur financier sous le régime militaire et de la volonté de réforme que ces critiques avaient nourrie. Ce n'est qu'en 1992, alors depuis mars 1991, le système monétaire et cambiste de l'Argentine était placé sous un régime de Currency Board, que de nouveaux statuts furent adoptés pour la Banque par la loi numéro 24 144. Ils stipulaient que " la mission principale et fondamentale de la Banque centrale de la république d'Argentine est de préserver la valeur de la monnaie ". Source : l'article 3 de la loi numéro 24111 d'octobre 1992. Dans le système de CUrrency Board, le taux de change du peso argentin était fixé légalement par le Parlement, à 1 peso pour 1 dollar américain et la banque centrale n'était pas autorisée, pour l'essentiel, à n'émettre que de la monnaie qu'en contrepartie des excédents nets de la balance des paiements ( une certaine marge d'émission était laissée, cepandant, à des émissions effectuées en contrepartie de titres de la dette publique libellée en dollars américains ). Toute référence à d'autres missions que ce soit la stabilisation financière ou la croissance et le plein emploi, a été supprimée. Ce libellé demeure aujourd'hui dans les status de 2002 qui, après suppression du Currency Board, ont permis à la banque de recouvrer sa fonction de prêteur en dernier ressort et de prêter des montants limités à l'Etat.
La banque qui reste statuairement soumise à cette seule mission, a de fait regagné à l'heure actuelle le pouvoir de formuler et mettre en oeuvre une politique monétaire et une politique des changes. Le système de taux de change a évolué en théorie vers un régime de flottement libre mais il reste assez fortement dirigé par la Banque, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. De ce point de vue, elle a également joué un rôle déterminant en recréant pour les devises à la fois un marché au comptant et un marché à terme. Elle a aussi développé à des fins de gestions monétaires, un marché de son propre papier puisque le papier de l'Etat, en défaut, ne pouvait être utilisé, ainsi qu'en recrént divers types d'opérations de report. Par ailleurs, ses nouveaux status, complétés en ce sens en 2003, l'obligent à annoncer publiquement avant la fin de chaque année un programme monétaire pour l'anéne à venir, qui doit inclure des objectifs chiffrés de taux d'inflation et de croissance des agrégats monétaires. Chaque trimestre, ou à tout instant dès lors que des écarts significatifs apparaissent par rapport aux prévisions, la Banque centrale doit expliquer publiquement les causes de ces écarts et reformuler sur ces nouvelles bases son programme monétaire. Source : l'article 1 de la loi numéro 25 562 se septembre 2003 modifiant l'article 3 de la loi précédente : au cas où l'information publique sur les causes qui ont conduit à s'écarter des objectifs chiffrés ou sur la fixation de nouveaux objectifs monétaires serait jugée défectueuse, les membres du conseil de la banque sont passibles d'une sorte de procédure accelérée d'impeachement.
L'esprit de la loi était dominé par une conception claire et nette. " Les capacités de production devaient être augmentées rationnellement... Il fallait assurer le bien être général... et la richese nationale devait être accrue. " Source : : décret loi numéro 8503 de mars 1946. Les nouveaux statues étaient explicites : " Dans le cadre de ses pouvoirs légaux.... favoriser, orienter et rendre opérationelle... une politique économique compatible avec la préservation d'un niveau d'activité élevé visant à l'emploi optimal des resources humaines et des ressources métarielles disponibles et à l'expansion ordonnée de l'économie en vue d'une croissance de la richesse nationale qui permette d'élever le niveau de vie des habitants du pays. " Source : Article 3 1 ) du décrit numéro 14 957 de mai 1946 adoptée par le gouvernement militaire de 1943 - 1946. Par ailleurs, les autres objectifs de nature anti inflationniste et visant à la stabilité financière ainsi que ceux qui se référaient à la liquidité du système bancaire, implicitement prescrits dans les status de 1935, furent conservés avec de légères modifications dans leur libellé. Source : article 3, b) , c), et d) du décret loi numéro 14 957. Avec les changements institutionnels entraînés par la Revolucion Libertadora qui renversa le président Peron en septembre 1935, la banque centrale s'est vue dotée de novueaux statuts, cohérents avec les évolutions d'un système bancaire qui revenait à des pratiques de crédit fondées sur l'emploi de ses ressources propres et dans le cadre d'un système plus traditionnel de réserves obligatoires.
Les nouveaux statuts qui n'étaient en fait qu'une reformulation de ceux de 1946, ont donné à la banque la responsabilité de " contrôler le volume du crédit bancaire et des moyens de paiements afin de maintenir le pouvoir d'achat de la monnaie, favoriser le développement ordonné de l'épargne et de l'investissement et stimuler la croissance ordonnée et continuelle du revenu national. " Source : Article 1 a) du décret loi numéro 13126 d'octobre 1957. En plus de cet objectif principal, il y avait la mention des objectifs secondaires qui visaient à modérer les fluctuations conjoncturelles liées aux évolutions de la balance des paiements et de la liquidité bancaire; Source :: article 1 b) et c) du décret loi 13126 d'octobre 1957 également. L'autre changement a ensuite eu lieu en 1973 avec le retour d'un gouvernement péroniste. A la mission principale légèrement modifiée de " contrôler le volume du crédit et des moyens de paiement en vue de créer les conditions qui permettent de préserver un développement économique ordonné et croissant ", il a ajouté : " dans une orientation sociale, avec un niveau élevé d'emploi ". L'objectif du maintien du pouvoir d'achat de la monnaie ne venait qu'au second plan. Pour la première fois aussi, était mentionné de manière explicité : " l'application de la politique des changes " qui de toute façon, avait fait partie des attributions de la Banque, le gouvernement militaire a instauré par la suite n'a pas jugé nécessaire d'apporter quelque modification que ce soit aux articles prescrivant ses missions; la clause concernant une " orientation sociale ", notamment, est demeurée inchangée. Source : Les modifications introduites par les lois numéro 21 364 de juillet 1976, numéro 21 947 de mars 1977, numéro 21 571 de mai 1977 et numéro 22 467 de juin 1981.
Le retour à un gouvernement démocratique en 1983, n'entraîna aucune modification fondamentale de la loi bancaire ou des status de la banque centrale, en dépit des critiques voilées à l'encontre des faveurs évidentes dont aurait bénéficié le secteur financier sous le régime militaire et de la volonté de réforme que ces critiques avaient nourrie. Ce n'est qu'en 1992, alors depuis mars 1991, le système monétaire et cambiste de l'Argentine était placé sous un régime de Currency Board, que de nouveaux statuts furent adoptés pour la Banque par la loi numéro 24 144. Ils stipulaient que " la mission principale et fondamentale de la Banque centrale de la république d'Argentine est de préserver la valeur de la monnaie ". Source : l'article 3 de la loi numéro 24111 d'octobre 1992. Dans le système de CUrrency Board, le taux de change du peso argentin était fixé légalement par le Parlement, à 1 peso pour 1 dollar américain et la banque centrale n'était pas autorisée, pour l'essentiel, à n'émettre que de la monnaie qu'en contrepartie des excédents nets de la balance des paiements ( une certaine marge d'émission était laissée, cepandant, à des émissions effectuées en contrepartie de titres de la dette publique libellée en dollars américains ). Toute référence à d'autres missions que ce soit la stabilisation financière ou la croissance et le plein emploi, a été supprimée. Ce libellé demeure aujourd'hui dans les status de 2002 qui, après suppression du Currency Board, ont permis à la banque de recouvrer sa fonction de prêteur en dernier ressort et de prêter des montants limités à l'Etat.
La banque qui reste statuairement soumise à cette seule mission, a de fait regagné à l'heure actuelle le pouvoir de formuler et mettre en oeuvre une politique monétaire et une politique des changes. Le système de taux de change a évolué en théorie vers un régime de flottement libre mais il reste assez fortement dirigé par la Banque, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. De ce point de vue, elle a également joué un rôle déterminant en recréant pour les devises à la fois un marché au comptant et un marché à terme. Elle a aussi développé à des fins de gestions monétaires, un marché de son propre papier puisque le papier de l'Etat, en défaut, ne pouvait être utilisé, ainsi qu'en recrént divers types d'opérations de report. Par ailleurs, ses nouveaux status, complétés en ce sens en 2003, l'obligent à annoncer publiquement avant la fin de chaque année un programme monétaire pour l'anéne à venir, qui doit inclure des objectifs chiffrés de taux d'inflation et de croissance des agrégats monétaires. Chaque trimestre, ou à tout instant dès lors que des écarts significatifs apparaissent par rapport aux prévisions, la Banque centrale doit expliquer publiquement les causes de ces écarts et reformuler sur ces nouvelles bases son programme monétaire. Source : l'article 1 de la loi numéro 25 562 se septembre 2003 modifiant l'article 3 de la loi précédente : au cas où l'information publique sur les causes qui ont conduit à s'écarter des objectifs chiffrés ou sur la fixation de nouveaux objectifs monétaires serait jugée défectueuse, les membres du conseil de la banque sont passibles d'une sorte de procédure accelérée d'impeachement.
il y a 3 mois
Tu n apprécies pas les animations humoristiques ? Je suppose que tu trouves que Kev Adams n est pas drôle non plus et qu'il est la uniquement grâce au piston ? On en parlera dans l épisode 2
Je ne suis qu'un vulgaire rageux...

il y a 3 mois
LES RELATIONS DE LA BANQUE CENTRALE AVEC LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT
Selon ses status de 1935, la Banque centrale était une institution mixte donc à la fois publique et privée. Il n'était donc pas question que la banque reçoive des instructions du Parlement ou du pouvoir exécutif. Sur un plan purement fonctionnel, il était établi néanmoins que la banque agissait en qualité d'agent et de conseiller du gouvernement sur le plan financier. Source : Article 3 d) et articles 43, 46 et 47 de la loi numéro 12 155, ainsi que l'article 9 du décret 61 126 précisant certains aspects des statuts. Il était aussi établi que les relations de la banque avec le gouvernement passaient par le ministre des Finances. Source : Article 48 de la loi numéro 12 155 également. Il était établi que le ministre des Finances devait fournir chaque trimestre des informations concernant les mouvements du compte du Trésor. Source : Article 45 de la loi numéro 12 155. Par ailleurs, la Banque centrale devait fournir au gouvernement des informations économiques et financières et soumettre au ministère des Finances un rapport annuel sur ses activités en tant qu'agent financier du gouvernement. Source : articles 8 et 20 du même decret. De plus, la banque était autorisée à faire des avances au gouvernement pour une période restreinte et dans la limite de 10% de la moyenne des recettes encaissées au cours des trois dernières années. Source : Article 44 de la loi numéro 12 155. Naturellement la banque avait bénéficié d'un monopole d'émission monétaire ( articles 35 à 41 de la loi numéro 12 155 ) et devait détenir des réserves de changes d'au moins 25% de la monnaie en circulation. Ce monopole lui est demeuré formellement acquis mais a été sérieusement mis à l'épreuve dans les années 1980 et à la fin des années 1990 quand plusieurs provinces ont commencé à émettre des obligations avec pouvoir libératoire.
Ces quasi monnaies ont été complètement absorbées au lendemain de la crise financière de 2002 - 2003. De plus, la Banque centrale pouvait acheter des obligations d'Etat dans la limite du montant de son capital et de ses réserves. Source : Article 34 b) de la loi numéro 12 155. La banque qui avait été nationalisée en 1946, avait été caractérisée comme étant une agence nationale autonome jouissant d'une totale indépendance dans l'accomplissement de ses fonctions. Source : Article 1 du décret numéro 14 957 de mai 1946. Mais ultérieurement, dans le cadre de la nouvelle loi numéro 13 571 et du décretgouvernemental numéro 25 120 promulguées en 1949, il fut décidé qu'elle était désormais " dépendante du ministère des Finances ". Source : article 1 du décret gouvernemental numéro 25 120 d'octobre 1949. En outre, il fut explicitement reconnu au ministère le pouvoir de diriger la Banque centrale dans l'élaboration et la réalisation de son budget propre et de surveiller ses conseillers juridiques. Source : décret gouvernemntal numéro 27 425 d'octobre 1949. De plus, sous la loi de 1949, son président et son vice président n'étaient autre que, respectivement le ministre des Finances et le sous secrétaire d'Etat aux Finances. Source : article 6 du décret gouvernemental numéro 25 120 d'octobre 1949. Sur le plan fonctionnel, les règles définissant les relations de la Banque centrale avec le Trésor public sont restées quasiment incahcnées, y compris en ce qui concerne les limites des avances qu'elle pouvait consentir au gouvernement, bien que la limite de 10% de la moyenne des recettes encaissées au cours des trois dernières années ait été élargie à 15% par l'article 30 du décret de 1949.
Etant désormais nationalisée, la banque devait soumettre ses comptes annuels au gouvernement et un membre du gouvernement avait le droit d'inspecter les réserves en devises. Sources pour les comptes annuels : Article 51 du décret de 1946 et article 46 du décret de 1949. Source pour les réserves en devises : Articles 53, 53 et 55 du décret de 1949. Par ailleurs, la Banque centrale est devenue le superviseur du système de la Banque centrale de la république d'Argentine, composée de divers établissements financiers publics. Source : Articles 56 - 57 du même décret de 1949. De plus, l'administration du contrôle des changes avait été transféré à la Banque centrale. Source : Décret numéro 12 596 de mai 1946 et articles 40, 41 et 42 du décret numéro 25120. Ainsi que de l'administration de la bourse des valeurs. Source : Articles 43, 44 du décret numéro 25 120 d'octobre 1949. A partir de 1957, la Banque centrale, bien que toujours nationalisée, retrouva un certain niveau d'autonomie par rapport au pouvoir exécutif. Elle fut à nouveau définie comme un agence nationale autonome. Source : article 1 du décret loi numéro 13 126 d'octobre 1957 ratifiée ensuite par la loi numéro 14 467 de septembre 1958. Et son président et vice président cessèrent d'être aussi membres du gouvernement. Source : article 6 du même décret loi numéro 13 126. Cependant, ses fonctions devaient être exercées conformément aux " directives fondamentales du gouvernement national en matière de politique économique ". Source : Article 1 du même décret loi numéro 13 126.
En matière de contrôle des changes, tout particulièrement, la Banque centrale restait soumise aux " décisions et instructions du ministère de l'Economie ". Source : article 1 du décret loi 4 611 d'avril 1958. En outre, une nouvelle instance fut définie :a le sindico, un contrôleur désigné par le gouvernement et approuvé par le Sénat. La ratification par le Sénat ne peut être interprétée également comme la volonté d'accorder un peu plus d'autonomie à la Banque centrale dans la mesure où, antérieurement, la nomination du contrôleur ne relevait que du pouvoir exécutif. Le sindico avait pour fonction de superviser les activités de la Banque centrale et d'informer le gouvernement de sa gestion ainsi que de certifier les comptes annuels. Source :: Article 39, du décret loi numéro 13 126 d'octobre 1957. Sur le plan fonctionnel, la limite des avances de la Banque au Trésor public fut portée à 30% du montant des recettes des 12 mois précédents. Source : article 27 du même décret loi numéro 13 126 d'octobre 1957. En outre, en vertu de la capacité de la Banque centrale à écheter et vendre des titres publics et dans le cadre de sa mission de régulation des marchés, un fonds constitué des obligations émises en contrepartie des avances de la banque à l'Etat pouvait être créé, à la hauteur de 15% du total des avances et bien qu'une telle limite pût être augmentée dans certains cas. Source : article 18 m ) du même décret loi. En outre, un article transitoire, l'article 49, autorisait des montants bien plus importants.
Une nouvelle évolution eut lieu en 1973. Elle accompagna une renationalisation des dépôts bancaires semblable à celle de la fin des années 1940 et du début des années 1950. La Banque centrale, chargée de l'administration de ce système, fut explicitement placée sous la direction du gouvernement. " Les activités de la Banque suivront les instructions du gouvernement central via le ministère de l'Economie en matière de politique économique, monétaire, des changes et financières. " Source : article 4, loi numéro 20 539 d'octobre 1973. L'appelation même de ministère de l'Economie consacrait un retour aux années 1960, période durant laquelle on avait pour la première fois abandonné la dénomination plus traditionnelle de " ministère des Finances ". Les limites des avances que la Banque centrale pouvait consentir au gouvernement restèrent inchangées mais son portefeuille d'obligations d'Etat put dès lors atteindre 35% du total des dépôts du système bancaire. Source : Articles 27 et 52 respectivement, de la même loi numéro 20 539 d'octobre 1973. Le retour à un gouvernement militaire entre 1976 et 1983, ne modifia pas véritablement les relations entre la Banque centrale et le pouvoir exécutif alors même que le système financier dans son ensemble fut soumis à une libéralisation assez profonde. la loi numéro 21 364 de juillet 1976 laissa donc globalement la Banque centrale soumise aux directives du gouvernement. Source : article 4 de la loi numéro 21 364. PAGE 211
Ce n'est qu'en 1992 que la banque centrale a été reconnue au moins formellement comme institution indépendante du gouvernement : " Pour ce qui concerne la formulation de l'exécution des politiques monétaires et financière, la banque centrale ne dépendra pas d'ordres, d'indications ou d'instructions émanant du pouvoir exécutif. Source : Article 3 de la loi numéro 24 144. Le premier ministre de l'Economie ou son représentant était autorisé à participer aux réunions du conseil des gouverneurs mais sans droit de vote. C'est marqué dans l'article 2. En outre, le président du conseil des gouverneurs devait et doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur les activités de la banque et présenter une fois par an au moins, un rapport sur la nature des politiques monétaires, des changes et financières en cours de réalisation. Il est vrai cependant que cette autonomie ne fut accordée qu'au moment même où la Banque centrale était privée de la plupart de ses instruments de politique monétaire. Mais cette formulation est demeurée jusqu'à nos jours alors même qu'avec l'effondrement du Currendy Board, la Banque nationale a recouvré sa fonction de prêteur en dernier ressort et même, quoique de façon limitée, sa capacité à prêter à l'Etat. Sur le plan fonctionnel, les statuts de 1992 ont innové sur deux points. D'abord en dépit des restrictions de la loi dite de convertibilité instituant le système de Currency Board, les obligations d'Etat détenues en portefeuille par la Banque centrale pouvaient gager jusqu'à un tiers des émissions monétaires. Source : article 20 de la loi numéro 24 144.
D'autre part, la fonction de sindico fut complétée par la désignation d'un contrôleur adjoint.
Selon ses status de 1935, la Banque centrale était une institution mixte donc à la fois publique et privée. Il n'était donc pas question que la banque reçoive des instructions du Parlement ou du pouvoir exécutif. Sur un plan purement fonctionnel, il était établi néanmoins que la banque agissait en qualité d'agent et de conseiller du gouvernement sur le plan financier. Source : Article 3 d) et articles 43, 46 et 47 de la loi numéro 12 155, ainsi que l'article 9 du décret 61 126 précisant certains aspects des statuts. Il était aussi établi que les relations de la banque avec le gouvernement passaient par le ministre des Finances. Source : Article 48 de la loi numéro 12 155 également. Il était établi que le ministre des Finances devait fournir chaque trimestre des informations concernant les mouvements du compte du Trésor. Source : Article 45 de la loi numéro 12 155. Par ailleurs, la Banque centrale devait fournir au gouvernement des informations économiques et financières et soumettre au ministère des Finances un rapport annuel sur ses activités en tant qu'agent financier du gouvernement. Source : articles 8 et 20 du même decret. De plus, la banque était autorisée à faire des avances au gouvernement pour une période restreinte et dans la limite de 10% de la moyenne des recettes encaissées au cours des trois dernières années. Source : Article 44 de la loi numéro 12 155. Naturellement la banque avait bénéficié d'un monopole d'émission monétaire ( articles 35 à 41 de la loi numéro 12 155 ) et devait détenir des réserves de changes d'au moins 25% de la monnaie en circulation. Ce monopole lui est demeuré formellement acquis mais a été sérieusement mis à l'épreuve dans les années 1980 et à la fin des années 1990 quand plusieurs provinces ont commencé à émettre des obligations avec pouvoir libératoire.
Ces quasi monnaies ont été complètement absorbées au lendemain de la crise financière de 2002 - 2003. De plus, la Banque centrale pouvait acheter des obligations d'Etat dans la limite du montant de son capital et de ses réserves. Source : Article 34 b) de la loi numéro 12 155. La banque qui avait été nationalisée en 1946, avait été caractérisée comme étant une agence nationale autonome jouissant d'une totale indépendance dans l'accomplissement de ses fonctions. Source : Article 1 du décret numéro 14 957 de mai 1946. Mais ultérieurement, dans le cadre de la nouvelle loi numéro 13 571 et du décretgouvernemental numéro 25 120 promulguées en 1949, il fut décidé qu'elle était désormais " dépendante du ministère des Finances ". Source : article 1 du décret gouvernemental numéro 25 120 d'octobre 1949. En outre, il fut explicitement reconnu au ministère le pouvoir de diriger la Banque centrale dans l'élaboration et la réalisation de son budget propre et de surveiller ses conseillers juridiques. Source : décret gouvernemntal numéro 27 425 d'octobre 1949. De plus, sous la loi de 1949, son président et son vice président n'étaient autre que, respectivement le ministre des Finances et le sous secrétaire d'Etat aux Finances. Source : article 6 du décret gouvernemental numéro 25 120 d'octobre 1949. Sur le plan fonctionnel, les règles définissant les relations de la Banque centrale avec le Trésor public sont restées quasiment incahcnées, y compris en ce qui concerne les limites des avances qu'elle pouvait consentir au gouvernement, bien que la limite de 10% de la moyenne des recettes encaissées au cours des trois dernières années ait été élargie à 15% par l'article 30 du décret de 1949.
Etant désormais nationalisée, la banque devait soumettre ses comptes annuels au gouvernement et un membre du gouvernement avait le droit d'inspecter les réserves en devises. Sources pour les comptes annuels : Article 51 du décret de 1946 et article 46 du décret de 1949. Source pour les réserves en devises : Articles 53, 53 et 55 du décret de 1949. Par ailleurs, la Banque centrale est devenue le superviseur du système de la Banque centrale de la république d'Argentine, composée de divers établissements financiers publics. Source : Articles 56 - 57 du même décret de 1949. De plus, l'administration du contrôle des changes avait été transféré à la Banque centrale. Source : Décret numéro 12 596 de mai 1946 et articles 40, 41 et 42 du décret numéro 25120. Ainsi que de l'administration de la bourse des valeurs. Source : Articles 43, 44 du décret numéro 25 120 d'octobre 1949. A partir de 1957, la Banque centrale, bien que toujours nationalisée, retrouva un certain niveau d'autonomie par rapport au pouvoir exécutif. Elle fut à nouveau définie comme un agence nationale autonome. Source : article 1 du décret loi numéro 13 126 d'octobre 1957 ratifiée ensuite par la loi numéro 14 467 de septembre 1958. Et son président et vice président cessèrent d'être aussi membres du gouvernement. Source : article 6 du même décret loi numéro 13 126. Cependant, ses fonctions devaient être exercées conformément aux " directives fondamentales du gouvernement national en matière de politique économique ". Source : Article 1 du même décret loi numéro 13 126.
En matière de contrôle des changes, tout particulièrement, la Banque centrale restait soumise aux " décisions et instructions du ministère de l'Economie ". Source : article 1 du décret loi 4 611 d'avril 1958. En outre, une nouvelle instance fut définie :a le sindico, un contrôleur désigné par le gouvernement et approuvé par le Sénat. La ratification par le Sénat ne peut être interprétée également comme la volonté d'accorder un peu plus d'autonomie à la Banque centrale dans la mesure où, antérieurement, la nomination du contrôleur ne relevait que du pouvoir exécutif. Le sindico avait pour fonction de superviser les activités de la Banque centrale et d'informer le gouvernement de sa gestion ainsi que de certifier les comptes annuels. Source :: Article 39, du décret loi numéro 13 126 d'octobre 1957. Sur le plan fonctionnel, la limite des avances de la Banque au Trésor public fut portée à 30% du montant des recettes des 12 mois précédents. Source : article 27 du même décret loi numéro 13 126 d'octobre 1957. En outre, en vertu de la capacité de la Banque centrale à écheter et vendre des titres publics et dans le cadre de sa mission de régulation des marchés, un fonds constitué des obligations émises en contrepartie des avances de la banque à l'Etat pouvait être créé, à la hauteur de 15% du total des avances et bien qu'une telle limite pût être augmentée dans certains cas. Source : article 18 m ) du même décret loi. En outre, un article transitoire, l'article 49, autorisait des montants bien plus importants.
Une nouvelle évolution eut lieu en 1973. Elle accompagna une renationalisation des dépôts bancaires semblable à celle de la fin des années 1940 et du début des années 1950. La Banque centrale, chargée de l'administration de ce système, fut explicitement placée sous la direction du gouvernement. " Les activités de la Banque suivront les instructions du gouvernement central via le ministère de l'Economie en matière de politique économique, monétaire, des changes et financières. " Source : article 4, loi numéro 20 539 d'octobre 1973. L'appelation même de ministère de l'Economie consacrait un retour aux années 1960, période durant laquelle on avait pour la première fois abandonné la dénomination plus traditionnelle de " ministère des Finances ". Les limites des avances que la Banque centrale pouvait consentir au gouvernement restèrent inchangées mais son portefeuille d'obligations d'Etat put dès lors atteindre 35% du total des dépôts du système bancaire. Source : Articles 27 et 52 respectivement, de la même loi numéro 20 539 d'octobre 1973. Le retour à un gouvernement militaire entre 1976 et 1983, ne modifia pas véritablement les relations entre la Banque centrale et le pouvoir exécutif alors même que le système financier dans son ensemble fut soumis à une libéralisation assez profonde. la loi numéro 21 364 de juillet 1976 laissa donc globalement la Banque centrale soumise aux directives du gouvernement. Source : article 4 de la loi numéro 21 364. PAGE 211
Ce n'est qu'en 1992 que la banque centrale a été reconnue au moins formellement comme institution indépendante du gouvernement : " Pour ce qui concerne la formulation de l'exécution des politiques monétaires et financière, la banque centrale ne dépendra pas d'ordres, d'indications ou d'instructions émanant du pouvoir exécutif. Source : Article 3 de la loi numéro 24 144. Le premier ministre de l'Economie ou son représentant était autorisé à participer aux réunions du conseil des gouverneurs mais sans droit de vote. C'est marqué dans l'article 2. En outre, le président du conseil des gouverneurs devait et doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur les activités de la banque et présenter une fois par an au moins, un rapport sur la nature des politiques monétaires, des changes et financières en cours de réalisation. Il est vrai cependant que cette autonomie ne fut accordée qu'au moment même où la Banque centrale était privée de la plupart de ses instruments de politique monétaire. Mais cette formulation est demeurée jusqu'à nos jours alors même qu'avec l'effondrement du Currendy Board, la Banque nationale a recouvré sa fonction de prêteur en dernier ressort et même, quoique de façon limitée, sa capacité à prêter à l'Etat. Sur le plan fonctionnel, les statuts de 1992 ont innové sur deux points. D'abord en dépit des restrictions de la loi dite de convertibilité instituant le système de Currency Board, les obligations d'Etat détenues en portefeuille par la Banque centrale pouvaient gager jusqu'à un tiers des émissions monétaires. Source : article 20 de la loi numéro 24 144.
D'autre part, la fonction de sindico fut complétée par la désignation d'un contrôleur adjoint.
il y a 3 mois
Je condamne fermement nonobstant.

Les deux contrôleurs devaient être nommés par le pouvoir exécutif et approuvés par le Sénat, de manière à les rendre totalement indépendants de la Banque centrale. A la différence du contrôleur institué en 1957, ils devaient désormais rendre des comptes devant le parlement et pas seulement au conseil de la banque et au gouvernement. Source : article 36 de la loi numéro 24 144. On imposa également de faire contrôler les comptes annuels de la banque par des audits privés. Source : article 39 de la loi numéro 24 144. Finalement, le régime en vigueur depuis 2002, bien qu'il préserve comme on l'a dit, l'indépendance de la Banque centrale à l'égard du pouvoir exécutif, a autorisé des avances au gouvernement à hauteur de 12% de M0 ( c'est à dire la base monétaire ). De plus, des prêts pouvaient être consentis par la Banque centrale à l'Etat à hauteur de 10% du montant des recettes encaissées par le Trésor public au cours des 12 derniers mois. Le montant total de ces prêts à l'exception de ceux affectés à l'amortissement des créances des institutions financières internationales, ne peut pas non plus dépasser 12% de M0. Source : Article 15 de la loi numéro 25 780. Les dispositions relatives aux sindicos et à l'audit privé externe sont restées inchangées. Mais l'article 40 des status actuels ajoute à ces obligations la nécessité d'un audit public externe confié à la Auditoria General de la Nacion, un organe du parlement dont la présidence est, de par la loi, toujours confiée à un membre du principal parti de l'opposition. Source : article 19 de la loi numéro 25 780.
LA BANQUE CENTRALE ET LE CONTROLE DU SYSTEME BANCAIRE.
Comme il a déjà été indiqué, dès l'origine et à la différence des banques centrales des pays d'Amérique du Sud de la façade pacifique, la Banque centrale d'Argentine a été chargée du contrôle du système bancaire. Cette attribution s'explique en fait par la nécessité à cette époque, de tenter de sauver un certain nombre de banques de la faillite. La loi bancaire numéro 12 156 de mars 1935, votée simultanément à la création de la banque nationale, prescrivait que le gouvernement ne délivrait une autorisation officielle aux banques qu'après avis de la Banque centrale. Source : article 1 de la loi numéro 12 156 de mars 1935. Les banques, une fois autorisées, devaient se conformer à certaines règles prudentielles et tenir la Banque centrale informée de toute modification de leurs activités. Source : décrit numéro 65 227, réglementant la loi bancaire, et les articles 27, 28, 29, 30 et 31. Elles étaient tenus de déposer auprès de la Banque centrale les deux tiers de leur passif exigible. la banque pouvait toutefois les dispensées temporairement de cette obligation. Source : Loi 12 155, article 42 et concernant l'obligation de détenir des réserves, loi 12 156, article 2 et décret 65 227, articles 11 à 18. La claude de renonciation fut incluse en tant qu'article 3 de la loi bancaire numéro 12 156. Elle fut par ailleurs, autorisée à réescompter du papier à court terme et à accorder des avances aux banques actionnaires de son capital pour une période n'excédant pas 90 jours et avec un nantissement adéquat. Source : loi 12 155 de mars 1935, article 32 d ) et e ) pour le réescompte et f) et g) pour les avances.
D'autre part, les banques avaient l'obligation de remettre un rapport mensuel, de nature confidentielle, sur leurs activités et toute information que la banque centrale jugerait nécessaire. Source : loi 12 156, articles 10 et 11. L'inspection des banques était une prérogative de la Banque centrale. En vertu de la loi bancaire, c'est à dire du décret 65 227, c'est son président qui était directement chargé de cette surveillance, moyennant l'obligation d'en tenir son conseil informé. Mais seulement dans les grandes lignes, et à son entière discrétion pour ce qui était des détails. Source : articles 13, 13 et 14 et décret 65 227, articles 19 à 26. Enfin, la banque centrale devait agir en tant qu'administrateur provisoire en cas de liquidation d'un établissement bancaire. Source : Article 33 du décret 65 227. Avec la nationalisaition des dépôts en 1946, les banques devinrent purement et simplement des agents de la Banque centrale. Elles recevaient des dépôts à son ordre et consentaient des crédits sans considération aucune du montant de leurs capitaux propres et de leurs réserves. Ces crédits étaient accordés par les banques en fonction de leur faculté de réescompte auprès de la Banque centrale. Et indépendamment de leur propre capacité à attirer des déposants. Source : décret 11 554 de mai 1946, articles de 1 à 7. Une assurance dépôt fut aussi introduite et mise à la charge de la Banque centrale. Source : décret 11 554 et décret 25 120 d'octobre 1949, article 5.
L'institut d'émission conserva donc la faculté de réescompte ainsi que la possibilité de consentir des avances au système bancaire, soit à partir de ressources indirectes provenant des dépôts bancaires, soit moyennant la réallocation d'autres ressources. De la sorte, elle conservait aussi faculté de déterminer les taux d'intérêt pour l'ensemble du système. Source : décret numéro 14 957. Naturellement l'obligation faite aux établissements de crédit de tenir la Banque cenrale informée demeura ainsi que le pouvoir de cette dernière d'inspecter les banques et d'agir en tant qu'administrateur provisoire en cas de liquidation. Source : décret 25 120, articles 15 à 22. Le pouvoir de la Banque centrale d'exiger de la part d'une banque dont la liquidité ou la solvabilité était menacée un programme de normalisation de sa situation fut aussi clairement instaurée, de même que les limitations subséquentes qui pouvaient être imposées à la distribution de dividendes. Source : article 33 du décret 25 120. En 1957, la responsabilité des dépôts et la libre capacité à consentir des crédits qui en résulteraient furent rendues aux banques.
Mais l'assurance dépôt resta à la charge de la Banque centrale. Cette dernière se vit en outre confier la surveillance du système financier dans son ensemble puisque son droit de contrôle s'étendait désormais aux institutions d'épargne et autres intermédiaires financiers ainsi qu'aux entreprises impliquées dans les opérations de change et aux sociétés de Bourse. Source : décret loi 13 127 et aussi le décret loi 13 126 articles 40 et 41 et à propos des opérations de change, le décret loi 4 611, d'avril 1958 ainsi que la loi 16 432 de novembre 1961. L'indépendance opérationnelle reconnue aux banques commerciales ne retira pas à la Banque centrale le pouvoir, lui même soumis à des règles, de déterminer les taux d'intérêt, aussi b ien débiteurs que créditeurs. Source : articles 10 et 16 du décret loi 13 127. Elle conserva également al faculté de réescompter le papier commercial et de garantir des avances aux banques sur nantissement. Source : décret loi 13 126. La Banque centrale, en outre, fixait pour chaque banque un niveau de réserves minimum assorti de pénalités en cas de non respect de cette norme. Source : décret loi 13 127 articles 12 à 15. L'obligation de fourni régulièrement des informations à la Banque centrale et la mission de surveillance du système bancaire exercée par cette dernière ont été conservées et un chapitre entier, consacré aux pénalités en cas de non respect de la réglementation a été ajoué à la réglementation. Source : Articles 27 à 31 et chapitre IX. La procédure de liquidation judiciaire est également restée entre les mains de la Banque centrale. Source : décret loi 13 127, chapitre X cette fois.
La période 1973 1976 a vu, on l'a mentionné, un bref retour au concept de dépôts nationalisés. La Banque centrale rçu donc le pouvoir de réallouer le crédit dans des limites préalablement attribuées à chaque établissement financier. Source : loi 20 539, article 17, c ) et d ). Mais la libéralisation complète des marchés de l'argent, décidée en 1976 par le régime militaire, retire à la Banque centrale son contrôle directe sur la distribution du crédit bancaire et le priva même de son pouvoir de fixer les taux d'intérêt. Son rôle se bornait désormais au réescompte du papier commercial et à l'octoroi d'avances sur garanties. Source : loi 20 539 modifiée par les lois 21 364 de juillet 1976, 21 547, de mars 1977 et 21 571 de mai 1977, article 17. Cette évolution a encore été accentuée par les statuts de 1992 destinées à adopter les relations entre la Banque centrale et les établissements financiers dans le cadre du régime de caisse d'émission instauré au début de 1991 : la Banque centrale conserva sa faculté de réescompte et d'octroi d'avances au profit des banques, mais seulement pour une période de 30 jours et dans la limite de leur actif net. Source : loi 24 144, article 17. Un autre changement important consista à créer une direction des institutions bancaires et cambiaires, entité semi autonome, une agence décentralisée, dépendant directement du président de la Banque centrale mais dotée d'une administration propre, placée sous la responsabilité d'un directeur, d'un directeur adjoint et de directeurs généraux adjoints qui se répartissaient ses différentes attributions.
Les deux contrôleurs devaient être nommés par le pouvoir exécutif et approuvés par le Sénat, de manière à les rendre totalement indépendants de la Banque centrale. A la différence du contrôleur institué en 1957, ils devaient désormais rendre des comptes devant le parlement et pas seulement au conseil de la banque et au gouvernement. Source : article 36 de la loi numéro 24 144. On imposa également de faire contrôler les comptes annuels de la banque par des audits privés. Source : article 39 de la loi numéro 24 144. Finalement, le régime en vigueur depuis 2002, bien qu'il préserve comme on l'a dit, l'indépendance de la Banque centrale à l'égard du pouvoir exécutif, a autorisé des avances au gouvernement à hauteur de 12% de M0 ( c'est à dire la base monétaire ). De plus, des prêts pouvaient être consentis par la Banque centrale à l'Etat à hauteur de 10% du montant des recettes encaissées par le Trésor public au cours des 12 derniers mois. Le montant total de ces prêts à l'exception de ceux affectés à l'amortissement des créances des institutions financières internationales, ne peut pas non plus dépasser 12% de M0. Source : Article 15 de la loi numéro 25 780. Les dispositions relatives aux sindicos et à l'audit privé externe sont restées inchangées. Mais l'article 40 des status actuels ajoute à ces obligations la nécessité d'un audit public externe confié à la Auditoria General de la Nacion, un organe du parlement dont la présidence est, de par la loi, toujours confiée à un membre du principal parti de l'opposition. Source : article 19 de la loi numéro 25 780.
LA BANQUE CENTRALE ET LE CONTROLE DU SYSTEME BANCAIRE.
Comme il a déjà été indiqué, dès l'origine et à la différence des banques centrales des pays d'Amérique du Sud de la façade pacifique, la Banque centrale d'Argentine a été chargée du contrôle du système bancaire. Cette attribution s'explique en fait par la nécessité à cette époque, de tenter de sauver un certain nombre de banques de la faillite. La loi bancaire numéro 12 156 de mars 1935, votée simultanément à la création de la banque nationale, prescrivait que le gouvernement ne délivrait une autorisation officielle aux banques qu'après avis de la Banque centrale. Source : article 1 de la loi numéro 12 156 de mars 1935. Les banques, une fois autorisées, devaient se conformer à certaines règles prudentielles et tenir la Banque centrale informée de toute modification de leurs activités. Source : décrit numéro 65 227, réglementant la loi bancaire, et les articles 27, 28, 29, 30 et 31. Elles étaient tenus de déposer auprès de la Banque centrale les deux tiers de leur passif exigible. la banque pouvait toutefois les dispensées temporairement de cette obligation. Source : Loi 12 155, article 42 et concernant l'obligation de détenir des réserves, loi 12 156, article 2 et décret 65 227, articles 11 à 18. La claude de renonciation fut incluse en tant qu'article 3 de la loi bancaire numéro 12 156. Elle fut par ailleurs, autorisée à réescompter du papier à court terme et à accorder des avances aux banques actionnaires de son capital pour une période n'excédant pas 90 jours et avec un nantissement adéquat. Source : loi 12 155 de mars 1935, article 32 d ) et e ) pour le réescompte et f) et g) pour les avances.
D'autre part, les banques avaient l'obligation de remettre un rapport mensuel, de nature confidentielle, sur leurs activités et toute information que la banque centrale jugerait nécessaire. Source : loi 12 156, articles 10 et 11. L'inspection des banques était une prérogative de la Banque centrale. En vertu de la loi bancaire, c'est à dire du décret 65 227, c'est son président qui était directement chargé de cette surveillance, moyennant l'obligation d'en tenir son conseil informé. Mais seulement dans les grandes lignes, et à son entière discrétion pour ce qui était des détails. Source : articles 13, 13 et 14 et décret 65 227, articles 19 à 26. Enfin, la banque centrale devait agir en tant qu'administrateur provisoire en cas de liquidation d'un établissement bancaire. Source : Article 33 du décret 65 227. Avec la nationalisaition des dépôts en 1946, les banques devinrent purement et simplement des agents de la Banque centrale. Elles recevaient des dépôts à son ordre et consentaient des crédits sans considération aucune du montant de leurs capitaux propres et de leurs réserves. Ces crédits étaient accordés par les banques en fonction de leur faculté de réescompte auprès de la Banque centrale. Et indépendamment de leur propre capacité à attirer des déposants. Source : décret 11 554 de mai 1946, articles de 1 à 7. Une assurance dépôt fut aussi introduite et mise à la charge de la Banque centrale. Source : décret 11 554 et décret 25 120 d'octobre 1949, article 5.
L'institut d'émission conserva donc la faculté de réescompte ainsi que la possibilité de consentir des avances au système bancaire, soit à partir de ressources indirectes provenant des dépôts bancaires, soit moyennant la réallocation d'autres ressources. De la sorte, elle conservait aussi faculté de déterminer les taux d'intérêt pour l'ensemble du système. Source : décret numéro 14 957. Naturellement l'obligation faite aux établissements de crédit de tenir la Banque cenrale informée demeura ainsi que le pouvoir de cette dernière d'inspecter les banques et d'agir en tant qu'administrateur provisoire en cas de liquidation. Source : décret 25 120, articles 15 à 22. Le pouvoir de la Banque centrale d'exiger de la part d'une banque dont la liquidité ou la solvabilité était menacée un programme de normalisation de sa situation fut aussi clairement instaurée, de même que les limitations subséquentes qui pouvaient être imposées à la distribution de dividendes. Source : article 33 du décret 25 120. En 1957, la responsabilité des dépôts et la libre capacité à consentir des crédits qui en résulteraient furent rendues aux banques.
Mais l'assurance dépôt resta à la charge de la Banque centrale. Cette dernière se vit en outre confier la surveillance du système financier dans son ensemble puisque son droit de contrôle s'étendait désormais aux institutions d'épargne et autres intermédiaires financiers ainsi qu'aux entreprises impliquées dans les opérations de change et aux sociétés de Bourse. Source : décret loi 13 127 et aussi le décret loi 13 126 articles 40 et 41 et à propos des opérations de change, le décret loi 4 611, d'avril 1958 ainsi que la loi 16 432 de novembre 1961. L'indépendance opérationnelle reconnue aux banques commerciales ne retira pas à la Banque centrale le pouvoir, lui même soumis à des règles, de déterminer les taux d'intérêt, aussi b ien débiteurs que créditeurs. Source : articles 10 et 16 du décret loi 13 127. Elle conserva également al faculté de réescompter le papier commercial et de garantir des avances aux banques sur nantissement. Source : décret loi 13 126. La Banque centrale, en outre, fixait pour chaque banque un niveau de réserves minimum assorti de pénalités en cas de non respect de cette norme. Source : décret loi 13 127 articles 12 à 15. L'obligation de fourni régulièrement des informations à la Banque centrale et la mission de surveillance du système bancaire exercée par cette dernière ont été conservées et un chapitre entier, consacré aux pénalités en cas de non respect de la réglementation a été ajoué à la réglementation. Source : Articles 27 à 31 et chapitre IX. La procédure de liquidation judiciaire est également restée entre les mains de la Banque centrale. Source : décret loi 13 127, chapitre X cette fois.
La période 1973 1976 a vu, on l'a mentionné, un bref retour au concept de dépôts nationalisés. La Banque centrale rçu donc le pouvoir de réallouer le crédit dans des limites préalablement attribuées à chaque établissement financier. Source : loi 20 539, article 17, c ) et d ). Mais la libéralisation complète des marchés de l'argent, décidée en 1976 par le régime militaire, retire à la Banque centrale son contrôle directe sur la distribution du crédit bancaire et le priva même de son pouvoir de fixer les taux d'intérêt. Son rôle se bornait désormais au réescompte du papier commercial et à l'octoroi d'avances sur garanties. Source : loi 20 539 modifiée par les lois 21 364 de juillet 1976, 21 547, de mars 1977 et 21 571 de mai 1977, article 17. Cette évolution a encore été accentuée par les statuts de 1992 destinées à adopter les relations entre la Banque centrale et les établissements financiers dans le cadre du régime de caisse d'émission instauré au début de 1991 : la Banque centrale conserva sa faculté de réescompte et d'octroi d'avances au profit des banques, mais seulement pour une période de 30 jours et dans la limite de leur actif net. Source : loi 24 144, article 17. Un autre changement important consista à créer une direction des institutions bancaires et cambiaires, entité semi autonome, une agence décentralisée, dépendant directement du président de la Banque centrale mais dotée d'une administration propre, placée sous la responsabilité d'un directeur, d'un directeur adjoint et de directeurs généraux adjoints qui se répartissaient ses différentes attributions.
il y a 3 mois
En parlant de banques, voici quelques documentaires qui pourraient vous intéresser pour vous redpill sur l'arnaque du système bancaire et monétaire.

Cependant, la surveillance des normes réglementaires fondamentales ainsi que le pouvoir d'autoriser l'ouverture ou la fermeture d'un établissement financier demeurèrent du ressort du conseil de la Banque centrale. Un autre changement important fut de confier au pouvoir judiciaire la capacité de nommer un administrateur provisoire en cas de mise en liquidation d'un établissement financier. Cependant, le lancement des procédures de faillite contre un établissement financier ne pouvait être demandé que par la Banque centrale elle même. Source : loi 24 144, titre VII. Avec la fin du régime de Currency Board au début de 2002, la Banque centrale retrouva son rôle de prêteur en derneir ressort. La Banque centrale est désormais de nouveau autorisée, quoique dans des limites assez strictes mais qui peuvent être dépassées dans certains cas, à réecompter et à accorder des avances aux établissements financiers. En fait, au cours de la première année qui a suivi l'explosion de la crise au tout début des années 2000, la Banque centrale avait apporté un soutien massif à quelques établissements financiers. Cette composante de son bilan est en cours de résorption progressive. Parallèlement, le portefeuille de prêts et d'obligations d'Etat des banques ayant bénéficé d'aides publiques a été restructuré à la fin de 2001 et ces banques se sont également vu accorder un moratoire pour l'application de la réglementation en matière de refinancement par la Banque centrale. Source : loi 25 562, article 6. Les autres aspects de la loi de 1992, en revanche, sont globalement demeurés en vigueur.
BONS DU TRESOR RUSSE
Le rapport de la commission des finances du 9 mars 1929 insiste sur le fait, important pour rassuer un grand nombre de parlementaires, que cette convention ne change rien au fait que c'est l'Etat français et non la Banque de France, qui demeure créancier de la Russie. Le statut des bons escomptés pour le compte de la Russie change à nouveau quelques mois plus tard avec l'adoption de la loi monétaire de juin 1928. Il est alors décidé de convertir, au bilan de la Banque de France, les bons du Trésor français escomptés pour le compte de la Russie en bons de la Caisse autonome d'amortissement ( CAA ). Créée initialement pour liquider les BDN, sans lien avec la Banque de France, la CAA sert ainsi également à mettre fin au versement à un compte spécial de réserve d'une partie des intérêts servies sur les avances de la Banque de France à l'Etat, qui continue un amortissement fictif dans la mesure où celui ci n'est obtenu qu'au moyen d'exécdents budgétaires comme l'explique le ministre des Finances, Joseph Caillaux dans une lettre au gouverneur le 30 mai 1925. Source : ABF1069199001/48, lettre de Joseph Cailleux au gouverneur, le 30 mai 1925. L'implication de la CAA dans laé liquidation des bons escomptés pour le compte de la Russie explique la signature dans le cadre de la loi monétaire du 25 juin 1928, d'une nouvelle convention entre la Banque centrale et la CAA. Source : " Le Pape et l'Empereur " Pages 412 - 413. Ecrit par Bertrand Blancheton.
Selon les termes de cette convention datée du 23 juin, les bons du Trésor arrêtent de produire des intérêts au profit de la Banque centrale et sont pris en charge par la CAA contre des bons de caisse. Source : article 2 de la loi. En échange des bons du Trésor visés par l'article 1 ci dessus, la Caisse autonome de gestion remettra à la Banque de France des bons de caisse sans intérêt à trois mois d'échéance maximum pour un montant égal à celui des bons du Trésor supervisés. Ces bons de caisse seront domiciliés à la Banque de France, libellés en blanc et au porteur, émis en coupures de 100 000 francs au maximum. C'est la CAA qui est chargée d'effectuer l'amortissement. La solution selon laquelle la Banque de France aurait acheté directement des BDN pour les liquider n'a en revanche jamais été officiellement considérée, sans doute car cela aurait été en contraductiona vec la politique de liquidation de ces bonq qui était précisément au fondement de la création de la CAA.
PAGE 110
Cependant, la surveillance des normes réglementaires fondamentales ainsi que le pouvoir d'autoriser l'ouverture ou la fermeture d'un établissement financier demeurèrent du ressort du conseil de la Banque centrale. Un autre changement important fut de confier au pouvoir judiciaire la capacité de nommer un administrateur provisoire en cas de mise en liquidation d'un établissement financier. Cependant, le lancement des procédures de faillite contre un établissement financier ne pouvait être demandé que par la Banque centrale elle même. Source : loi 24 144, titre VII. Avec la fin du régime de Currency Board au début de 2002, la Banque centrale retrouva son rôle de prêteur en derneir ressort. La Banque centrale est désormais de nouveau autorisée, quoique dans des limites assez strictes mais qui peuvent être dépassées dans certains cas, à réecompter et à accorder des avances aux établissements financiers. En fait, au cours de la première année qui a suivi l'explosion de la crise au tout début des années 2000, la Banque centrale avait apporté un soutien massif à quelques établissements financiers. Cette composante de son bilan est en cours de résorption progressive. Parallèlement, le portefeuille de prêts et d'obligations d'Etat des banques ayant bénéficé d'aides publiques a été restructuré à la fin de 2001 et ces banques se sont également vu accorder un moratoire pour l'application de la réglementation en matière de refinancement par la Banque centrale. Source : loi 25 562, article 6. Les autres aspects de la loi de 1992, en revanche, sont globalement demeurés en vigueur.
BONS DU TRESOR RUSSE
Le rapport de la commission des finances du 9 mars 1929 insiste sur le fait, important pour rassuer un grand nombre de parlementaires, que cette convention ne change rien au fait que c'est l'Etat français et non la Banque de France, qui demeure créancier de la Russie. Le statut des bons escomptés pour le compte de la Russie change à nouveau quelques mois plus tard avec l'adoption de la loi monétaire de juin 1928. Il est alors décidé de convertir, au bilan de la Banque de France, les bons du Trésor français escomptés pour le compte de la Russie en bons de la Caisse autonome d'amortissement ( CAA ). Créée initialement pour liquider les BDN, sans lien avec la Banque de France, la CAA sert ainsi également à mettre fin au versement à un compte spécial de réserve d'une partie des intérêts servies sur les avances de la Banque de France à l'Etat, qui continue un amortissement fictif dans la mesure où celui ci n'est obtenu qu'au moyen d'exécdents budgétaires comme l'explique le ministre des Finances, Joseph Caillaux dans une lettre au gouverneur le 30 mai 1925. Source : ABF1069199001/48, lettre de Joseph Cailleux au gouverneur, le 30 mai 1925. L'implication de la CAA dans laé liquidation des bons escomptés pour le compte de la Russie explique la signature dans le cadre de la loi monétaire du 25 juin 1928, d'une nouvelle convention entre la Banque centrale et la CAA. Source : " Le Pape et l'Empereur " Pages 412 - 413. Ecrit par Bertrand Blancheton.
Selon les termes de cette convention datée du 23 juin, les bons du Trésor arrêtent de produire des intérêts au profit de la Banque centrale et sont pris en charge par la CAA contre des bons de caisse. Source : article 2 de la loi. En échange des bons du Trésor visés par l'article 1 ci dessus, la Caisse autonome de gestion remettra à la Banque de France des bons de caisse sans intérêt à trois mois d'échéance maximum pour un montant égal à celui des bons du Trésor supervisés. Ces bons de caisse seront domiciliés à la Banque de France, libellés en blanc et au porteur, émis en coupures de 100 000 francs au maximum. C'est la CAA qui est chargée d'effectuer l'amortissement. La solution selon laquelle la Banque de France aurait acheté directement des BDN pour les liquider n'a en revanche jamais été officiellement considérée, sans doute car cela aurait été en contraductiona vec la politique de liquidation de ces bonq qui était précisément au fondement de la création de la CAA.
PAGE 110
il y a 3 mois
BANQUE CENTRALE D'ARGENTINE
EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE LA BANQUE
La structure de la gouvernance de la Banque centrale d'Argentine ne pouvait que refléter les changements profonds qui, au cours de l'histoire mouvementée, ont affecté ses missions, ses rapports avec l'Etat et son rôle vis à vis du système bancaire. Le gouvernement de la banque a été normalement placé, dès l'origine, sous l'autorité d'un conseil, organe suprême, et d'un président du conseil assisté d'un directeur général et de directeurs généraux adjoints. Toutefois, la composition du conseil, son rôle et ses rapports avec les autres autres pouvoirs et autorités de la République ont considérablement changé. Globalement, le conseil a été composé dès l'origine et pendant plus de 40 ans, au moins pour partie, de représentants du secteur bancaire. Pendant un laps de temps plus court, il s'est composé aussi de représentants d'autres secteurs de la vie économique ainsi que de divers ministères. Ce n'est qu'à partir de 1981 que le conseil a été totalement indépendant, du moins dans la lettre, de la représentation de ces divers secteurs. Parallèlement, une autonomie plus grande du conseil vis à vis du pouvoir exécutif a été instaurée en renforçant les conditions de la désignation de son président et des autres membres du conseil et en prévoyant l'approbation de celle ci par le Sénat, comme c'est déjà le cas, en vertu de la Constitution de la République, pour les hauts fonctionnaires des forces armées et de la diplomatie, afin de mieux les prémunir des pressions ou d'un limogeage de la part du gouvernement. Aux termes des status primitifs, la Banque centrale étant une institution mixte, les actionnaires privés, qui tous étaient en fait les représentants d'institutions financières, disposaient d'un certain pouvoir. Il était prévu, en pratique, que le conseil comprenne un président, un vice président et 12 administrateurs.
Le président et le vice président étaient désignés par le pouvoir exécutif parmi 3 candidats proposés pour chaque poste par les actionnaires de la Banque centrale. Ces nominations étaient également soumises à l'approbation du Sénat de la République. Il s'agissait de fonctionnaires à plein temps et la durée de leurs fonctions était de 7 ans, à une époque où celle du président de la République n'était que de 6 ans. En outre, ils ne pouvaient être révoqués qu'au terme d'une procédure de mise en accusation. Source : loi 12 155 de mars 1935, article 9 et 10. Sur les 12 administrateurs, nommés pour une durée de seulement 3 ans, l'un était directement nommé par le gouvernement, un autre représentait le Banco de la Nacion Argentina, une banque publique regroupant très vraisemblablement le quart des dépôts et des crédits de tout le système bancaire. Les actionnaires de la Banque centrale avaient le pouvoit de nommer 6 administrateurs. L'un d'entre eux devait être élu par les représentants des banques provinciales, en particulier ceux qu Banco de la Provincia de Buenos Aires, la plus vieille banque d'Argentine, propriété de la province la plus riche et la plus grande de ce pays fédéra. 3 autres administrateurs étaient élus par les représentants de banques locales et les 2 restants par les représentants de banques étrangères. Enfin, 4 administrateurs devaient être élus par l'ensemble de l'assemblée des actionnaires de la Banque centrale, mais sur proposition du conseil et après consultation des organisations professionnels représentatives des milieux agricoles, du secteur de l'élevage, du commerce et de l'industrie. Source : article 12 et 13 de la loi 12 155 de mars 1935. Les administrateurs ne percevaient pas de traitement à moins de devenir membres du comité consultatif.
Le conseil devait se réunir au moins tous les 15 jours et prendre des décisions sur toutes questions statuaires. La gestion quotidienne de la Banque centrale dépendait du président qui pouvait créer une comité consultatif auquel siégeaient le vice président et 2 administrateurs choisis par le conseil, l'un d'entre eux devant être un banquier. Ce comité devait se réunir au moins 1 fois par semaine. Source : articles 18, 19 et 20 de la loi 12 155 de mars 1935. Il n'est pas fait mention du personnel de direction de la Banque centrale dans les status mais dès l'origine et pendant près de 10 ans, le directeur général, on l'a dit, fut un économiste de premier plan, Raul Prebish. Il a contribué à modeler la Banque centrale selon des critères extraordinairement élevés de compétence, de discipline et d'intégrité morale. En outre, une fois par an, l'assemblée générale des actionnaires se réunissait pour discuter et approuver le rapport annuel, les comptes de la banque et la répartition des bénéfices entre réserves et dividences. Source : articles 21, 22, 23 et 24 de la loi 12 155 de mars 1935. Aucun actionnaire individuel ne pouvait réunir plus d'un dixième du total des droits de vote. La nationalisation de la Banque centrale en 1946 modifia ses règles de gouvernance. Elle plaça l'institut d'émission sous la responsabilité d'un président, d'un vice président et d'un conseil de 13 membres. Source : décrets loi 8503 de mars 1946, 11 544 de 1946, et 14 957 de mai 1946.
Le président et le vice président étaient en fonction pour des durées de respectivement 7 et 4 ans et bien qu'ils fussent nommés par le gouvernement, ils ne pouvaient toujours être révoqués qu'au terme des procédures de mise en accusation déjà prévues par les status de 1935. 3 fauteuils d'administrateurs étaient réservés de droit aux présidents de 3 banques publiques. Les autres administrateurs étaient nommés soit par le chef du gouvernement, soit par 5 ministères différents, soit encore par les représentants professionnels des agriculteurs, des éleveurs, de l'industrie, du commerce, mais aussi, c'était une innovation, des salariés. Source : décret 14 957 de mai 1946, articles de 5 à 10. Ultérieurement, le président d'un autre établissement financier public, le Caja Nacional de Ahorro Postal, c'est à dire une institution d'épargne postale, fut adjoint au conseil via le décret 15 561 de mai 1946. La durée de leurs fonctions, 4 ans seulement, était plus courte que celles du président et du vice président, mais ils étaient désormais rémunérés. Plus aucune place n'était donc laissée aux banques privées, qu'elles soient locales ou étrangères. En outre, il était spécifié que tous les membres du conseil devaient désormais être nés en Argentine. L'assemblée générale des actionnaires ayant disparu, le conseil eut à reprendre certaines de ses fonctions ainsi que certaines des fonctions jusqu'alors exercées par le président; Source : article 13 du décret 13 957 de mai 1946. Par ailleurs, il était désormais fait explicitement mention du management de la Banque centrale et il fut attribué davantage de pouvoir à ses directeurs.
Dans les faits, le directeurs général et un directeur général adjoint étaient nommés eux aussi par le gouvernement mais sur propositions du conseil. Ils devaient également être argentins de naissance et ne pouvaient eux aussi être révoqués qu'au terme de procédures légales de mise en accusation. l'administration de la Banque centrale leur était officiellement confiée, avec obligation de rendre compte quotidiennement de leur action au président. Source : articles 14, 15 et 16 du décret 14 957 de mai 1946. Les modalités de gouvernance issues de la nationalisation devaient encore évoluer dans les années qui suivirent. En 1949, il fut décidé que le gouvernement de la banque serait exercé par un président, un vice président et 9 administrateurs, tous argentins de naissance. Les fonctions du président et du vice président étaient désormais assurés respectivement par le ministre des Finances lui même et par son secrétaire d'Etat. 4 administrateurs étaient les présidents de 4 établissements financiers publics. Les 5 autres étaient nommés par le gouvernement pour une durée de 4 ans et représentaient les 5 secteurs de la vie économique déjà prescrits dans la législation de 1946. Ces nouvelles dispositions ne laissaient cette fois subsister plus aucune indépendance de la Banque centrale à l'égard du pouvoir exécutif. Source : décret 25 120 d'octobre 1949, chapitre III. Le gouvernement continuait, en outre, à nommer, sur proposition du conseil, le directeur général et le directeur général adjoint. A ces 2 hauts fonctionnaires fut de plus reconnue la capacité d'adapter le règlement intérieur de la Banque centrale en fonction des décisions du conseil. Source : décret 25 120 d'octobre 1949, chapitre IV. PAGE 219.
il y a 3 mois
STRUCTURES ET FONCTIONS DE LA BANQUE D'ARGENTINE DE 1935 A NOS JOURS.
L'abandon du principe de la " nationalisation " des dépôts bancaires conduisit à réformer radicalement en 1957 les modalités du gouvernement de la Banque centrale dans le sens d'une plus grande autonomie vis à vis du pouvoir politique. Ainsi, le président et le vice président cessèrent ils d'être en même temps membres du gouvernement. Ils restaient cependant nommés par le pouvoir politique. Mais leur nomination était soumise à l'approbation du Sénat de la République et la durée de leur mandat était portée à 7 ans, soit une année de plus que le président de la République. Leur révocation ne pouvait intervenir qu'au terme d'une procédure légale de mise en accusation. Source : décret loi 13 126 d'octobre 1957, articles 5 à 8. Par ailleurs, la fonction de directeur général fut dès lors confondue avec celle du président de la Banque centrale. Source : décret loi 5 382 d'avril 1958, article 1. Le pouvoir de nommer, promouvoir, suspendre et révoquer les responsables de la Banque centrale, qui revenait précédemment au conseil, fut transféré au président. Le conseil se composait du président et du vice président auxquels s'ajoutent 6 administrateurs nommés pour 4 ans. Le conseil, autre innovation notable, se doublait d'un conseil consultatif constitué de 12 membres avec voix consultative mais sans droit de vote et ne réunissant que trimestriellement. Sur les 6 administrateurs du conseil proprement dit, l'un était de droit le président de la Banco de la Nacion Argentina. Un autre fauteuil était réservé au président de l'une des banques provinciales publiques ou semi publiques choisies par le gouvernement parmi 3 candidates désignée par l'association professionnelle des banques provinciales. Les 4 administrateurs restants étaient choisis par le pouvoir exécutif, sur proposition du ministre de l'Economie, parmi des personnes à l'expérience professionnelle reconnue dans les domaines de la monnaie et de la banque. Source : décret 5 382, d'avril 1958, article 1.
Le conseil n'avait pas que des responsabilités réglementaires. Il lui était également demandé de " se tenir informé en permanence des évolutions de la monnaie, du secteur bancaire, des changes et des marchés financiers et de suivre attentivement la situation économique et financière du pays afin de pouvoir déterminer la politique générale de la Banque centrale et de s'acquitter des obligations de celle ci en tant que conseiller économique et financier du gouvernement ". Source : décret 5 382, d'avril 1958, article 15. Les représentants des divers établissements financiers publics et privés et des secteurs de l'économie réelle étaient désormais relégués au sein du conseil consultatif où ils n'avaient plus voix délibérative. Comme il a déjà été indiqué, un sindico, c'est à dire un contrôleur légal, était nommé par le gouvernement avec l'approbation du Sénat pour contrôler la gestion de la Banque centrale. Source : décret 5 382 d'avril 1958, chapitre IX. Les postes de directeur général, et si nécessaire, de plusieurs directeurs généraux adjoints subsistaient avec sensiblement les mêmes obligations que celles prévues par les status précédents. Mais dorénavant, pour marquer une autonomie plus grande à l'égard du pouvoir politique, les directeurs de la Banque centrale étaient désignés par le président et nommés par le conseil. Source : décret 5 382 d'avril 1958, articles 16 et 17? et article 15, n ). Avec la renationalisation des dépôts en 1973, on revint à u conseil où siégeaient de droit les présidents de 4 établissements financiers publics fédéraux. Au gouvernement revenaient derechef la nomination du président, du vice président et des 5 autres administrateurs pour une période de 4 ans. Les 5 administrateurs représentaient pour 3 d'entre eux les banques provinciales à statut officiel, et les 2 autres, le secteur des affaires et les travailleurs.
La nomination du président et du vice président était toujours soumise à la ratification du Sénat. Source : loi 20 539 d'octobre 1979, chapitre III. Tous les membres du conseil devaient être argentins de naissance ou posséder la nationalité argentine depuis 10 ans au moins. Les directeurs généraux de la Banque centrale continuèrent à être nommés directement par le président et par le conseil. Source : loi 20 539, d'octobre 1973, chapitre IV et article 14, s ). Sous le régime militaire, à partir de 1976, la composition du conseil fut une nouvelle fois réformée : au président et au vice président s'ajoutaient dès lors 10 administrateurs. Sur ce nombre, comme précédemment, 4 étaient les présidents des 4 principaux établissements financiers publics fédéraux. Les 5 autres étaient nommés par le gouvernement pour une durée de 4 ans. L'un d'entre eux représentait encore les banques provinciales. En revanche, le monde des affaires et le monde du travail n'étaient plus représentés. En outre, la claude de ratification par le Sénat de la nomination du président et du vice président était purement et simplement supprimée. Il est vrai qu'elle était, de fait, tombée en désuétude. Source : loi 20 539, modifiée par les décrets loi 21 364 de juillet 1976, 21 547 de mars 1977 et 21 571 de mai 1977. En 1981, une nouvelle réforme ramena le nombre d'administrateurs de 10 à 18. Aucun d'entre eux ne représentait plus le secteur bancaire, ni même aucun secteur de la vie économique. Les administrateurs étaient également réputés indépendants du pouvoir politique, même si leur nomination continuait à dépendre du gouvernement. Source : décret 22 467 de juin 1981. Les représentants des banques publiques fédérales n'étant plus membres de droit, le quorum fut ramené à 6.
Cette évolution visait à accroître l'autonomie de la Banque centrale et à garantir que tous les membres du conseil se consacraient exclusivement aux tâches liées à leur fonction. Les changements intervenus en 1992 furent décisifs pour la gouvernance de la Banque centrale de la république d'Argentine. D'une part, son indépendance opérationnelle vis à vis du gouvernement a été garantie. Mais, d'autre part, le système du Currency Board, on l'a vu, limite sérieusement ses pouvoirs en lui ôtant de fait la quasi totalité de ses instruments de politique monétaire. En outre, les prérogatives du conseil en matière de politique bancaire se sont trouvées également restreintes en raison de la décentralisation partielle des fonctions de supervision du système bancaire. La nomination des membres du conseil ( une président, un vice président et 8 autres administrateurs ) continua à relever du pouvoir exécutif, mais était de nouveau soumise à la ratification du Sénat. La durée de leur mandat était portée à 6 ans. La révocation de tout membre du conseil n'était possible qu'au terme d'une sorte de procédure accélérée de mise en accusation. Source : loi 24 144 d'octobre 1992, chapitre III. Le ministre de l'Economie ou son représentant pouvait siéger aux réunions du conseil mais seulement avec voix consultative et sans droit de vote. La gestion administrative de la Banque centrale continuait à dépendre du président, comme sous la plupart des status antérieurs, mais elle était partiellement déléguée et confiée à un directeur et à un directeur adjoint nommés pour 3 ans par le pouvoir exécutif sur proposition du président, parmi les 8 administrateurs du conseil. Source : loi 24 144 d'octobre 1992, chapitre III, article 45.
Un coup étranger fut porté, par ailleurs, au poste de directeur général dans les nouveaux status. Il était stipulé que l'administration de la Banque centrale était désormais confiée aux directeurs généraux adjoints, " fonctionnellement dépendants " du président qui était habilité à choisir de façon discrétionnaire, en leur sein, un directeur général, auquel les directeurs généraux adjoints rendraient des comptes. Source : loi 24 144 d'octobre 1992, chapitre IV. Le système de gouvernance de la Banque centrale est resté le même après l'effondrement du régime de Currency Board et la restauration de la capacité de la Banque centrale à intervenir comme prêteur en dernier ressort et, dans certaines limites, à prêter à l'Etat. De la sorte, la Banque centrale recouvrait une marge de maneuvre en matière de politique monétaire et de politique des changes. Mais cette restauration s'est accomplie dans un contexte difficile, encore aggravé par la crise bancaire, exigeant un grand nombre de décisions de la part tant des dirigeants de la Banque centrale que de son personnel. Le problème des modalités de la gouvernance de la Banque centrale de la république d'Argentine a donc connu des évolutions radicales au cours de ses quelques 90 années d'existence. Ces questions sont plus que jamais à l'ordre du jour dans la situation bien plus complexe que nous connaissons actuellement, caractérisée par un système monétaire très libéralisé, mais marqué aussi par les héritages de la grande crise financière qu'a traversée le pays.
il y a 3 mois
























