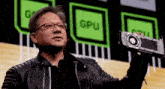Ce sujet a été résolu
PlayStation
3 mois
il y a 3 mois
Le partage capital travail au XXIème siècle.
De la vieille Europe au nouveau monde.
L'Allemagne : capitalisme rhénan et propriété sociale.
L'évolution allemande et celles anglaises et françaises ont des similarités car sur longue période les terres agricoles ont été remplacées par le capital immobilier, industriel et financier et d'autre part le rapport capital/revenu n'a pas arrêté d'augmenter depuis la WW2 et semble retrouver son niveau d'avant les chocs des années 1914 1915. L'importance des terres agricoles en Allemagne à la Belle Epoque est plus proches du cas français que du cas britannique car l'agriculture n'a pas encore disparu outre rhin. Et le capital industriel allemand est plus élevé que dans les 2 autres pays. Par contre les actifs étrangers sont à la veille de la Première Guerre mondiale 2 fois plus faibles en Allemagne qu'en France, environ 50% du revenu national contre plus d'une année. Et 4 fois plus faible qu'au Royaume Uni, près de 2 années de revenu national. C'est pour une large part la traduction du fait que l'Allemagne n'a pas d'empire colonial ce qui génère de fortes tensions politiques et militaires. On peut notamment penser aux crises marocaines de 1905 et 1911 durant lesquelles la Kaiser voulait contester la suprématie française au Maroc. Cette concurrence exacerbée entre puissances européennes pour ls actifs coloniaux a de toute évidence contribué au climat menant à la déclaration de guerre en 1914. D'importants actifs étrangers ont été accumulé durant ces dernières décennies grâce aux excédents commerciaux. Au début des années 2010 la position extérieure de l'Allemagne s'approchait de 50% de son revenu national dont plus de la moitié accumulée depuis 2000, soit quasiment le même niveau qu'en 1913. C'est faible par rapport aux actifs étrangers français et britanniques de la Belle Epoque certes. Mais cela reste considérable par rapport à la position actuelle de ces 2 pays, qui est proche de 0.
Pour ce qui est de la dette publique et le partage entre capital public et capital privé, la trajectoire allemande est assez proche de celle de la France car avec 17% d'inflation par an entre 1913 et 1950, l'Allemagne a noyé sa dette publique dans l'inflation au XXème siècle. Malgré des forts déficits durant chacune des 2 guerres mondiales ( l'endettement public dépasse brièvement les 100% du PIB en 1918 - 1920 et les 150% du PIB en 1943 - 1944 ), l'inflation permet de ramener rapidement à chaque fois la dette à des niveaux très faibles, à savoir à 20% du PIB en 1930 ou en 1950. Mais le recours à l'inflation a été extrême et déstabilisé toute la société allemande durant l'hyperinflation notamment durant les années 1920. L'opinion public allemande en est ressortie viscéralement anti inflationniste. C'est pourquoi l'Allemagne ne veut pas entendre parler aujourd'hui d'une hausse des prix supérieurs à 2% par an. Le pays ayant toujours remboursé ses dettes publiques y compris au delà du raisonnable, le Royaume Uni, a une attitude plus souple par comparaison et ne voit pas de mal à ce que sa banque centrale achète une bonne part de sa dette publique et laisse légèrement filer l'inflation. Pour ce qui est de l'accumulation des actifs publics, le cas allemand est aussi proche du cas français avec des participations publiques importantes dans le secteur industriel et bancaire dans les années 1950 1970 mais qui ont été en partie vendues depuis les années 1980 1990, mais qui sont loin d'avoir totalement disparu. L'état régional de Basse Saxe détient aujourd'hui près de 15% des actions et 20% des droits de votes, garantis par la loi, ce que l'UE cherche d'ailleurs à contester, de Volkswagen, premier constructeur automobile européen et mondial.
Durant les années 1950 1970, étant donné la dette publique quasi nulle, le patrimoine public net avoisinait une année de revenu national en Allemagne contre à peine 2 années pour le patrimoine privé, qui était alors à un niveau très faible. En France, la puissance publique détenait entre 25% et 30% du capital national outre Rhin durant les décennies de la reconstruction et du miracle économique allemand. Le patrimoine public net est presque exactement nul au début des années 2010, et les patrimoines privés qui n'ont cessé de progresser depuis les années 1950, représentent la quasi totalité du patrimoine national. Il existe une différence grande tout de même de niveau entre la valeur du capital privé en Allemagne et celles de la France et du Royaume Uni car les patrimoines privés allemands ont beaucoup progressé après guerre et se situaient à un niveau très faible en 1950, à peine une année et demi de revenu national. Et ils atteignent à partir des années 2010 plus de 4 années de revenu national. Le phénomène de reconstitution de la fortune privée au niveau européen ne fait pas de doute. Cependant la valeur des patrimoines privés allemands est au début des années 2010 sensiblement en dessous des niveaux français comme britanniques. A peine plus de 4 années de revenu national en Allemagne contre entre 5 et 6 années de revenu national en France et au Royaume Uni.
Pour plus de 6 années de revenu national en Espagne et en Italie. Etant donné le gros niveau de l'épargne allemande, ce faible niveau relatif des patrimoines allemands quand on compare aux autres grands pays européens peut sembler un paradoxe. Le premier facteur pour expliquer cela est le faible niveau des prix immobiliers en Allemagne quand on compare aux autres pays européens qui peut en partie s'expliquer par le fait que les fortes hausses de prix ayant eu lieu partout ailleurs entre 1990 et 2000 ont été bridées par la réunification allemande, ce qui a conduit à mettre sur le marché un grand nombre de logements à bas prix. Pour justifier cet écart sur le long terme, il faudrait des facteurs plus durables comme une plus forte régulation des loyers. Mais la majeure partie de l'écart avec les autres grands pays européens ne vient pas de la différence entre la valeur du stocks de logements, mais davantage de l'écart concernant la valeur des autres capitaux intérieurs soit principalement le capital des entreprises. Donc l'écart ne vient pas tant de la faible capitalisation immobilière allemande que de la faible capitalisation boursière des entreprises. Si on mesurait le total des patrimoines privés en utilisant non pas la valeur des marchés de société et des actifs financiers correspondants mais leur valeur de bilan, soit la valeur comptable obtenue en cumulant les investissements inscrits à leur bilan et en déduisant les dettes, dans ce cas le paradoxe allemand disparaîtrait et les patrimoines privés allemands passeraient aux même niveaux que les niveaux français et britanniques.
Ces faibles valeurs de marché des entreprises allemandes semblent correspondre à ce qu'on appelle parfois le modèle du capitalisme rhénan, ou stakeholder model, un modèle économique où la propriété des entreprises appartient non seulement aux actionnaires mais aussi à un certain nombre de parties prenantes ayant un intérêt à agir, les stakeholders, à commencer par les représentants des salariés, qui ont dans les conseils d'administration allemands, des voix délibératives, et non seulement consultatives, sans que ce soit nécessaire de détenir des actions. ). Et aussi dans certains cas les représentants de l'Etat régional, des associations de consommateurs, de défense de l'environnement, etc.... Il ne s'agit pas d'idéaliser ici ce modèle de propriété sociale partagée des entreprises, qui a ses limites mais simplement constater qu'il peut être au moins aussi efficace économiquement que le modèle du capitalisme de marché anglo saxon ou stock holder model, où tout le pouvoir repose théoriquement sur les actionnaires. En pratique ce n'est pas toujours aussi simple. Et surtout qu'il implique mécaniquement une valorisation de marché plus faible pour les sociétés, sans que la vraie valeur sociale soit nécessairement plus faible. Ces débats sur les différentes formes du capitalisme ont eu principalement lieu après la chute de l'URSS. Puis le modèle économique allemand semblait en perte de vitesse après l'unification car entre 1998 et 2002 l'Allemagne était souvent présenté comme l'homme malade de l'Europe.
Les chocs subis par le capital au XXème siècle. L'évolution capital/revenu et du partage public privé. Il faut comprendre les raisons de l'effondrement puis la remontée du rapport capital/revenu durant le XXème siècle avant de parler du XXIème siècle. Ce sont des évolutions qui ont concerné l'ensemble du continent européen avec presque aucune exception. Avec seulement quelques variations selon les pays. Depuis les années 1970, l'Italie et l'Espagne on vu une forte remontée du rapport capital/revenu bien plus que le Royaume Uni et la France. Il est probable que le rapport capital/revenu à la Belle Epoque était de 17 années de revenu national environ. Pareil pour ba Belgique, l'Autriche et la Hollande. La destruction physique de capital, conséquences des guerres, n'explique que partiellement la chute observée de ce rapport entre 1914 et 1945. En 1913, au Royaume Uni, en Allemagne et en France, la valeur du capital national était comprise entre 6 années et demi et 7 années de revenu national. Ils sont passés à 2 années et demi en 1950, soit une chute de plus de 4 années de revenu nationale. Les destructions physiques ont été plus limitées au Royaume Uni, nulles durant la WW1. Pourtant leur capital national a chuté de 4 années de revenu national, soit plus de 40 fois les destructions physiques. Autant qu'en France et en Allemagne. Les chocs budgétaires et politiques expliquent bien mieux la chose.
il y a 3 mois
En dehors des destructions physiques, les principaux facteurs expliquant la chute du rapport capital/revenu entre 1913 et 1950 sont d'une part l'effondrement des portefeuilles étrangers et la très faible épargne caractérisant la période, ajoutés aux destructions.
Cela fait que ces facteurs cumulés explique entre les 2 tiers et les 2 quarts de la baisse. Et d'autre part, les faibles niveaux des prix des actifs en vigueur dans le nouveau contexte politique de propriété mixte et régulé de l'après guerre, lequel explique entre un quart et un tiers de la baisse. Le capital étranger net est passé de 2 années de revenu national pour le Royaume Uni en 1913 à une position légèrement négative dans les années 1950. La perte subie sur les portefeuilles internationaux du Royaume Uni a donc été clairement plus forte que les destructions physiques de capital intérieur français ou allemand et a plus que compensé la faiblesse des destructions sur le sol britannique. En fait la chute des capitaux étrangers s'explique d'une part par les expropriations entraînés par des révolutions et des processus de décolonisation, et d'autre part et surtout par la très faible épargne nationale en vigueur dans les différents pays européens entre 1914 et 1945 qui a conduit les épargnants britanniques, français, voire allemands dans une moindre mesure, à se défaire progressivement de leurs actifs étrangers. Pour ce qui est des expropriations et des processus de décolonisation, on peut évoquer aux emprunts russes souscrits abondamment par les épargnants français de la Belle Epoque et répudiés par les bolcheviques en 1917. On peut ajouter la nationalisation du canal de Suze par Nasser en 1956 au grand dam des actionnaires britanniques voire français qui possédaient le canal et en touchaient les dividendes cet royalties depuis 1869. Etant donné la faible croissance et des récessions qui se répétaient, les années 1914 - 1945 sont une période noire en particulier pour les détenteurs de patrimoine dont les revenus sont beaucoup moins florissants que pendant la Belle Epoque.
Les taux d'épargne privée sont relativement faibles surtout si on déduit les réparations et remplacements des dommages de guerre, et pour maintenir leur niveau de vie certains choisissent de vendre progressivement une partie de leurs actifs. Les faillites de la crise des années 1930 ruinent aussi bien des actionnaires et porteurs d'obligations. Le peu d'épargne privée et largement absorbée par les énormes déficits publics notamment durant les guerres. En effet l'épargne nationale qui est la somme de l'épargne privée et de l'épargne publique, est très faible au Royaume Uni comme en France et en Allemagne entre 1914 et 1945. Les épargnants prêtent massivement à leur gouvernement, parfois en vendant leurs actifs étrangers, et seront finalement expropriés par l'inflation, plus vite en France et en Allemagne, plus lentement au Royaume Uni, ce qui donnait illusion aux patrimoines privés britanniques de mieux se porter en 1950 que leurs équivalents sur le continent alors qu'en réalité le patrimoine nationale est tout aussi affecté dans les 3 cas. Les gouvernements empruntent parfois à l'étranger. Les USA sont ainsi passés d'une position négative avant la WW1 à une position positive dans les années 1950. Cela revient au même pour ce qui est du patrimoine nationale de la France ou du Royaume Uni. La chute du rapport capital/revenu entre 1913 et 1950 est une histoire de l'euthanasie des capitalistes européens au profit des capitalistes américains notamment.
Il faut aussi parler du fait que le faible niveau du rapport capital/revenu de l'après guerre européen est en partie un choix positif dans le sens où cette réalité reflète en partie un choix positif dans le sens où cette réalité reflète pour une large part le choix de politiques publiques visant à réduire plus ou moins consciemment et avec plus ou moins d'efficacité, la valeur de marché des actifs et le pouvoir économique de leur détenteur. Les prix de l'immobiliers comme des entreprises se situent à des niveaux historiquement bas dans les années 195°/1960 relativement aux prix des biens et services. Cela explique en partie les faibles niveaux du rapport capital/revenu. Toutes les formes de patrimoine sont toujours évaluées aux pris de marchés en vigueur aux différentes époques. Cela introduit une part d'arbitraire car les marchés sont souvent capricieux. Cependant c'est la seule méthode pour le moment possible pour calculer le stock de capital national. Sinon comment faire pour additionner les hectares de terres agricoles avec les mètres carrés d'immeubles et de hauts-fourneaux. Sauf que dans l'après guerre les prix des logements sont historiquement faibles notamment du fait des politiques de blocage des loyers ayant été mises en place presque partout en temps d'inflation forte au début des années 1920 et encore plus dans les années 1940. Les loyers ont progressé moins fortement sur les autres prix et c'était devenu moins coûteux de se loger pour les locataires et inversement les logements rapportent moins à leurs propriétaires, si bien que les prix immobiliers ont baissé. De même les prix des entreprises c'est à dire la valeur des actions et des parts des sociétés non cotées et cotées, se situent à des niveaux plutôt bas dans les années 1950 - 1960. La crise des années 1930 a aussi ébranlée la confiance des marchés boursiers.
Ainsi que par les nationalisations de l'après guerre. Des politiques de taxation des bénéfices et des dividendes ainsi que des politiques de régulation financière ont été mises en place pour réduire le pouvoir des actionnaires ainsi que la valeur de leurs actifs. En gros le faible niveaux des actifs immobiliers et boursiers de l'après guerre explique pour entre un quart et un tiers de la baisse du rapport capital/revenu selon les pays alors que les effets de volume, c'est à dire les pertes d'actifs étrangers, les destructions et la faible épargne nationale expliquent entre 2 tiers et 3 quarts de la chute. Il faut aussi savoir que la forte remontée des prix boursiers et immobiliers depuis les années 1970 notamment dans les années 1990 - 2000 explique une par significative de la remontée du rapport capital/revenu, quoique là encore moins importante que les effets de volume, lesquels sont liés cette fois à l'affaiblissement structurel du taux de croissance.
Le capital en Amérique : plus stable qu'en Europe.
Pour ce qui est du cas américain, on voit qu'en Amérique à l'origine, le capital comptait moins qu'en Europe. La valeur du stock de capital national selon les multiples estimations réalisées à l'époque est d'à peine plus de 3 années de revenu national au moment de l'indépendance américain à la fin du XVIIIème siècle. La valeur des terres agricoles est comprise entre 1 année et 1 année et demi de revenu nationale. Il n'y a aucun doute que le ratio capital/revenu est beaucoup plus faible que dans les colonies américaines qu'au Royaume Uni et en France où le capital national vaut de l'ordre de 7 années du revenu national dont près de 4 pour les terres agricoles. L'Amérique du Nord a plus d'hectares de terres par habitant que l'Europe à l'origine. Donc plus de capital par habitant. Mais elle en compte tellement que la valeur marchande des terres est réduire à des niveaux très faibles car chacun peut avoir d'énormes quantités de terres et donc la terre ne vaut pas grand chose en définitive. Cela veut dire que l'effet prix fait plus que contre balancer l'effet volume : dès lors que le volume de capital d'un type donné dépasse certains seuils, il est inévitable que son prix tombe à des niveaux tellement bas que le produit de 2, c'est àd ire la valeur du capital, est plus faible que pour un volume plus modéré. L'écart entre le prix de la terre en Europe et dans le Nouveau Monde à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème siècle est confirmé par toutes les sources historiques disponibles relatives aux transactions ou transmissions des terres agricoles, notamment les inventaires de biens au décès et les actes de succession.
Les autres types de capitaux, logements et autres capitaux intérieurs, se situent également à des niveaux relativement bas aux USA à l'époque coloniale et lors de la naissance de la République américaine. Cela révèle une autre logique mais pas plus surprenant. Les nouveaux arrivants qui représentent une forte part de la population américaine, n'ont pas traversée l'Atlantique avec leur capital logement ou leurs machines. Et il faut du temps pour accumuler l'équivalent de plusieurs années de revenu national en biens immobiliers et en équipements professionnels. Le faiblesse du rapport capital/revenu en Amérique traduit une différence importante dans la structure des inégalités sociales comparée à l'Europe. Le fait que la totalité des patrimoines ne représente qu'à peine 3 années de revenu nationale en Amérique contre plus de 7 en Europe, signifie concrètement que le poids des propriétaires et des positions acquises dans le passé est moins important que dans le Nouveau monde. Avec quelques années de production et de travail il est possible de combler les écarts initiaux de patrimoines entre groupes sociaux ou du moins il est possible de les combler plus vite qu'en Europe. En 1840, Tocqueville note que " le nombre de grandes fortunes est fort petit aux USA et les capitaux encore rares ". Il y voit l'une des origines les plus évidentes de l'esprit démocratique qui règne en Amérique selon lui. Il ajoute que tout découle selon ses observations, du faible prix des terres agricoles. : " En Amérique, la terre coûte peu et chacun peut devenir propriétaire ". C'est l'idéal jeffersonien d'une société de petits propriétaires terriens, libres et égaux.
il y a 3 mois
Durant le XIXème siècle la situation évolue avec la part de l'agriculture dans la production diminuant progressivement et la valeur des terres agricoles devenant de plus en plus faible comme en Europe. Mais les USA accumulent un stock considérable de capital industriel et immobilier, si bien que le capital national avoisine les 5 années de revenu national en 1910 contre 3 années en 1810. L'écart avec l'Europe s'est réduit car il a été divisé par 2 en un siècle. L'Amérique est devenue capitaliste, mais le patrimoine continue de peser moins lourdement aux USA qu'en Europe à le Belle Epoque, si on considère le territoire américain dans son ensemble. Si on parle seulement de la côte Est, l'écart est encore plus réduit. Les romans de Henry James se déroulant dans le Boston et le New York des années 1880 - 1910 montrent aussi des sociétés où le patrimoine immobilier financier et industriel compte presque autant que dans les romans européens car les temps ont changé depuis l'Amérique sans capital de l'époque de l'Indépendance. Les chocs du XXème siècle atteignent l'Amérique de façon moins violent qu'en Europe et du coup le rapport entre capital national et revenu national est plus stable aux USA. Il a oscillé entre 4 et 5 années de revenu national alors qu'en Europe il est passé de plus de 7 années à moins de 3 avant de remonter à entre 5 et 6 années de revenu national. Les patrimoines américaines ont certes subi des contrecoups des crises ayant eu lieu entre 1914 et 1945 avec un fort endettement public durant la WW2 notamment, ce qui affecte l'épargne nationale, le tout dans un contexte économiquement instable. Les USA ont mis sous Roosevelt le même type de politiques publiques qu'en Europe pour réduire le poids du capital privé comme la régulation des loyers. Après la WW2 la capitalisation immobilière comme la capitalisation boursière se retrouvent à des niveaux historiquement bas.
Sur la fiscalité progressive, les USA vont même plus loin que l'Europe, preuve sans doute que leur souci était plus de réduire les inégalités que de mettre fin à la propriété privée. Pas de politique massive de nationalisation a eu lieu et des investissements publics importants sont lancés dans les années 1930 et 1940 dans les infrastructures notamment. L'inflation et la croissance finissent par ramener la dette publique à un niveau modeste dans les années 1950/1960 si bien que la patrimoine publique est nettement positif en 1970. Finalement les patrimoines privés américains sont passés de près de 5 années de revenu national en 1930 à moins de 3 années et demi de revenu national en 1970 ce qui est une baisse malgré tout non négligeable. Ceci dit, le capital depuis le début du XXème siècle, semble rester stable, au point que la stabilité du rapport capital/revenu ou capital/production est parfois considérée comme une loi universelle dans les manuels américains comme dans celui de Samuelson. Par comparaison en Europe, durant la Belle Epoque, le patrimoine était roi puis ça s'est inversé. Enfin au début du XXIème siècle, on assiste à un renouveau du capitalisme patrimonial avec des patrimoines privés ayant dépassé les niveaux américains. Cela s'explique par la plus faible croissance économique et surtout démographique caractérisant l'Europe par rapport aux Etats Unis, ce qui conduit de façon mécanique à un poids plus important des richesses accumulées dans le passé. Mais quoi qu'il en soit le fait est que l'Amérique a connu un rapport capital/revenu bien plus stable qu'en Europe au cours du siècle écoulé, ce qui peut expliquer pourquoi l'opinion américaine semble entretenir une relation plus apaisée avec le capitalisme.
Le Nouveau Monde et les capitaux étrangers.
La question de la dette publique.
Le crise chypriote : quand l'impôt sur le capital rejoint la régulation bancaire.
Les banques centrales sont censées garantir la stabilité du système financier. Elles sont les mieux placées pour s'assurer au quotidien de la position des différentes banques pour les refinancer le cas échéant. et pour vérifier que le système de paiements fonctionne de façon normal. Elles sont parfois aidées par des structures et autorités chargés de la régulation bancaire pour distribuer les licences par exemple, licences requises pour opérer un établissement financier car on ne peut pas créer une banque dans un garage après tout. Ou alors vérifier que les ratios prudentiels en vigueur, donc les volumes de réserves et d'actifs réputés peu risqués que les banques doivent détenir pour pouvoir prêter ou investir tel ou tel montant dans des actifs plus risqués, sont bien respectés. Dans tous les pays, les banques centrales et autorités re régulation bancaire qui leurs sont souvent rattachées, travaillent de concert. Les banques centrales pour les crises jugées importantes sont censées travailler avec les structures internationales créées à cet effet, notamment le FMI. C'est le cas de la fameuse Troika, regroupant BCE, Commission européenne et FMI qui s'est mêlée à la crise européenne à partir de 2009 mêlant à la fois crise bancaire et crise de dette publique, notamment en Europe du Sud. La récession de 2008 - 2009 a conduit à une aggravation de l'endettement publique qui était déjà élevé avant la crise dans la plupart des pays et notamment en Grèce et en Italie. Cela a mené à une détérioration des bilans bancaires notamment dans les pays touchés par l'éclatement de la bulle immobilière notamment l'Espagne. Les 2 crises étaient donc liées.
Les banques détiennent des titres de la dette publique dont personne ne sait exactement ce qu'ils valent. Troika comme les autorités publiques des différents pays n'avaient pas de transmissions automatiques d'informations bancaires internationales et du cadastre financier, qui leur permettraient de répartir de manière transparente et efficace les pertes et efforts. L'Italie et l'Espagne ont eu des difficultés à mettre en place un impôt progressif sur le capital pour rétablir leurs finances publiques. Le cas de la Grèce est encore plus extrême car parmi les solutions évoquées il y avait celui de faire payer des impôts plus élevés aux ressortissants les plus aisés ce qui était une bonne idée en soit. Mais sans coopération internationale adéquate la Grèce n'avait pas les moyens d'imposer seule une fiscalité juste et efficace tant il est facile pour ses plus riches citoyens de déplacer leurs fonds à l'étranger, souvent dans d'autres pays européens. Or les autorités européennes et internationales n'ont à aucun moment pris les mesures adéquates, la Grèce comme les autres pays concernés par la crise, se sont retrouvés incités à trouver des recettes en se défaisant des actifs publics qui leur restent, souvent à bas prix, ce qui pour les acheteurs concernés, grecs ou européens de diverses nationalités, est sans doute plus intéressant que de payer des impôts. On peut parler de la crise chypriote spécifiquement qui s'est déroulée en mars 2013 car Chypre est une île de plus de 1 million d'habitants ayant rejoint l'UE en 2004 puis la zone euro en 2008. Son secteur bancaire est hypertrophié du fait visiblement de très importants dépôts étrangers, notamment russes, attirés par la faible fiscalité de le côté peu regardant des autorités locales.
Selon les déclarations des responsables de la Troika, il semblerait que ces dépôts russes incluent d'énormes sommes individuelles. Chacun imagine donc des oligarques dont les avoirs se chiffrent en dizaines de millions d'euros au moins,. Le problème étant qu'aucune statistique même approximative a été publiée par les autorités européennes et par le FMI. Ces institutions ne savaient peut être pas grand chose car elles ne se sont jamais donné les moyens de faire des progrès que cette question pourtant importante. Les banques chypriotes n'avaient plus l'argent figurant dans leur bilan, et les sommes ont été investies dans des titres grecs aujourd'hui dévalués et des investissements immobiliers en partie illusoires. Les autorités européennes ont donc hésiter à renflouer les banques chypriotes sans contrepartie, surtout si c'était pour renflouer des millionnaires russes.
il y a 3 mois
L'inégalité mondiale des patrimoines au XXIème siècle.
Héritiers et entrepreneurs dans les classements de fortune.
On voit qu'au delà d'un certain seuil toutes les fortunes héritées ou entrepreneuriales progressent à des rythmes très élevés, que le titulaire de la fortune en question exerce ou non une activité professionnelle. Il faut pas surestimer la précision des conclusions que l'on peut tirer de ces données qui ne portent que sur un nombre réduit d'observations et qui sont issues d'un processus de collectif parcellaire et relativement approximatif. Entre 1990 et 2010 en haut de la hiérarchie mondiale, la fortune de Bill Gates, fondateur de Microsoft et leader mondial des systèmes d'exploitation, incarnation de la fortune entrepreneuriales et numéro 1 des classements Forbes durant plus de 10 ans, est passée de 4 milliards de dollars à 50 milliards de dollars. En même temps, Liliane Bettencourt, héritière de l'Oréal, leader mondial des cosmétiques fondé par son père Eugène Schueller, inventeur en 1907 de teintures pour cheveux promises à un grand avenir, ( à la manière d'un César Birotteau un siècle plus tôt - est passée de 2 milliards à 25 milliards de dollars, selon Forbes toujours. Cela correspond à une progression annuelle moyenne de plus de 13% par an entre 1990 et 2010 soit un rendement réel de l'ordre de 10% - 11% par an si on retire l'inflation. Donc Liliane Bettencourt n'a jamais travaillé mais sa fortune a progressée aussi vite que celle de Bill Gates dont le patrimoine continue d'augmenter très rapidement aussi même après qu'il ait arrêté ses activités professionnelles.
A noter que Bill Gages a été numéro 1 du classement Forbes entre 1995 et 2007 avant que Warren Buffet ne prennent sa place. Puis ce fut le tour de Carlos Slim entre 2010 et 2013. Une fois la fortune lancée, la dynamique patrimoniale suit sa logique propre et un capital peut continuer de progresser à un rythme soutenu durant des décennies simplement du fait de sa taille. Au delà d'un certain seuil, les effets de taille, liés aux économies d'échelle notamment dans la gestion du portefeuille peut se recapitaliser quasi intégralement. Avec un patrimoine d'un tel niveau le train de vie du détenteur absorbe au maximum quelque dixièmes de pourcents du capital chaque année et la quasi totalité du rendement peut être réinvestie. C'est un mécanisme économique élémentaire mais important dont on sou estime trop souvent les conséquences redoutables pour la dynamique à long terme de l'accumulation et de la répartition des patrimoines. L'argent tend parfois à se reproduire tout seul. Cet état de fait n'avait pas échappé à Balzac quand il raconte le récit de l'ascension patrimoniale de l'ex ouvrier vermicellier : " Le citoyen Goriot amassa les capitaux qui plus tard lui servirent à faire son commerce avec toute la supériorité que donne une grande masse d'argent à celui qui la possède. " Steve Jobs incarne encore plus que Bill Gates dans l'imaginaire collectif le symbole de l'entrepreneur sympathique et de la fortune méritée. Il ne possédait au sommet de sa gloire et des cours boursiers de sa société Apple en 2011, que 8 milliards de dollars soit 6 fois moins que Bill Gates à cette époque alors que Gates était moins inventif que Jobs selon de nombreux observateurs. Et 3 fois moins que Liliane Bettencourt.
On trouve dans les classements Forbes des dizaines d'héritiers qui étaient plus riches que Steve Jobs. Autant dire qu'être fortuné n'est pas seulement une affaire de mérité, loin de là. Cela s'explique notamment par le fait que les patrimoines hérités parviennent souvent à obtenir un rendement très élevé du simple fait de leur taille initiale. Mais les données de type Forbes ne permettent malheureusement pas des analyses systématiques et 100% fiables contrairement aux données des dotations universitaires par exemple. Les méthodes utilisées par les magazines font qu'on sou estime l'importance des fortunes héritées. Les journalistes n'ont pas de listes fiscales ou administratives complète pour repérer ces fortunes. Ils fonctionnent donc sur une base pragmatique en rassemblant des informations de sources très disparates souvent en passant des coups de téléphone ou en envoyant des mails, permettant d'avoir des informations utiles mais pas si fiables que cela. La puissance publique n'a pas réussi à faire la collecte d'informations très précises sur ce sujet à partir de déclarations annuelles de patrimoines par exemple, ce qui remplirait une mission utile d'intérêt général et pourrait se faire en partie de manière automatisée grâce aux technologies modernes. Les journalistes des magazines partent notamment des listes des grandes entreprises cotées et cherchent à déterminer la structure de leur actionnariat. C'est plus difficile donc de repérer les fortunes héritées, lesquelles sont souvent placées dans des portefeuilles relativement diversifiés, que les fortunes entrepreneuriales ou en voie de constitution, qui en règle générale, sont plus fortement concentrées sur une seule et unique entreprise.
Concernant les patrimoines hérités les plus importants, de l'ordre de dizaines de milliards de dollars ou d'euros, on peut supposer que les actifs restent placés dans l'entreprise familiale pour une large part, comme les actifs de la famille Bettencourt dans l'Oréal, ou bien la famille Walton dans Wal Mart aux USA, auquel cas ces fortunes sont aussi facilement détectables que celles de Bill Gates ou de Steve Jobs. Mais ce n'est pas le cas à tous les niveaux car dès lors qu'on descend autour de quelques milliards de dollars ( selon Forbes il y a chaque années plusieurs centaines de fortunes nouvelles de ce niveau dans le monde, ) et encore plus au niveau de quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'euros, il est probable qu'une part importante des fortunes héritées prenne la forme de portefeuilles relativement diversifiés, auquel cas il est difficile pour les journalistes des magazines de les détecter, d'autant plus que les personnes en question ont en général moins envie de se faire connaître publiquement que les entrepreneurs. On est dans un cas typique de biais statistique. En France, Challenges et autres magazines du genre, précisent qu'ils veulent seulement répertorier les fortunes dites " professionnelles " c'est à dire investies principalement dans une entreprise particulière et que les patrimoines prenant la forme de portefeuilles diversifiés ne les intéressent pas. Le problème est que c'est difficile d'avoir de leur part une définition précise de ce qu'ils entendent par là : faut il dépasser un certain seuil de détention du capital de la société pour être classé comme fortune professionnelle? Et ce seuil dépend il de la taille de la société et si oui suivant quelle formule? En fait dans les classements les fortunes dont les journalistes ont eu connaissance sont les seules qui apparaissent.
Ainsi que les fortunes remplissant le critère fixé ( dépasser le milliard de dollars dans le cas de la liste de Forbes ou faire partie des 500 plus grandes fortunes répertoriées pour un pays donné dans le cas de Challenges et de nombreux magazines dans d'autres pays. Mais ce n'est pas assez précis pour faire des comparaisons entre pays et époques. En plus de cela, ces magazines ont souvent tendance à avoir un biais idéologique en faveur des entrepreneurs et une volonté de les célébrer quitte à en exagérer l'importance. A noter que Steve Forbes qui possédait ce magazine, est lui même milliardaire et 2 fois candidat malheureux à l'investiture présidentielle pour le parti républicain. Il est aussi d'ailleurs un héritier. Son grand père avait créé en 1917 le magazine à l'origine de la fortune de Forbes, qu'il a ensuite développée. Les classements publiés dans le magazine proposent parfois une décomposition des milliardaires en 3 groupes à savoir les héritiers purs, les entrepreneurs purs et les personnes ayant hérité d'une fortune tout en la faisant furctifier. Selon les données publiées par Forbes, chacun de ces 3 groupes représente en général autour de un tiers du total, avec néanmoins une tendance selon le magazine à la baisse de la part des héritiers purs et une augmentation de celle des héritiers partiels. Mais aucune définition de ces différents groupes n'a été donnée par Forbes, notamment concernant la frontière exacte entre hériters purs et partiels. De plus aucun montant n'est indiqué concernant les héritages. A noter que ce n'est pas facile de définit ce qu'est un rendement normal pour une fortune.
On peut très bien appliquer le même rendement moyen à tous les patrimoines, ce qui conduirait à faire apparaître Liliane Bettencourt comme une héritère partielle étant donné le rendement élevé obtenu sur sa fortune, plus partielle probablement que Steve Forbes, qui la classe pourtant en héritière pure alors qu'il se range lui même dans la catégorie des héritiers ayant fait fructifié la fortune héritée. En réalité la part des héritiers dans les plus hautes fortunes est d'entre 60% et 70% à l'heure actuelle ce qui est un peu moins qu'à la Belle Epoque durant laquelle cette part était de plus de 80% au moins. Cela peut s'expliquer par la croissance élevée mondialement et l'arrivée de nouvelles fortunes issues de pays émergents.
il y a 3 mois
Bordel
Il y a trois sortes d'hommes, les vivant, les morts et ceux qui sont sur la mer
il y a 3 mois