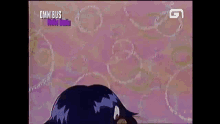Ce sujet a été résolu
La dette publique française atteint UN NOUVEAU RECORD HISTORIQUE, DU JAMAIS VU de 3 228,4 milliards d'euros au 2eme trimestre
La catastrophe économique s'aggrave !
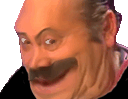

L'État en 2001 :
L'État en 2011 :
L'État en 2019 :
L'État en 2024 :
La catastrophe économique s'aggrave !
L'État en 2001 :
L'État en 2011 :
L'État en 2019 :
L'État en 2024 :
il y a un an
Vivement que ça pète, qu'on rigole.

https://bfmtv.me Juif qui parle, bouche qui ment.
il y a un an
prêt pour l'apocalyse économique ?
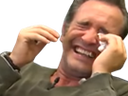
Rien à perdre, rien à gagner, rien à foutre

𓃫 𓃩 𓁣
il y a un an
il y a un an
LA DETTE PUBLIQUE, UNE AFFAIRE RENTABLE.
A QUI PROFITE LE SYSTEME?
Imaginons qu'un organisme privé réussirait à privatiser l'air que nous respirons et le fasse payer. Ce serait scandaleux bien entendu. Par contre, l'air en bouteille lors des plongées sous marines doit être payé et cela est considéré comme étant normal. Dans le premier cas, il y a appropriation illégitime d'une richesse collective et vente d'un service inexistant. Dans le second en revanche, il y a une vraie plus value apportée légitimant une rémunération. Pour la dette c'est la même chose. Dans certains cas, la dette représente un service une rémunération au prêteur et dans d'autres, la dette est doublement illégitime que ce soit par son existence même et par son prix qu'aucun service réel justifie. Dans notre esprit, une dette est ce qu'une personne doit à une personne lui ayant rendu service en prêtant une somme d'argent notamment. Si le prêteur a relevé cette somme sur son épargne, il est juste qu'il en reçoive la rémunération puisqu'il n'aura pas la disponibilité de cet argent jusqu'à échéance au prêt, outre le risque de ne pas être remboursé. De plus, il y a réel service, car l'emprunteur trouve grâce à ce prêt, satisfaction à ce besoin. Mais il y a une autre dette visible de par ses montants abyssaux, dénoncé mais dont la cause profonde est inconnue du grand public. Pour cause, si la cause était connue, une révolution pourrait bien avoir lieu. La monnaie a différentes fonctions : instrument de mesure, de réserve de valeur et de paiement. La monnaie est d'abord une convention sociale qui n'a de valeur que celle que nous lui accordons. Elle repose sur la confiance. Quand on parle de monnaie on pense avant tout aux pièces de monnaie et aux billets, sans doute du à la persistance des temps anciens dans notre mémoire collective où la monnaie était physique. Aujourd'hui, les monnaies et les billets ne sont que l'un des supports monétaires en circulation, support minoritaire dans la masse monétaire, c'est à dire la quantité globale d'argent en circulation.
La dette publique, une affaire rentable.
Annexe 3.
Proposition constitutionnelle.
On peut penser à une gestion type monnaie pleine ou SMART, incluant le point de vue charlatiste qui défini que les impôts et taxes étant nécessairement payés en monnaie centrale, puisque le Trésor public a son compte à la Banque de France, celle ci doit être émise en quantité suffisante pour que les citoyens puissent payer ces taxes et impôts. Le néocharlatisme qui est en fait très proche du keynésianisme, sur ce sujet ajoute que quand le secteur privé faillit aux investissements nécessaires pour assurer le plein emploi, c'est au secteur public de prendre le relais en utilisant tous les leviers de relance et en particulier en émettant la monnaie qui manque au financement de l'offre et de la demande. L'un ne va pas sans l'autre. L'idée de révision constitutionnelle consisterait à cela concernant le système bancaire et monétaire : 1. Toute création de monnaie, hormis certaines monnaies localement autorisées doit relever de l'Etat et de l'Etat seul, par l'intermédiaire de sa banque centrale. 2. Le Trésor public est la banque de l'Etat, système de gestion des comptes des administrations. Il reçoit les recettes et paye les débits de l'Etat, des collectivités et de l'administration : Il recouvre les recettes publiques. Il reçoit les intérêts de la monnaie émise par la Banque centrale et confiée au système bancaire. Il contrôle et exécute les dépenses publiques. Il produit l'information budgétaire et comptable publique. Il offre des prestations d'expertise et de conseil financier. Il gère l'épargne et les dépôts de fonds d'intérêt général.
La Banque centrale : Est chargér d'émettre la monnaie fiduciaire ( pièces et billets ) ainsi que la monnaie scripturale et électronique prêtée contre intérêt aux banques de prêts qui en font la demande. Emet la monnaie à la Nation. Détermine et fait appliquer les règles de bonne conduite bancaire aux banques et établissements d'investissement à un terme donné doit être assuré par des emprunts au moins de même terme. Aucun emprunt à long terme ne peut être financé par des emprunts à court terme. Surveille l'interdiction, faite aux banques et établissements financiers, de spéculer pour compte propre sur les changes, les actions, obligations et produits dérivés. Veille à la dissociation rtotale des activités bancaires formant le réseau des banques privées ( 3 catégories d'établissements distincts et indépendants : les banques de dépôts, les banques de prêts et les banques d'affaires. 4. Le budget de l'Etat doit être équilibré en fonctionnement par la fiscalité, excepté en période de risque de récession économique. L'équipement de l'Etat et des diverses collectivités publiques fait partie d'un budget séparé, financé par émission monétaire. 5. Le réseau des banques privées comporte 3 types de banques : Banques de dépôts : encaissements, paiements, garde de dépôts de leurs clients. Banques de prêts : le montant global des prêts ne peut excéder le montant global des fonds empruntés ( épargne des agents économiques ou émission monétaire de la Banque centrale ). Les financements proposés par les banques de prêts doivent être assurés par des emprunts dont le terme est au minimum de même durée. Banques d'affaires : investissent dans les entreprises les fonds empruntés au public ou aux banques de prêts. 6. Aucune banque privée ne peut prendre une dénomination qui pourrait faire penser qu'elle est une émanation du secteur public ( dénominations telles que " nationale " ou " public ". La crise monétaire et bancaire actuelle, quasiment mondiale, conforte cette position.
Annexe 4.
Rembourser la dette?
Imaginons que maintenant un nouveau président veuille rembourser la dette publique aussi vite que possible. Il se rend compte que le budget de l'Etat ne pouvant déjà pas couvrir les 50 milliards d'intérêt annuel, le recours à l'emprunt est adopté pour les payer en plus du déficit primaire. Quant au capital formant la dette, inutile de penser le rembourser même en diminuant comme jamais le nombre de fonctionnaires et en réduisant de toute part les dépenses car la réduction des revenus de tous entraîne une récession et une baisse des recettes fiscales. Bien sûr il pourrait augmenter les impôts des classes moyennes mais elles sont déjà exsangues et cela ne pourrait se faire sans des conséquences graves sur l'activité. Il reste une autre solution, à savoir la monétisation directe par la Banque de France. Ici il faut se souvenir que le système de création de monnaie par une banque centrale est exactement le même que celui utilisé par les banques commerciales privées ou non. L'emprunteur dépose une " obligation " ( reconnaissance de dette ) que la banque porte à l'actif de son bilan. Puisque c'est " son droit " ( et les banques sont les seules à en disposer ), elle porte au passif de son bilan, au crédit du compte de l'emprunteur, le montant de la valeur de l'obligation, en monnaie qu'elle crée par cet acte. C'est ce qu'on appelle la monétisation. L'emprunteur peut dès lors se servir de cette monnaie créée. Dans le cas de la Banque centrale, l'emprunteur est le Trésor public qui recevra donc sur son compte, tenu par la Banque de France, l'équivalent de l'obligation déposée. La différence est que rien n'oblige l'Etat à rembourser car il est propriétaire de la Banque centrale. Il s'agit dans ce cas d'une simple monétisation.
Malheureusement c'est doublement interdit. D'abord par la loi française, article L 141 - 3 du code monétaire et financier, ce qui est relativement facile à changer. Ensuite interdit par l'article 104 du traité de Maastricht, devenu par la suite article 123 du Traité de Lisbonne, qui interdit en termes très clairs toute avance directe, sous quelque forme que ce soit, des Banques centrales nationales aux Etats et autres administrations publiques. Alors les options restantes consistent à d'abord laisser filer l'inflation de façon excessive. Les effets secondaires risquent d'être graves. " Faire défaut, total ou partiel, possible mais pas très populaire et à considérer l'état de la Grèce, pas sûr que cela donne envie. Vendre tous nos actifs? E qui et est ce que c'est une solution libératrice? Sans doute pas. Il faut trouver autre chose. Il faut considérer plusieurs hypothèses d'évolution de la dette calculée en valeur monétaire constante sur la base d'une augmentation espérée du PIB en volume de 2% par an ( quoique très optimiste à et de taux d'intérêts réels de 2%, c'est à dire le taux nominal diminué du taux d'inflation, sur le solde de dette à rembourser. Hypothèse 1 : intérêts réels 2% / an, déficit 3% du PIB / an. Pas de monétisation : la dette explose à plus de 200% du PIB avant 2050. Hypothèse 2 : intérêts réels 2% / an, pas de déficit. Pas de monétisation mais donc pas d'investissements : la dette suit exactement le PIB. Cela ne marche pas alors ion reprend les hypothèses de monétisation. Hypothèse 3 : intérêts réels 2% / an déficit 3% du PIB/an, monétisation annuelle 3% du PIB : la dette reste quasi stable en montants mais ne représente plus que 57% du PUB, c'est à dire proche du pourcentage qu'avait imposé Maastricht. Hypothèse 4 : intérêts réels 2% / an, pas de déficit. Monétisation annuelle 5% du PIB : D'ici 2050 la dette aura énormément baissée, disons à 10% du PIB.
Pour sortir du joug de la dette, le président aura-t-il d'autre alternative que de décider de passer outre et de quitter l'euro? Sans doute. Car il n'y aura pas de prise de conscience général au niveau des dirigeants européens. En tout cas il est clair que les financements futurs, qu'ils soient ceux d'investissements écologiques et énergétiques qui n'offrent pas de rentabilité à long terme, ou ceux correspondant à une volonté de remboursement de la dette publique passent nécessairement par une monétisation.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
.
Quand on parle de monnaie, on pense avant tout aux billets et aux pièces de monnaie. Sans doute par habitude vu que c'est de la monnaie physique. Ou alors le fait qu'il existe le souvenir dans notre mémoire collective des temps plus anciens où l'argent n'était pas dématérialisé. A l'heure actuelle, il s'agit d'un des supports monétaires en circulation, et un support très minoritaire puisque la masse monétaire consiste en de la monnaie scripturale. La masse monétaire est détenue par les différents acteurs ( personnes physiques, morales, ou administratives ), sous la forme de monnaie fiduciaire ou scripturale. La monnaie fiduciaire, ce sont les pièces et les billets,la monnaie physique en gros. Tandis que la monnaie scripturale est une monnaie d'écriture suite à un dépôt.
L'une des croyances les plus tenaces est que l'argent existe encore, à la manière d'un gâteau qu'il faudrait répartir entre les convives. Car si des siècles durant, l'argent existait bel et bien, ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui monnaie permanente, eh bien aujourd'hui, elle est dématérialisée. Cette dématérialisation est devenue totale en 1971 lorsque le dollar a abandonné sa convertibilité en or. A ce moment là c'était encore la seule monnaie à avoir gardé cette convertibilité. Cela fait que l'argent n'existe pas vraiment. Il est créé en fait au moyen du crédit. Contrairement à la monnaie permanente, cette monnaie là est temporaire. Car cette monnaie existe entre le moment où il est emprunté et le moment où il est remboursé. L'argent est devenue une dette car il faut l'emprunter pour qu'il y en ait. La monnaie, c'est de la dette. Malgré cela, il y a deux choses positives à retirer de cela. D'abord, en théorie du moins, cela permet d'émettre la monnaie en proportion de la richesse réelle produite, ce qui était impossible à l'époque où la monnaie était en métaux précieux. Quand espagnols étaient revenus d'Amérique en Europe avec énormément d'or, de même qu'il n'y avait de contrepartie métallique disponible, ce qui fut le cas la plupart du temps. Ensuite, l'argent s'affranchit de la rareté. Car bien sûr les métaux précieux étaient rares pour beaucoup d'entre eux, surtout l'or. Sauf qu'on ne dit que très rarement à qui la création monétaire est elle confiée. Et c'est là que le mât blesse. La dette trouve sa source dans cette question. Toute la monnaie en circulation a été créée ex nihilo par les banques commerciales sous la forme de crédits aux ménages, aux entreprises et à l'Etat.
On parle de la monnaie comme s'il y en avait qu'une. Qu'elle se présente sous la forme de pièces et billets ou d'écritures sur le compte en banque. Il n'y a qu'une monnaie, celle dont la banque centrale a le monopole d'émission, appelée monnaie de base, ou monnaie centrale. Cette monnaie se décompose en : une monnaie scripturale ou électronique d'abord. Cette monnaie n'est utilisée qu'entre banques commerciales ou dans les relations entre la banque centrale et l'Etat, soit en France, le trésor public. Ensuite il y a la monnaie fiduciaire qui sont les pièces et les billets de banque qu'on utilise. On en parle parfois aussi sous le nom de monnaie manuelle. Mais le principe de réserve fractionnaire fait que les banques commerciales n'ont en réserve sur leur compte à la Banque centrale, qu'une fraction seulement de nos dépôts. Cela signifie que le solde figurant sur notre relevé de compte n'est pas encore de la vraie monnaie techniquement mais une promesse faite par notre banque de nous remettre ce montant en monnaie centrale quand on la demande et qu'on veut retirer l'argent. Cet engagement de la banque lui permet d'assimiler une promesse de monnaie à de la monnaie de sorte que dans la pratique, la distinction n'est ni faite ni dite. Mais il faut comprendre que toute la partie non couverte par de la monnaie centrale n'est que de la monnaie maison, soit des euros BNP, société générale ou euro crédit agricole. Soit des euros ne valant rien en dehors de l'enseigne. Quand une banque doit une somme à une autre, elle le paie en monnaie centrale qu'elle prélève sur son compte à la banque centrale ou qu'elle emprunte au cas où elle n'en aurait pas assez.
On dit que la banque monétise une créance non monétaire, privilège qu'elle est la seule entreprise à avoir, monétiser voulant dire créer de la monnaie. Elle n'a pas besoin de disposer d'une quelconque épargne préalable pour nous prêter, même si elle est aussi, en plus, intermédiaire entre épargnants et emprunteurs dans son rôle d'intermédiation, qui représente sensiblement 40% des crédits qu'elles accordent. Les économistes ont coutume de dire que les crédits sont à l'origine des dépôts, ou en anglais " loans create deposits ". Ces dépôts, à ce stade monnaie secondaire, sont pour nous de la monnaie utilisable immédiatement qu'on peut même échanger contre de la monnaie fiduciaire qui est la monnaie centrale. La banque devant nous en fournir. En effet, ce sont les banques privées et non pas la banque central qui crée le gros de la masse monétaire, via les crédits qu'elles accordent aux ménages et aux entreprises. Les banques ne sont pas de simples intermédiaires contrairement à une idée reçue. Il ne s'agit pas de récolter l'épargne des gens pour la prêter à d'autres. En accordant un prêt, la banque crée du pouvoir d'achat puisqu'elle crédite sur un compte de l'argent qui avant cela, n'existait pas. Un crédit est accordé via un simple jeu d'écriture. Lorsqu'il y a remboursements, la monnaie disparaît car le banquier va effacer le montant de la somme empruntée puis remboursée dans les deux colonnes de son bilan. La dette de l'emprunteur sera alors effacée et son compte réduit du même montant. Il faut s'imaginer un robinet des crédits alimentant la quantité d'eau dans la baignoire qui est la masse monétaire. Car l'économie fonctionne comme une baignoire. Il ne faut ni trop la remplir, car sinon, il y a le risque de l'inflation qui va avec. Ni la remplir trop peu sous peine de risque de récession. La masse monétaire par la société est à chaque instant le solde résultant de la différence entre flux sortants et flux entrants.
C'est cette quantité d'eau dans cette baignoire qui sert aux multiples échanges économiques ainsi qu'à des prêts entre diverses entités. Tant qu'elle est dans la baignoire, cette monnaie circuite entre les acteurs économiques en servant plusieurs fois à éteindre des dettes ou à payer des fournisseurs comme l'illustre le conte de la Dame de Condé. Donc, s'il n'y avait plus de nouveaux crédits pour remplacer ceux arrivant à échéance, la baignoire se viderait. La monnaie, c'est du crédit. Et sans crédits, il n'y a pas de monnaie.
Du coup on peut penser que la banque peut créer de la monnaie à l'infini et faire tout ce qu'elle veut. Car les banques avaient abusé de leur pouvoir durant les années 2000 on l'a bien vu, en émettant pour compte propre à des fins purement spéculatives visant un enrichissement personnel au lieu de répondre aux besoins de l'économie réelle. Cependant, il existe des limites.
Parmi les réglementations imposées, il y a le fait de disposer en Banque centrale donc en monnaie centrale, de liquidités égales à 1% des comptes de dépôts et d'épargne en ce qui concerne la zone euro : ce sont les réserves obligatoires en monnaie centrale. Ce taux est fixé par la Banque centrale. Ce taux varie d'une zone monétaire à une autre. Par exemple si on a 1000 euros sur notre compte à vue et 1000 euros d'épargne sur un livret, la banque doit détenir 20 euros sur con compte à la BCE en monnaie de base qui n'est pas une partie des dépôts mais d'obligations éligibles que détient ou emprunte la banque. On entendra à ce sujet parler de multiplicateur ou de diviseur. Il s'agit en fait de la capacité dont dispose une banque commerciale de créer de la monnaie de crédit en fonction du montant de ses réserves obligatoires en monnaie centrale. Si anciennement, la tendance voulait que la banque soit tenue par ce montant, les excès ayant abouti à la crise de 2008 ont montré que les banques pouvaient émettre tous les crédits qu'elles souhaitaient, et que les Banques Centrales leurs fournissaient de toute façon cette monnaie centrale. Ensuite l'autre limite est d'avoir un montant de fonds propres qui soit égal à 8% des crédits qu'elles offrent, ce qui dans l'absolu limite le nombre des crédits à 12,5 fois leurs fonds propres. On dit dans l'absolu car si les banques américaines sont soumises à une réglementation qui leur impose aussi un rapport des fonds propres sur les crédits, les banques européennes pratiquent des calculs de fonds propres sur la base d'une pondération des risques. On peut dire que dans un certain sens, les banques américains sont devenues plus sûres que les banques européennes. Enfin, la dernière réglementation est d'assurer l'obligation de fournir la demande de monnaie centrale sous forme de billets de banque au public.
Quand on parle de monnaie, on pense avant tout aux billets et aux pièces de monnaie. Sans doute par habitude vu que c'est de la monnaie physique. Ou alors le fait qu'il existe le souvenir dans notre mémoire collective des temps plus anciens où l'argent n'était pas dématérialisé. A l'heure actuelle, il s'agit d'un des supports monétaires en circulation, et un support très minoritaire puisque la masse monétaire consiste en de la monnaie scripturale. La masse monétaire est détenue par les différents acteurs ( personnes physiques, morales, ou administratives ), sous la forme de monnaie fiduciaire ou scripturale. La monnaie fiduciaire, ce sont les pièces et les billets,la monnaie physique en gros. Tandis que la monnaie scripturale est une monnaie d'écriture suite à un dépôt.
L'une des croyances les plus tenaces est que l'argent existe encore, à la manière d'un gâteau qu'il faudrait répartir entre les convives. Car si des siècles durant, l'argent existait bel et bien, ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui monnaie permanente, eh bien aujourd'hui, elle est dématérialisée. Cette dématérialisation est devenue totale en 1971 lorsque le dollar a abandonné sa convertibilité en or. A ce moment là c'était encore la seule monnaie à avoir gardé cette convertibilité. Cela fait que l'argent n'existe pas vraiment. Il est créé en fait au moyen du crédit. Contrairement à la monnaie permanente, cette monnaie là est temporaire. Car cette monnaie existe entre le moment où il est emprunté et le moment où il est remboursé. L'argent est devenue une dette car il faut l'emprunter pour qu'il y en ait. La monnaie, c'est de la dette. Malgré cela, il y a deux choses positives à retirer de cela. D'abord, en théorie du moins, cela permet d'émettre la monnaie en proportion de la richesse réelle produite, ce qui était impossible à l'époque où la monnaie était en métaux précieux. Quand espagnols étaient revenus d'Amérique en Europe avec énormément d'or, de même qu'il n'y avait de contrepartie métallique disponible, ce qui fut le cas la plupart du temps. Ensuite, l'argent s'affranchit de la rareté. Car bien sûr les métaux précieux étaient rares pour beaucoup d'entre eux, surtout l'or. Sauf qu'on ne dit que très rarement à qui la création monétaire est elle confiée. Et c'est là que le mât blesse. La dette trouve sa source dans cette question. Toute la monnaie en circulation a été créée ex nihilo par les banques commerciales sous la forme de crédits aux ménages, aux entreprises et à l'Etat.
On parle de la monnaie comme s'il y en avait qu'une. Qu'elle se présente sous la forme de pièces et billets ou d'écritures sur le compte en banque. Il n'y a qu'une monnaie, celle dont la banque centrale a le monopole d'émission, appelée monnaie de base, ou monnaie centrale. Cette monnaie se décompose en : une monnaie scripturale ou électronique d'abord. Cette monnaie n'est utilisée qu'entre banques commerciales ou dans les relations entre la banque centrale et l'Etat, soit en France, le trésor public. Ensuite il y a la monnaie fiduciaire qui sont les pièces et les billets de banque qu'on utilise. On en parle parfois aussi sous le nom de monnaie manuelle. Mais le principe de réserve fractionnaire fait que les banques commerciales n'ont en réserve sur leur compte à la Banque centrale, qu'une fraction seulement de nos dépôts. Cela signifie que le solde figurant sur notre relevé de compte n'est pas encore de la vraie monnaie techniquement mais une promesse faite par notre banque de nous remettre ce montant en monnaie centrale quand on la demande et qu'on veut retirer l'argent. Cet engagement de la banque lui permet d'assimiler une promesse de monnaie à de la monnaie de sorte que dans la pratique, la distinction n'est ni faite ni dite. Mais il faut comprendre que toute la partie non couverte par de la monnaie centrale n'est que de la monnaie maison, soit des euros BNP, société générale ou euro crédit agricole. Soit des euros ne valant rien en dehors de l'enseigne. Quand une banque doit une somme à une autre, elle le paie en monnaie centrale qu'elle prélève sur son compte à la banque centrale ou qu'elle emprunte au cas où elle n'en aurait pas assez.
On dit que la banque monétise une créance non monétaire, privilège qu'elle est la seule entreprise à avoir, monétiser voulant dire créer de la monnaie. Elle n'a pas besoin de disposer d'une quelconque épargne préalable pour nous prêter, même si elle est aussi, en plus, intermédiaire entre épargnants et emprunteurs dans son rôle d'intermédiation, qui représente sensiblement 40% des crédits qu'elles accordent. Les économistes ont coutume de dire que les crédits sont à l'origine des dépôts, ou en anglais " loans create deposits ". Ces dépôts, à ce stade monnaie secondaire, sont pour nous de la monnaie utilisable immédiatement qu'on peut même échanger contre de la monnaie fiduciaire qui est la monnaie centrale. La banque devant nous en fournir. En effet, ce sont les banques privées et non pas la banque central qui crée le gros de la masse monétaire, via les crédits qu'elles accordent aux ménages et aux entreprises. Les banques ne sont pas de simples intermédiaires contrairement à une idée reçue. Il ne s'agit pas de récolter l'épargne des gens pour la prêter à d'autres. En accordant un prêt, la banque crée du pouvoir d'achat puisqu'elle crédite sur un compte de l'argent qui avant cela, n'existait pas. Un crédit est accordé via un simple jeu d'écriture. Lorsqu'il y a remboursements, la monnaie disparaît car le banquier va effacer le montant de la somme empruntée puis remboursée dans les deux colonnes de son bilan. La dette de l'emprunteur sera alors effacée et son compte réduit du même montant. Il faut s'imaginer un robinet des crédits alimentant la quantité d'eau dans la baignoire qui est la masse monétaire. Car l'économie fonctionne comme une baignoire. Il ne faut ni trop la remplir, car sinon, il y a le risque de l'inflation qui va avec. Ni la remplir trop peu sous peine de risque de récession. La masse monétaire par la société est à chaque instant le solde résultant de la différence entre flux sortants et flux entrants.
C'est cette quantité d'eau dans cette baignoire qui sert aux multiples échanges économiques ainsi qu'à des prêts entre diverses entités. Tant qu'elle est dans la baignoire, cette monnaie circuite entre les acteurs économiques en servant plusieurs fois à éteindre des dettes ou à payer des fournisseurs comme l'illustre le conte de la Dame de Condé. Donc, s'il n'y avait plus de nouveaux crédits pour remplacer ceux arrivant à échéance, la baignoire se viderait. La monnaie, c'est du crédit. Et sans crédits, il n'y a pas de monnaie.
Du coup on peut penser que la banque peut créer de la monnaie à l'infini et faire tout ce qu'elle veut. Car les banques avaient abusé de leur pouvoir durant les années 2000 on l'a bien vu, en émettant pour compte propre à des fins purement spéculatives visant un enrichissement personnel au lieu de répondre aux besoins de l'économie réelle. Cependant, il existe des limites.
Parmi les réglementations imposées, il y a le fait de disposer en Banque centrale donc en monnaie centrale, de liquidités égales à 1% des comptes de dépôts et d'épargne en ce qui concerne la zone euro : ce sont les réserves obligatoires en monnaie centrale. Ce taux est fixé par la Banque centrale. Ce taux varie d'une zone monétaire à une autre. Par exemple si on a 1000 euros sur notre compte à vue et 1000 euros d'épargne sur un livret, la banque doit détenir 20 euros sur con compte à la BCE en monnaie de base qui n'est pas une partie des dépôts mais d'obligations éligibles que détient ou emprunte la banque. On entendra à ce sujet parler de multiplicateur ou de diviseur. Il s'agit en fait de la capacité dont dispose une banque commerciale de créer de la monnaie de crédit en fonction du montant de ses réserves obligatoires en monnaie centrale. Si anciennement, la tendance voulait que la banque soit tenue par ce montant, les excès ayant abouti à la crise de 2008 ont montré que les banques pouvaient émettre tous les crédits qu'elles souhaitaient, et que les Banques Centrales leurs fournissaient de toute façon cette monnaie centrale. Ensuite l'autre limite est d'avoir un montant de fonds propres qui soit égal à 8% des crédits qu'elles offrent, ce qui dans l'absolu limite le nombre des crédits à 12,5 fois leurs fonds propres. On dit dans l'absolu car si les banques américaines sont soumises à une réglementation qui leur impose aussi un rapport des fonds propres sur les crédits, les banques européennes pratiquent des calculs de fonds propres sur la base d'une pondération des risques. On peut dire que dans un certain sens, les banques américains sont devenues plus sûres que les banques européennes. Enfin, la dernière réglementation est d'assurer l'obligation de fournir la demande de monnaie centrale sous forme de billets de banque au public.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
Les Etats ont besoin d'argent mais malheureusement l'article 123 du TFUE et avant cela l'article 105 du traité de Maastricht les interdisent de se faire financer directement par leur propre banque centrale. Ainsi, l'Etat français ne peut pas se faire financer directement par sa banque centrale. Il faut donc emprunter sur les marchés financiers. En France, quelques banques dites habilitées, françaises ou étrangères, souscrivent aux emprunts d'Etat qu'elles vont revendre avec bénéfice aux autres banques, aux fonds de pension ou aux assureurs. Ces titres de l'Etat qui sont des dettes souveraines vont permettre aux autres banques, en les déposant à titre de garantie à la Banque centrale, laquelle les inscrit à l'actif de son bilan selon le fameux jeu d'écriture, eh bien d'obtenir de la monnaie centrale dont elles ont besoin que ce soit les réserves obligatoires, les compensations interbancaires ou la demande de monnaie fiduciaire. Aux détenteurs d'obligation que ce soit les Bons du Trésor ou les OAT, l'Etat paye des intérêts. Le tout à des taux généralement bas mais avaient explosé entre 2008 et 2012.
Parmi toutes les idées reçues qui circulent encore dans les médias mainstream est que l'Etat vivrait au dessus de ses moyens et que la dette serait le résultat d'une augmentation des dépenses publiques, elle même jugée comme étant excessive par certains. Le message qui est fait passer est simple : on ne peut pas dépenser plus que l'on gagne. Si on continue comme ça on va endetter les générations futures en payant sans arrêt en crédit. Apparemment ce discours a l'air d'être plein de bon sens. En apparence seulement. Ainsi parmi ceux qui ont fait circulé cette idée notons François Fillon le 21 septembre 2007 qui disait : " Je suis à la tête d'un Etat qui est en situation de faillite sur le plan financier. " Le 23 mai 2002, sur France 2, Raffarin, premier ministre de l'époque sous Chirac avant que Fillon ne le soit sous Sarkozy, disait : " Moi, j'ai des idées simples. C'est de la bonne gestion de père de famille, c'est cela qu'il faut faire. Je suis tout à fait favorable à ce que nous puissions, très rapidement, réduire les déficits. ".
Le problème est qu'il n'y a pas de comparaison possible entre un père de famille et l'Etat. Car l'Etat n'est pas une personne physique, ni morale. L'Etat n'est pas un simple composant de la société. C'est là qu'on voit que nombre de politiciens ne faisaient pas bien la différence entre le collectif et le particulier. Un Etat a un privilège que le particulier n'a pas, à savoir le fait de pouvoir fixer lui même le montant de ses recettes. Concrètement, quand l'Etat emprunte, c'est par choix. Il peut faire le choix entre avoir des dépenses supérieures aux recettes, dans le souci de répondre aux besoin de son pays du mieux possible. Ou alors de financer le déficit en empruntant, au lieu d'utiliser l'outil fiscal. De plus, contrairement à une entreprise qui est soumise à des bons résultats financiers et qui est donc dans une logique de profit, l'Etat a une fonction de régulation et de redistribution. C'est l'intérêt commun qui doit primer. Le profit de l'Etat réside dans le maintien du lien social et de la prospérité dans son pays. Accepter le déficit pour le maintenir peut en être le prix. C'est pourquoi selon que ce soit une entreprise ou un Etat, la dette n'a pas la même signification.
On voit souvent la loi 63 - 7 du 3 janvier 1973, soutenue par Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances du président Pompidou, est souvent vu comme la loi ayant interdit à l'Etat de se financer gratuitement auprès de la Banque de France. La réalité est un peu plus nuancée. Cette loi est en réalité l'un des épisodes, certes marquant, mais un épisode seulement du processus ayant conduit la France et pas que, a abandonné l'option de pouvoir se financer gratuitement auprès de sa banque. A noter qu'après la guerre à la fin des années 1940, la France a réussit à faire face à sa reconstruction ainsi qu'au financement d'une politique sociale généreuse tout en ayant à financer ses guerres pour tâcher de conserver son empire colonial. Et pourtant c'était un pays ruiné. Parmi les outils utilisés il y avait le recours aux avances de la Banque de France, qui a permit à l'Etat de ne pas emprunter sur les marchés. Un autre instrument utilisé était le circuit du Trésor, qui a été conceptualisé par François Bloch Lainé qui fut jadis entre 1947 et 1952, directeur du Trésor. La thèse du doctorat de Benjamin Lemoine intitulée " Les valeurs de la dette " est très éclairante sur cet outil utilisé entre 1945 et la fin des années 1960. Le circuit consistait à un ensemble de mécanismes conduisant de nombreuses institutions appelées les correspondants du Trésor, à déposer au Trésor public tout ou partie des ressources qu'elles collectaient. Et ces institutions étaient nombreuses, entre les banques nationalisées comme le Comptoire National d'Escompte, la Société Général, le Crédit Lyonnais, la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie; également la Caisse des Dépôts, les Caisses d'épargne, les entreprises publiques comme semi publiques ainsi que les collectivités locales. Le circuit du Trésor alimentait ainsi les caisses de l'Etat en lui permettant de se servir de ressources qui ne lui appartenaient pas mais dont il pouvait se servir gratuitement.
Il y avait en plus de cela la pratique du plancher obligeant les banques à acheter des bons du Trésor dont les taux étaient fixés par l'Etat et pas par le marché, taux qui conduisait souvent les banques, avec l'inflation, à contracter des emprunts à rendement négatifs. Avant, c'était l'Etat qui imposait ses conditions aux banques et non l'inverse.
Ce circuit, certains essayeront de le démanteler, notamment Yves Haberer en 1967, qui était haut fonctionnaire et futur directeur du Trésor. Et la loi du 3 janvier 1973 fait justement partie de la réforme de statuts de la Banque de France qui avait pour but principal de rompre une fois pour toutes avec le circuit qui ne correspondait ni aux intérêts des banquiers ni à celui de l'oligarchie financière en général. Sans oublier les libéraux qui ont adopté entretemps les théories monétaristes. Pour rappel, le monétarisme est un courant de pensée économique pour lequel les gouvernements doivent mener une politique monétaire stricte et rigoureuse pour limiter la quantité de monnaie en circulation. L'idée de cette théorie est que la monnaie n'est qu'un voile n'ayant pas d'influence sur l'économie en dehors de l'inflation qui est provoquée par trop de monnaie en circulation. Ainsi donc, la loi de janvier 1973 fait partie de cette volonté de mettre à bas le circuit ainsi que de mettre en place un abandon des avances gratuites de la Banque de France. C'était la pratique du plancher et celle de la dette à vue, soit l'utilisation des ressources des correspondants du Trésor, qui devait disparaître. Ainsi, deux articles de la loi du 3 janvier 1973 ont été abrogés par la loi numéro 93 - 980 du 4 août 1993 qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 1994. D'abord l'article 25 : " Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. " Ensuite, l'article 19 : " Les conditions dans lesquelles l'Etat peut obtenir de la Banque des avances et des prêts sont fixées par des conventions passées entre le ministre de l'Economie et des Finances et le gouverneur, autorisé par délibération du conseil général. Ces conventions doivent être approuvées par le Parlement. " Je précise que le Parlement n'a été consulté que pour l'approbation ou pour le rejet.
A noter que la loi numéro 93 980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France interdit à celle ci dans son article 3 d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics, de même que l'acquisition de titres de leur dette. Les services bancaires ( opération de caisse, tenue de compte, placement des bons du Trésor, etc.. ) encore assurés par la Banque pour le compte du Trésor sont désormais rémunérés par l'Etat. Le code monétaire et financier actuellement en vigueur précise bien dans l'article L 141 - 3 : " Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout organisme ou entreprises publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite. " Comme l'impose l'article 104 du Traité de Maastricht puis l'article 123 du Traité de Bisbonne : " Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des Etats membres, ci après dénommées " banques centrales nationales ", d'accorder des découverts ou tout autre type de crédits aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. ". Or, il est bien plus difficile de modifier une loi européenne qu'une loi française car il faut pour renégocier les traités européens l'unanimité des états membres. Vu que l'Etat n'a plus ses sources de financements avantageuses, il faut qu'il se tourne vers les marchés financiers notamment. Il ne paie pas ses fonctionnaires ou fournisseurs qu'en monnaie centrale, de compte à compte à la Banque de France, au bénéfice des banques commerciales qui gèrent les comptes de ceux ci.
Parmi toutes les idées reçues qui circulent encore dans les médias mainstream est que l'Etat vivrait au dessus de ses moyens et que la dette serait le résultat d'une augmentation des dépenses publiques, elle même jugée comme étant excessive par certains. Le message qui est fait passer est simple : on ne peut pas dépenser plus que l'on gagne. Si on continue comme ça on va endetter les générations futures en payant sans arrêt en crédit. Apparemment ce discours a l'air d'être plein de bon sens. En apparence seulement. Ainsi parmi ceux qui ont fait circulé cette idée notons François Fillon le 21 septembre 2007 qui disait : " Je suis à la tête d'un Etat qui est en situation de faillite sur le plan financier. " Le 23 mai 2002, sur France 2, Raffarin, premier ministre de l'époque sous Chirac avant que Fillon ne le soit sous Sarkozy, disait : " Moi, j'ai des idées simples. C'est de la bonne gestion de père de famille, c'est cela qu'il faut faire. Je suis tout à fait favorable à ce que nous puissions, très rapidement, réduire les déficits. ".
Le problème est qu'il n'y a pas de comparaison possible entre un père de famille et l'Etat. Car l'Etat n'est pas une personne physique, ni morale. L'Etat n'est pas un simple composant de la société. C'est là qu'on voit que nombre de politiciens ne faisaient pas bien la différence entre le collectif et le particulier. Un Etat a un privilège que le particulier n'a pas, à savoir le fait de pouvoir fixer lui même le montant de ses recettes. Concrètement, quand l'Etat emprunte, c'est par choix. Il peut faire le choix entre avoir des dépenses supérieures aux recettes, dans le souci de répondre aux besoin de son pays du mieux possible. Ou alors de financer le déficit en empruntant, au lieu d'utiliser l'outil fiscal. De plus, contrairement à une entreprise qui est soumise à des bons résultats financiers et qui est donc dans une logique de profit, l'Etat a une fonction de régulation et de redistribution. C'est l'intérêt commun qui doit primer. Le profit de l'Etat réside dans le maintien du lien social et de la prospérité dans son pays. Accepter le déficit pour le maintenir peut en être le prix. C'est pourquoi selon que ce soit une entreprise ou un Etat, la dette n'a pas la même signification.
On voit souvent la loi 63 - 7 du 3 janvier 1973, soutenue par Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances du président Pompidou, est souvent vu comme la loi ayant interdit à l'Etat de se financer gratuitement auprès de la Banque de France. La réalité est un peu plus nuancée. Cette loi est en réalité l'un des épisodes, certes marquant, mais un épisode seulement du processus ayant conduit la France et pas que, a abandonné l'option de pouvoir se financer gratuitement auprès de sa banque. A noter qu'après la guerre à la fin des années 1940, la France a réussit à faire face à sa reconstruction ainsi qu'au financement d'une politique sociale généreuse tout en ayant à financer ses guerres pour tâcher de conserver son empire colonial. Et pourtant c'était un pays ruiné. Parmi les outils utilisés il y avait le recours aux avances de la Banque de France, qui a permit à l'Etat de ne pas emprunter sur les marchés. Un autre instrument utilisé était le circuit du Trésor, qui a été conceptualisé par François Bloch Lainé qui fut jadis entre 1947 et 1952, directeur du Trésor. La thèse du doctorat de Benjamin Lemoine intitulée " Les valeurs de la dette " est très éclairante sur cet outil utilisé entre 1945 et la fin des années 1960. Le circuit consistait à un ensemble de mécanismes conduisant de nombreuses institutions appelées les correspondants du Trésor, à déposer au Trésor public tout ou partie des ressources qu'elles collectaient. Et ces institutions étaient nombreuses, entre les banques nationalisées comme le Comptoire National d'Escompte, la Société Général, le Crédit Lyonnais, la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie; également la Caisse des Dépôts, les Caisses d'épargne, les entreprises publiques comme semi publiques ainsi que les collectivités locales. Le circuit du Trésor alimentait ainsi les caisses de l'Etat en lui permettant de se servir de ressources qui ne lui appartenaient pas mais dont il pouvait se servir gratuitement.
Il y avait en plus de cela la pratique du plancher obligeant les banques à acheter des bons du Trésor dont les taux étaient fixés par l'Etat et pas par le marché, taux qui conduisait souvent les banques, avec l'inflation, à contracter des emprunts à rendement négatifs. Avant, c'était l'Etat qui imposait ses conditions aux banques et non l'inverse.
Ce circuit, certains essayeront de le démanteler, notamment Yves Haberer en 1967, qui était haut fonctionnaire et futur directeur du Trésor. Et la loi du 3 janvier 1973 fait justement partie de la réforme de statuts de la Banque de France qui avait pour but principal de rompre une fois pour toutes avec le circuit qui ne correspondait ni aux intérêts des banquiers ni à celui de l'oligarchie financière en général. Sans oublier les libéraux qui ont adopté entretemps les théories monétaristes. Pour rappel, le monétarisme est un courant de pensée économique pour lequel les gouvernements doivent mener une politique monétaire stricte et rigoureuse pour limiter la quantité de monnaie en circulation. L'idée de cette théorie est que la monnaie n'est qu'un voile n'ayant pas d'influence sur l'économie en dehors de l'inflation qui est provoquée par trop de monnaie en circulation. Ainsi donc, la loi de janvier 1973 fait partie de cette volonté de mettre à bas le circuit ainsi que de mettre en place un abandon des avances gratuites de la Banque de France. C'était la pratique du plancher et celle de la dette à vue, soit l'utilisation des ressources des correspondants du Trésor, qui devait disparaître. Ainsi, deux articles de la loi du 3 janvier 1973 ont été abrogés par la loi numéro 93 - 980 du 4 août 1993 qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 1994. D'abord l'article 25 : " Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. " Ensuite, l'article 19 : " Les conditions dans lesquelles l'Etat peut obtenir de la Banque des avances et des prêts sont fixées par des conventions passées entre le ministre de l'Economie et des Finances et le gouverneur, autorisé par délibération du conseil général. Ces conventions doivent être approuvées par le Parlement. " Je précise que le Parlement n'a été consulté que pour l'approbation ou pour le rejet.
A noter que la loi numéro 93 980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France interdit à celle ci dans son article 3 d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics, de même que l'acquisition de titres de leur dette. Les services bancaires ( opération de caisse, tenue de compte, placement des bons du Trésor, etc.. ) encore assurés par la Banque pour le compte du Trésor sont désormais rémunérés par l'Etat. Le code monétaire et financier actuellement en vigueur précise bien dans l'article L 141 - 3 : " Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout organisme ou entreprises publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite. " Comme l'impose l'article 104 du Traité de Maastricht puis l'article 123 du Traité de Bisbonne : " Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des Etats membres, ci après dénommées " banques centrales nationales ", d'accorder des découverts ou tout autre type de crédits aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. ". Or, il est bien plus difficile de modifier une loi européenne qu'une loi française car il faut pour renégocier les traités européens l'unanimité des états membres. Vu que l'Etat n'a plus ses sources de financements avantageuses, il faut qu'il se tourne vers les marchés financiers notamment. Il ne paie pas ses fonctionnaires ou fournisseurs qu'en monnaie centrale, de compte à compte à la Banque de France, au bénéfice des banques commerciales qui gèrent les comptes de ceux ci.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an