Ce sujet a été résolu
En musique occidentale
l'écart entre 2 notes le plus juste c'est la quinte parfaite qui sonne comme ça :
l'écart le plus dissonant est la quinte diminué / quarte augmenté, mais surtout connu sous son autre nom le triton :
la quinte parfaite a un écart de 7 demi-tons avec sa fondamentale (la note de la quelle on part pour résumer)
7 = chiffre de dieu, perfection
et 6 pour le triton
6 = imperfection, satan, faiblesse humaine
voilà c'est tout, je pense pas que cela soit fait exprès, mais la coïncidence est marrante
l'écart entre 2 notes le plus juste c'est la quinte parfaite qui sonne comme ça :
l'écart le plus dissonant est la quinte diminué / quarte augmenté, mais surtout connu sous son autre nom le triton :
la quinte parfaite a un écart de 7 demi-tons avec sa fondamentale (la note de la quelle on part pour résumer)
7 = chiffre de dieu, perfection
et 6 pour le triton
6 = imperfection, satan, faiblesse humaine
voilà c'est tout, je pense pas que cela soit fait exprès, mais la coïncidence est marrante
il y a 2 ans
il y a 2 ans
je crois que c'est naturellement dissonant, le fait qu'on soit pas habitué à cet écart n'aide pas, même s'il est utilisé pas pas mal de son un peu rock
typiquement :

c'est un mythe assez récent que les compositeurs ne l'utilisait car "écart du diable" juste on utilisait pas cet écart car dur à chanter si je ne dis pas de bêtises ! le mythe du diabolus in musica c'est 18eme je crois
typiquement :
c'est un mythe assez récent que les compositeurs ne l'utilisait car "écart du diable" juste on utilisait pas cet écart car dur à chanter si je ne dis pas de bêtises ! le mythe du diabolus in musica c'est 18eme je crois
il y a 2 ans
non ça l'est pas, mais c'est super passionnant par contre

c'est un putain de terrier de lapin, tu découvres un sujet, qui te font déboucher sur d'autre sujet, avec la connaissance que t'acquérais tu peux tout lier et tout, je trouve ça trop bien

c'est un putain de terrier de lapin, tu découvres un sujet, qui te font déboucher sur d'autre sujet, avec la connaissance que t'acquérais tu peux tout lier et tout, je trouve ça trop bien
il y a 2 ans
J'aime bien étudier la théorie de la musique.
La ronde.
La ronde dure 4 fois plus longtemps qu'une noire. On dit qu'elle vaut 4 noires. La ronde vaut aussi 2 blanches et 8 croches. La ronde est la figure de note la plus simple car elle n'a qu'un ovale évidé. La ronde est l'unité entière principale et toutes les valeurs se réfèrent à elle pour trouver la mesure. Un blanche se définit comme une demi ronde, le noire se déifnit comme un quart de ronde et la croche un huitième de ronde, etc.... Le rôle de la ronde se vérifie dans les différentes figures de notes. La ronde est le dessin le plus simple, à savoir unovale. La blanche se forme en y ajoutant une hampe. La noire en noircissant l'ovale. La croche en ajoutant un crochet. A chaque nouvelle division correspond un nouvel élement visuel ajouté. Lors de l'interprétation d'une ronde, il faut penser à faire vivre sa durée sur 4 temps car il y a souvent une attaque pui un son qui se meurt.
La double croche.
Une double croche est 2 fois plus rapide qu'une croche. On dit qu'une croche vaut 2 doubles croches. La noire vaut 4 doubles croches. La ronde vaut donc 16 doubles croches étant donné que la ronde vaut 4 noires. La double croche se dessine comme la croche en ajoutant un deuxième crochet. Quand une musique itilise des croches et doubles croches, les ligatures deviennent indispensables pour regrouper visuellement les notes. Le nombre de barres d'une ligaure permet de différencier les croches des doubles croches.
Plus bref que la double croche.
La double croche peut à son tour être divisée en 2 triples croches an ajoutant un troisième crochet. La triple croche peut à son tour être divisée en 2 quadruples croches en ajoutant un autre crochet. Une croche vaut donc 2 doubles croches, 4 triples croches, 8 quadruples croches et 16 quintuples croches. Cela veut dire par conséquence qu'une ronde vaut 128 quintuples croches. Les valeure plus petites que lad ouble croches se trouvent surtout dans les musiques lentes dans le cas de phrases très ornementées. Elles sont également souvent liées à des tournures de phrases instrumentales comme des gammes ou des arpèges rapides. Ces gammes étaient souvent nommées dusées dans la musique baroque ( Lully, ouvertures à la français ). On les appelle aussi des traits. Le jazz de style be bop, comme celui de Charlie Parker, aime aussi utiliser des valeurs très brèves. La musique contemporaine demande parfois également qu'une musique soit jouée le plus rapidement possible.
Graphies des ligatures.
Les ligatures regroupant plusieurs notes suivent les règles gouvernant la direction des hampes. Mais quand un groupe possède des notes nécessitant des directions de hampes opposées, le groupe prend la direction de la note extrême. En cas d'égalité, c'est la direction ascendante qui prime. Quand une musique est écrire sur un système de 2 portées, comme la musique pour harpe ou pour piano, il est possible de dessiner une ligature chevauchant les 2 portées. La musique vocale représente une particularité en ce sens pù quand elle est syllabique, c'est à dire quand une syllabe différente est chantée à chaque note, l'usage veut que l'on évite les ligatures et que chaque note garde son propre crochet. Quand elle est par contre vocalisée ( ou mélismatique ), les ligatures mettent en valeur les différentes notes chantées sur la même syllable. Une même phrase chantée peut bien entendu mélager des moments syllabiques et des moments vocalisés.
Plus lent que la ronde.
Une durée peut restée en vigueur jusqu'à une époque baroque : c'est la note carrée valant 2 rondes. Elle tombe ensuite en désuétude à l'époque classique où plus aucune figure de note dépassant la ronde ne sera utilisée : les compositeurs préférant alors utiliser les signes de prolongations. La note carrée est dessinée comme un rectangle dont les 2 côtés verticaux dépassent légèrement. Les musiques de la Renaissance et de l'époque baroque utilisaient fréquemment des tempi très rapides, donnant tout son intérêt à cette figure de note qui allait par la suite être abandonnées.
Nouvelles notations de durées.
Au XXème siècle de nouvelles graphies de durées se sont généralisées. Certaines servent à noter des figures rythmiques qui accélèrent ou ralentissent indépendamment du temps.
Le goût pour des groupes de notes répétées, semi improvisés, a conduit à désolidariser les hampes des têtes de notes. Déjà employée dans le Kammerkonzet de Ligeti, cette technique est présente dans le premier Quatuor à cordes de Michael Lévinas.
Les silences.
La ronde.
La ronde dure 4 fois plus longtemps qu'une noire. On dit qu'elle vaut 4 noires. La ronde vaut aussi 2 blanches et 8 croches. La ronde est la figure de note la plus simple car elle n'a qu'un ovale évidé. La ronde est l'unité entière principale et toutes les valeurs se réfèrent à elle pour trouver la mesure. Un blanche se définit comme une demi ronde, le noire se déifnit comme un quart de ronde et la croche un huitième de ronde, etc.... Le rôle de la ronde se vérifie dans les différentes figures de notes. La ronde est le dessin le plus simple, à savoir unovale. La blanche se forme en y ajoutant une hampe. La noire en noircissant l'ovale. La croche en ajoutant un crochet. A chaque nouvelle division correspond un nouvel élement visuel ajouté. Lors de l'interprétation d'une ronde, il faut penser à faire vivre sa durée sur 4 temps car il y a souvent une attaque pui un son qui se meurt.
La double croche.
Une double croche est 2 fois plus rapide qu'une croche. On dit qu'une croche vaut 2 doubles croches. La noire vaut 4 doubles croches. La ronde vaut donc 16 doubles croches étant donné que la ronde vaut 4 noires. La double croche se dessine comme la croche en ajoutant un deuxième crochet. Quand une musique itilise des croches et doubles croches, les ligatures deviennent indispensables pour regrouper visuellement les notes. Le nombre de barres d'une ligaure permet de différencier les croches des doubles croches.
Plus bref que la double croche.
La double croche peut à son tour être divisée en 2 triples croches an ajoutant un troisième crochet. La triple croche peut à son tour être divisée en 2 quadruples croches en ajoutant un autre crochet. Une croche vaut donc 2 doubles croches, 4 triples croches, 8 quadruples croches et 16 quintuples croches. Cela veut dire par conséquence qu'une ronde vaut 128 quintuples croches. Les valeure plus petites que lad ouble croches se trouvent surtout dans les musiques lentes dans le cas de phrases très ornementées. Elles sont également souvent liées à des tournures de phrases instrumentales comme des gammes ou des arpèges rapides. Ces gammes étaient souvent nommées dusées dans la musique baroque ( Lully, ouvertures à la français ). On les appelle aussi des traits. Le jazz de style be bop, comme celui de Charlie Parker, aime aussi utiliser des valeurs très brèves. La musique contemporaine demande parfois également qu'une musique soit jouée le plus rapidement possible.
Graphies des ligatures.
Les ligatures regroupant plusieurs notes suivent les règles gouvernant la direction des hampes. Mais quand un groupe possède des notes nécessitant des directions de hampes opposées, le groupe prend la direction de la note extrême. En cas d'égalité, c'est la direction ascendante qui prime. Quand une musique est écrire sur un système de 2 portées, comme la musique pour harpe ou pour piano, il est possible de dessiner une ligature chevauchant les 2 portées. La musique vocale représente une particularité en ce sens pù quand elle est syllabique, c'est à dire quand une syllabe différente est chantée à chaque note, l'usage veut que l'on évite les ligatures et que chaque note garde son propre crochet. Quand elle est par contre vocalisée ( ou mélismatique ), les ligatures mettent en valeur les différentes notes chantées sur la même syllable. Une même phrase chantée peut bien entendu mélager des moments syllabiques et des moments vocalisés.
Plus lent que la ronde.
Une durée peut restée en vigueur jusqu'à une époque baroque : c'est la note carrée valant 2 rondes. Elle tombe ensuite en désuétude à l'époque classique où plus aucune figure de note dépassant la ronde ne sera utilisée : les compositeurs préférant alors utiliser les signes de prolongations. La note carrée est dessinée comme un rectangle dont les 2 côtés verticaux dépassent légèrement. Les musiques de la Renaissance et de l'époque baroque utilisaient fréquemment des tempi très rapides, donnant tout son intérêt à cette figure de note qui allait par la suite être abandonnées.
Nouvelles notations de durées.
Au XXème siècle de nouvelles graphies de durées se sont généralisées. Certaines servent à noter des figures rythmiques qui accélèrent ou ralentissent indépendamment du temps.
Le goût pour des groupes de notes répétées, semi improvisés, a conduit à désolidariser les hampes des têtes de notes. Déjà employée dans le Kammerkonzet de Ligeti, cette technique est présente dans le premier Quatuor à cordes de Michael Lévinas.
Les silences.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
VI
L'harmonie
HARMONIE
Le chiffrage.
Le chiffrage a plusieurs origines. Il apparait à l'époque baroque pour guider certaines parties improvisées. L'interprète de la ligne de basse devait reconstituer les harmonies avec l'aide de ce chiffrage. Ce procédé d'appelle la réalisation de la basse continue. Caccini est un bon exemple car il est une des premières formes de notation expérimentée. C'est un chiffrage d'intervalles très éloigné de ce qui se pratiquera ultérieurement. Car rien n'est indiqué qu'il s'agit d'accords de quinte. Les chiffrages indiquent eux même les dissonances. Les altérations agissent différemment d'aujourd'hui car le dièse pour la sixte sur ré signale sur le si est bémol. Le chiffrage sur la basse continue disparait avec la fin du baroque. Suite à un siècle et demi d'interruption, le XXème siècle voit le chiffrage rennaître. C'est un chiffrage d'improvision : celui du jazz. Dans la pratique les partitions n'indiquent généralement que la ligne mélodique surmontée surmontée du chiffrage des accords. Le musicien doit trouver et la basse et la réalisation. L'envie de comprendre la musique tonale et de perfectionner son écoute intérieure a conduit à une troisième méthode, à savoir le chiffrage d'analyse harmonique. Il vaut mieux essayer plusieurs solutions de mise en page d'analyse harmonique avant de choisir celle que nous convient le mieux. Une d'elle cependant offre une meilleure visibilité et fait apparaître de nombreuses informations utiles pour l'analyse ( tonaliités, degrés, accords, cadences, notes étrangères, fonctions ) et évite bien des ambiguités. Plus on progresse et moins il sera besoin de surcharger une partition d'indications souvent d'importance secondaire. Il y a souvent une confusion entre indiquer les fonctions d'une part, c'est à dire Dominante notée D, sous dominante notée SD ou S, Tonique notée T, et d'autre part indiquer les degrés comme I, II, III, etc....
Pour former un accord de 3 sons, il faut superpose 2 tierces. Exemple : do - mi, puis mi - sol, soit - do-mi-ol. La première des 3 notes est dite note fondamentale de l'accord. La superposition de deux tierces forme une quinte par rapport à la fondamentale : do - sol. QUand cette quinte est juste l'accord est dit parfait. Autrement le nom de l'accord prend le nom du type de sa quinte, soit accord de quinte diminuée ou accord de quinte augmentée. Un accord parfait peut être majeur ou mineur et c'est sa première tierce ( celle formée à partir de la fondamentale ) qui lui donne sa qualification. A noter que sur le premier degré d'une gramem majeure la première tierce de l'accord est elle même majeure. De même sur le premier degré d'une gamme mineure, la première tierce de l'accord est mineure.
Pour ce qui est du chiffrage des accords de 3 sons, il faut savoir que cet accord présente un état dit fondamentale ( le basse est la note fondamentale ) et 2 renversements ( la basse est la tierce ou la quinte de l'état fondamentale ). Le chiffrage de l'état fondamental d'un accord de 3 sons est 5 ( ou rien ). Le chiffrage du premier renversement est 6. Le chiffrage du second renversement est 6/4. Toute altération accidentale doit être signalée dans le chiffrage. Si l'intervalle portant l'altération n'est pas dans le chiffrage, il doit être complété. Une altération seule signale toujours une altération de la tierce. QUand la quinte d'un accord de quinte est omise, le seul moyen de signaler cette absence est de signaler la présence da la tierce. Il n'y a pas de chiffrage pour signaler l'absence de la tierce, celle ci étant vraiment exceptionnelle ( on peut cependant utiliser le chiffrage 5/0 même s'il ne n'est pas généralisé. Un chiffre barré signifie un intervalle diminué. Un + signale la sensible. Il vaut mieux sans doute indiquer le chiffrage des accords comme un indice du degré de l'accord. La méthode la plus usuelle consistant à indiquer les degrés sous la ligne basse et les chiffrages d'intervalles au dessus de la ligne de basse offre une moins bonne lisibilité du au manque de place dans la plupart des partitions.
L'état fondamentale.
L'accord de quinte est l'accord de 3 sons à l'état fondamental : sa basse est la note fondamentale. Les intervalles dans cette position constituent l'accord peuvent se réduire à une suite de tierces. Lors de l'analyse harmonique, pour trouver le degré d'un accord il faut ramener celui ci à son état fondamental. L'accord parfait à l'état fondamental est l'accord stable par excellence. Il peut se rencontrer à tout moment dans une oeuvre. C'est à lui de conclure une phrase ou de terminer une oeuvre.
L'accord de sixte.
Un accord de sons présente 2 renversements; Le premier renversement se nomme accord de sixte. Il s'obtient quand la tierce de l'accord de 3 sons à l'état fondamental devient la basse. l'accord de sixte ne peut pas servir pour conclure. A cette exception près, on peut la trouver à tout moment. Cet accord est assez caractéristique des récitatifs, moments de l'oratorio ou de l'opéra où le texte chanté fait progresser l'action dramatique notamment comme dans l'extrait de la Passion selon saint Mattheiu de J.S. Back qui commence par le premier renversement d'un accord parfait de la dominante de la majeur.
L'accord de quarte et sixte.
Un accord de 3 sons présente 2 renversements. Le deuxième renversement se nomme accord de quarter et sixte. Il s'obtient quand la quinte de l'accord de 3 sons à l'état fondamental devient la basse : l'accord de quarte et sixte est un accord instable. Cette instabilité vient de l'intervalle de quarter existant entre la basse et une autre voix. En effet si la quarte est consonante comparée aux secondes et aux septièmes, elle est dissonante comparée aux quintes, octaves, tierces et sixtes. Duu à cette dissonance, les compositeurs ont pris des précautions méthodiques pour utiliser cet accord : ils l'ont traité comme un accord de passage, soit comme un accord broderie ou soit comme un accord de la dominante ( la quarte et sixte cadentielle ).
Les septièmes.
Un accord de septième est un accord de 4 sons. On l'obtient en superposant une tierce à un accord de quinte. Cette nouvelle note forme une septième avec la note fondamentale. Dans la pratique il n'y a souvent que 3 sons émis. Les compositeurs y parviennent en supprimant soit la quinte, soit la fondamentale de l'accord. L'intervalle de septième est considéré comme dissonant. Les compositeurs classiques ont utilisé quelques précautions mélodiques pour adoucir cette tension : le septième se préparer : elle existe déjà de manière consonantes dans le premier accord. Ensuite cette note consonante devient la septième su second accord ( donc une note dissonante ). 3 : La dissonance se résout conjointement par mouvement descendant, sur une note d'un troisième accord. Un septième non préparée se nomme une septième attaquée. De même qu'il y a différents types d'accord de 3 sons, il y a différents accords de septièmes. Le mode mineur harmonique est parfait pour les découvrir car chacun de ses degrés porte un type d'accord différent. En rupture avec l'esprit de la Renaissance, le début de l'époque baroque vit les compositeurs italiens attaquer tous les types de dissonances. A partir du XVIIIème siècle la situation change et seules les septièmes de dominante et les septièmes diminuées seront encore couramment attaquées. Pour que les autres septièmes, dits d'espèce, soit à nouveau attaquées, il faut attendre la fin du XIXème siècle et surtout le XXème siècle. Dans la musique de jazz, les septièmes sont couramment attaquées d'autant qu'un accord sans septième y est rare.
La septième de dominante.
L'accord de septième de dominante se construit sur le cinquième degré ( la dominante ) est y est identique en majeur et en mineur. Ses intervalles sont ceux d'un accord parfait majeur additionné d'une septième mineure. Sa tierce est la sensible du ton ( notée + ). L'intervalle entre la sensible et la septième est une quinte diminuée ou une quarter augmentée ( triton ). Cet intervalle constitue la tension centrale de l'accord de septième de dominante. Sa résolution usuelle se fait par mouvement contraire sur un accord de tonique par 2 mouvements obligés : la sensible monte à la tonique et la septième se résout en descendant sur la médiante. Une septième de dominante possède un état fondamental et 3 renversements. L'état fondamental se chiffre 7/+. Le premier renversement quand la tierce est à la basse, se nomme sixte et quinte diminuée et ce chiffre 6/5 barré. Le deuxième renversement quand la quinte est à la basse, se nomme sixte sensible et ce chiffre +6. Le troisième renversement quand la septième est à la basse, se nomme triton et se chiffre +4. Contrairement aux accords de quinte où chaque note altérée doit être signalé, le chiffrage de la septième de dominante est invariable. Il faut la prendre comme une indication d'intervalles absolus. Un do chiffré + 6 donnera l'accord do - mi b - fa - la, quelle que soit l'armure. Il faut faire attention aussi à ne bas barrer le sept car cela signifie sept diminué. Le signe + veut dire note sensible et pas intervalle augmentée. La septième de dominante est l'accord de septième le plus fréquent.Au début de Choral en mi b majeur de J.S. Back, il constitue le seul accord de septième. La première septième apparaît fugitivement comme une note de passage. La seconde est en revanche nette dans la forme de cadence parfaite. Aucune de ces deux septièmes n'est préparée. La sonorité de la septième de dominante est particulièrement stable car ses notes reflètent approximativement les 8 premiers harmoniques naturels.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
Même si ça fait un peu boucle des fois. 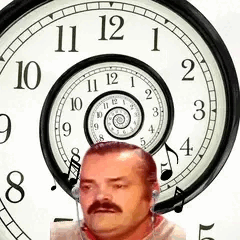
La septième de dominante sans fondamentale.
La septième de dominante est souvent présentée sans sa fondamentale. Elle devient alors un accord de 3 sons. Cette spécificité peut être signalée via chiffrage. L'état fondamental par définition ne peut exister sans fondamentale. Le premier renversement 6/5 barré devient 5 barré. Le second renversement +6 devient +6/3. Le troisième renversement +4 devient 6/+4. Quand la septième de dominante est exprimée sans quinte, le chiffrage ne signale pas cette omission. A noter que comme la septième de dominante sans fondamentale reste une dominante, il vaut mieux généralement indiquer son degré par V que par VII. C'est un des rares cas où il y a une fusion entre chiffrer des degrés et chiffrer des fonctions.
Les septièmes majeures et mineurs.
L'accord dit de septième majeure ( abréviation 7M ) est formé d'un accord parfait majeur et d'une septième majeure. Il se trouve sur les degrés I et IV en majeur et VI en mineur. L'accord dit de septième mineure ( abréviation 7m ), est formé d'un accord parfait mineur et d'une septième mineure. Il se trouve sur les degrés II, III et VI en majeur et IV en mineur. Le chiffrage de ces 2 accords est : 7 à l'état fondamental, 6/5 pour le premier renversement, 4/3 pour le second renversement, 2 pour le troisième renversement. Ces chiffrage n'indiquent que les intervalles minimuax pour comprendre le type d'accords. Quand il y a des altérations, il faut ajouter devant les chiffres concernés.
Le septième diminué.
L'accord de septième diminuée se trouve sur le septième degré en mineur. Son chiffrage est invariable à l'exception du second renversement qui nécessite parfois de préciser la nature de la tierce. 7 barré pour l'état fondamental, +6/5 barré pour le premier renversement, +4/3 pour le second renversement, +2 pour le dernier renversement. On retrouve à la suite 7, 6/5, 4/3 et 2 des septièmes majeures et mineures, complétées par des indications d'intervalles diminués et de sensibles. Cet accord est généralement utilisé comme une neuvième de dominante mineure sans fondamentale. Il est donc souvent préférable de considérer sa fonction ( dominante ou V ) plutôt que son degré ( sensible ou VII ). Il est parfois dur de trouver à l'oreille la fondamentale d'un accord de septième diminuée. En effet comme il est formé de 3 tierces mineures et d'une seconde augmentée ( enharmonie de tierce mineure à, c'est un accord symétrique. Ce n'est que l'orthographe (altération utilisées à et le contexte ) qui permettent d'isoler la seconde augmentée ou la septième diminuée dans la suite des tierces mineures, et donc de trouver la fondamentale : sol - si - ré - fa est le VII de la mineur, alors que la b-si-ré-fa de sonorité identique, est le VII de do mineur.
La septième et quinte diminuée.
Ce type de septième se voit soit sur le second degré en mineur, soit sur le septième degré en majeur. Ses intervalles sont ceux d'un accord de quinte diminuée additionné d'une septième mineure. L'accord du second degré, l'accord se 7/5 barré se chiffre comme suit : 7/5 barré à l'état fondamental, 6/5 pour le premier renversement, 4/3 pour le second renversement, 2 pour le troisième renversement; Pour l'accord du septième degré, dit septième de sensible, il est généralement utilisé comme une neuvième de dominante majeure sans fondamentale. Ses chiffrages sont : 7/5 barré à l'état fondamental, 5/+6 pour le premier renversement, 3/+4 pour le second renversement, 4/+2 pour le troisième renversement. A noter l'invertion de certains intervalles. En effet la septième de cet accord serait la neuvième de l'accord complet et à ce titre, doit toujours être plus aigué que la sensible ( voir les neuvièmes ).
La neuvième de dominante.
La neuvième de dominante est un accord de 5 sons. Sa qualification est différente selon le mode : accord de neuvième majeure de dominante en majeur et accord de neuvième mineure de dominante en mineur. La neuvième de dominante présente un état fondamenta et seulement 3 renversements. En effet le renversement avec la neuvième à la baisse est inusité. Ses chiffrages sont les suivants : état fondamental : 9/7 + ( les altérations de la neuvième doivent être indiquées ). Premier renversement : en majeur 7/6/5 barré et en mineur 7 barré/6/5 barré. Seconde renversement : en majeur 5/+6/4 et en mineur 5 barré/+6/4. Troisième renversement : 3/+4/2 ( les altérations de la tierce doivent être indiquées ). Le quatrième renversement, la neuvième à la basse, est inusité avec l'accord complet. A noter l'inversion de certains intervalles dans le chiffrage. Ils indiquent que dans sa disposition usuelle, la note formant neuvième doit toujours être plus aigue que la sensible. Attention au fait que sile fondamentale et la quinte de l'accord peuvent être omises, la tierce et le septième doivent être présentes. Cet accord utilisé à l'époque baroque devient très fréquent à partir du classicisme et y converve toutes les caractéristiques des septièmes de dominante qu'il contribua à enrichir. Sa note supplémentaire, la neuvième, est couramment attaquée est se rédout par un mouvement descendant. On voit comment elle trouve une place naturelle dans une des Mazurka de Chopin dans opus 7 numéro 1.
.
.
Page 170
.
.
Les notes étrangères.
Dans la musique tonale, chaque note d'une mélodie peut être rattachée à une harmonie ou à un accord, présent ou sou entendu. Mais l'harmonie ne doit pas supprimer la souplesse des lignes mélodiques ou empêcher la superposition de belles mélodies indépendantes. Pour réussir cet équilibre entre mélodie et harmonie, chaque note peut avoir 2 origines distinctes. : être une note constitutive ( réelle ) quand elle appartient à un accord. Ou être une note étrangère quand elle est reliée méthodiquement aux notes réelles d'un accord. Il y a une grande variété de notes étrangères possédant chacune leurs spécificités. La dénomination note constitutive et note ornementale se généralise et a tendance à supplanter note réelle et note étrangère.
Le rythme harmonique.
Pour distinguer notes constitutives et étrangères, il faut déterminer le moment où une harmonie débute et celui où elle est remplacée par l'harmonie suivante. Si ça peut paraître évident pour certains cas, pour d'autres par contre, le rythme et l'écriture instrumentale estompent ces instants où les harmonies s'enchaînent : Les notes d'une musique peuvent être rapides alors que les harmonies ne changent que lentement ( une même harmonie peut durer une croche comme plusieurs mesures ). Les harmonies peuvent changer régulièrement ou se révéler irrégulières et imprévisibles. Le rythme harmonique correspond à la fréquence de ces changements. On peut prendre l'exemple du Clavier bien tempéré de J.S. Bacj, qui montre un rythme harmonique régulier car l'harmonie change à chaque mesure. Dans " Rêverie " de Robert Schuman, le rythme harmonique est irrégulier. Schumann place ses harmonies à ses endroits chaque fois différents ce qui lui permet de varier les appuis de sa ligne mélodique et de conférer ainsi au morceau une merveilleuse souplesse dans l'esprit d'une libre improvisation.
C'est en étant attentif à ces aspects qu'on devient sensible à la dimension du rythme harmonique, indépendante de celle du rythme des notes. Elle a d'importantes implications pour l'interprétation musicale.
La note de pasage.
La note de passage est une note étrangère qui relie conjointement 2 notes réelles distinctes. Elle peut être diatonique ou chromatique, ascendante ou descendante. Quand l'intervalle à franchir le nécessite, il est possible d'enchaîner plusieurs notes de passage. L'abréviation de la note de passage est " p ".
La broderie.
La broderie est une note ornementale quittant conjointement une note réelle et la retrouve. La broderie est supérieure quand la note de broderie est au dessus de la note réelle. Elle est inférieure quand la note de broderie est en dessous de la note réelle. L'abréviation de la broderie est " br ". Quand la broderie enchaîne une broderie supérieure et une broderie inférieure ou l'inverse, elle est dite double broderie. La broderie est au coeur de nombreux ornements étudiés plus loin. Un trille est une suite de broderies rapides, qu'un mordant correspond à une broderie supérieure ou inférieure et que le gruppetto est une double broderie. A noter que la broderie et la note de passage commencent d'une manière identique. La broderie ne poursuit simplement pas son chemin car elle revient à son point de départ.
Le retard.
Le retard est une note étrangère tenue sur un temps fort ou une partie forte d'un temps. Cela se déroule en 3 phases. D'abord la note réelle est tenue lors d'un changement d'harmonie. Ensuite elle devient dissonante et donc note étrangère, dans la nouvelle harmonie. Enfin, elle se résout alors conjointement sur une note réelle. Son abréviation est " ret ". La résolution d'un retard peut être descendante ou ascendante. Plusieurs retards superposés se nomment doubles ou triples retards. Le retard peut parfois aller de manière disjoincte vers une autre note de l'accord avant de rattraper la note réelle, conjointe, attendue. Cela se nomme résolution exceptionnelle. Remarques : le retard est une appoggiature préparée. Les septièmes sont des retards que les compositeurs ont progressivement perçus comme des notes constitutives.
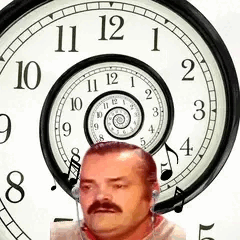
La septième de dominante sans fondamentale.
La septième de dominante est souvent présentée sans sa fondamentale. Elle devient alors un accord de 3 sons. Cette spécificité peut être signalée via chiffrage. L'état fondamental par définition ne peut exister sans fondamentale. Le premier renversement 6/5 barré devient 5 barré. Le second renversement +6 devient +6/3. Le troisième renversement +4 devient 6/+4. Quand la septième de dominante est exprimée sans quinte, le chiffrage ne signale pas cette omission. A noter que comme la septième de dominante sans fondamentale reste une dominante, il vaut mieux généralement indiquer son degré par V que par VII. C'est un des rares cas où il y a une fusion entre chiffrer des degrés et chiffrer des fonctions.
Les septièmes majeures et mineurs.
L'accord dit de septième majeure ( abréviation 7M ) est formé d'un accord parfait majeur et d'une septième majeure. Il se trouve sur les degrés I et IV en majeur et VI en mineur. L'accord dit de septième mineure ( abréviation 7m ), est formé d'un accord parfait mineur et d'une septième mineure. Il se trouve sur les degrés II, III et VI en majeur et IV en mineur. Le chiffrage de ces 2 accords est : 7 à l'état fondamental, 6/5 pour le premier renversement, 4/3 pour le second renversement, 2 pour le troisième renversement. Ces chiffrage n'indiquent que les intervalles minimuax pour comprendre le type d'accords. Quand il y a des altérations, il faut ajouter devant les chiffres concernés.
Le septième diminué.
L'accord de septième diminuée se trouve sur le septième degré en mineur. Son chiffrage est invariable à l'exception du second renversement qui nécessite parfois de préciser la nature de la tierce. 7 barré pour l'état fondamental, +6/5 barré pour le premier renversement, +4/3 pour le second renversement, +2 pour le dernier renversement. On retrouve à la suite 7, 6/5, 4/3 et 2 des septièmes majeures et mineures, complétées par des indications d'intervalles diminués et de sensibles. Cet accord est généralement utilisé comme une neuvième de dominante mineure sans fondamentale. Il est donc souvent préférable de considérer sa fonction ( dominante ou V ) plutôt que son degré ( sensible ou VII ). Il est parfois dur de trouver à l'oreille la fondamentale d'un accord de septième diminuée. En effet comme il est formé de 3 tierces mineures et d'une seconde augmentée ( enharmonie de tierce mineure à, c'est un accord symétrique. Ce n'est que l'orthographe (altération utilisées à et le contexte ) qui permettent d'isoler la seconde augmentée ou la septième diminuée dans la suite des tierces mineures, et donc de trouver la fondamentale : sol - si - ré - fa est le VII de la mineur, alors que la b-si-ré-fa de sonorité identique, est le VII de do mineur.
La septième et quinte diminuée.
Ce type de septième se voit soit sur le second degré en mineur, soit sur le septième degré en majeur. Ses intervalles sont ceux d'un accord de quinte diminuée additionné d'une septième mineure. L'accord du second degré, l'accord se 7/5 barré se chiffre comme suit : 7/5 barré à l'état fondamental, 6/5 pour le premier renversement, 4/3 pour le second renversement, 2 pour le troisième renversement; Pour l'accord du septième degré, dit septième de sensible, il est généralement utilisé comme une neuvième de dominante majeure sans fondamentale. Ses chiffrages sont : 7/5 barré à l'état fondamental, 5/+6 pour le premier renversement, 3/+4 pour le second renversement, 4/+2 pour le troisième renversement. A noter l'invertion de certains intervalles. En effet la septième de cet accord serait la neuvième de l'accord complet et à ce titre, doit toujours être plus aigué que la sensible ( voir les neuvièmes ).
La neuvième de dominante.
La neuvième de dominante est un accord de 5 sons. Sa qualification est différente selon le mode : accord de neuvième majeure de dominante en majeur et accord de neuvième mineure de dominante en mineur. La neuvième de dominante présente un état fondamenta et seulement 3 renversements. En effet le renversement avec la neuvième à la baisse est inusité. Ses chiffrages sont les suivants : état fondamental : 9/7 + ( les altérations de la neuvième doivent être indiquées ). Premier renversement : en majeur 7/6/5 barré et en mineur 7 barré/6/5 barré. Seconde renversement : en majeur 5/+6/4 et en mineur 5 barré/+6/4. Troisième renversement : 3/+4/2 ( les altérations de la tierce doivent être indiquées ). Le quatrième renversement, la neuvième à la basse, est inusité avec l'accord complet. A noter l'inversion de certains intervalles dans le chiffrage. Ils indiquent que dans sa disposition usuelle, la note formant neuvième doit toujours être plus aigue que la sensible. Attention au fait que sile fondamentale et la quinte de l'accord peuvent être omises, la tierce et le septième doivent être présentes. Cet accord utilisé à l'époque baroque devient très fréquent à partir du classicisme et y converve toutes les caractéristiques des septièmes de dominante qu'il contribua à enrichir. Sa note supplémentaire, la neuvième, est couramment attaquée est se rédout par un mouvement descendant. On voit comment elle trouve une place naturelle dans une des Mazurka de Chopin dans opus 7 numéro 1.
.
.
Page 170
.
.
Les notes étrangères.
Dans la musique tonale, chaque note d'une mélodie peut être rattachée à une harmonie ou à un accord, présent ou sou entendu. Mais l'harmonie ne doit pas supprimer la souplesse des lignes mélodiques ou empêcher la superposition de belles mélodies indépendantes. Pour réussir cet équilibre entre mélodie et harmonie, chaque note peut avoir 2 origines distinctes. : être une note constitutive ( réelle ) quand elle appartient à un accord. Ou être une note étrangère quand elle est reliée méthodiquement aux notes réelles d'un accord. Il y a une grande variété de notes étrangères possédant chacune leurs spécificités. La dénomination note constitutive et note ornementale se généralise et a tendance à supplanter note réelle et note étrangère.
Le rythme harmonique.
Pour distinguer notes constitutives et étrangères, il faut déterminer le moment où une harmonie débute et celui où elle est remplacée par l'harmonie suivante. Si ça peut paraître évident pour certains cas, pour d'autres par contre, le rythme et l'écriture instrumentale estompent ces instants où les harmonies s'enchaînent : Les notes d'une musique peuvent être rapides alors que les harmonies ne changent que lentement ( une même harmonie peut durer une croche comme plusieurs mesures ). Les harmonies peuvent changer régulièrement ou se révéler irrégulières et imprévisibles. Le rythme harmonique correspond à la fréquence de ces changements. On peut prendre l'exemple du Clavier bien tempéré de J.S. Bacj, qui montre un rythme harmonique régulier car l'harmonie change à chaque mesure. Dans " Rêverie " de Robert Schuman, le rythme harmonique est irrégulier. Schumann place ses harmonies à ses endroits chaque fois différents ce qui lui permet de varier les appuis de sa ligne mélodique et de conférer ainsi au morceau une merveilleuse souplesse dans l'esprit d'une libre improvisation.
C'est en étant attentif à ces aspects qu'on devient sensible à la dimension du rythme harmonique, indépendante de celle du rythme des notes. Elle a d'importantes implications pour l'interprétation musicale.
La note de pasage.
La note de passage est une note étrangère qui relie conjointement 2 notes réelles distinctes. Elle peut être diatonique ou chromatique, ascendante ou descendante. Quand l'intervalle à franchir le nécessite, il est possible d'enchaîner plusieurs notes de passage. L'abréviation de la note de passage est " p ".
La broderie.
La broderie est une note ornementale quittant conjointement une note réelle et la retrouve. La broderie est supérieure quand la note de broderie est au dessus de la note réelle. Elle est inférieure quand la note de broderie est en dessous de la note réelle. L'abréviation de la broderie est " br ". Quand la broderie enchaîne une broderie supérieure et une broderie inférieure ou l'inverse, elle est dite double broderie. La broderie est au coeur de nombreux ornements étudiés plus loin. Un trille est une suite de broderies rapides, qu'un mordant correspond à une broderie supérieure ou inférieure et que le gruppetto est une double broderie. A noter que la broderie et la note de passage commencent d'une manière identique. La broderie ne poursuit simplement pas son chemin car elle revient à son point de départ.
Le retard.
Le retard est une note étrangère tenue sur un temps fort ou une partie forte d'un temps. Cela se déroule en 3 phases. D'abord la note réelle est tenue lors d'un changement d'harmonie. Ensuite elle devient dissonante et donc note étrangère, dans la nouvelle harmonie. Enfin, elle se résout alors conjointement sur une note réelle. Son abréviation est " ret ". La résolution d'un retard peut être descendante ou ascendante. Plusieurs retards superposés se nomment doubles ou triples retards. Le retard peut parfois aller de manière disjoincte vers une autre note de l'accord avant de rattraper la note réelle, conjointe, attendue. Cela se nomme résolution exceptionnelle. Remarques : le retard est une appoggiature préparée. Les septièmes sont des retards que les compositeurs ont progressivement perçus comme des notes constitutives.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
L'appoggiature ( harmonique ). L'appoggiature est une note étrnagère attaquée sur un temps fort ou une partie forte d'un temps. De l'italien appoggiare, appuyer, elle implique une accentuation. Elle est à une distance de seconde majeure ou mineure de la note constitutive sur laquelle elle se résout, conjointement, par un mouvement descendant ou ascendant ( plus rare ). L'abréviation d'appoggiature est " app ". Quand l'appoggiature comprend la note supéreiure et la note inférieure avant la résolution, elle est dite double appogiature. L'appogiature s'indique par une valeur rythmique précise ou par une petite note. Quand la petite note n'est pas barrée, sa réalisation rythmique dépend de nombreux facteurs. Quand la petite note est barrée, elle doit être jouée comme une note brève placée selon le style, avant ou après le temps. L'appoggiature est un retard sans préparation. En plus de cela, une note de passage située dans un temps fort est perçue comme une appogiature. Aussi une appoggiature peut être simplement rythmique et ne pas impliquer de note étrangère.
L'anticipation.
L'anticipation se caractèrise par une note jouée avant l'accord auquel elle appartient. A ce moment cette note est dissonante. Lors de l'arrivée de l'accord, la note est rejouée comme une note réelle. Elle se signale par une note répétée. Une anticipation est généralement plus brève que la note constitutive qu'elle anticipe. Son abréviation est " ant ". L'anticipation apparait souvent au moment des cadences conclusives. L'exemple de " Anticipations " Haydn, Final du Quatuor, opus 33, numéro 2, montre 2 anticipations : le fa de la mesure 2 et le si bémol de la mesure 4. Ces 2 notes sont dissonantes par rapport à l'harmonie. L'exemple présente de nombreuses autres notes répétées mais celles ci sont consonantes du coup elles ne peuvent être qualifiées d'anticipations.
L'échappée.
L'échappée est une note ornementale disjointe. Le plus souvent elle se présente comme une broderie supérieure sans troisième note. C'est pourquoi on la nomme sous cette forme broderie tronquée. C'est une des notes ornementales les plus libres. Son abréviation est " éch ".
La note pédale.
La note pédale est une note tenue. Selon les harmonies qui surviennent durant une note pédale, elle peut à tout moment passer de consonance à dissonance. Toute voix peut porter une note pédale, mais ce type de note étrangère est souvent usuel à la basse. Son abréviation est " péd ". Il ne faut pas confondre avec le symbole désignant l'utilisation de la pédale de résonance du piano. Au sein d'un thème, il est fréquent de trouver une pédale de tonique. par contre c'est souvent une pédale de dominante qui prépare l'apparition ou le retour d'un thème important.
Groupes de notes étrangères.
Les différentes notes étrangères peuvent se combiner entre elles. On peut entendre des broderies de la broderie, des appoggiatures brodées, des anticipations d'une note de passage.
Les notes étrangères et le chiffrage.
.
L'appoggiature ( harmonique ).
L'appoggiature est une note étrnagère attaquée sur un temps fort ou une partie forte d'un temps. De l'italien appoggiare, appuyer, elle implique une accentuation. Elle est à une distance de seconde majeure ou mineure de la note constitutive sur laquelle elle se résout, conjointement, par un mouvement descendant ou ascendant ( plus rare ). L'abréviation d'appoggiature est " app ". Quand l'appoggiature comprend la note supéreiure et la note inférieure avant la résolution, elle est dite double appogiature. L'appogiature s'indique par une valeur rythmique précise ou par une petite note. Quand la petite note n'est pas barrée, sa réalisation rythmique dépend de nombreux facteurs. Quand la petite note est barrée, elle doit être jouée comme une note brève placée selon le style, avant ou après le temps. L'appoggiature est un retard sans préparation. En plus de cela, une note de passage située dans un temps fort est perçue comme une appogiature. Aussi une appoggiature peut être simplement rythmique et ne pas impliquer de note étrangère.
Le jazz.
Le jazz aujourd'hui désigne surtout un ensemble de courants d'origine afro américaine d'un genre unique. Son language s'est renouvelé au cours des décennies. Il serait incongru de vouloir réunir sous une seule et même étiquette les expériences libertaires du free jazz et les arrangements plus consensuels de la Swing Era. Mais il existe un esprit jazz que chacun perçoit plus ou moins intuitivement. Le traitement du rythme et des sonorités en est le caractère le plus évident. Mais l'harmonie joue aussi un rôle important.
Le swing.
Le swing est une notion essentielle dans le jazz. C'est un effet de balancement résultant d'un conflit rythmique savamment entretenu, une alternance tension/détente reposant sur la combinaison simulatnée de plusieurs actions : la régularité métronomique du mouvement, l'accentuation des temps faibles ( lafter beat ), l'interprétation très souple des croche en ternaire et l'usage de la syncope comme signe de ponctuation musical. Dans un trio de jazz le contrebassiste assure la régularité du tempo avec la walking bass qui consiste à jouer chaque temps de la mesure tandis que le batteur marque l'after beat en fermant du pied les cymbales de la charleston ( hi hat ) sur les temps faibles tout en insufflant la pulsation ternaire en frappant le chabada sur le cymbale ride. De son côté le pianiste souligne les harmonies en plaquant des accords syncopés à la main gauche et improvise de l'autre main un début de croches irrégulières parfois très appuyées parfois littéralement avalées ( les ghost notes ).
La notation.
Même si toutes les formes rythmiques ont été expérimentées dans le jazz, ce dernier n'en demeure pas moins une musique fondamentalement ternaire. Or il est presque toujours transcrit de façon binaire. La première raison à cela est que la valeur des proches est fluctuante selon le tempo et le style de la pièce. Plus le mouvement est rapide comme dans beaucoup de thèmes du be-bop, plus cette valeur se rapproche de la durée normale d'une croche. Seules les inflexion du phrasé permettent d'évoquer un sentiment ternaire qu'on ne peut transcrire sur le papier. Mais à tempo modéré, la première des 2 croches s'allonge tandis que la seconde est retardée. On a cru longtemps pouvoir l'écrire en croche pointée double puis en 12/8 avec une noire suivie d'une croche mais le résultat, trop rigide, n'était pas satisfaisant. La deuxième raison est d'ordre pratique car c'est plus facile de lire un thème complexe en 4/4 qu'en 12/8 a fortiori si le jeu souvent très libre, amène l'interprète à ajouter diverses ornementations.
Le répertoire.
Le jazz est une musique de tradition orale et en grande partie improvisée mais les arrangements pour grands orchestres ( les big bands ) et petites formations ( les combos ) sont nombreux et il est rare que les thèmes n'aient pas été écrits. Certains ont été composés par les musiciens de jazz eux même comme Duke Ellington ( Satin Doll ), Thelonious MOnk ( Round About Midnight ), Miles David ( Tune Up ). D'autres proviennent de genres populaires variés comme les comédies musicales de Broadway ( Body And Soul ), la variété internaitonale ( Les Feuilles Mortes ) voire les musiques de films ou de dessins animés ( Some Day My Prince Will Come ). A force d'être joéues et rejouées, ces thèmes deviennent de véritables standards. Les plus connus sont répertoriés dans des recueils appelés Real Book.
L'improvisation.
Interpréter un standard se déroule en 3 étapes principalement. A savoir l'exposition du thème précédée éventuellement d'une introduction originale. Improvisations d'un ou plusieurs solistes à partir du canevas harmonique lu en boucle. Réexposition du thème et coda. On appelle familièrement chorus qui signifie cheur ou refrain en anglais la phase improvisée par les solistes. Si le sens de ce mot a évolué avec le jazz, c'est parce que beaucoup de standards comme " Les Feuilles mortes " ( devenu Autumn Leaves ), sont d'anciennes chansons à succès, limitées à la seule partie du refrain. Improviser sur le thème revient donc à jouer sur le chorus lui même et par extension à le faire. Ces improvisations peuvent être proches de la mélodie d'origine avec des ornementations plus ou moins développées ou s'en écarter totalement. Dans ce cas seule la progression des harmonies rattache le discours du soliste au thème initial. DUrant un solo de batterie, ces harmonies sont mêmes vouées à disparaître laissant alors à l'interprète le seul décompte des mesures pour repère. QUand un musicien execute un chorus, il passe musicalement au premier plan. Les autres l'accompagnent voire cessent de jouer pour le mettre davantage en valeur et lui laisser plus de liberté. Plusieurs solistes peuvent se succéder donc jusqu'au retour du thème où tarditionnellement, tous les musiciens se remettent à jouer. C'est naturel d'applaudir la fin d'un chorus très réussi ( contrairement à une cadence de concerto classique ). Pour ce qui est de l'esprit de ces improvisations, il est très varié selon l'instrument, l'interprète et le style même s'il s'apparente toujours quasiment à celui d'une narration, guidant l'auditeur progressivement vers un climax particulier avant de conclure et laisser la place au soliste suivant. Un bon narrateur peut émouvoir son auditoire en jouant sur l'émotion, la virtuosité, l'audace et même l'humour, évoquant parfois des fragments de thèmes ou de chorus célèbres.
Le chiffrage.
.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
Le voicing.
Etre en mesure d'analyser un accord chiffré est quelque chose, mais le faire sonner en est une autre. Une bonne connaissance des voicings est indispensable. Le concept de voicing désigne à la fois la conduite des voix intermédiaires et la manière de disposer ces voix. C'est difficile d'harmoniser correctement un standard sans maîtriser cette notion. Dans bien des cas il est nécessaire d'enrichir les accords et de les disposer de façon à obtenir certaines couleurs en harmonie avec le style du morceau ou au contraire, radicalement novatrices. Certains voicings particulièrement appréciés ont marqué l'histoire et se sont vus attribuer le nom de leur géniteur. On peut parler des voicings de Kenny Barron ou de Bill Evans.
Les grilles.
Le mot grille désigne ces petits tableaux dans lesquels les musiciens de jazz ou de variété inscrivent le chiffrage des accords. Les harmonies sont regroupées par cases et présentées indépendamment de la mélodie souvent d'ailleurs pour les bassistes et les guitaristes. Chaque case correspond à une mesure et si les 2 accords s'enchaînent dans cette seule période, on séparer les 2 symboles par une barre oblique. Dans une mesure à 4 temps, chaque accord vaut donc 2 temps et avec ce système pas besoin de connaître le solfège rythmique. Une grille comporte en général 12, 16 et 32 mesures, le plus souvent de forme AABA, et se joue en boucle. Elle est de nature plus ou moins complexe selon la présence éventuelle d'une introduction, d'un point et/ou d'une coda. Avec la pratique le terme a fini par se généraliser. De nos jours on l'emploi indifféremment pour désigner tableaux et lead sheets. Le chiffrage comme on a pu le voir dans les partitions de type Real Book, est le plus souvent indiqué au dessus de la mélodie. Parfois, cette notation s'enrichit de petits diagrammes présentant la position des doigts sur la manche d'une guitare.
Le blues.
Les modes.
Le Moyen Age musical se caractérisait souvent par ses degrés de récitation, ses règles d'enchaîneements, ses formules d'intonation et ses finales. Les modes modernes ont fait des expérimentations de cominaisons de tons et demi tons pour susciter des couleurs alternatives aux sempiternels modes majeur et mineur.
Il y a les modes naturels qui sont la reprise des modes du Moyen Age et de la Renaissance pour leur charme médiéval, ancien mais avec des nouveautés découlant de l'esprit d'harmonique de l'époque moderne. Le jazz en fait aussi usage. Parmi les synonymes des modes naturels on a les modes ecclésiastiques, d'Eglise et les modes diatoniques, voire, les modes grescs même s'ils sont à proscrire car erroné. Ensuite il y a les modes artificiels qui sont de nouvelles échelles créées par un désir de sonorités et de nouvelle rhétoriques : la gramme par tons, le mode ton/demi ton, le mode de Bartok. Enfin il y a les modes ethniques qui sont les adoptions de nombreuses échelles caractéristiques, suscitée par l'éveil des écoles nationales et par un goût pour l'exotisme : gamme chinoise, mode andalou, mode de Java, modes d'Europe centrale, échelles karnatiques d'Inde. Ils sont innombrables dont il s'agira seulement de parler des plus fréquentes et celles qui furent utilisées plus récemment.
Pour ce qui est des modes naturels, le Moyen Age avait mis au point un système de 8 modes ( l'octoéchos ). 4 nouvelles échelles les complétèrent à la Renaissance. Construites à partir du la et du do, elles préfiguraient les modes mineures et majeures. Ce système modal fut abandonné à l'époque baroque. QUand les compositeurs, pour renouveler le langage, les compositeurs de la fin du XIXème siècle reprirent ces échelles anciennes, les 12 modse furent réduits à 6 car il n'a plus été tenu compte des différences d'ambitus ( formes authentes et plagales ). De plus un septième mode construit à partir du si fut ajouté. Chaque note naturelle peut être le départ d'un mode. On dit alors selon la note de départ, mode de do, mode de ré,, etc.... Une deuxième terminologie d'origine grecque s'est généralisée depuis le IXème siècle. Bien que provenant d'une lecture erronée de la théorie grecque, elle propose une alternative courante de dénomination. Dans la pratique, chacun des 7 modes peut être transposé sur les 12 degrés chromatiques. On peut avoir un mode de ré transposé sur mi, un mode de fa transposé sur ré bémol, etc.... On peut joeur ces modes, explorer leurs harmonies et noter les cadences particulières qu'ils permettent. Des compositeurs ont mis en valeur ces enchaînements harmoniques caractéristiques. Notament en mode ré, le rapport plagal ( IV -I ) est souvent privilégié avec son enchaînement entre un quatrième degré majeur et un premier degré mineur.
Une méthode pour construire les modes naturels.
Les différents modes se comprennent et se perçoivent par eux même. Mais pour leur apprentissage, il y a une autre méthode de construction par comparaison avec le majeur et le mineur mélodique descendant. Elle permet de parvenir à une très grande vivacité. Il suffit d'apprendre les notes caractéristiques de grande échelle. A part le mode de si, comportant 2 notes caractéristiques, aucun mode n'a plus d'une note caractéristique à mémoriser. Exemple d'application : imaginons qu'on souhaite consturire un mode de mi, transposé sur fa. Il suffit d'imaginer un mode de fa mineur mélodique descendant et d'ajouter la note caractéristique, le second degré abaissé.
Une classification des modes naturels.
Pour reconnaître à l'oreille 7 modes diatoniques, on les classe en regardant si leurs deuxième, troisième, 6ème et 7ème sont majeures ou mineures et si leurs quartes et quintes sont justes. En suivant le cycle des quintes, on ne modifie à chaque fois qu'un intervalle et on passe du plus sombre, le mode de si, au plus lumineux, le mode de fa.
Le mode pentatonique ( ou pentaphonique ).
Contrairement aux gammes diatoniques, les modes ne sont pas toujours faites de 7 notes. Il peuvent n'en avoir que 4 ( modes tétraphoniques ). Ou alors 5. Voire parfois plus, à savoir 8, 9, voire 11 ou 12.Le mode de 5 sons dit mode pentatonique ou pentaphonique est presque un mode universel tant le nombre de cultures l'ayant utilisé est varié. Mais ses 2 zones géographiques principales se trouvent en Afrique et en Asie. Il faut noter qu'il y est aussi en Occident et qu'il est parfois à l'origine de la formation des modes grégoriens. Mais il est parfois utilisé sans connotation historique ou ethnique particulière. Une de ses particularités est de n'avoir aucun demi ton. Aussi il est qualifié de mode anhémitonique. Pour visualiser instantanément ce mode il suffit de remarquer qu'il correspond aux touches noires du piano.
.
Le mode blues.
Le mode blues est de base un mode pentatonique.
Mais il peut être utilisé avec quelques notes de passage, dont une chromatique. Il donne le sentiment de partir du second degré du mode pentatonique et d'être de type mineur. C'est la tierce qui donne son caractère principal au mode blues. A savoir mineure dans les mélodies mais majeures dans les harmonies. C'est une tierce majeure ou mineure. La tierce du blues, quand elles est chantée, est souvent intermédiaire entre le majeur et le mineur : c'est l'une des 3 blues notes, les 2 autres étant la quinte diminuée et la septième mineure.
Le mode andalou.
La culture ibérique a connu un grand essor à la fin du XIXème siècle que ce soit via le rayonnement de grands compositeurs espagnols comme Albeniz, de Falla ou Granados ou par l'influence qu'elle a exercé sur ls musiciens français comme Ravel, Bizet ou encore Debussy. La richesse des rythmes et le charme des tournures musicales harmoniques et mélodiques des musiques espagnoles sont les raisons pour lesquelles ces musiques espagnoles ont eu autant de succès. On peut notamment citer le mode andalou qui fut utilisé par bien des compositeurs au début du XXème siècle. Il se caractérise par un tierce mobile pouvant être alternativement voire simultanément majeure et mineure. L'intervalle de seconde augmentée optionnelle entre le deuxième et le troisième degré ainsi que le demi ton au dessus de la tonique sont aussi typiques et originales. A noter qu'il peut être penser comme un mode mineur mélodique descendant dont la dominante serait prise comme tonique.
On peut prendre les exemples du " Le mode andalou " de Raval, Rhapsodie espagnole où le mode andalou transposé sur fa a nettement une fière allure espagnole alors que celui ci, transposé sur sol de l'exemple " Le mode andalou ", Debussy, Quatuor, est plus abstrait, comme une libre improvisation sur un tapis d'ostinatos.
La classification de messiaen.
A noter que Olivier Messiaen a classifié 7 notes, allant de 6 à 10 sons. Fasciné par les impossibilités comme les rythmes non rétrogradables, c'est à dire des rythmes identiques qu'ils soient lus de gauche à droite ou droite à gauche, Messiaen s'est intéressé aux modse de transpositions limitées. Il s'agit des modes ne pouvant pas être transposés 11 fois comme les modse mineurs et majeurs car ils redonnent la forme initiale en moins d'étapes. Dans la liste de 7 modes, on a déjà parlé du mode 1, la gamme par tons, et le mode 2, le mode ton/demi ton. Les modes à transpositions limitées de Messiaen montre les 7 modes de Messiaen et indique le nombre de sons de chacun, plus son nombre de formes distinctes.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
Ableton
2 ans
En musique occidentale
l'écart entre 2 notes le plus juste c'est la quinte parfaite qui sonne comme ça :
l'écart le plus dissonant est la quinte diminué / quarte augmenté, mais surtout connu sous son autre nom le triton :
la quinte parfaite a un écart de 7 demi-tons avec sa fondamentale (la note de la quelle on part pour résumer)
7 = chiffre de dieu, perfection
et 6 pour le triton
6 = imperfection, satan, faiblesse humaine
voilà c'est tout, je pense pas que cela soit fait exprès, mais la coïncidence est marrante
l'écart entre 2 notes le plus juste c'est la quinte parfaite qui sonne comme ça :
l'écart le plus dissonant est la quinte diminué / quarte augmenté, mais surtout connu sous son autre nom le triton :
la quinte parfaite a un écart de 7 demi-tons avec sa fondamentale (la note de la quelle on part pour résumer)
7 = chiffre de dieu, perfection
et 6 pour le triton
6 = imperfection, satan, faiblesse humaine
voilà c'est tout, je pense pas que cela soit fait exprès, mais la coïncidence est marrante
El famoso triton gamme du diable et mineur aeolien gamme de Dieu

La meilleure gamme est la gamme phrygienne avec la démonstration
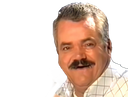
La meilleure gamme est la gamme phrygienne avec la démonstration
il y a un an
Sans doute le HASARD

Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres

il y a un an
La gamme par tons.
On a une gamme par tons instantanément en faisant des notes de passage régulière sur un accord de quinte augmentée car la gamme de tons est formée de 2 accords de quinte augmentée imbriquées. C'est une échelle de 6 sons constituée exclusivement de secondes majeures. L'exception réside dans la tierce diminuée ( enharmonie de seconde majeure ) nécessaire pour retourner à l'octave. La préférence pour les accidents notés, dièses ou bémols, peut souvent varier au fur et à mesure des mouvements mélodiques. C'est une échelle symétrique. Il n'y en a que 2 distinctes car quand on transpose 2 fois de suite l'échelle d'un demi ton, on retombe sur la première. A noter aussi que les 6 sons de l'échelle, plus les 6 sons de l'échelle transposée, totalisent les 12 sons possibles. Pour ces 2 raisons, ce mode est répertorié dans la classification des modes à transpositions limitées de Messiaen : c'est le mode 1. Ce mode peut, comme dans l'exemple " Voiles " de Debussy, créer une atmosphère diaphane, irréelle. Il se suffit dans ce cas à lui même. Une de ses autre Une de ses autres utilisations fréquentes consiste à " noyer le ton ". Le mode a pour utilité de créer dans ce cas une zone floue entre 2 modes ou 2 tonalités. Puis il existe une utilisation inattendue, à savoir quand on altère la quinte d'un accord de septième de dominante, on a un fragment de gamme par tons. Les musiciens de jazz, notamment le pianiste Thelonious Monk, se servent parfois de cette propriété pour jouer une gamme de tons lors des cadences.
Les modes du mineur mélodique ascendant.
De même que les modes peuvent être construits sur les différents degrés de la gamme majeure, ls musiciens de jazz aiment jouer sur les modes utilisant les degrés de la gamme mineure mélodique ascendante. Parmi les 7 échelles possibles à partir du mineur mélodique ascendant, celle partant du septième degré est particulièrement intéressante et se nomme mode altéré. On peut la concevoir comme l'enchaînement d'un fragment de mode demi-ton/ton avec un fragment de gamme par ton. Cette échelle est surtout utilisée pour improviser sur un accord de dominante altéré, d'où son nom. A noter que le mode acoustique étudié avant cela, et pensé comme une échelle évoquant les harmoniques naturels, se construit également en partant du mineur mélodique ascendant. C'est le mode 4.
Le mode ton/demi-ton.
.
.
La transposition.
Il y a plusieurs raisons pour transposer. La transposition peut changer la hauteur d'un morceau entier. C'es une pratique courante pour les chanteurs et instrumentistes souhaitant qu'un morceau corresponde à leur tessiture. la transposition peut résoudre des cas d'instruments aux diapasons différents à partir d'un demi ton d'écart. La transposition peut déclarer un thème, un motif ou faire des marches d'harmonies. Pour ceux souhaitant travailler l'improvisation, transposer de courts motifs dans tous ls tons est un exercice efficace pour progresser. Et les thèmes d'une composition sont couramment présentés dans différentes tonaltiés. Aux moments de développements, notamment, les motifs présentent de grands parcours tonals. Le transposition est aussi indispensable dans le cas des instruments transpositeurs. Ces instruments font entendre une autre note ( la note réelle ) que celle écrite que leur partition ( la note écrite ). La transposition permet de rétablir la réalité à la lecture ou à l'interprétation ( cas où l'instrument transpositeur est différent de celui qui était prévu au départ ).
Une méthode simple de transposition consiste à ajoute rou enelver un intervalle fixe à la musique à transposer. Cela se pratique tout autant mentalement ( cela s'appelle transposer à vue ) que par écrit. L'avantage de la méthode est du à la simplicité car il suffit juste de bien connaître les intervalles. Cette méthode a quand même des limites car si on veut faire une transposition à vue d'une partition d'orchestre avec plusieurs transpositeurs, cela devient trop lent. On passe trop de temps à calculer les intervalles pour rester dans le tempo musical. Dans un tel cas, il faut ransposer pour les clés. Pour ce qui est de transposer les clés, en changeant mentalement de clé, il est possible de lire directement une musique dans une nouvelle tonalité. La tonique du ton dans lequel on est, doit devenir la tonique du ton dans lequel on va. Il faut donc s'imaginer la tonique de départ écrire sur la portée, puis trouver la clé permettant de la lire comme la nouvelle tonique d'arrivée. En do majeur, il n'y a rien à la clé. On peut prendre un exemple en clé de sol, extrait d'un quatuor de Haydn. Ecrit en fa majeur, il est à transposer vers do majeur. La clé de lecture sera fa 3. Car nous voulons que là où nous lisons fa, nous lisons désormais do. Le fa de la clé de sol est écrit dans le premier interligne, comme le do de la clé de fa 3. Dans un autre exemple, si on transpose en do majeur, et qu'on est en ré majeur, il faut que ré devienne un do. Donc la clé d'ut4 permet d'y arriver.
A noter qu'il y a une limitation aux transpositions car elles sont toujours d'un ton majeur vers un autre ton majeur ou d'un ton mineur vers un autre ton majeur. On ne change donc pas de mode. On change simplement de tons. Quand la musique à transposer contient des altérations accidentelles , cela nécessite une opération supplémentaire. On peut prendre l'exemple du thème " Dans la halle ru doi de la montagne " de Peer Gynt de Grieg de si mineur vers fa mineur. Toutes les altérations accidentelles ont été modifiées. Les dièses et bécarres de la mesure 2 sont devenus des bécarres et bémols et le bécarre de précaution de la mesure 4 est devenu un bémol de précaution. Pour une transposition par les clés il faut donc aussi déterminer le nombre x d'altérations accidentelles devant être corrigés ainsi que le type de correction. Il faut regarder la différence d'armure entre les 2 tonalités. Repérez vos tonalités et comptez le nombre de colonnes les séparant. Il faut ensuite trouver la direction de la correction pour les x notes à corriger. Si le deuxième tonalité est plus à droite que la première, la modulation va vers les dièses et il faudra hausser ls altérations. Si la seconde tonalité est à gauche de la première, la modulation va vers les bémols et il faudra abaisser les altérations. Un cas délicat se produit parfois : une modulation peut enchaîner 2 tonalités ayant plus de 7 quintes d'écart par exemple de ré bémol majeur vers si majeur. Il faut dans ce cas hausser les altérations devant 10 notes : fa, do, sol, ré, la, mi, si, fa, do, sol. Comme fa, do et sol sont lus 2 fois dans cette liste, leurs corrections vont s'additionner. En ce qui concerne les dièses et double dièses, ils vont nécessiter obligatoirement une enharmonie.
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an
Batman sera toujours là pour faire régner la justice sur les topics de onche.
il y a un an













